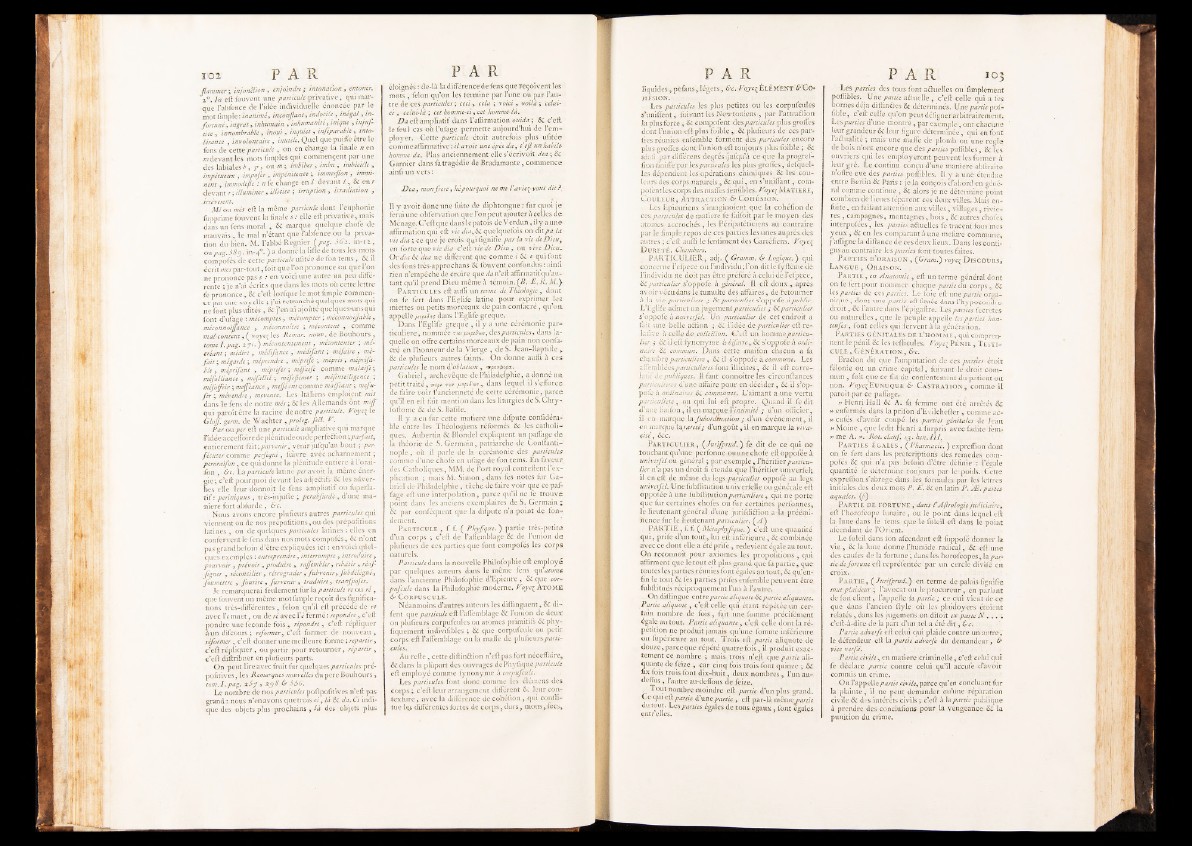
f animer ; injonction , enjoindre ; intonation, eniontr.
a°. In eft fouvent une particule privative, qui marque
l’abfence de l’idée individuelle énoncée par le
mot firnple: inanimé, inconfiant, indocile , inégal, infortuné,
ingrat, inhumain , inhumanité , inique , injuf-
' àce , innombrable 9 inoui, inquiet , inféparablt, intolérance
, involontaire , inutile. Quel quepuifîe être le
fens de cette particule , on en change la finale n en
m devant les mots fimples qui commençent par une
des labiales b , p , ou m ; imbiber, imbu, unbécille ,
impétueux , -impofer , impénitence ; immerfion, imminent,
immodepe : n le change en ’/ devant l , & ; enr
■ devant r ; illuminer., illicite ; irruption, irradiation ,
arrivèrent. * f. 1
Mé ou mis eft la même particule dont 1 euphonie
fupprime fouvent la finale * : elle eft privative, mais
dans un fens moral , 8c marque quelque chofe de
mauvais-, le mal n’étant que l’abfence ou la privation
du bien. M. l’abbé Regnier (pag. 56u. in-12 ,
ou pag. 589. in-40-. ) a donné la lifte de tous les mots
compofés de cette particule ufitee de fon tems, 8c il
■ écrites par-tout, foit que l’on prononce ou que l’on
ne prononce pas s .* en voici une autre un peu difté-
rente ; je n’ai écrits que dans les mots oii cette lettre
(e prononce-, 8c c’eft lorfque le mot firnple commence
par une voyelle ; j’ai retranche quelques mots qui
ne font plus ufités , & j’en ai ajoute quelques-uns qui
font d’ufage : mécomptes, mètompter;méconnoiffable,
méconnoifjance , méconnoître ; mécontent , comme
mal-content, ( voyez les Remar. nouv. de Bouhours^,
tome I.pag. 27/. ) mécontentement, mécontenter ; mécréant
; médire , medifance , inedijant, mefaire , méfait
; mégarde ; méprendre , méprife ; mépris, méprifa-
b le , méprifant , méprifer ; méfaife comme malaife;
méfalliance , méf allié ; méfefiimer ; méfintelligence ;
méfoffrir -,mefféance , méfiant comme malféant; mefu-
fer; mévendre, mevente. Les Italiens emploient mis
dans le fens de notre més ; 8c les Allemands ont miff
■ qui paroît être la racine de notre particule. Voyez le
■ Glof. germ. de Wachter , proleg. fecl. V.
Par ou per eft une particule ampliative qui marque
l’idée acceffoire de plénitude ou de perfeftion -, parfait,
entièrement fait j parvenir, venir jufqu’au bout ; per-
fécuter comme perfequi, fuivre avéc acharnement ;
peroraifon, ce qui donne la plénitude entière à forai-
fon , &c. La particule latine per avoit la même énergie;
c’eft pourquoi devant les adjeéfifs 8c les adverbes
elle leur donnoit le fens ampliatif ou fuperla-
t if : periniquus , très-injufte ; perabfurdh , d’une maniéré
fort abfurde, &c.
Nous avons encore plufieurs autres particules qui
viennent ou-de nos prépofitions, ou des prépofitions
latines , ou de quelques particules latines : elles en
confervent le fens dans nos mots compofés, 8c n’ont
pas'grand befoin d’être expliquées ici : en voici quelques
exemples : entreprendre , interrompre , introduire ,
pourvoir , prévoir , produire , raffembler, rebâtir , réaf-
figner , réconcilier , rétrograder , fubvenir, fubdélégué,
foumettre , fourire , furvenir , traduire, tranfpofer.
Je remarquerai feulement fur la particide re ou ré,
que fouvent un même mot firnple reçoit des fignifica-
tions très-différentes , félon qu’il eft précédé de re
avec l’e muet, ou de ré avec 17 fermé : repondrec’ eft
pondre une fécondé fois , répondre , c’eft répliquer
à un difeours ; reformer, c’eft former de nouveau ,
réformer, c’eft donner une meilleure forme ; repartir,
c’eft répliquer , ou partir pour retourner, répartir ,
c ’eft diftribuer en plufieurs parts.
On peut lire avec fruit fur quelques particules pre-
pofitives, les Remarques nouvelles du pere Bouhours,
tom. I . pag. 25y , 29 8 & 556.
Le nombre de nos particules poftpofitives n’eft pas
grand : nous n’en avons que trois ri , là 8c da. Ci indique
des objets plus prochains , là des objets plus
éloignés : de-là la différence de fens que reçoivent les
mots , félon qu’on les termine par l’une ou par l’autre
de ces particules ; ceci, cela ; voici , voila ; celui-
c i , celui-là ; cet homme-ci, cet homme-la.
Da eft ampliatif dans l’affirmation ouida ; & c’eft
le feul cas ou l’ufage permette aujourd’hui de l’employer.
Cette particule étoit autrefois plus ufitée
comme affirmative : il avoit une épée da, défi un habile
homme da. Plus anciennement elle s’écrivoit dea ; 8c
Garnier dans fa tragédie de Bradamante, commence
ainfi un vers :
Dea, mon frere , hépourquoi ne me Paviez-vous dit ?,
Il y avoit donc une fuite de diphtongue : fur quoi je
ferai une obfervation que l’on peut ajouter à celles de
Ménage. C’eft que dans le patois de Verdun, il y aune
affirmation qui eft vie dia,8c quelquefois on ditpa la
vie dia ; ce que je crois qui fignifie par la vie de Dieu,
en forte que vie dia c’eft vie de Dieu, ou vive Dieu.
Or dia & dea ne different que comme i & e qui font
des fons très-approchans & fouvent confondus : ainfi
rien n’empêche de croire que da n’eft affirmatifqu’au-
tant qu’il prend Dieu même à témoin. {B. E. R. M .j
Particules eft auffi un terme de Théologie, dont
on fe fert dans l’Eglife latine pour exprimer les
miettes ou petits morceaux de pain confacré, qu’oa
appelle /«p/JY? dans l’Eglife greque.
Dans l’Eglife greque , il y a une cérémonie particulière,
nommée Twi'/uep/JW, des particules, dans laquelle
on offre certains morceaux de pain non confacré
en l’honneur de la Vierge , de S. Jean-Baptifte ,
& de plufieurs autres faints. On donne auffi à ces
particules le nom d’oblation , vpompopet.
Gabriel, archevêque de Philadelphie, a donné un
petit traité, 7npi t «j> p.ipiS'av, dans lequel il s’efforce
défaire voir l ’ancienneté de cette cérémonie, parce
qu’il en eft fait mention dans les liturgies de S. Chr.y-
foftome & de S. Bafile.
Il y a eu fur cette matière line difpute confidéra-
ble entre les Théologiens réformés & les catholiques.
Aubertin & Blondel expliquent un paffage de
la théorie de S. Germain, patriarche de Conftanti-’
nople, où il parle de la cérémonie des particules
comme d’une chofe en ufage de fon tems. En faveur
des Catholiques , MM. de Port royal conteftent l’explication
; mais M. Simon, dans fes notes fur Gabriel
de Philadelphie , tâche de faire voir que ce paffage
eft une interpolation, parce qu’il ne fe trouve
point dans les anciens exemplaires de S. Germain ;
& par conféquent que la difpute n’a point de fondement.
Particule , f. f. ( Phyfque. ) partie très-petite
d’un corps ; c’eft de l’affemblage & de l’union de
plufieurs de ces parties que font compofés les corps
naturels.
Particule dans la nouvelle Philofophie eft employé
par quelques auteurs dans le même fens qu'atome
dans l’ancienne Philofophie d’Epicure , & que cor-
pufcule dans la Philofophie moderne. Voyez Atome
& Corpuscule.
Néanmoins d’autres auteurs les diftinguent, & di-
fent que particule eft l’affemblage & l’union de deux
ou plufieurs corpufcules ou atomes primitifs & phy-
fiquement indivifibles ; & que corpufcule ou petit
corps eft l’affemblage ou la maffe de plufieurs particules.
Au refte, cette diftin&ion n’eft pas fort néceffaire,
& dans la plupart des ouvrages dePhyfique particule
eft employé comme fynonyme.à corpufcule.
Les particules font donc comme les élémens des
corps ; c’eft leur arrangement différent & leur contexture
, avec la différence de cohéfion, qui confti-
tue les différentes fortes de corps, durs, mous, fecs,
liquides, pèfans, légers, &c.Vyyez ÉLÉMENT &’C ohésion.
Les particules les plus petites ou les corpufcules
s’unifient, fuivant les Newtoniens:, par l’attraélion
la plus forte, & compofent des particules plus groffes
dont l’union eft plus foible, & plufieurs de ces parties
réunies enfemble forment des particules encore
plus groffes dont l’union eft toujours plus foible ; &
ainfi par différens degrés ijufqti’à ce que laprogref-
fion finiffe par \esparticules, les plus groffes, defquel-
les dépendent les opérations, chimiques Scies.couleurs
des corps-naturels, Ôc.qui, en s’unifiant, compofent
les corps des maffes fenfibles. Voyez Matière,
C ouleur, At tract ion & C ohésion.
Les Epicuriens s’imaginoient que la cohéfion de
ces particules de matière fe faifoit par le moyen des
atomes accrochés , les Péripatéticiens au'Contraire
par le firnple repos de ces parties les unes auprès.des
autres ; c’eft auffi le fentiment des Cartéfiens. Voyez
D ureté. Chambers.
PARTICULIER, adj. ( Gramm. & Logique.} qui
concerne l’efpece ou l’individu;l’on dit le fyftè.me dé
rindividu ne doit pas être préféré à.celui de.l’efpece,
8cparticulier s’oppofe à général. Il eft doux , après
avoir vécu dans le tumulte des. affaires, de fetourner
à la vie particulière ; 8c particulier s’oppofe à public.
L’Eghfe admet un jugement particulier ; & particulier
s’oppofe à ïmiverfel. Un particulier de cet endroit a
fait une belle aétion ; 8c l’idée de particulier eft relative
à celle de collection. C’e ft un homme particulier
i 8c il eft fynonyme à bifarre, 8c s’oppofe à ordinaire
8c commun. Dans cette maifon chacun a fa
chambre particulière, 8c il s’oppofe à commune. Les
afiembléesparticulières font illicites, 8c il eft corre-
laitif de publiques. Il faut connoître les circonftances
particulières d’une affaire pour en décider, & il s’oppofe
à, ordinaires 8c communes. L ’aimant aune vertu
particulière , qu qui lui eft propre. Quand il fe dit
d’une liaifon, il en maçquje.l'intimité ; d’un officier,
il en marque la fubordbnqtion,;. d>un événement, il
en marque lu rareté; d’un goût, il en marque la vivacité
, 8cc.
. Pa r t icu l ier , ( JunfprUd.} fe dit de ce qui ne
touchant qu’une perfonne ou une chofe eftoppofée à
univerfel ou général ; par exemple,. l’héritier particulier
n’a pas un droit fi étendu que l’héritier univerfel;
il en eft de même du legs particulier oppofé au legs
univerfel. Une fubftitution univerfelle ou générale eft
oppolee à une fubftitution particulière, qui ne porte
que fur certaines chofes ou fur certaines perfonnes,
le lieutenant général d’une jurifdiftion a la prééminence
fur le.lieutenantparticulier. ( ^ )
PARTIE , f. f. ( Métaphyfique. •) c’eft une quantité
qui, prife d’un tout, lui eft inférieure, 8c combinée
avec ce dont elle a été prife, redevient égale au tout.
On reconnoit pour axiomes les propofitions , qui
affirment que le tout eft plus grand que fa partie, que
toutes les parties réunies font égales au tout, 8c qu’en-
fin le tout 8c les parties prifes enfemble peuvent être
fubftitués réciproquement l’un à l’autre.
On diftingue entre partie aliquote 8c partiealiquante.
Partie aliquote , c’eft celle qui étant répétée un certain
nombre de fois , fait une fomme précifément
é^ale au tout. Partie aliquante, c’eft celle dont la répétition
ne produit jamais qu’une fomme inférieure
ou fuperieure au tout. Trois eft partie aliquote de
douze, parce que répété quatre fois, il produit exactement
ce nombre ; mais trois n’eft que partie aliquante
de feize., car cinq fois trois font quinze ; 8c
fix fois trois font dix-huit, deux nombres, l’un au-
deffus , l’autre au-deffous de feize,.
Tout nombre moindre eft partie d’un plus grand.
Ce qui eft partie d’une partie , eft par-là mêmepartie
du tout. Les parties égales de tous égaux, font égales
entr elles.
Les parties des tous font actuelles ou Simplement
poffibles.^ Une partie aétuelle , c’eft celle qui a fes
bornes déjà diftinétes 8c déterminés. Une partie pol-
fible, c’eft celle qu’on peut défigner arbitrairement.
Les parties d’une montré, par exemple, ont chacune
leur grandeur 8c leur figure déterminée, qui en font
1 actualité ; mais' une mafle de plomb ou une re°Ie
de bois n’ont encore que des parties polfibles, 8c tes
ouvriers qui les employeront peuvent les former à
leur gré. Le continu conçu d’une maniéré abftraite
n’offre que des parties poffibles. Il y a une étendue
entre Berlin 8c Paris : je-la conçois d’abord en général
comme continue , 8c alors je ne détermine point
combien de lieues feparent ces deux villes. Mais en-
ftiite, en.faifànt attention aux villes, villages, rivières
, campagnes, montagnes, bois , & autres chofes
interpofees, les parties aâuelles fe tracent fous mes
y e u x , 8c en les comparant à une mefure commune,
j’affigne la diftance de ces deux lieux. Dans les-Conti-
gus au contraire les parties font toutes faites. •
Parties d’oraison , (Gram} voyez D iscours»
La n g u e , O raison; „
Partie , en Anatomie , eft un terme général dont
on fe fert pour nommer chaque partie du corps , 8c
les parties de ces parties. Le foie eft une partie orga-
nique, dont une partie eft fituée dans l’hypocondre
droit , 8c 1 autre dans l’epigaftre. Les parties fecretes
ou naturelles, que le peuple, appelle les parties hon-
teufes, font celles qui.fervent à la génération.
Parties génitales de l’h om m e , qui comprennent
le pénil 8c les tefticules. Voyez Pénil , T esticule
, G énération., & c.
Bradon dit que l’amputation de ces parties étoit
félonie ou,un crime capital,’ fuivant le droit commun
, foit que ce fut du contentement du patient oit
non. Voyez Eunuque & Ca s t r a t io n , comme il
paroît par ce paflàge..
» Henri Hall & A. fa femme ont été arrêtés 8c
» enfermés, dans la prifon d’Evilchefter -, comme ac-
» eufés d’avoir coupé lés parties génitales de Jean
» Moine , que ledit Henri a;furpris avec ladite fem-
» me A. ». Rot. clduf. es . hen.HI.
Parties Ég a l e s , (Pharmacie. ) exprefliondont
on fe fert dans les prèfcriptiôns des remedes compofés
8c qui n’a pas befoin d’être définie .: l’égale
quantité le détermine toujours par le poids. Cette
expreflion s’abrege dans.'les, formulés.'par les lettres
initiales des deux mots P. E. 8c en latin P. Æ. partes
oequales. '(b');J .
Partie DE fortune ,dans l'Aftrologiejudiciaire,
eft l’horofeope lunaire, ou le point dans-lequel eft
la lune dans le tems quelle foleil eft dans le point
afçendant de l’Orient.
Le foleil dans Ion afçendant eft fuppofé donner la
vie , & la lune donne l’humide radical, 8c eft une
des caufes de la fortune ; dans: les horofeopes, la partie
de fortune eft repréfentée par un cercle divifé en
croix.
Pa r t ie , (Jurifprud.} en terme de palais.fignifie
tout plaideur ; l’avocat ou le procureur ,- en parlant
de fon client, l’appelle'fa partie ; ce qui vient de ce
que dans l’ancien ftyle oit les plaidoyers étoient
relatés, dans les jugemerîs _on diloit ex parte N . . . .
c’eft-à-dire de la part d’un tel a été d it , &c^ B
Partie adverfe eft celui qui'plaide contre un autre,
le défendeur eft la partie adverfe du demandeur, 6»
vice verfâ.
Partie civile, en matière criminelle,.c’eft celui qui
fe déclare partie contre celui qu’il accufe d’avoir
commis un crime.
On l’appelle partie civile, parce qu’en concluant fur
la plainte, il ne peut demander qu’une réparation
civile 8c des intérêts civils ; c’eft à la partie publique
à prendre des conclufions pour la vengeance 8c la
punition du crime.