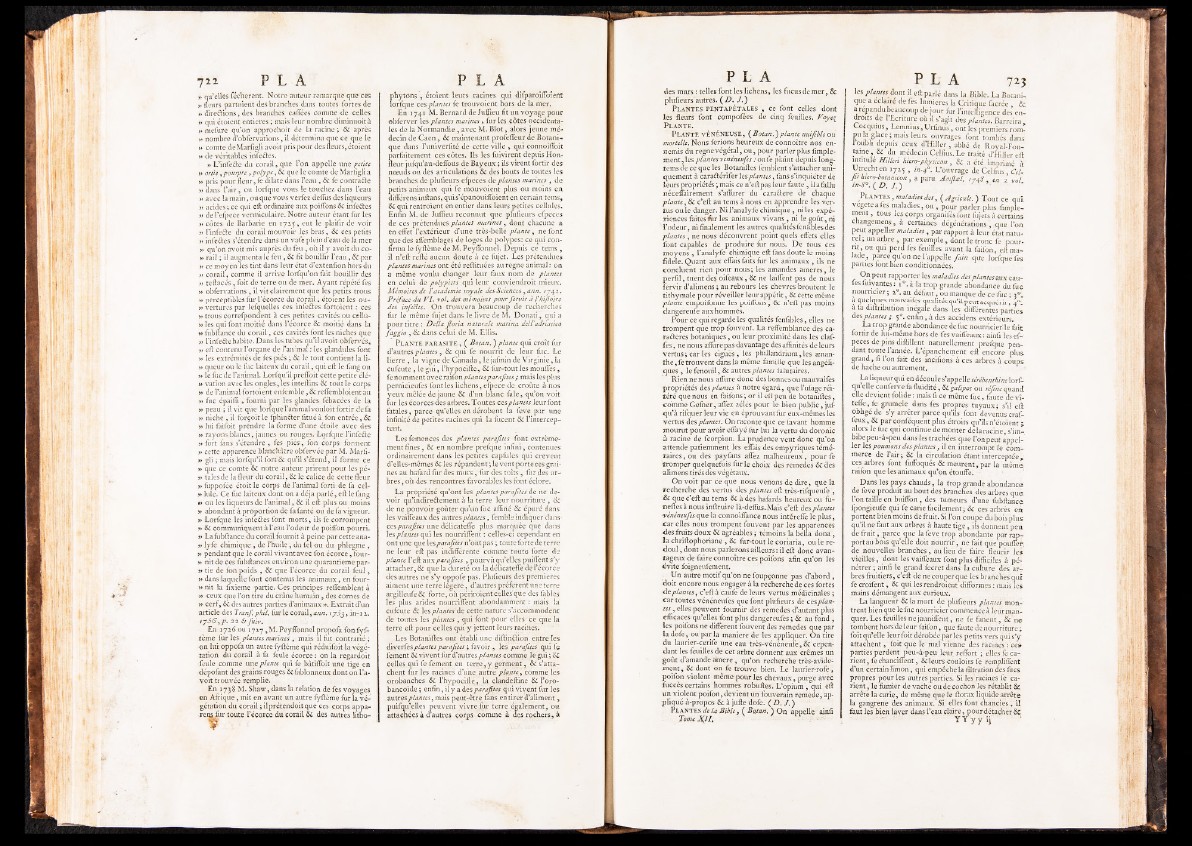
7 » P L A
>y qu’elles fécherent. Notre auteur remarqué qiteces
» fleurs partaient des branches dans toutes fortes de
» direôions, des branches caffées comme de celles
» qui étoient entières ; m«p$ leur nombre diminuoità
» mefure qu’on approchôit de la racine ; 6c après
» nombre d’obfervations, il détermina que. ce que le
» comte de Marfigli avoit pris pour des fleurs, étoient
» de véritables infeftes.
» L’infe&e du corail, que l’on appelle une petite
» ortie, pourpre, polype, 6c que le Comte de Marfigli a
» pris pour fleur, fe dilate dans l’eau, & fe contracte
» dans l’air , ou lorfque vous le touchez dans l’eau
» avec la main, ou que vous verfez deflits des liqueurs
» acides ; ce qui eft ordinaire aux poiflons 6c infeûes
» de l’efpece vermiculaire. Notre auteur étant fur les
» côtes de Barbarie en 1725 , eut le plaifir de voir
» l’infefte du corail mouvoir les bras, & ces petits
» infeftes s’étendre dans un vafe plein d’eau de la mer
» qu’on avoit mis auprès du feu , oh il y avoit du co-
» rail ; il augmenta le feu , & fit bouillir l’eau, 6c par
» ce moyen les tint dans leur état d’extenfion hors du
» corail, comme il arrive lorfqu’on fait bouillir des
» teftacés, foit de terre ou de mer. Ayant répété fes
» obfervations , il vit clairement que les petits trous
» perceptibles fur l ’écorce du corail, étoient les ou-
» vertures par lefquelles ces infe&es fortoient : ces
» trous correfpondent à ces petites cavités ou cellu-
» les qui font moitié dans l’écorce 6c moitié dans la
» fubftance du corail, ces cavités font les niches que
» l’infeftehabite. Dans les tubes qu’il avoit obfervcs,
» eft contenu l ’organe de l’animal : les glandules font
» les extrémités de fes piés ; & le tout contient la li-
» queur ou le fuc laiteux du corail, qui eft le fang ou
» le fuc de l’animal. Lorfqu’il prefloit cette petite élé-
» vation avec les ongles, les inteftins 6c tout le corps
» de l’animal fortoient enfemble, 6c reffembloient au
» fuc épaifli, fourni par les glandes fébacées de la
» peau ; il vit que lorfque l’ânimalvouloit fortir de fa
» niche , il forçoit le fphinâer fitué à fon entrée, &
» lui faifoit prendre la forme d’une étoile avec des
» rayons blancs, jaunes ou rouges. LorfqueTinfeâe
» fort fans s’étendre , fes piés, fon corps forment
» cette apparence blanchâtre obfervée par M. Marfi-
» gli ; mais lorfqu’il fort & qu’il s’étend, il forme ce
» que ce comte 6c notre auteur prirent pour les pé-
» taies de la fleur du corail, 6c le calice de cette fleur
» fuppofée étoit le corps de l’animal forti de fa cel-
» Iule. Ce fuc laiteux dont on a déjà parlé, eft le fang
»» ou les liqueurs de l’animal, 6c il eft plus ou moins
» abondant à proportion de fa fanté ou de fa vigueur.
» Lorfque les infe&es font morts, ils fe corrompent
» 6c communiquent à l’eau l’odeur de poiflon pourri.
» La fubftance du corail fournit à peine par cette ana-
» lyfe chimique , de l’huile, du fel ou du phlegme ,
» pendant que le corail vivant avec fon écorce, four-
» nit de ces fubftances environ une quarantième par-
» tie de fon poids , 6c que l’écorce du corail feu l,
» dans laquelle font contenus les animaux, en four-
»nit la fixieme partie. Ces principes reffemblent à
» ceux quel’on tire du crâne humain, des, cornes de
» cerf, 8c des autres parties d’animaux ». Extrait d’un
article des Tranf. phil. fur ie corail, ann. in-12.
iy S S ,p . i i & fuiv.
En 1726 ou 1727 ,M. Peyflonnel propofa fon fyftème
fur les plantes marines , mais il fut contrarié ;
on lufoppofa un autre fyftème qui réduifoit la végétation
du corail à fa feule écorce : on la regardoit
feule comme une plante qui fe bâtiffoit une tige en
dépofant des grains.rouges 6c fablonneux dont on l ’a-
voit trouvée remplie.
En 1738 M. Shaw, dans la relation de fes voyages
en Afrique, mit en avant un autre fyftème fur la végétation
du corail ; ilprétendoitque ces corps appa-
•rens fur toute l’écorce du corail 6c des autres litho-
¥
P L A
phytôns , étoient leurs racines qui difpâroiflbîent
lorfque ces plantes fe trouvoierit hors de la mer.
En 1741 M. Bernard de Juflieu fit un voyage pour
obferver les plantes marines, fur les ÇÔtes occidentales
de la Normandie, avec M. B lot, alors jeune médecin
de Caen, 6c maintenant profeffeur de Botani-.
que dans l’iiniverfité de cette ville , qui connoifloit
parfaitement ces côtes. Ils les fuivirent depuis Honneur
jufqu’au-defToüs de Bayeux ; ils virent fortir des
noeuds ou des articulations 6c des bouts de toutes les
branches de plufieurs efpeces de plantes marines , de
petits animaux qui fe mouvoient plus ou moins en
différens inftans, quis’épanouifloient en certain tems,
& qui rentroient en entier dans leurs petites cellules.
Enfin M. de Juflieu reconnut que plufieurs efpeces
de ces prétendues plantes marines, dont chacune a
en effet l’extérieur d’une très-belle plante , ne font
ue des affemblages de loges de polypes: ce qui conrma
le fyftème ae M. Peyflonnel. Depuis ce tems ,
il n’eft refté aucun doute à ce fujet. Les prétendues
plantes marines ont été reftituées au régné animal : on
a même voulu changer leur faux nom de plantes
en celui de polypiers qui leur conviendroit mieux.
Mémoires de l'academie royale des Sciences, ann. 1742.
Préface du VI. vol. des mémoires pour fervir à l'hijloire
des infectes. On trouvera beaucoup de recherches
fur le même fujet dans le livre de M. Donati, qui a
pour titre : Délia Jloria naturale marina dell' adriatico
faggio , 6c dans celui de M. Ellis.
Pl a n t e p a r a s it e , ( Botan. ) plante qui croît fur
d’autres plantes, 6c qui fe nourrit de leur fuc. Le
lierre , la vigne de Canada, le jafmin de Virginie, la
eufeute, le gui, l’hypocifte, 6c fur-tout les moufles,
fe nomment avec raifonplantesparajites ÿ mais les plus
pernicieufes font les lichens, efpece de croûte à nos
yeux mêlée de jaune 6c d’un blanc fale, qu’on.voit
fur les écorces des arbres. Toutes ces plantes leur font
fatales, parce qu’elles en dérobent la feve par une
infinité de petites racines qui la fucent 6c l’interceptent.
Les feiflences des plantes parajites font extrêmement
fines, 6c en nombre prefque infini, contenues
ordinairement dans les petites capfules qui crevent
d’elles-mêmes 6c les répandent ; lèvent porte ces graines
au hafard fur des murs, fur des toîts, fur des arbres,
oîi des rencontres favorables les font éclore.
La propriété qu’ont les plantes parajites de ne devoir
qu’indireélement à la terre leur nourriture , 6c
de ne pouvoir goûter qu’un fuc affiné 6c épuré dans
les vaiffeaux des autres plantes, femble indiquer danS'
ces parajites une délicateffe plus marquée que dans
les plantes qui les nourriflent : celleS-éi cependant en
ont une que les parajites n’ofit pas ; toute forte de terre
ne leur eft pas indifférente comme toute forte de
plante l’eft aux parajites , pourvû qu’elles puiffent s’y
attacher, & que la dureté ou la délicateffe dé l’écorce
des autres ne s’y oppofe pas. Plufieurs des premières
aiment une terre légère, d’autreS préfereht une terre
argilleufe& forte, bit périroient cellesqüe des fables
les plus arides nourriflent abondammènt : mais la
eufeute 6c les plantes' de cette nature s’accommodent
de toutes les plantes , qui font pour elles Cë que la
terre eft pour celles qui y jettent leurs racines.
Les Botaniftes ont établi une diftin£iion entre les
diverfesplantes parajites ; favoir , les parajites qui fe
fement 6c vivent fur d’autres plantes comme le gui ; 6c
celles qui fe fement en terre , y germept, 6c s’attachent
fur les racines d’une, autre plante, comme les
orobanches 6c l’hypocifle, la clandèftine 6c l’oro-
bancoïde ; enfin, il y a des parajites qui vivent fur les
autres plantes, mais peut-être fans en tirer d’aliment,
puifqu’ elles peuvent vivre fur terre également, ou
attachées à d’autres corps comme à des rochers, à
P L A
des murs : telles font les lichens, les fucus de mer, &
plufieurs autres. ( D . J.')
P l a n t e s p e n t a p é t a l e s , ce font celles dont
les fleurs font compofées de cinq feuilles. Voye^
P l a n t e .
P l a n t e v é n é n e u s e , ( Botan. ) plante nujiblç ou !
mortelle. Nous ferions heureux de connoître nos ennemis
du régné végétal, ou, pour parler plus Amplement,
les plantes vénéneufes : on fe plaint depuis long-
lems de ce que les Botaniftes femblent s’attacher uniquement
à caraétérifer les plantes, fans s’inquiéter de
leurs propriétés ; mais ce n’eft pas leur faute, ilafallu
néceffairement s’affurer du cara&ere de chaque
plante, 6c c’eft au tems à nous en apprendre les vertus
ou le danger. Ni l’analyfe chimique , ni les expériences
faites fur les animaux vivans , ni le goût, ni
l’odeur, ni finalement les autres qualitésfenfibles des
plantes , ne nous découvrent point quels effets elles
font capables de produire fur nous. De tous ces
moyens , l'analyfe chimique eft fans doute le moins
fidele. Quant aux effais faits fur les animaux , ils ne
concluent rien pour nous; les amandes ameres, le
perfil, tuent de§ oifeaux, 6c ne laîffent pas de nous
fervir d’alimens ; au rebours les chevres broutent le
tithymale pour réveiller leur appétit, & cette même
plante empoifonne les poiflons, 6c n’eft pas moins
dangereufe aux hommes.
Pour ce qui regarde les qualités fenfibles, elles ne
trompent que trop fouvent. La reffemblance des caractères
botaniques, ou leur proximité dans les claf-
fes, ne nous affurepas davantage des affinités de leurs
Vertus ; car les ciguës , les phillandrium, les ænan-
the, fe trouvent dans la même famille que les angéliques
, le fenouil , 6c autres plantes lalutaires.
Rien ne nous affure donc des bonnes ou mauvaifes
propriétés des plantes à notre égard, que l’ulâge réitéré
que nous en failons ; or il eft peu de botaniftes,
comme Gefner, affez zélés pour le bien public, juf-
qu’à rifquer leur vie en éprouvant fur eux-mêmes les
vertus des plantes. On raconte que ce favant homme
mourut pour avoir effayé fur lui la vertu du doronic
à racine de feorpion. La prudence veut donc qu’on
attende patiemment les effais des empyriques téméraires
, ou des payfans affez malheureux, pour fe
tromper quelquefois fur le choix des remedes 6c des
alimens tirés des végétaux.
On voit par ce que nous venons de dire, que la
recherche des vertus des plantes eft très-rifqueufe ,
&c que c’eft au tems & à dés hafàrds heureux ou fu-
neftes à nous inftruire là-deffus.Mais c’eft des plantes
vénéneufes que la connoiffance nous intéreffe le plus,
car elles nous trompent fouvent par les apparences
ries fruits doux 6c agréables ; témoins la beila dona,
la chriftophoriane , 6c fur-tout le coriaria, ou le re-
rioul, dont nous parlerons ailleurs : il eft donc avantageux
de faire connoître ces poifons afin qu’on lés
lévite foigneulèment.
Un autre motif qu’on ne foupçonne pas d’abord ,
doit encore nous engager à la recherche de ces fortes
rie plantes, c’eft à caufe de leurs vertus médicinales ;
car toutes vénéneufes que font plufieurs de ces plantes
, elles peuvent fournir des remedes d’autant plus
efficaces qu’elles font plus dangereufes ; & ; âü fond j
les poifons ne different fouvent des remedes que par
ladofe, ou par la manière de les appliquer. On tire
du laurier-cerife une eau très-vénéneufe, 6ç cependant
les feuilles de cet arbre donnent aux crèmes un
goût d’amande aW r e , qu’on recherche très-avidement,
& dont on fe trouve bien. Le laurier-rofe,
poifon violent même pour les chevaux, purgé avec
îiiccès certains hommes robuftes; L’opium , qui eft
un violent poifon, devient un fouverain remede, appliqué
à-propos 6 c à jufte d'ofe. (D . J. J
P l a n t e s de la Bible, ( Bo.tan,j On a p p e lle ainfi
JomeXJ f ' - , -
P L A 723
les plantes iont il .eftparlé.dans la Æble..La Botani.
que a éclairé de Tes lumières la C'riticme facrée , &
a répandu beaucoup de jour fur l’intelligence des endroits
de l’Ecriture où il s’agit des plantes. Barreira ,
Oocquius, Lemnius, Urfinus;, ont les premiers rom-
pu la glace; mais leurs;ouvrages; font tombés dans 1 oubli depuis , ceux d’Hiller, abbé de Royal-Fon-
taine ,-Sc du médecin Celfius. Le traité .d’Hiller eft
intitulé HilUri hiero-phyûam., & a cté imprimé ù
Utrecht en 1725 , in-40. L’ouvrage de Celfius Cel-
Ju hiero-botanicon, a paru Arnficelf 1748 , en a. vol.
m -8°. ( D . J . )
Plantes , maladies des, ( Agricult. ) Tout ce qui
vegeteafes maladies, ou , pour parler plus fimplement,
tous les corps organifés font fujets à certains;
changemens, à certaines dégénérations, que l’on
peut appeller maladies, par rapport à leur état naturel
; un arbre , par exemple, dont le tronc fe pourrit,
ou qui perd fes feuilles avant la faifon, eft malade,
parce qu’on ne l’appelle fain que lorfque fes
parties font bien conditionnées.
On peut rapporter les maladies des plantes aux cau-
les fui vantes : 1 °. a la trop grande abondance du fuc
nourricier ; 20. au défaut, ou manque de ce fuc ; 30.
a 5ue^ uf s mauvaifes qualités qu’il peut acquérir; 40.
a fa diftribution inégalé dans les différentes parties
dtsplantes 50. enfin, à des accidens extérieurs.
La trop grande abondance de fuc nourricier! le fait
fortir de lui-même hors de fes vaiffeaux : ainfi les ef-1
peces de pins diftillent naturellement prefque pendant
toute l’année. L’épanchement eft encore plus
grand, fi l’on fait des iricifions à ces arbres à coups
de hache ou autrement.
La liqueur qui en découle s'appelle térébenthine lorf-
qu’elle conferve fa fluidité, & galipot ou^ réfine quand
elle devient folide : mais fi ce même fuc, faute de vî-
teffe, fe grtimele dans fes propres tuyaux; s’il eft
obligé de s’y arrêter parce qu’ils font devenus craf-
feux, 6c par cqnféquent plus étroits qu’ils n’étoient ;
alors le fuc qui continue démonter de la racine s’imbibe
peu-à-peu dans les trachées que l’on peut appeller
les poumons des plantes , il en interrompt le commerce
de l’air; 6c la circulation étant interceptée,
ces arbres font fuffoqués 6c meurent, par la;même
raifon que les animaux qu’on étouffe.
Dans les pays chauds, la trop grande abondance
de feve produit au bout des branches des arbres que
l’on taille en buiffon, des tumeurs d’une fubftance
fpongieufe qui fe carie facilement; 6c ces arbres en
portent bien moins de fruit. Si l’on coupe dubois plus
qu’il ne faut aux arbres à haute tig e, ils donnent peu.
de fruit ; parce que la feve trop abondante par rapr
portau Bois qu’elle doit nourrir, ne fait que pouffer;
de nouvelles branches , âü lieu de faire fleurir les
vieilles, dont les vaiffeaux font plus difficiles à pénétrer
; ainfi le grand fecret dans la culture des arbres
fruitiers, c’eft de ne couper que les branches qui
fe croifent, 6c qui les rendroient difformes : mais les
mains démangent aux curieux.
La langueur & la mort de plufieurs plantes mon-’
trent bien que le fuc nourricier commence à leur manquer.
Les feuilles ne jauniffent, ne fe fanent, & ne
tombent hors de leur faifon, que faute denourrititre ;
foit qu’ elle leur foit dérobée par les petits vers qui s’y
attachent, foit que le mal vienne des racmes;.’ ce»
partiés perdënt peu-à-peu leur reffort'; elles fe carient,
fe chanciffent, & leurs couloirs fe rempliffent
d’un certain limon, qui empêche la filtration des fiics
propres pour les autres parties. Si les’racines fe carient.
le fumier de vache oüde cochon les rétablit &
arrête la carie, de même que le ftorax liquide arrête
la gangrené des animaux. Si elles font châhcies V il
faut les bien laver dans l’eau claire,Tg pgouHrdétaçhér 6c
; -7'i
B