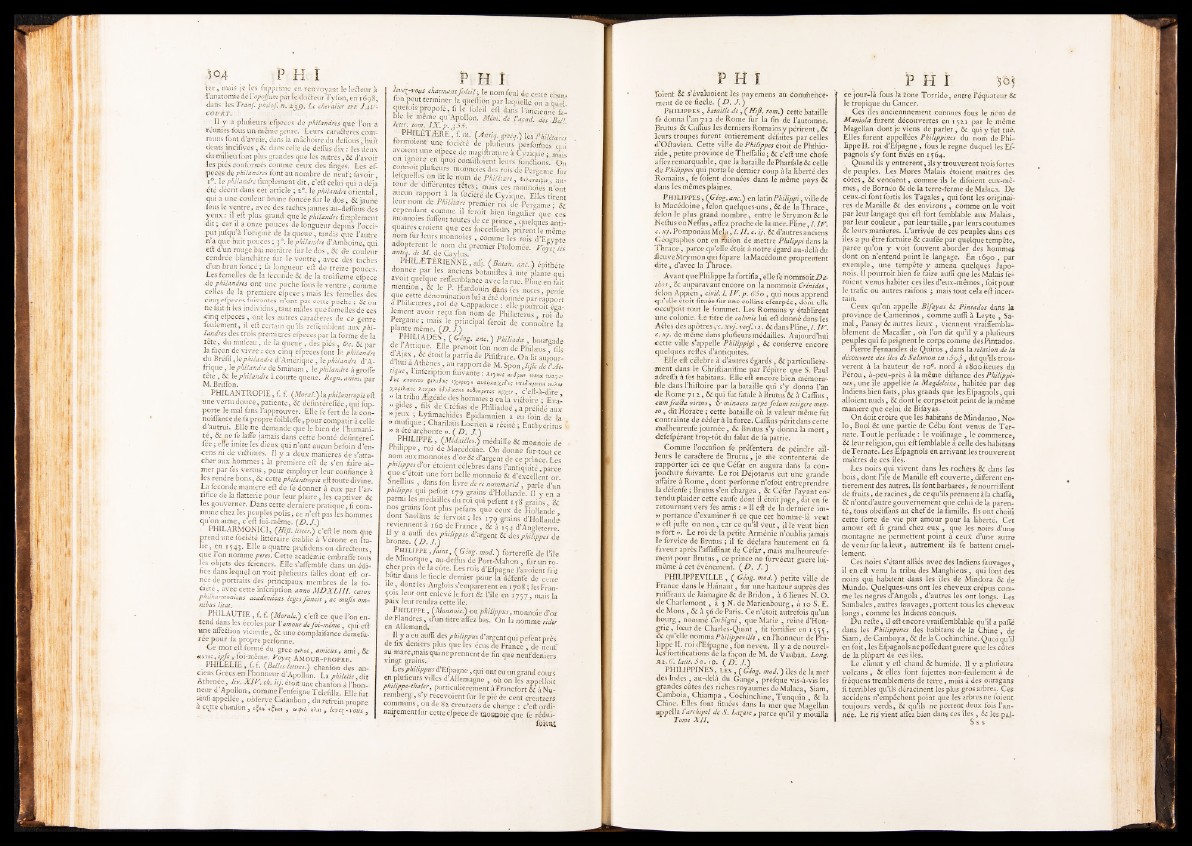
5 Q 4 P
^er, maïs je les Aipprime en renvoyant le lefleur r
i’anatomie dèVopaffum par le doâeur Tyfon, ènTffog,
dans - les Tranj. philo/ n. 2.3$. Le chevalier BE Ja u '-
COURT .
Il y a plufieurs .efpeces dé philandrescsjxt l’on à
réunies fous un même genre. Leurs caraôéres communs
font d’avoir, dans la mâchoire du deffous hurt
dents incifives, & dans celle de deflus dix.J es’deux
du milieu font plus grandes que les autres-, & d’avoir
les piés conformés comme ceux des linges? '-Les efpeces
de philandres font au nombre de neuf ; favoir
i° . le philandre Amplement dit, c’eft celui qui a déjà
été décrit dans cet article ; 20. le philandre oriental
quia une couleur brune foncée fur le dos, & jaunè
fous le ventre, avec des taches jaunes au-deffous des
y eux : il eft plus grand que le philandre Amplement
dit; car il a onze pouces de longueur depuis l’ôcci-
put jufqu’à l’origine de la queue, tandis que l’autre
n’a que huit pouces ; 3°. ltphilandre d’Amboine, qui
eft d’un rouge bai noirâtre fur le dos , & d'e couleur
cendree blanchâtre Air le ventre, avec dès taches
d’un brun foncé ; fa longueur eft de treize pouces.
Les femelles de la fécondé & de la troifieme efpece
de philàndres ont une poche fous le ventre, comme
celles de la première efpece ; mais les femelles des
-cinq efpeces fuivantes n’ont pas cette poche ; & on
ne fait A k s individus, tant mâles que femelles de ces
cinq efpeces, ont les autres caractères de ce genre
feulement, il eft certain qu’ils reffemblent aux philandres
des trois premières efpeces par la forme de la
tête, du muieau, de la queue , des niés * &c. & par
la façon de vivre : ces cinq efpeces font le philandre
du Br eûl , 1e philandre d’Amerique, le philandre d’A frique
, le philandre deSminam , le philandre à groffe
tête , & le philandre à courte queue. Resn. anim, nar
M. Briffon. ^ , F
PHILANTROPIE, f. f. (Moral.) la philahtropie eft
une vertu douce, patiente, & défintéreffée, qui fup-
porte le mal fans l’approuver. Elle fe fert de la con-
noiffance de fa propre foibleffe , pour compatir à celle
d ’autrui. Elle ne demande que le bien de l’humani-
& ne fe laffe jamais dans cette .bonté défintéref-
•fée ; elle imite les dieux qui n’ont aucun befoin d ’encens
ni de viftimes. Il ÿ a deux maniérés de s'attacher
aux hommes ; la première eft de s’en faire aimer
par fes vertus, pour employer leur confiance à
les rendre bons, & cette philantropie eft toute divine.
La fécondé maniéré eft de fe donner à eux par lar-
tiAce de la flatterie pour leur p laire, les captiver &
les gouverner. Dans cette derniere pratique, fl commune
chez les peuples polis, ce n’ eft pas les hommes
qu’on aime, c’eft loi-même. (D. J.)
PHILARMONICI, (Hift. littér.) c’eft le nom que
prend une fociete littéraire établie à Vérone en Italie
, en 1543. Elle a quatre préAdens ou directeurs
que l ’on nomme /*/-«. Cette académie embraffe tous
lès objets des fciences. Elle s’affemble dans un édi-
Ace dans lequel on voit plufieurs falles dont eft or-
nee de portraits des principaux membres de la fociete
, avec cette infcription anno M DXLUI. catus
philhannonicus academicas leges fancit , ac mufis omnibus
litat. J
PHILAUTIE, f. f. (Morale.') c ’eft ce que l ’on entend
dansles écoles par M amour de foi-même qui èft
une affection vicieufe, & une complaifance démefu-
ree pour fa propre perfonne.
Ce mot eft formé du grec ?/Aoç, amicus, ami, &
«tt/Toç, ipfi-, foi-meme. V oye? Amour-propre.
. PHILELIE f f. { S ü L L r c s .) chanfon des anciensGréessn
l hQnneur d’Apoibn. La phiUlU, dit
Athenee, hv. XIV . ch. üj. étoit une chanfon à rhon-
neur d Apollon , comme l’enfeigne Telefllla. Elle Ait
ainii appellée, obferve Cafaubon, du refrein propre
a cette chanfon, . Uvc^-yous,
P H I
J f ' W 4 «rmdmfokiL-, le nom feul de cette chou.
fon terminer la 8— B B M W M Ü
q u e ^ w o p o f e . fi lé folêil eft daürmd iëh né fable,
le même qu'Ap&flôH. Mém\ de tasad:'dèsiSell
leur. tom. IX . p. f 65. : :
PHOEÉTÆRE, f. lit. {À/ùïq. gricq^ljzs PhiUiircs
rorinoient une focicté de p',i:liu:rs perionWs ouï
avoient Ulte efpece de magillrature à Cyzique lirais
op ignore en quoi eoiuifitcier.t leurs'Saiêti,ura. (>:,
eonnoit plufieurs irioïîftofes fies rbis’cfePefraine fur
leiquellos on Ht lenom de Phililoer, I «XnL'oV au_
tour de ifterentes têtes; mais ces monnoies ifo'nt
aucun rapport à la ioûété de Cyzique. Elles firent
leui nom de Philètztrz premier foi de Pereame ; &
fingidier que ces
fnonnoies fitffent toutes de ce prince, quelques antiquaires
croient que; cW fuCceffeiifs prirent le même
nom lur leurs monnoies , comme les rois d'Egypte
adoptèrent lé nom dit premier Ptolomce Voyez les
annj.'i& M. dèCayluiV5' “ ' J \
■ PHILÆTÉR1ENNE, {BotaH. kni.X épithéte
donnée par les ancteira hotaniftes à uhe plante qui
avoir quelque reflemblance avec la rde. Pline en fait
mention & le P. Hàrddïin Saris fes notesi, p.enfe
?m;uette denonlmatt0ri lui a été, donnée par rapport
f . rot de Cappadiics : elle pOitVoit également
avoir reçu fon h o« de Philtéfoïus , roï de'
rergame; mais le principal ferait dé connoître la
plante meme. (D .J .)
PHILIADES, ( GioS. une. ) Philiada: I bourgade
deiAtnque. Elle prenoit fon nom de 'fhilæus EIs
d , I;?* » «toit la patrie de Pififtrate. On lit auiourd
tau a Athènes, au rapport de M. Saon,lijle de f.-lt-
tique 9 1 infcription fuivante : Arywç ctvS'puv iw.a. vja.yir
KTnmou txopnyt auffi^x^iç
m m roç „pxev, c’eft-à-dire,
» la tribu Ægeide des hommes a eu la viéfoire ; Eva-
» gides , Aïs de CtéflaS de Philiadôé , a préAdé aux
» jeux ; LyAmachidès Epidamnïen a eu foin de la
» miilique ; Chanlaus Locriên a récité ; Euthycritiis fe
» a ete archonte » . ( D . J . ) J
’ (Médailles.) médaille & nionnoie de H
Philippe, roi de Macédoine. On donne fur-tout ce
nom aux monnoies d’or & d’argent de cé prince. Les
phihppes d’or étoient célébrés da'ns l’antiquité, parce
que c etoit une fort belle monnoie & d’excellent or.
inellius , dans fon livre de re nummariâ parle d’un
phUippe qui pefoit 179 grains d’Hollande. Il y e n a
parmi les médailles du roi qui pefent 158 grains &
nos grains font plus pefans que ceux de Hollande
dont Snelhus fe fervoit ; les 179 grains d’Hollandô-
reviennent à 160 de France , & à 154 d’Angleterre.
Il y a aiiffi des philippes d’argent & des philippes de
bronze. (D . J.)
P h i l i p p e ,faint t (Gébg. mod.) forterefle dePile
de Minorque, au-deffus de Port-Mahon , fur un fo-
cherpres de la côte. Les rois d’Efpagne l’avoient fait
bâtir dans le flecle dernier pour la défenfe de cette
î le , dont les Anglois s’emparèrent en 1708 ; les François
leur ont enlevé le fort & l’île en 1757, niais la
paix leur rendra cette île.
Phïlippe! (Monnoie.) ou philippus, monnoie d’or
de Flandres, d’un titre affez bas. On la nomme rider
en Allemand.
. n. y a, eu.au® des Philippus d’argent qui pefent près
de fix demers- plus que les écus de France, de rièuf
au marc,maisquineprennent de fin que neufdeniers
vingt grains.:
te s phiiippiisd ’Efpagrie, qiiifont eu un grand coùis
en plufieurs villes d’Allemagne , ; oh on les appéll'bit
philippe-tkuUr, particulièrement! Francfort & à Nu-
remberg , s y recevoient fur le pié de cent creutzers
communs, où de 82 creutzers de change : c’eft ordinairement
fur cette efpece de taoeaoie que fe réduifoieut
P H I
Toknt & s’évaluoient les payemens aû èômrîience-
meht de ce fiecle. (D . J .)
P h i l i p p e s , bataille de, (Hifi. rom.) cette bataillé
fe donna l’an 712 de Rome fur la An de l’gutomnè.
Brutus & CaïÂuS les derniers Romains y périrent, &
leurs troupes furent entièrement défaites par celles
d’Oftavi.en. Cette ville de Philippes étoit de Phthio-
îid e , petite province de Theffalie; & c’eft une chofo
affez remarquable, que la bataille de Pharlàle& celle
de Philippes qui porta le dernier coup à la liberté des
Romains, Je foieùt données dans le môme pays &
dans les mêmes plaines.
P h i l i p p e s , (Gèog. ant.) en latinPhilippi, viHe de
la Macédoine, lelon quelques-uns, & de la Thrace,
félon le plus grand nombre , entre le Strymon & le
Neftus où Neflus -, affez proche de la mer. Pline, L. IV.
c. x j. Pomponius Mêla, l. I I. c. ij. & d’autres anciens
Géographes ont eu; rlifon de mettre Philippi dans la
Thrace, parce qu’elle étoit à notre égard au-delà du
fleuve Strÿmon qui fépare laMacédoine proprement
dite , d’avec la Thrace*
Avant que Philippe la fortiflà/elle fê nommoitZ)^-
‘thbs*, & auparavant encore on la nommoit Crénides,
Telon Appien, civil. L IV. p. Ç5 o , qui nous appren’d
qu’elle etoit fltuee fur Une colline efearpée, dont elle
occùpôit tout le fommet. Les Romains y établirent
une colonie. Le titre de colonie lui eft donné dans les
Aftes des apôtres Xvj. verf i 2. & dans Pline, l. IV.
c. x j. de même dans pluAeùrs médailles. Aujourd’hui
cette ville s’appelle Philippigi y & conferve encore
quelques reftes d’antiquités.
Elle eft célébré à d’autres égards, & ‘particuliere-
ment dans le Chriftianifme par l’épître que S. Paul
adreffa à fes habitans. Elle eft encore bien mémora2-
ble dans l’hiftoire par la bataille qui s’y donna l’an
de Rome 712, & qui fut fatale à Briitus & à Caflius,
cum /racla virtus, '6* minaces turpe jblum tetigere mert-
to , dit Horate ; cette bataille où la valeur même Ait
contrainte de céder à la force. Câflius périt dans cette
analheureufe journée, & Brutus s’y donna la mort,
defefpérant trop-tôt du falut de la patrie.
Comme l’occâAon fe prefèntera dé pêindre ailleurs
le cara&ere de Brutus, jê mê contenterai de
rapporter ici Ce que Céfar en augura dans la conjoncture
fuivante. Le roi Déjotams ’eut uhe grande
affaire à R ome, dont perfonne h’ofoit entreprendre
la défeflfe ; Brutus s’èn chargea , & Céfar l’ayant entendu
plaider Cette caufe dont il étoit juge, dit en fe
retournant vers fes amis : « Il eft de la derniere' im-
» portance d’examiner fl ce aue cet hOmtfte-là veut
» eft jufte ou non , câr cé qiril v eu t, il le veut bien
» fort ». Le roi de la petite Arménie n’oublia jamais
lefervice dé Btutus ; il fe déclara hautement eri fà
faveur après l’affaflinat de Cé far, mais malheureufé-
ment pour Brutus, ce prince ne furvécut güere lui-
anême à cet événement. (D . J .)
PHILIPPEVILLE , ( Géog. modj) petite Ville de
France .dans le Hairiaut, fur une hauteur auprès des
ruiflèaux de Jaimagiie & de Bridon, à 6 lieues N. O.
de Charlemont, à 3 N. de Marienbourg, à 10 S. E.
de Mons , & à ^6 de Paris. Ce ii’étoit autrefois qu’un
bourg , nommé Corbigni, que Marie , reine d’Hongrie
, foeur de Charles-Quint , flt fortifler en 1555,
& qu’elle nomma PhilippeviÙe , en l’honneur de Phi-
lippé Iï. roi d’Ëlpaghe, fon neveu. Il y a de nouvel-
les'fortiflcations de la façon de M. de Vauban. Long.
u.2.6. huit. 5o. 10. ( D. J.)
PHILIPPINES, l e s , ( Géog. mod. ) îles de la mér
des Indes , au-delà du Gange, prefque vis-à-vis lés
grandes cotes des riches royaumes de Malaca, Siam,
Camboia, Chiampa , Cochinchine, Tunquin , & la
Chine. Elles font fltuees dans la mer que Magellan
appella C archipel de S. Lazare, parce qu’il y mouilla
Tome X I I ,
P II I sfi
ce jour-là fous là 2one Torride, entré Féqùateur &
le tropique du Cancer.
.. Ces îles anciennnement connues fous le nom de
Manipla furent découvertes en 1521 par le même
Magellan dont je viens de parler, & qui y fut tué.
Elles furent appellées Philippines du nom de Philippe
II. roi d’Efpagne, fous le regne duquel les Espagnols
s’y font Axés en 1564.
. Quand ils y entrèrent, ils y trouvèrent trois fortes
de peuples. Les Mores Malais étoient maîtres des
côtes , & ven.oient, comme ils le difoiént eux-mêmes,
de Bornéo & de la terre-ferme de Malaca. De
ceüx-ci font fortis les Tagàles -, qui font les originaires
;de Manille & des environs , .comme on le voit
.par leur langage qui eft fort femblable aux Malais,
par leur couleur •, par leur taille, par leurs coutumes
& leurs maniérés. L’arrivée de ces peuples dans ces
îles a pu être fortuite & câufée par quelque tempête,
parce qu’on y voit fouvent aborder des hommes
dont on n’entend point le langage. En 1690 , par
exemple , une tempête y amena quelques Japo-
nois. 11 pourroit bien fe faire auffi que les Malais fe-
roient venus habiter ces îles d’eux-mêmes, foit pour
le traAc ou autres raifons ; mais tout cela eft incer-
tain.
Ceux qu ôh appelle Bifayas & Pintados dans la
province de Camerinos , comme aufli à Leyte , Sa-
mal , Panay & autres lieux , viennent vraisemblablement
de Macaffar, où l’on dit qu’il y a plufieurs
peuples qui fe peignent le corps comme des Pintados.
Pierre Fernandez de Quiros , dans la relation de la
découverte des îles de Salomon en / 5g5 , dit qu’ils trouvèrent
à la hauteur de io d. nord à 1800 lieues du
Pérou, à-peu-près à la même diftance des Philippines,
une île appellée la Magdeleine, habitée par des
Indiens bien faits, plus grands que les Efpagnols, qui
alloient nuds, & dont le corps etoit peint de la même
maniéré que celui de Bifâyas.
On doit croire que les nabitans de Mindanao, No-
lo , Bool & une partie de Cébu font venus de Ter-
nate, Toutlé perfuade : le voiAnage , le .commerce^
& leur religion, qui eft femblable à celle des habitans
deTernate. Les Efpagnols en arrivant les trouvèrent
maîtres de ces îles*
. Les noirs qui vivent dans les rochers & dans les
bois, dont Pile de Manille eft couverte, different entièrement
des autres. Ils font barbares, fenourriffent
de fruits, de racines, de ce qu’ils prennent à la chaffe,
& n’ont d’autre gouvernement que celui, de la parenté
, tous obéiflans au chef de la famille* Ils ont choifi
cette forte de vie par amour pour la liberté. Cet
amour eft A grand chez eux , que les noirs d’une
montagne ne permettent point à ceux d’une autre
de venir fur la leur, autrement ils fe battent cruellement.
,
Ces hoirs s’étant allies avec des Indiens fauvages ,
il en eft venu la tribu des Manghiens , qui font des
noirs qui habitent dans les îles de Mindora & de
Mundo. Quelques-uns ont les cheveux crépus comme
les negres d’Angola , d’autres les ont longs. Les
Sambales, autres fauvages, portent tous les cheveux
longs, comme les Indiens conquis*
Du refte, il eft encore vraiffemblable qu’il a pafîe
dans les Philippines des habitans de la Chine, de
Siam, de Camboya, & de la Cochinchine. Quoi qu’il
en foit, les Efpagnols ne poffedentguere que les côteà
de la plupart de ces îles.
Le climat y eft chaud & humide. Il y a plufieurs
volcans , & elles font fujettes non-feulement à de
fréquens tremblemens de terre, mais à des ouragans
A terribles qu’ils déracinent les plus gros arbres. Ces
accidens n’empêchent point que les arbres ne foient
toujours verds, & qu’ils ne portent deux fois l’année.
Le ris' vient affez bien dans ces île s , & les pal