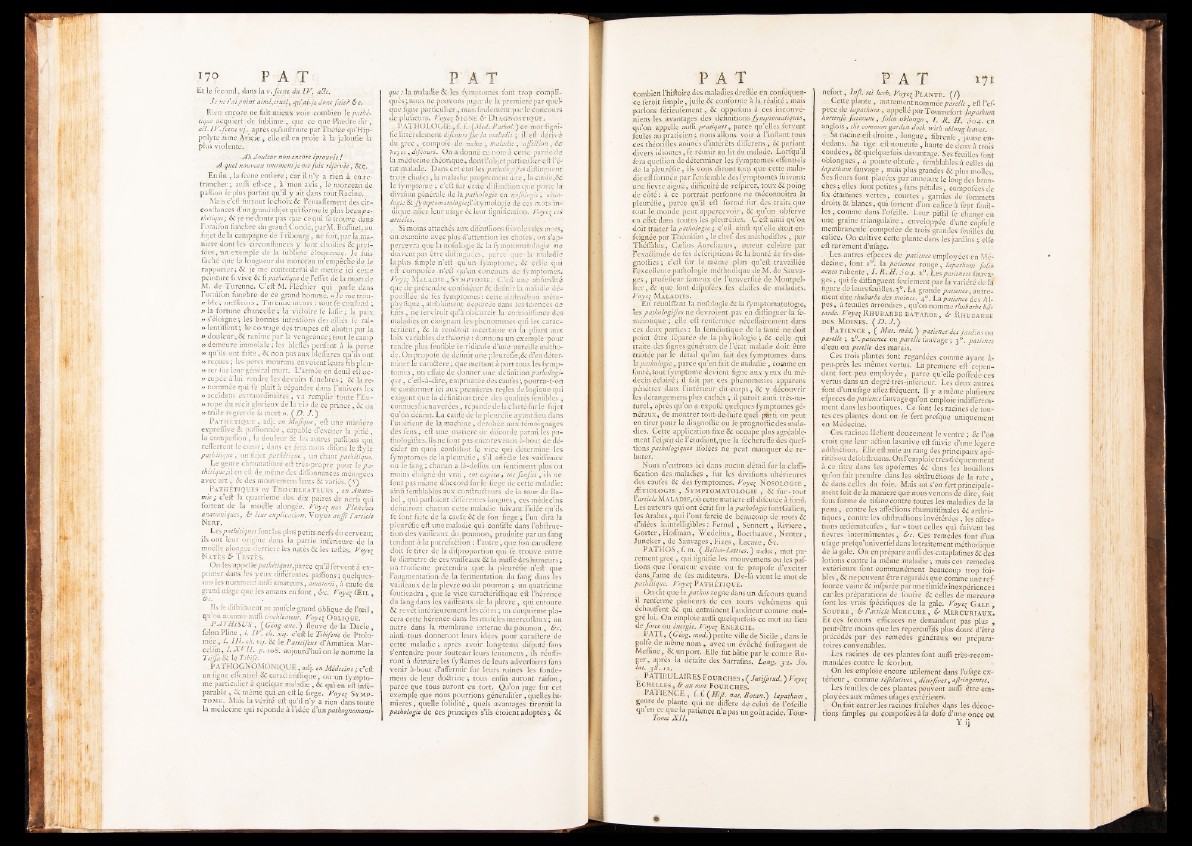
Et le fécond, dans la v. feene du IV. acte.
Je né?ai point aimé,cruel, qu!ai-jedonc fait? &e.
Rien encore ne fait mieux voir combien le pathétique
acquiert de fublime ,. que ce que Phèdre d it ,'
aiï. IV .feene y). après qu’inftruite par Théié.e qu’Hip-
polyte aime Aricie , elle eft en proie à la jaloufie la
plus violente. ;
Ah douleur non encore éprouvée ! '
A quel nouveau tourmentjeme fuis réfèi'véé, &ç.
Enfin , la feene entière ; car il h’y a rien à en retrancher
; auflï eft-ce , à mon avis, le morceau de,
pafiion le plus parfait qu’il y ait dans toutjlacine.,
Mais c’eft furtout le choix & l’ëntaflement des cir-
conftances d’un grand objet qui forme le plus beau/?a-
thétiqiu; & je ne doute pas que ce qui fe ti;.ôuve; dans
l’oraifon funebre du grand Condé, parM. Boffuet, au
fujet delà campagne de Fribourg, ne foit,parlama-
niere dont les circonftances ÿ font chôifiès 64 pref-
fées, un exemple de la fublime. éloquence. Je luis
fâché que la longueur du inorëe'aù m’empêche de le
rapporter; Ô4 je me contenterai de mettre icjeêffe,
peinture fi v ive & fi pathétique de l’effet de la mort de .
M. de Turenne. C’eft M. Fléchièr qui. parle dans
l’oraifon funèbre de ce grand homme. «.Je me trou-
» ble, meffieurs , Turenne meurt : toutie confond ;
» la fortune chancelle ; la vi&Ôire fe lalfe ; la paix,
» s’éloigne ; les bonnes interifibhs des alliés fe ral-
» lentiflënt ; le courage des troupes eft abattu par la.
» douleur § & ranimé par la vengeance; tout le camp
» demeure immobile ; les blefl.es penfent à -la perte
» qu’ils ont faite, 84 non pas aux bleffures qu’ils, ont
» reçues ; les peres moiirans envoient leurs fils pleu-
» rer fur leur général mort. L’armée en deuil eft oc-
» cupée a lui rendre les devoirs funèbres ; 84 la re-
» nommée qui fe plaît à répandre dans l’univers les
» accidens extraordinaires , va remplir toute l’Eli-
» rope du récit glorieux de la vie de ce prince, 84 du
» trille regret de fa mort ». ( D . J. ) '
Pathé tique , adj. en Mujzque, eft une maniéré
expreflive & paffionnée , capable d’ëxciter la.pitié,
la compaflion, la douleur & les autres pallions qui
refferrent le coeur ; dans cë fens nous difons' le ftyle
pathétique , un fujet pathétique , tin chant pathétique.
Le genre chromatique eft très-propre pour le pa-.
thétique;i\ en eft de .même; des diffonnances ménagées
avec a r t , & des mouvemens lents 84 variés. (,Ç)
Pathétiques ou T rochleateurs , en Anator
mie; c’eft la quatrième des dix paires de nerfs'qui
fortent de la moelle alongée. Voye^ nos Tlanch.es
anatomiques, & leur explication-. Voyez aufji Varticle
Nerf.
Les pathétiques fontles plus petits nerfs du cerveau;
ils ont leur origine dans la partie inférieure de la
moelle alongée derrière les natès 84 les teftès. Voyez
N atès & T estés. >
On les appelle pathétiques,parce qu’il fervent à exprimer
dans les yeux différentes paffionS ; quelques-
uns les nomment aufii amateurs, amatqrii, à caufe du
giand ufage que les amans enfont, &c. V0ye{ (Eil ,
Ils fe diftribuent au rnufcle grand oblique de l’oe il,
qu on nomme aufli trockleateur. Voye[ Oblique.
PA TH ISUS , ( Géog anc.) fleuve de la Dacie,
félon Pline , l. IV. ch. x ij. c’eft le Tibifene de Ptolo-
mee, l. III. ch. vij. 84 le Poncif eus d’Ammien Mar-
P• 1 °8’ aujourd’hui on le -nomme la
Teiffa 84 le Tibifc.
PATHOGNOMONIQUE, adj. en Médecine ; c’eft
un ligne effentiel & caratf ériftique, ou un fympto-
me particulier à quelque maladie , & qui en eft infé-
parable , 84 même qui en eft le fiege. Voye[ S y m p t
ô m e . Mais la vérité eft qu’il n’y a rien dans toute
la médecine qui réponde à l’idée d’un pathognomonique
.'.lamaladie 84-les.'fymptomes font trop compliqués,;
nous ne pouvons juger de la premieré par quelque
figue particulier, mais feulement par le concours
de,plufieurs'. Voye^ Signe & D iagnostique.
1; PATHOLOGIE., 1. f.-x(Méd. Pathoif ce mot figni-
fie littéralement difeours fur la maladie ; il eft dérivé
du grec , compofé' de -nahos , maladie, affection, 86
Ao>cç, difeours. On a donné ce nom à cette partie de
la médecine théorique, dont l’objet particulier eft l’é-'
tat malade. Dans,cet: état les. pathologifies diftinguent
trois chofes, la maladie proprement dite, la caillé, Scie
fymptome ; c’eft fur cette diftinclion que porte la
divifion-générale de la pathologie en nofnlogit , ahio-
Iqgie &c jÿmptomatologiej’ étymologié dé ces mots indique,
allez leur ufage, & leur fignification. Voyc{ a s
articles.. .
,, Si moins attachés aux difeuflions frivoles des mots,1
on examine avec plus d’attention les chofes, on s’ap-
percevra que la nçfologie Ô4 la fymptomatologie ne
doivent pas être diftinguées, parce que la' m'aladié
la plus fimple n’eft qu’un fymptome ; & celle qui
eft compolée n’eft qu’un concours • de fymptomes.
Voyez Ma l a d ie ., Symptôme. C ’eft: une abfurdité
que de prétendre cpnfidérer & définir la maladie dépouillée
de fes fymptomes : cette abftra&ion méta-
phyfique , abfolument déplacée dans les fciences de
faits, nç lerviroit qu’à oblciircir la connoilfance des
maladies en éloignant les phénomènes qui les carac-
térifent, & la rendroit incertaine en la pliant aux
loix variables de théorie : donnons un exemple pour
rendre plus fenfible le ridicule d’une pareille méthode.
On propofe de définir une pleùr.éfie;& d’endéter-
miner le caraétere ; que mettant à part tous les fy mp-
tonres, on effaie de donner une définition pathologique
, c’eft-à-dire, empruntée descaufes; pourra-t-on
fe conformer ici aux premières réglés de logique qui
exigent que la définition tirée des qualités fenfibles ,
connues bien avérées, répande de la clarté fur le fujet
qu’dn.définit. La caufe de la pleuréfie ayant lieu dans
l’intérieur de la machine, dérobée aux témoignages
des fens, eft une matière de difeorde parmi les pa-
thologiftes.Ils ne font pas encore venus, à-bout de décider
en quoi confiftoit le vice qui détermine les
fymptomes de la pleuréfie, s’il affeéte les vaiffeaux
oh le fang ; chacun a là-deffus un fentiment plus ou
moins éloigné du v ra i, tôt capita, tôt fenfus. , ils ne
font pas même d’accord furie fiege de cette maladie:
ainfi lémblables aux cônftrufteurs de la tour de Babel
, qui parloient différentes langues, ces médecins
définiront chacun cette maladie fuivant l’idée qu’ils
fe font faite de la caufe & de fon fiege ; l’un dira la
pleuréfie eft une maladie qui confifte dans l’obftruc-
tion des vaiffeaux du poumon, produite par un fang
tendant à la putréfaftion : l’autre, que fon.cara&ere
doit fe tirer de la difproportion qui fe trouve entre
le diamètre de ces vaiffeaux & la maffe des humeurs ;
un troifieme prétendra que la pleuréfie n’eft que
l’augmentation de la fermentation du fang dans les
vaiffeaux de la plevre ou du poumon ; un quatrième
foutiendra , que le vice caraftériftique eft I’hérence
du fang dans les vaiffeaux de la plevre, qui entoure
& revet intérieurement les côtes ; un cinquième placera
cette hérence dans les mufcles intercoftaux; un
autre dans la membrane externe du poumon , &c:
ainfi tous donneront leurs idées pour cara&ere de
cette maladie ; après avoir long-tems difputé fans
s’entendre pour , foutenir leurs fentimens, ils réufli-
ront à détruire les fyftèmes de leurs adverfaires fans
venir à-bout d’affermir fur leurs ruines les fonde-
mens de leur dottrine ; tous enfin auront raifon,
parce que tous auront eu tort. Qu’on juge fur cet
exemple que nous pourrions généralifer , quelles lumières
, quelle folidité, quels avantages tireroit la
pathologie de ces principes s’ils étoient adoptés ; 64
Combien l’hiftoire des maladies dreflee en conféquen-
■ ce feroit fimple, jufte 64 conforme và la réalité ; mais
parlons férieufement, 64 oppofons à ces inconvé-
niens les avantages des définitions fymptômatiques,
qu’on appelle aufli pratiques, parce qu’elles feryept
.feules au praticien ; nous allons voir à l’inftant tous
ees théoriftes animés d’intérêts différens , 64 parlant
■ divers idiomes, fe réunir au lit du malade* Lprfqu’il
fera queftion de déterminer les fymptomes effentiels
de la pleuréfie, ils vous diront tous que cette maladie
eft formée par l’enfemble des fymptomes fuivans:
une fievre aiguë, difficulté de refpirer, toux 64 poing
de côté : à ce portrait perfonne ne méconnoîtra la
pleuréfie, parce qu’il eft formé fur d,es traits que
tout le monde peut, appercevoir, 64 qu’on obferve
en effet dans toutes les pleuréfies. C’eft ainfi qu’on
doit traiter la pathologie ; c’eft ainfi qu’elle étoit enseignéepar
Thémifon, le chef des methodiftes , par
Théflalus, Cælius Aurelianus, auteur célébré par
l’exaftitude de fes deferiptions 84 la bonté de fes dia-
gnoftics ; c’eft fur le même plan qu’eft travaillée
Pexcellente pathologie méthodique ue.M. de Sauvages
, profeffeur fameux de l’univerfité de Montpellier,
64 que font difpofées fes claffes de maladies.
Voyei M a l a d i e s .
En réunifiant la nofologie 64 la fymptomatologie,
les pathologiftes ne devroient pas en diftinguer la fe*-
méiotique ; elle eft renfermée néceffairement dans
■ ces deux parties': la féméiotique de lafanté ne doit
point être féparée de la phyfiologie ; ; 64 celle qui
traite des fignes,généraux de l ’état malade doit être
traitée par le détail qu’on fait des fymptomes dans
la pathologie, parce qu’en fait de maladie , comme en
fanté,tout fymptome devient figne aux yeux du médecin
éclairé ; il fait par ces phénomènes apparens
pénétrer dans l’intérieur du corps, 64 y découvrir
les dérangemens plus cachés ; il paroît ainfi très-na-
turel, après qu’on a èxpofé quelques fymptomes généraux,
de montrer tout-de-liiite quel parti on peut
en tirer pour le diagnoftic ou le prognoftic des maladies,
Cette application fixe 64 occupe plus agréablement
l’efprit de l’étudiant,que la féchereffe des quef-
tions pathologiques ifolées ne peut manquer de rebuter
»
Nous n’entrons ici dans aucun détail fur la clafii-
fication des maladies , fur les divifions ultérieures
des caufes 64 des fymptomes. Voye{ N o s o l o g i e ,
Æ t i o l o g i e , S y m p t o m a t o l o g i e ,* 6c fur-tout
Xarticle M a l a d i e ,oh cette matière eft difeutée à fond.
Les auteurs qui ont écrit fur la pathologie fontGalien,
les Arabes, qui l’ont farcie de beaucoup de mots 64
d’idées inintelligibles : Fernel , Sennert, Riviere ,
Gorter, Hoffman, Wedelius, Boerhaave, Nenter,
Juncker, de Sauvages , Fizes, Lacaze, &c.
PATHOS, f. m. ( Belles-Lettres. ) waôo$, mot purement
grec , qui lignifie ,les mouvemens ou les paf-
fions que l’orateur excite ou fe propofe d’exciter
dansj.’ame de fes auditeurs. De-là vient le mot de
pathétique. Voye{ PATHÉTIQUE.
. On dit que le pathos regne dans un difeours quand
il renferme plufieurs de ces tours véhémens qui
échauffent 64 qui entraînent l’auditeur comme maigre
lui. On emploie aufli quelquefois ce mot au lieu
de force ou énergie. Voyeq Energie.
PA T I , {Géog. mod.) petite ville de Sicile , dans le
golfe de même nom , avec un évêché fuffragant de
Mefline, 64 un port. Elle fut bâtie par le comte Roger,
après la défaite des Sarrafins. Long. r<t. 5o,
tat. 3 S,>12.' : „ . . . J .
• PATIBULAIRES F o u r c h e s , { Jurifprud. ) Voyeç
E c h e l l e s , & au mot F o u r c h e s .
PATIENCE , f. f. ( Hiß. nat. Botanf lapaihum,
genre de plante qui ne différé de celui de l’ofeille
qu en ce que la patience n’a pas un goût acide» Tour-
Tome X II,
néfort, tnfl.rei herb, Voye^ Plan t é , (ƒ)
Cette plante , autrement nommée parelie, ëft ï’eft
pece (le lapathum appellé par Tournefort lapathurfi
hortenfe fativum , folio oblongo , /. R m H. S04. en
anglois , the common garden dock with o b long leaves.
■ . Sa racine eft droite , longue , fibreufe , jaune en-
dedans. Sa tige eft noueufe , haute de deux à trois
coudées, 64 quelquefois davantage. Ses feuilles font
oblongues , à pointe obtufe, femblables à celles du
lapathum fauvage, mais plus grandes 64 plus molles»
Ses fleurs font placées par anneaux le long des branches;
elles font petites , fans pétales, compofées cle
fix étamines vertes, courtes , garnies de fommets
droits 6c blancs , qui fortent d’un calice à fept feuilles
, comme dans l’ofeille. Leur piftil fe changé en
une graine triangulaire , enveloppée d’une capfule
membraneufe compofée de trois grandes feuilles du
calice. On cultive cette plante dans les jardins ; elle
eft rarement d’ufage. '
. Les autres efpeces de patience employée'sen Médecine.,
font i° . la patience rouge, Lapathum folio
acuto rubente, I. R. H. i 04. i ° . Les patiences fauva-
ges, qui fe diftinguent feulement par la variété de B
figure de leurs feuilles. 30. La grande patience, autrement
dite rhubarbe des moines. 40. La patience des Alpes
, à feuilles arrondies, qu’on nomme rhubarbe bd-*
tarde. Voye^ R hubarbe b â t a r d e , & Rhubarbe
des: Moines. ( D . J. )
PATIENCE , ( Mat. méd. ) patience des jardins ou
parelie ; i° . patience ou parelie fauvage ; 30. patience
d’eau ou perelle des marais,. .
Ces trois plantes font regardées comme ayânt à-
peu-près les mêmes vertus. La première eft cependant
fort peu employée, parce qu’elle poffede ces
vertus dans un degré très-inférieur. Les deux autres
font d’un ufage allez fréquent. Il y a même plufieurs
efpeces de patience ÙLiivage qu’on emploie indifféremment
dans les boutiques. Ce font les racines de toutes
ces plantes dont on fe fert prefque uniquement
en Médecine.
Ces racines lâchent doucement le ventre ; 64 l’on
croit que leur aétion laxative eft fuivie d’une légère
adftrioion. Elle eftmife au rang des principaux apéritifs
ou defobftruans. On l’emploie très-fréquemment
à ce titre dans les apofemes 64 dans les bouillons
qu’on fait prendre dans les obftru&ions de la rate ,
64 dans celles du foie* Mais on s’en fert principalement
foit de la maniéré que nous venons de dire, foit
fous forme de tifane contre toutes les maladies de la
peau, contre les affeûions rhumatifmales 64 arthritiques
, contre les obftru&ions invétérées, les affections
oedémateufes -, fur - tout celles qui fuivent les
fievres intermittentes, &c. Ces remedes font d’un
ufage prefqu’univerfel dans le traitement méthodique
de la gale. On en prépare aufli des eataplafmes 64 dès
lotions contre la même maladie ; mais ces remedes
extérieurs font communément beaucoup trop foi-
bles, 64 ne peuvent être regardés que comme une refi
fource vaine 64 infpirée par une timide inexpérience :
car les préparations de foufre 64 celles de mercure
font les vrais fpécifiques de la gale. Voye{ Gale ,
Soufre , 6* l'article Mercure , & Mercuriau x *
Et ces fecours efficaces ne demandent pas plus ,
peut-être moins que les repereuflifs plus doux d’être
précédés par des remedes généraux ou préparatoires
convenables.
Les racines de ces plantes font aüfli très-recommandées
coutre le feorbut.
On les emploie encore utilement dans l’ufage extérieur
, comme réfolutives , déterfives, aflringentes.
Les feuilles de ces plantes peuvent aufli être employées
aux mêmes ufages extérieurs*
On fait entrer les racines fraîches d<yls les décoctions
fimplçs ou compofées à la dofe d’une once ou
y »