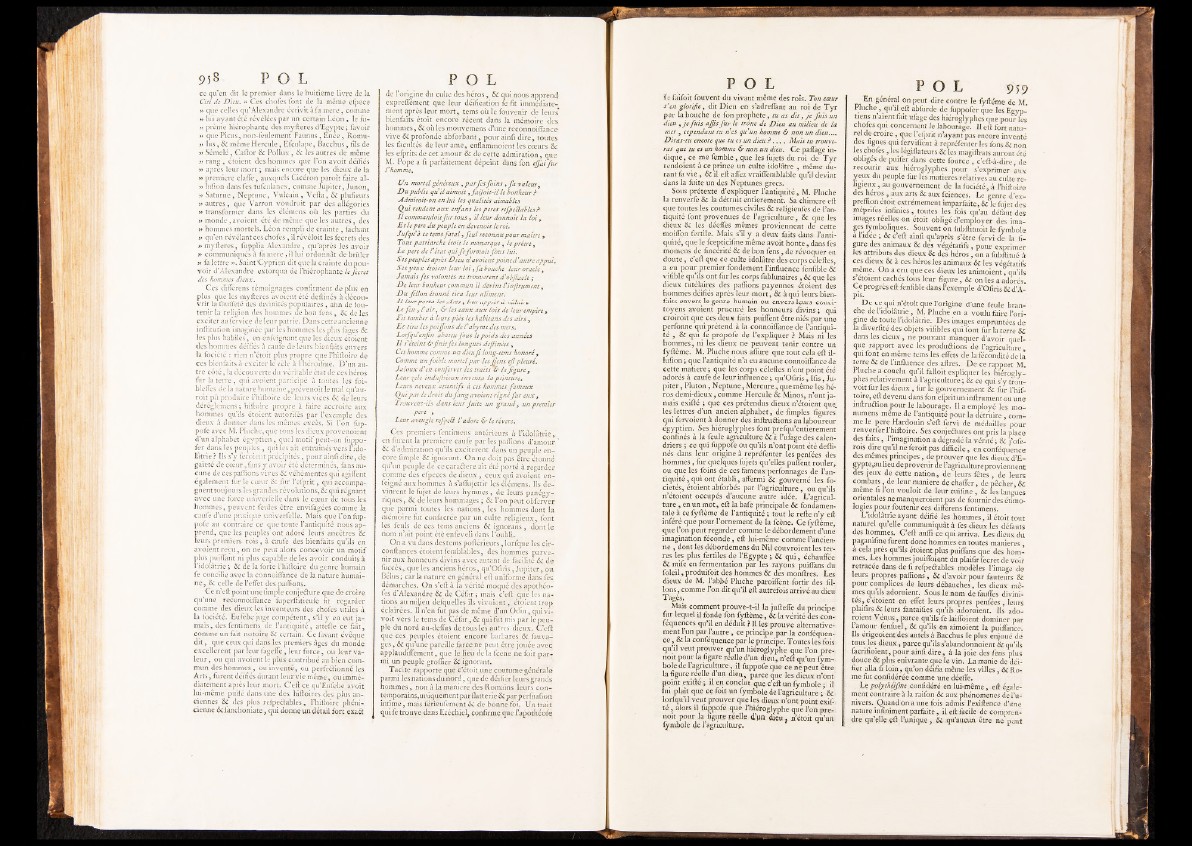
ce qu’en dit le premier dans le huitième livre de la
Cite de Dieu. « Ces chofes font de la même elpece
» que celles qu’Alexandre écrivit à fa mere, comme
» lui ayant été révélées par un certain L éon, le fu-
» prème hiérophante des myfteres d’Egypte; favoir
» que Picus, non-feulement Faunus , Enee, Romu-
» lus, & même Hercule, Efculape, Bacchus, fils de
» Sémelé, Caftor & Pollux, & les autres de même
» rang , étoient des hommes que l’on avoit déifiés
» après leur mort ; mais encore que les dieux de la
» première claffe, auxquels Cicéron paroît faire al-
» îufion dans fes tufculanes, comme Jupiter, Junon,
» Saturne, Neptune, Vulcain, Vefta, & plufieurs
» autres, que Varron voudroit par des allégories
» transformer dans les élémens où les parties du
» monde, avoient été de même que les autres, des
» hommes mortels. Léon rempli de crainte , fachant
» qu’en révélant ces chofes, ilrévéloit les fecrets des
»myfteres, fupplia Alexandre, qu’après les avoir
» communiqués à fa mere, il lui ordonnât de brûler
» fa lettre ». Saint Cyprien dit que la crainte du pouvoir
d’Alexandre extorqua de l’hiérophante le fecret
des hommes dieux.
Ces différens témoignages confirment de plus en
plus que les mylteres avoient été deftinés à découvrir
la fauffeté des divinités populaires , afin de fou-
tenir la religion des hommes de bon fens , & de les
exciter aufervice de leur patrie. Dans cette ancienne
inftitution imaginée par les hommes les plus fages &
les plus habiles, en enfeignant que les dieux étoient
des hommes déifiés à caule de leurs bienfaits envers
lafociété : rien n’étoit plus propre que l’hiftoire de
ces bienfaits à exciter le zèle à l’héroïfme. D ’un autre
côté, la découverte du véritable état de ces héros
fur la terre, qui avoient participé à toutes les foi-
bleffes de la nature humaine, pré venoit le mal qu’au-
roit pu produire l’hiftoire de leurs vices & de leurs
déréglemens ; hiftoire propre à faire accroire aux
hommes qu’ils étoient autorifés par l’ exemple des
dieux <i donner dans les mêmes excès. Si l’on fup-
pofe avec M. Pluche, que tous les dieux provenoient
d’un alphabet égyptien, quel motif peut-on fuppo-
fer dans les peuples , qui les ait entraînés vers l’idolâtrie
? Ils s’y feroient précipités, pour ainfi dire, de
gaieté de coeur, fans y avoir été déterminés, fans aucune
de ces pallions vives & véhémentes qui agiffent
également fur le coeur & fur l’efprit, qui accompagnent
toujours les grandes révolutions, & qui régnant
avec une force univerfelle dans le coeur de tous les
hommes, peuvent feules être envifagées comme la
caufe d’une pratique univerfelle. Mais que l’on fup-
pofe au contraire ce que toute l’antiquité nous apprend,
que les peuples ont adoré leurs ancêtres &:
leurs premiers rois , à caufe des bienfaits qu’ils en
avoient reçu, on ne peut alors concevoir un motif
plus puiffant ni plus capable de les avoir conduits à
l’idolâtrie ; &c de la forte l’hiftoire du genre humain
fe concilie avec la connoiflânce de la nature humain
e, & celle de l’effet des pallions.
Ce n’eft point unefimpîe conjecture que de croire
qu’une reconnoiffance fuperftitieufe fit regarder
comme des dieux les inventeurs des chofes utiles à
la fociété. Eufebe juge compétent, s’il y en eut jamais,
des fentimens de l’antiquité, attelle ce fait,
comme un fait notoire & certain. Ce favant évêque
dit, que ceux qui dans les premiers âges du monde
excellèrent par leur fageffe, leur force, ou leur valeur
, ou qui avoient le plus contribué au bien commun
des hommes , ou inventé, ou perfectionné les
Arts, furent déifiés durant leur vie même, ou immédiatement
après leur mort. C’eft ce qu’Eufebe avoit
lui-même puifé dans une des hiftoires des plus anciennes
& des plus relpeCtables, l’hiftoire phénicienne
ôcfanchoniate, qui donne un détail fort exaCt
de l’origine du culte des héros, & qui nous apprend
expreffément que leur déification le fit immédiatement
après leur mort, tems où le fou venir de leurs*
bienfaits étoit encore récent dans la mémoire des
hommes, & où les mouvemens d’une reconnoiffance
vive & profonde abforbant, pour ainfi dire, toutes
les facultés de leur ame, enflammoient les coeurs &
les efprits de cet amour & de cette admiration, que
M. Pope a fi parfaitement dépeint dans fon ejfai fur
l'homme.
Un mortel généreux, par fes foins , fa valeur,
Du public qu'il aimoit ,faifoit-il le bonheur ?
Adtniroit-on en lui les qualités aimables
Qui rehdent aux enfans les peres refpeclables ?
I l commandoit fur tous , il leur donnait la loi ,
E t le pere du peuple en devenoit le roi.
Jufqu a ce tems fatal, feul reconnu pour maître ,
Tout patriarche étoit le monarque, le prêtre,
Le pere de l'état qui fe formoit fous lui.
Ses peuples apres Dieu n avoient point d'autre appui.
Ses yeux étoient leur loi, [abouche leur oracle ,
Jamais fes volontés ne trouvèrent d'obflacle ;
De leur bonheur commun il devint l'infiniment,
Du jillon étonné tira leur aliment.
I l leur porta les Arts, leur apprit à réduire
Le feu , l'air, & les eaux aux lois de leur empire ,
Fit tomber à leurs piés les habitans des airs , ' ■
E t tira les poifions de l'abyme des mers.
Lorfqii enfin abattu fous le poids des années
I l s'éteint & finitfes longues deflinées ,
Cet homme comme un dieu f i long-tems honoré ,
Comme un foible mortel par les fiens efi pleuré.
Jaloux d'en conferver les traits & la figure ,
Leur tçelc indufirieux inventa la peinture.
Leurs neveux attentifs à ces hommes fameux
Qui par le droit du J'ang avoientrégné fur eux ,
Trouvent-ils dans leur fuite un grand, un premier
pere ,
Leur aveugle refpeci l'adore 6* le révéré.
Ces premiers fentimens antérieurs à l’idolâtrie,
en furent la première caufe par les paffions d’amour '
& d’admiration qu’ils excitèrent dans un peuple encore
fimple & ignorant. On ne doit pas être, étonné
qu’un peuple de ce caraCtere ait été porté à regarder
comme des efpec.es de d ieux, ceux qui avoient en-
feigné aux hommes à s’affujettir les élémens. Ils devinrent
le fujet de leurs hymnes , de leurs panégyriques
, & de leurs hommages ; & l’on peut obferver
que parmi toutes les nations, les hommes dont la
mémoire fut confacrée par un culte religieux, font
lçs feuls de ces tems anciens & ignorans, dont le
nom n’ait point été enfeveli dans l ’oubli.
On a vu dans destems poftérieurs, lorfque les cir-
confiances étoient femblables, des hommes parve,t
nir aux honneurs divins avec autant de facilite & de
fuçcès, que les anciens héros, qu’Ofiris,. Jupiter, ou
Bélus ; car la nature en général eft uniforme dans fes
démarches. On s’eft à la vérité moqué des apothéo-
fes d’Alexandre & de Céfar ; mais c’eft que les nations
au milieu defquelles ils vivoient, étoient trop
éclairées. Il n’en fut pas de même d’un Odin, quivi-
voit vers le tems de Çéfar, & qui fut mis par le peuple
du nord au-deffus de tous les autres dieux. C ’efi:
que ces peuples étoient encore barbares & fauva-
ges, & qu’une pareille farce ne peut être jouée avec
applaudiffement, que le lieu de la feene ne foit parmi
un peuple groflier & ignorant.
Tacite rapporte que e’étoit.june coutume générale
parmi les nations du nord, que de déifier leurs grands
hommes, non à la maniéré des Romains leurs contemporains,
uniquement par flatterie & par pèrfuafion
intime, mais férieufement & de bonne foi. Un trait
quife trouve dans Ezéchiel, confirme que l’apothéofe
fe faifoit fouvent du vivant même des rois. Ton coeur
s'en glorifie, dit Dieu en s’adreffant au roi de T y r
par la bouche de fon prophète, tu as dit, je fuis un
dieu , je fuis affis fur le trône de Dieu au milieu de la
mer, cependant tu n'es qu'un homme & non tin dieu....
Diras-tu encore que tu es un dieu ? . . . . Mais tu trouveras
que tu es tpi homme & non un dieu. Ce paffage indique,
ce me femble , que les fujets du roi de T y r
rendoient à ce prince un culte idolâtre , même durant
fa vie , & il eft allez vraiffemblable qu’il devint
dans la fuite un des Neptunes grecs.
Sous prétexte d’expliquer l’antiquité, M. Pluche
la renverfe & la détruit entièrement. Sa chimere eft
que toutes les coutumes civiles & religieufes de l’antiquité
font provenues de l’agriculture, & que les
dieux & les déeffes mêmes proviennent de cette
moiffon fertile: Mais s’il y a deux faits dans l’anti-
quité, que le fcepticifme même avoit honte, dans fes
momens de fincerité & de bon fens, de révoquer en
doute, c’eft que ce culte idolâtre des corps celeftes,
a eu pour premier fondement l’influence fenfible &
vifible qu’ils ont fur les corps fublunaires , & que les
dieux tutélaires des paffions payennes étoient des
hommes déifiés après leur mort, & à qui leurs bienfaits
envers le genre humain ou envers leurs concitoyens
avoient procuré les ' honneurs divins ; qui
croiroit que ces deux faits puiffent être niés par une
perfonne qui prétend à la connoiffance de l’antiquité
, & qui fe propofe de l’expliquer ? Mais ni les
hommes, ni les dieux ne peuvent tenir contre un
fyftème. M. Pluche nous affure que tout cela eft il-
lufion ; que l’antiquité n’a eu aucune connoiffance de
cette matière ; que les corps céleftes n’ont point été
adorés à caufe de leur influence ; qu’Ofiris, Ifis, Jupiter
, Pluton, Neptune, Mercure, que même les héros
demi-dieux, comme Hercule & Minos, n’ont jamais
exifté ; que ces prétendus dieux n’étoient que.
les lettres d’un ancien alphabet, de fimples figures
qui fervoient à donner des inftru&ions au laboureur
égyptien. Ses hiéroglyphes font prefqu’entierement
confinés à la feule agriculture & à l’ufage des calendriers
; ce qui fuppofe ou qu’ils n’ont point été defti-
nés dans leur origine à repréfenter les penfées des
hommes, fur quelques fujets qu’elles puflënt rouler>
ou que les foins de ces fameux perfonnages de l’antiquité
, qui ont établi, affermi & gouverné les fo-
cietés, étoient abforbés par l’agriculture, ou qu’ils
n’étoient occupés d’aucune autre idée. L’agriculture
, en un mot, eft la bafe principale & fondamentale
à ce fyftème de l’antiquité ; tout le refte n’y eft
inféré que pour l’ornement de la fcène. Ce fyftème,
que l’on peut regarder comme le débordement d’une
imagination féconde, eft lui-même comme l’ancienne
, dont les débprdemens du Nil couvroient les terres
les plus fertiles de l’Egypte ; & qui, échauffée
& mife en fermentation par les rayons puiffans du
foleil, produifoit des hommes & des monftres. Les
dieux de M. l’abbé Pluche paroiffent fortir des filions,
comme l’on dit qu’il eft autrefois arrivé au dieu
Tagès.
Mais comment prouve-t-il la jufteffe du principe
fur lequel il fonde fon fyftème, & la vérité des conr
fequences qu’il en déduit ? Il les prouve alternative--
ment l’un par l’autre, ce principe par la conféqüen-
c e , & la conféquence par le principe. Toutes les fois
qu’il veut prouver qu’un hiéroglyphe que l’on pre*;
noit pour la figure reelle d’un dieu, n’eft qu’un fym-
bolede l’agriculture, il fuppofe que ce ne peut être
la figure reelle d’un dieu, parce que les dieux n’ont
point exifté ; il en conclut que c’eft un fymbole ; il
lui plaît que ce foit un fymbole de l’agriculture ; &
lqrlqu’il veut prouver que les dieux n’ont point exil- ,
t é , alors il fuppofè que l’hiéroglyphe que l’on prer
noit pour la figuré réelle d’un dieu, n’étoit qu’un
fymbole de l'agriculture.
En général on peut dire contre le fyftème de M.
Pluche, qu il eft abfiirde de fuppofer que les Egyptiens
n’aient fait ufage des hiéroglyphes que pour les
chofes qui concernent le labourage. Il eft fort naturel
de croire , que l’efprit n’ayant pas encore inventé
des lignes qui ferviffent à repréfenter les fons & non
les chofes, les legiflateurs & les magiftrats auront été
obliges de puifer dans cette four.ee , c’eft-à-dire, de
recourir aux hiéroglyphes pour s’exprimer aux
yeux du peuple fur les matières relatives au culte religieux
, au gouvernement de la fociété, à Phiftoire
des héros , aux arts & aux fciences. Le genre d’ex-
prelfion étoit extrêmement imparfaite, & le fujet des
mepnfes infinies, toutes les fois qu’au défaut des
images réelles on étoit obligé d’employer des ima-
ges ifymboliques. Souvent on lubftituoit le fymbole
à 1 idee ; & c’eft ainfi qu’après s’être fervi de la figure
des animaux & des végétatifs, pour exprimer
les attributs des dieux & des héros, on a fubftitué à
ces dieux & à ces héros les animaux & les végétatifs
meme. On a cru que ces dieux les animoient, qu’ils
s etoient caches fous leur figure, & on les a adorés.
Ce progrès eft fenfible dans l’exemple d’Ofiris & d’A-
pis.
De ce qui n’étoit que l’origine d’une feule branche
de l’idolâtrie, M. Pluche en a voulu faire l’origine
de toute l’idolâtrie. Des images empruntées de
Ta diverfité des objets vifibles qui font fur la terre &
dans les d e u x , ne pouvant manquer d’avoir quelque
rapport avec les produÛions de l’agriculture,
qui font en même tems les effets de la fécondité de la
terre & de l’influence des aftres. De ce rapport M,
Pluche a conclu qu’il falloit expliquer les hiéroglyphes
relativement à l’agriculture ; & ce qui s’y trou-
voit fur les dieux, fur le gouvernement & fur l’hiftoire,
eft devenu dans fon efprit un infiniment ou une
inftruûionj>our le labourage. Il a employé les mo-
numens même de l’antiquité pour la détruire , comme
le pere Hardouin s’eft fervi de médailles pour
renverfer l’hiftoire. Ses conjectures ont pris la place
des faits, l’imagination a dégradé la vérité; & j’ofe-
rois dire qu’il ne feroit pas difficile, en conféquence
des mêmes principes, de prouver que les dieux d’Egypte,
au lieu de provenir de l’agriculture proviennent
des jeux de cette nation, de leurs fêtes , de leurs
combats, de leur maniéré de chaffer, de pêcher, &c
même fi l’on vouloit de leur cuifine, & les langues
orientales ne manqueroient pas de fournir des étimo-
logies pour foutenir ces différens fentimens.
L’idolâtrie ayant déifié les hommes, il étoit tout
naturel qu’elle communiquât à fes dieux les défauts
des hommes. C ’eft aufli ce qui arriva. Les dieux du
paganifme furent donc hommes en toutes maniérés ,
à cela près qu’ils étoient plus puiffans que des hommes.
Les hommes jouiffoient du plaifir fecret de voir
retracée dans de fi refpe&ables modèles l’image de
leurs propres pallions , & d’avoir pour fauteurs &
pour complices de leurs débauches, les dieux mê-
nies qu’ils adoroient. Sous le nom de fauffes divinités
, c’etoient en effet leurs propres penfées, leurs
plaifirs &: leurs fantaifies qu’ils adoroient. Ils adoroient
Vénus , parce qu’ils fe laiffoient dominer par
l’amour fenfuel, & qu’ils en aimoient la puiffance;
Ils érigeoient des autels, à Bacchus le plus enjoué dé
tous les dieux, parce qu’ils s’abandonnoient & qu’ils
fàcrifioient, pour ainfi dire, à la joie des fens plus
douce & plus enivrante que le vin. La manie de déifier
alla fi lo in q u ’on déifia même les villes, & Rome
fut confidérée comme une déeffe.
Le polythçjfme çonfidéré en lui-même, eft également
contraire à la raifon & aux phénomènes de l’univers.
Quand on a une fois admis l’exiftence d’une
nature infiniment parfaite, il eft facile de comprendre
qu’elle eft l’unique, & qu’aucun être ne- peut