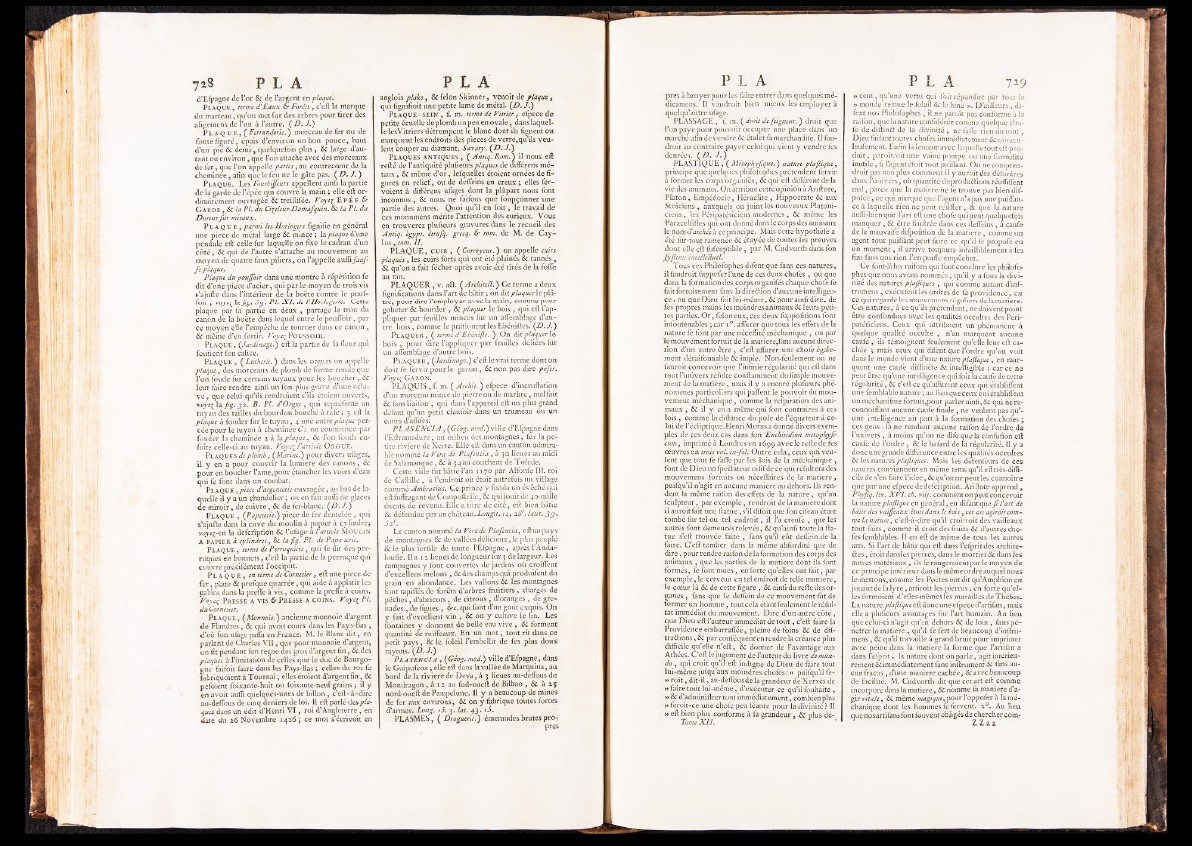
d’Efpagne de l’or & de l’argent en plaque'.
Pl a q u e , terme d’Eaux & Forêts, c’eft la marque
du marteau, qu’on met fur des arbres pour tirer des
aligemens de l’un à l’autre. ( D . J.)
P L A Q U E, ( Ferrandcrie. ) morceau de fer ou de
fonte figuré, épais d’environ un bon pouce, haut
d’un pié & demi, quelquefois plus, & large d’autant
ou environ, que l’on attache avec des morceaux
de fer, que l’on appelle pattes, au contrecoeur de la
cheminee, afin que le feu ne le gâte pas. ( D . J . )
P l a q u e . Les Fourbiffeurs appellent ainfi la partie
de la garde de l’épée qui couvre la main ; elle eft ordinairement
ouvragée & treillifée. Foye{ É P É E &
G a r d e 9&cla PI. du Ciseleur-Damafquin. & la PI. du
Doreur fur métaux.
P l a q u e , parmi les Horlogers fignifie en général
une piece de métal large & mince ; la plaque d’une
pendule eft celle fur laquelle on fixe le cadran d’un
cô té , & qui de l’autre s’attache au mouvement au
moyen de quatre faux piliers, on l’appelle aulïi fauf-
fe plaque.
Plaque du poujfoir dans une montre à répétition fe
dit d’une piece d’acier, qui par le moyen de trois vis
s’ajufte dans l’intérieur ae la boëte contre le pouf-
fo i r , voye^ la fig. 5$. PI. X I . de VHorlogerie. Cette
plaque par fa partie en deux , partage le trou du
canon de la boëte dans lequel entre le poulfoir, par
ce moyen elle l’empêche de tourner dans ce canon,
& même d’en fortir. Foye^ Po u s s o ir .
P la q u e , (Jardinage?) eft la partie de la fleur qui
foutient fon calice.
Pl a q u e , ( Lutherie. ) dans les orgues on appelle
plaque, des morceaux de plomb de forme ronde que
l’on foude fur certains tuyaux pour les boucher, êf
leur faire rendre ainfi un fon plus grave d’une o£la-
v e , que celui qu’ils rendroient s’ils étoient ouverts,
voyei la fig. 32. B. PI. d Orgue, qui repréfente un
tuyau des tailles du bourdon boucné à rafe ; 3 eft la
plaque à fouder fur le tuyau, 4 une autre plaque percée
pour le tuyau à cheminée C : on commence par
foud'er la cheminée 2 à la plaque, ôç l ’on foude en-
fuite celle-ci au tuyau. V?ye{ 1’artj.de O r g u e .
P l a q u e s de plomb, (Marine.) pour divers ufages,
il y en a pour couvrir la lumière des canons, &
pour en boucher l’ante,pour étancher les voies d’eau
qui fe font dans un combat.
Pl a q u e , piece d argenterie ouvragée, au bas de laquelle
il y a un chandelier ; on en fait auffi de glaces
de miroir, de cuivre, & de fer-blanc. (D . J.)
P l a q u e , (Papeterie.) piece de fer dentelée , qui
s’ajufte dans la cuve du moulin à papier à cylindre;
voyez-eti la defcription & l’ufage à üarticle Mo u l in
A PAPIER à cylindres, & la figi PI. de Pape terie.
PLAQUE, terme de Perruquiers, qui fe dit des perruques
en bonnets, c’eft la partie de la perruque qui
couvre précifément l’occiput.
P l a q u e , en terme de Cornetier, eft une piece de
fe r , plate & prefque quarrée, qui aide à applatir les
gabins dans la preffe à v is , comme la preffe à coins.
Foyei Pr e sse a v i s & Pr e sse a c o in s . Foyei PI.
du Cornetier.
P l a q u e , (Monnoi».) anciennemonnoie d’argent
de Flandres, & qui avoit cours dans les Pays-Bas,
d ’où fon ufaee paffa en France. M. le Blanc d it , en
parlant de Charles V I I , que pour monnoie d’argent,
on fit pendant fon régné des gros d’argent fin, & des
plaques à l’imitation de celles que le duc de Bourgogne
faifoit faire dans les Pays-Bas ; celles du roi fe
fabriquoient à Tournai ; elles étoient d’argent fin, &
pefoient foixante-huit ou foixante-neuf grains ; il y
en avoit auffi quelques-unes de billon , c’eft-à-dire
au-deffous de cinq deniers de loi. Il eft parlé des plaques
dans un édit d’Henri V I , roi d’Angleterre, en
date du 26 Novembre 1426 ; ce mot s’écrivoit en
anglois plafce, & félon Skinner, ven,oit de plaqué ,
qui fignifioit une petite lame de métal. (D . J.)
Pl a q u e - s e in , f. m. terme de Vitrier, efpece de
petite écuelle de plomb un peu en ovale, dans laquelle
lesVitriers détrempent le blanc dont ils lignent ou
marquent les endroits des pièces de verre,qu’ils veulent
couper au diamant. Savary. (D . J .)
Pl a q u e s a n t iq u e s , ( Antiq. Rom.) il nous eft
refté de l’antiquité plufieurs plaques de différens métaux
, & même d’o r , lefquelles étoient ornées de figures
en relief, ou de deffeins en creux ; elles fer-
voient à différens ufages dont la plûpart nous font
inconnus , & nous ne faifons que foupçonner une
partie des autres. Quoi qu’il en fo i t , le travail de
ces monumens mérite l’attention des curieux. Vous
en trouverez plufieurs gravures dans le recueil des
Antiq. ègypt. étrufq. grecq. & rom. de M. de Cay-
■ lus, tom. II.
PLAQUÉ, c u ir , ( Corroyeur. ) on appelle cuirs
plaqués, les cuirs forts qui ont été plainés & tannés ,
& qu’on a fait fécher après avoir été tirés de la foffe
ail tan.
PLAQUER, v. a£t. ( Architect. ) Ce terme a deux
fignifieations dans l’art de bâtir ; on dit plaquer le plâtre,
pour dire l’employer avec la main, comme pour
gobeter & hourder , & plaquer le bois , qui eft l’appliquer
par feuilles minces fur un affemblage d’autre
bois, comme le pratiquent les Ebéniftes. (D . J.)
Pl a q u e r , ( terme d'E béni fie. ) On dit plaquer le
bois , pour dire l’appliquer par feuilles déliées fur
lin affemblage d’autre bois.
Pl a q u e r , (Jardinage.) c’eft le vrai terme dont on
doit fe fervir pour le gazon , Sinon pas dire pofer..
Voye^ G a z o n .
PLAQUIS , f. m. ( Archit. ) efpece d’incmftation
d’un morceau mince de pierre ou de marbre, mal fait
& fans liaifon , qui dans l’appareil eft un plus grand
défaut qu’un petit claufoir dans un trumeau ou un
cours d’affifes.
P LA S EN C IA , (Géog. mod.) ville d’Efpagne dans
l’Eftramadure, au milieu des montagnes, fur la petite
riviere de Xerte. Elle eft dans un canton admirable
nommé la Fera de Plafencia, à 30 lieues au midi
de Salamanque, & à 3 4 au couchant de Tolede.
Cette ville fut bâtie l’an 1170 par Alfonfe III. roi
de Caftille , à l’endroit où étoit autrefois un village
nommé Ambracius. Ce prince y fonda un évêché qui
eftfuffragant de Compoftelle, & qui jouit de 40 mille
ducats de revenu. Elle a titre de cité, eft bien bâtie
& défendue par un château. Longit. 12.28'. latit. Je/.
S d.L
e canton nommé la Fera de Plafencia, eft un pays
l de montagnes & de vallées délicieux, le plus peuplé
& le plus fertile de toute l’Efpagne, après TA ncla-
loufie. Il a 12 lieues de longueur fur 3 de largeur. Les
campagnes y font couvertes de jardins où croiffent
d’exceflens melons , &des champs qui produifent du
grain en abondance. Les vallons & les montagnes
font tapiffés de forêts d’arbres fruitiers, chargés de
pêches, d’abricots, de citrons, d’oranges , de grenades
, de figues , & c- qui f ° nt d’un goût exquis. On
y fait d’excellent vin , & on; y cultive le lin. Les
fontaines y donnent de belle eau vive , & forment
quantité de ruiffçaux. En un mot, tout rit dans ce
petit pa ys, & le foleil l’ embellit de fes plus doux
rayons. (D . J.)
Pl a s e n c ia f (Géog. mod.) ville d’Efpagne, dans
le Guipufcoa ; elle eft dans la vallée de Marquina, au
bord de la riviere de Deya, à 3 lieues au-deffous de
Mondragon, à 12 au fud-oueft de Bilbao , & à 25
nord-oueft de Pampelune. Il y a beaucoup de mines
de fer aux environs, & on y fabrique toutes fortes
d’armes. Long. iS. 3. lat. 43. iS.
PLASMES, (Droguerie.) émeraudes brutes pro7
' près
près à broyer pour les faire entrer dans quelques mé-
dicamens. Il vaudroit bien mieux les employer à
quelqu’autre ufage.
PLASSAGE , f. m. ( droit de feigneur. ) droit que
l’on paye pour pouvoir occuper une place dans un
marche afin de vendre S i étaler fa marchandilè. Il fau-
droit au contraire payer celui qui vient y vendré fes
denrées. (D . J .)
PLASTIQUE , ( Métaphyjîque. ) nature plafiique,
principe que quelques philofophes prétendent fervir
a former les corps organifés, & qui eft différent de la
vie des animaux. On attribue cette opinion à Ariftote,
Platon, Empédocle, Héraclite , Hippocrate & aux
Stoïciens , auxquels on joint les nouveaux Platoniciens
, les Péripatéticiens modernes, Si même les
Paracelfiftes qui ont donné dans le corps des animaux
le nom d archée à ce principe. Mais cette hypothèfe a
été fur-tout ramenée & étayée de toutes les preuves
dont elle eft fufceptible , par M. Cudvorth dans fon
fyfleme intellectuel.
Tous ces Philofophes difent que fans ces natures,
ilfaudroit fuppofer l’une de ces deux chofes , ou que
dans la formation des corps organifés chaque chofe fe
fait fortuitement fans ladireétion d’aucune intelligenc
e , ou que Dieu fait lui-même, & pour ainfi dire, de
fes propres mains les moindres animaux & leurs petites
parties. O r, félon eux, ces deux fuppofitions font
infoutenables ; car 1 °. affurer que tous les effets de la
nature fe font par une néceffite méchanique , ou par
le mouvement fortuit de la matière,fans aucune direction
d’un autre être , c’eft affurer une chofe également
déraifonnable & impie. Non-feulement on ne
fauroit concevoir que l’infinie régularité qui eft dans
tout l’univers réfulte conftamment du fimple mouvement
de la matière, mais il y a encore plufieurs phénomènes
particuliers qui paffent le pouvoir du mouvement
méchanique, comme la refpiration des animaux
, & il y en a même qui font contraires à ces
lo is , comme la diftance du pôle de l’équateur à celui
de l’écliptique.Henri Morus a donné divers exemples
de ces deux cas dans fon Enchiridion metaphyfi-
cum, imprimé à Londres en 1699 avec le reftede les
oeuvres en trois vol. in-fol. Outre cela, ceux qui veulent
que tout fe faffe par les lois de la méchanique ,
font de Dieu un fpeftateur oififde ce qui réfultera des
mouvemens fortuits ou néceffaires de la matière ,
puifqu’il n’agit en aucune maniéré au dehors. Ils rendent
la même raifon des effets de la nature , qu’un
fculpteur, par exemple, rendroit de la maniéré dont
il auroitfait une ftatue, s’il difoit que fon cifeau étant
tombé fur tel ou tel endroit, il l’a creufé , que les
autres font demeurés relevés, & qu’ainfi toute la fta-
fue s’eft trouvée faite , fans qu’il eût deffein de la
faire. C ’eft tomber dans la même abfürdité que de
dire, pour rendre raifon de la formation des corps des
animaux, que les parties de la matière dont ils font
formés, fe font mues, en forte qu’elles ont fait, par
exemple, le cerveau en tel endroit de telle maniéré,
' le coeur là & de cette figure , & ainfi du refte des organes
, fans que le deffein de ce mouvement fut de
former un homme, tout cela étant feulement le réfül-
tat immédiat du mouvement. Dire d’un autre cô té,
que Dieu eft l’auteur immédiat de tou t, c’eft faire la
Providence embarraffée, pleine de foins & de dif-
traftions, & par conféquènt en rendre la créance plus
difficile qu’elle n’eft, & donner de l’avantage aux
Athées. C ’eft le jugement de l’auteur du livre demun-
do , qui croit qu’il eft indigne de Dieu de faire tout
lui-même jufqü’aux moindres chofes: « puifqu’ilfe-
» ro it, dit-il, âu-deffous de la grandeur de Xerxès de
» faire tout lui-même, d’exécuter ce qu’il fouhaite ,
» & d’adminiftrer tout immédiatement, combien plus ;
»feroit-ce une chofe peu féante pour la divinité? Il
» eft bien plus conforme à fa grapdeur , & plus dé-
Tome X I I .
>» cent, qu’une vertu qui foit répandue par tout le
» monde remue le foleil & h lune ». D ’ailleurs difent
nos Philofophes , il ne paroît pas conforme à la
raifon, que la nature confidérée comme quelque chofe
de diftinft de la divinité, ne faffe rien du tou t,
Dieufaifanttoutes chofes immédiatement & miracu-
leufement. Enfin la lenteur avec laquelle tout eft produit
, paroïtroit une vaine pompé ou une formalité
inutile, fi l’agent étoit tout puiffant. On ne compren-
droit pas non plus comment il y auroit des défordres
dans l’univers, où quantité de productions réuffiffent
mal, parce que la inatiere ne fe trouve pas bien dif-
pofée, ce qui marque que l’agent n’a pas une puiffan-
ce à laquelle rien ne peut réfifter, & que la nature
auffi-bienque Part eft une chofe qui peut quelquefois
manquer, & être fruftrée dans ces deffeins, à caufe
de la mauvaife difpofition de la matière , comme un
agent tout puiffant peut faire ce qu’il fe propofe en
un moment, il'arrive toujours infailliblement à fes
fins fans que rien l’en puiffe empêcher.
Ce font-là les raifons qui font conclure les philofophes
que nous avons nommés, qu’il y a fous la divinité
des natures plafiiques , qui comme autant d’infi-
trumens , exécutent les ordres de fa providence , en
ce qui regarde les mouvemens réguliers de la matière.
Ces natures, à ce qu’ils prétendent, ne doivent point
être confondues avec les qualités occultes des Péripatéticiens.
Ceux qui attribuent un phénomène à
quelque qualité occulte , n’en marquent aucune
caufe , ils témoignent feulement qu’elle leur eft cachée
; mais ceux qui difent que l’ordre qu’on voit
dans le monde vient d’une nature plafiique , en marquent
une caufe diftinûe & intelligible ; car ce ne
peut être qu’une intelligence qui foit la caufe de cette
régularité, & c’eft ce qu’affurent eeux qui établiffent
une femblable nature ; au lieu que ceux qui établiffent
un méchanifme fortuit,pour parler ainfi, & qui nere-
connoiffant aucune caufe finale , ne veulent pas qu’une
intelligence ait part à la formation des chofes ;
ces gens - là ne rendent aucune raifon de l’ordre de
l’univers, à moins qu’on ne dife que la confiifion eft
caufe de l’ordre, & le hafard de la régularité. Il y a
donc une grande différence entre les qualités occultes
& les natures plafiiques. Mais les defenfeurs de ces
natures conviennent en même tems qu’il eft très-difficile
de s’en faire l’idée, & qu’on ne peut les connoître
que par une efpece de defcription. Ariftote apprend ,
Phyjîq.liv. X F I . ch. viij. comment on peut concevoir
la nature plafiique en général, en difant que J i l ’art de
bâtir des vaiffeaux étoit dans le bois , cet art agiroit comme
la nature, c ’eft-à-dire qu’il croîtroit des vaiffeaux
tout faits, comme il croît des fruits & d’autres chofes
femblables. Il en eft de même de tous les autres
arts. Si l’art de bâtir qui eft dans l’efprit des archite-
éles, étoit dans les pierres, dans le mortier & dans les
autres matériaux, ils fe rangeroientpar le moyen de
ce principe intérieur dans le même ordre auquel nous
le mettons, comme les Poètes ont dit qu’Amphion en
jouant de la ly re , attiroit les pierres, en forte qu’elles
formoient d’elles-mêmes les murailles de Thèbes.
La nature plafiique eft donc une efpece d’artifan, mais
elle a plufieurs avantages fur l’art humain. Au lieu
que celui-ci n’agit qu’en dehors & de loin , fans pénétrer
la matière , qu’il fe fert de beaucoup d’ifp iu -
mens, & qu’il travaille à grand bruit pour imprimer
avec peine dans la matière la forme que l’artifan a
dans l’efprit, la nature dont on parle, agit intérieu-
rement&immédiatementfans infiniment & fans aucun
fracas , d’une maniéré cachée, & avec beaucoup
de facilité. M. Cudvorth dit que cet art eft comme
incorporé dans la matière, & nomme fa maniéré d’agir
vitale, & même magique, pour l’oppofer à la méchanique
dont les hommes fe fervent. 20. Au lieu
que nosartifans font fouvent obligés de chercher com