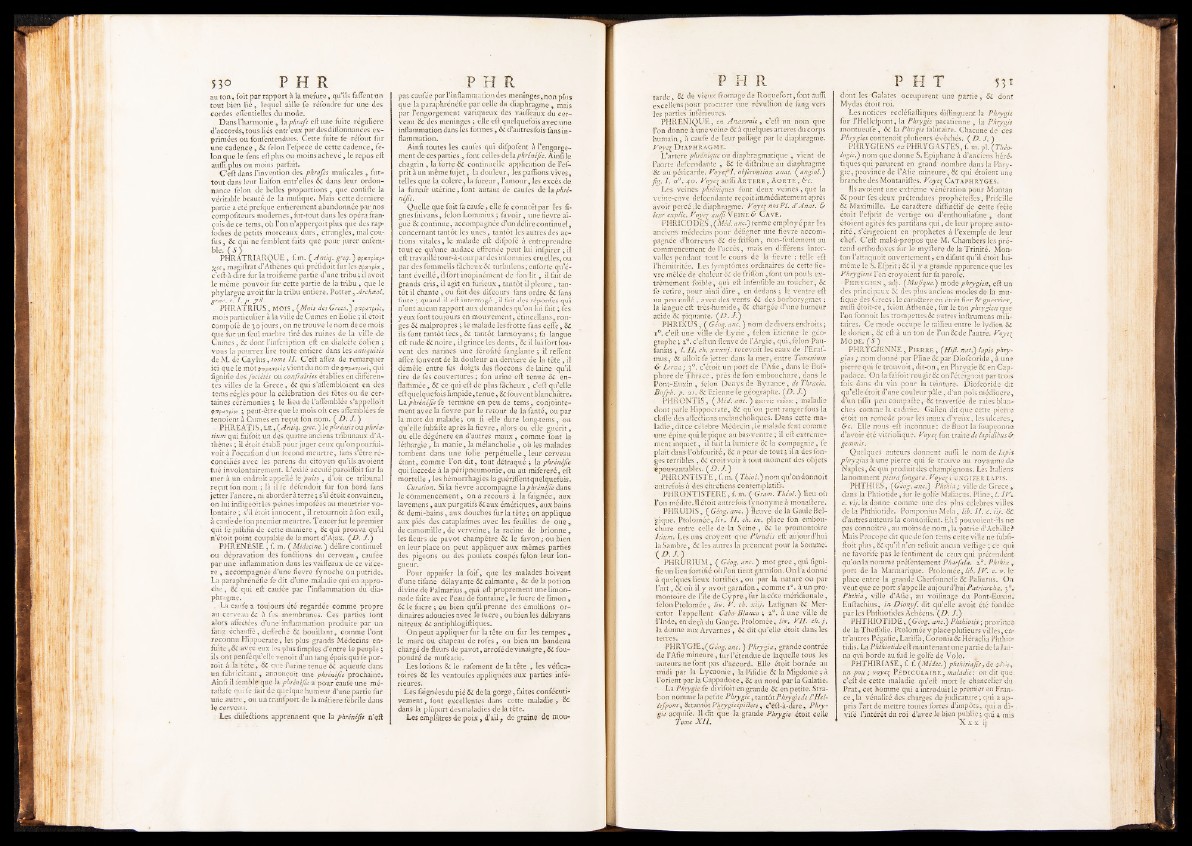
53° P H R
au ton, foit par rapport à la mefure, qu’ ils faflent un
tout bien lie , lequel aille fe réfoudre fur une des
cordes efîentielles du mode.
Dans l’harmonie , la phrafe eft une fuite régulière
d’accords, tous liés entr’eux par des diflonnances exprimées
ou foufentendues. Cette fuite fe réfout fur
une cadence, 6c félon l’efpece de cette cadence, félon
que le fens eft plus ou moins achevé, le repos eft
aufli plus ou moins parfait.
C ’eft dans l’invention des phrafes muficales , fur-
tout dans leur liaifon entr’elles 6c dans leur ordonnance
félon de belles proportions , que confifte la
véritable beauté de la mufique. Mais cette derniere
partie a été prefque entièrement abandonnée par nos
çompofiteurs modernes, fur-tout dans les opéra fran-
çois de ce tems, où l’on n’apperçoit plus que des rap-
fodies de petits morceaux durs, étrangles, malcou-
fus, 6c qui ne femblent faits que pour jurer enfem-
ble. ( S )
PHRATRIARQUE, f.m. ( Antiq•. greq. ) ipparpiap-
%eç, magiftrat d’Athènes qui préfidoit fur les opa.Tplu,
ç’eft-à dire fur la troifieme partie d’une tribu ; il avoit
le même pouvoir fur cette partie de la tribu, que le
phylargue avoit fur la tribu entière. Potter, Arckxol.
grac.t. I .p .y S .
. PHRATRIUS, MOIS, (Mois des Grecs.) <pvp*rpoV,
mois particulier à la ville de Cumes en EoÜe ; il étoit
compofé de 3 o jours, on ne trouve le nom de ce mois
que fur un feul marbre tiré des ruines de la ville de
Cumes, & dont l’infcription eft en dialeôe éolien ;
vous la pourrez lire toute entière dans les antiquités
de M. de Caylus, tome II. C’eft affez de remarquer
ici que le mot prpuTpios vient du nom de <pwparpiaî, qui
lignifie des fociétés ou confrairies établies en differentes
villes de la Grece, 6c qui s’affembloient en des
tems réglés pour la célébration des fêtes ou de certaines
cérémonies ; le lieu de l’aflemblée s’appelloit
<P7rpct7piov ; peut-être que le mois oii ces afîemblées fe
tenoient à Cumes en reçut fon nom. ( D . J. )
PHRÉ ATI S , LE, {Antiq. grec.) le phréatis ou phréa-
tium qui faifoit un des.quatre anciens tribunaux d’Athènes
; il étoit établi pour juger ceux qu’on pourfui-
voit à l’occafion d’un fécond meurtre, fans s’être réconciliés
avec les parens du citoyen qu’ils avoient
tué involontairement. L’exilé accufé paroiffoit fur la
mer à un endroit appelié le puits , d’où ce tribunal
reçut fon nom ; là il fe défendoit fur fon bord fans
jetter l’ancre, ni aborder à terre ; s’il étoit convaincu,
on lui'infligeoit les peines impofées au meurtrier volontaire
; s’il étoit innocent, il retournoit à fon exil,
à caufe de fon premier meurtre. Teucer fut le premier
qui fe juftifia de cette maniéré , 6c qui prouva qu’il
n’étoit point coupable de la mort d’Ajax. (D . J.)
PHRÉNÉSIE , f. m. {Médecine.) délire continuel
ou dépravation des fondions du cerveau, caufée
par une inflammation dans les vaiffeaux de ce vifee-
re , accompagnée d’une fievre fynoche ou putride.
La paraphrénélie fe dit d’une maladie qui en approche
, 6c qui eft caufée par l’inflammation du diaphragme.
- La caufe a toujours été regardée comme propre
au cerveau & à fes membranes. Ces parties font
alors affectées d’une inflammation produite par un
fang échauffé, defleché 6c bouillant, comme l’ont
reconnu Hippocrate, les plus grands Médecins en-
fuite ,& avec eux les plus Amples d’entre le peuple ;
ils ont penfé qu’elle venoit d’un fang épais qui fe por-
toit à.la tê te , 6c que l’urine tenue 6c aqueufe dans
un fébricitant, annonçoit une phrénéjie prochaine.
Ainft il femble’que la phrénéjie a pour caufe une mé-
taftafe qui fe fait de quelque humeur d’une partie fur
urt e autre , ou un tranfport de la mâtiere fébrile dans
le cerveau.
Les diftedions apprennent que la phrénéjie n’eft
P H R
pas caufée par l’inflammation des méningés,non plus
que la paraphrénélie par celle du diaphragme , mais
par l’engorgement variqueux des vaiffeaux du cerveau
6c des méningés ; elle eft quelquefois avec une
inflammation dans les formes, 6c d’autres fois fans inflammation.
Ainfi toutes les caufes qui difpofent à l’ engorgement
de ces parties * font celles delà phrénéjie. Ainfi le
chagrin , la forte 6c continuelle application de l’ef-
prit à un même fujet, la douleur, les pallions vives,
telles que la colere, la fureur, l’amour, les excès de
la fureur utérine, font autant de caufes de la phrénéjie.
Quelle que foit fa caufe, elle fe cônnoît par les lignes
fuivans, félon Lommius,; fa v o ir , une fievre aiguë
& continue, accompagnée d’un délire continuel,
concernant tantôt les unes, tantôt les autres des actions
vitales, le malade eft difpofé à entreprendre
tout ce qu’une audace effrenée peut lui infpirer ; il
eft travaillétour-à-tourpardesinfomnies cruelles, ou
par des fommeils fâcheux & turbulens; enfôrte qu’étant
éveillé, il fort inopinément de fon l i t , il fait de
grands cris, il agit en furieux, tantôt il pleure, tantôt
il chante , ou fait des difeours fans ordre 6c fans
fuite ; quand il eft interrogé , il fait des réponfes qui
n’ont aucun rapport aux demandes qu’on lui fait ; les
yeux font toujours en mouvement, étincellans, rouges
6c malpropres ; le malade les frotte fans ceflè, &
ils font tantôt fecs, 6c tantôt larmoyans ; fa langue
eft rude 6c noire, il grince les dents, & il lui fort fou-
vent des narines une férofité fanglante ; il reffent
affez fouvent de la douleur au derrière de la tête , il
démêle entre fes doigts des floccons de laine qu’il
tire de fes couvertures ; fon urine eft tenue 6c en-
flaftimée, & ce qui eft de plus fâcheux , c’eft qu’elle
eft quelquefois limpide,tenue, & fouvent blanchâtre.
La phrénéjie fe termine en peu de tems, conjointement
avec la fievre par le retour de la fanté, ou par
la mort du malade ; ou fi elle dure long-tems, ou
qu’elle fubfifte après la fievre, alors ou elle guérit,
ou elle dégénéré en d’autres maux, comme font la
léthargie, la manie, la mélancholie , oîi les malades
tombent dans une folie perpétuelle, leur cerveau
étant, comme l’on dit, tout détraqué ; la phrénéjie
qui fuccede à la péripneumonie, ou au mifereré, eft
mortelle > les hémorrhagies la guériffentquelquefois.
Curation. Si la fievre accompagne la phrénejie dans
le commencement, on a recours à la faignée, aux
lavemens, aux purgatifs 6c aux émétiques, aux bains
6c demi-bains, aux douches fur la tête ; on applique
aux piés des cataplafmes avec les feuilles de o u e ,
de camomille, de verveine j la racine de brionne ,
les fleurs de pavot champêtre & le favon ; ou bien
en leur place on peut appliquer aux mêmes parties
des pigeons ou des poulets coupés félon leur longueur.
Pour appaifer la foif, que les malades boivent
d’une tifane délayante & calmante, 6c de la potion
divine de Palmarius , qui eft proprement une limon-
nade faite avec l’eau de fontaine, le fucre de limon ,
6c le fucre ; ou bien qu’il prenne des émulfions ordinaires
adoucies avec le lucre, ou bien les délayans
nitreux 6c antiphlogiftiques.
On peut appliquer fur la tête ou fur les tempes ,
le marc ou chapeau de rofes, ou bien un bandeau
chargé de fleurs de pavot, arrofé de vinaigre, 6c fou-
poudré de mufeade.
Les lotions 6c le rafement de la tête , les véfica-
toires & les ventoufes appliquées aux parties inférieures.
Les faignées du pié & de la gorge, faites confécuti-
vement, font excellentes dans cette maladie , 6c
dans la plupart des maladies de la tête.
L e s em p lâ t r e s d e p o i x , d’ a i l , d e g r a in e d e m o u -
P H R
tarde, 6c de vieux fromage de Roquefort, font aufli
excellens pour procurer une révulîion de fang vers
les parties inférieures.
PHRÉNIQUE, en Anatomie, c’eft un nom que
l’on donne à une veine & à quelques arteres du corps
humain, à caufe de leur paffage par le diaphragme.
)7oye{ D i a p h r a g m e .
L’artere phrénique ou diaphragmatique , vient de
l’aorte defeendante , 6c fe diftribue au diaphragme
6c au péricarde. Voye£ I.obJ'ervntion anat. { angiol.)
Jig. I. n°. 40. Voye^ aufli A r t e r e , A o r t e , &c.
Les veines phréniques font deux veines , que la
veine-cave defeendante reçoit immédiatement après
avoir percé île diaphragme. Voye^nosPl. d'Anat. &
leur explic. Voye^ aujjî V e in e & C a v e .
PHRICODÈS, (Méd. anc.) terme employé par les
anciens médecins pour défigner une fievre accompagnée
d’horreurs 6c de frilfon, non-feulement au
commencement de l’accès, mais en différens intervalles
pendant tout le cours de la fievre : telle eft
Phémitritée. Les fymptômes .ordinaires de cette fievre
mêlée de chaleur 6c de friflon, font un pouls extrêmement
foible, qui eft infenfible au toucher, 6c
fe retire, pour ainfi dire , en dedans ; le ventre eft
un peu enflé, avec des vents & des borborygmes ;
la langue eft très-humide, 6c chargée d’une humeur
acide 6c piquante. (D . J.)
PHRIXUS, ( Géog. anc. ) nom de divers endroits ;
i° . c’eft une ville de Lycie , félon Etienne le géographe
; i° . c’eft un fleuve de l’Argie, qui, félon Pau-
ianias, l. II. ch. xxxvj. recevoit les eaux de l’Eraf-
mus, & ailoitfe jetter dans la mer, entre Temenium
& Lerna;. 30. c’étoit un port de l’Afie, dans le Bof-
phore de Thrace, près de fon embouchure, dans le
Pont-Euxin , félon Denys de Byzance, de Thracic.
Bojph. p. 21. 6c Etienne le géographe. (D . J.) •
PHRONTIS, (Méd. anc. ) opoiriç voucos, maladie
dont parle Hippocrate, 6c qu’on peut ranger fous la
clafle dés affe&ions mélancholiques. Dans cette maladie,
dit ce célébré Médecin,le maladefent comme
une épine qui le pique au bas-ventre ; il eft extrêmement
inquiet, il fuit la lumière 6c la compagnie, fe
plaît dans l’obfcurifé, 6c a peur de tout ; il a des fondes
terribles , 6c croit voir à tout moment des objets
épouvantables. (Z*. J .)
PHRONTISTE, f. m. ( Théol.) nom qu’ondonnoit
•autrefois à des chrétiens contemplatifs.
PHRONTISTERE, f. m. ( Gram. Théol.) lieu oii
l’on médite. Il étoit autrefois lÿnonyme à monafteré.
PHRUDIS, {Géog. anc. ) fleuve de la Gaule Belgique.
Ptolomée, AV. II. ch. ix. place fon embouchure
entre celle de la Seine , 6c le promontoire
itium; Les uns croÿent que Phrudis eft aujourd’hui
la Sambre, 6c les autres la prennent pour la Somme".
( D J )
■ PHRURIUM, ( Géog. anc. ) mot grec, qui lignifie
un lieu fortifié où l’on tient garnifon. On l ’a donné
à quelques lieux fortifiés , ou par la nature ou par
l’a r t , 6c où il y avoit garnifon, comme i°. à un promontoire
de l’ile deCypre-, fur la côte méridionale,
félon Ptolomée j Av. V. ch. xiij. Lulignan 6c Mer-
cator l’appellent Cabo Blanco ; z°. a une ville de
l’Inde, en deçà du Gange. Ptolomée, AV. VII. ch.j.
la donne aux Arvarnes , 6c dit qu’elle étoit dans les
terres.-
PHRYGIE jGéog.anc. ) Phrygia, grande contrée
de l’Afie mineure, fur l’étendue de laquelle tous les
auteurs ne font pas d’accord. Elle étoit bornée au
-midi par la Lycaonie, la Pifidie 6c la Migdonie ; à
l’orient par la Cappadoce, 6c au nord par la Galatie.
• La Phrygie fe divifoit en grande 6c en petite. Stra-
bon nomme la petite Phrygie, tantôt Phrygie de l'Hel-
lefpont^ &tantôt Phrygieépiciete, c’ëft-à-dire, Phrygie
acquife. Il dit que la grande Phrygie étoit celle
Tome X I I .
P H T 53*
dont les Galates occupèrent une partie, 6c dont
Mydas étoit roi.
Les notices eccléfiaftiques diftinguent la Phrygie
fur l’Hellefpont, la Phrygie pacatienne , la Phrygie
montueufe , 6c la Phrigie falutaire. Chacune de ces
Phrygies contenoit plufieurs évêchés. (D . J .)
PHRYGIENS ouPHRYGASTES, f. m. pl. (Théo*
logie.) nom que donne S. Epiphane à d’anciens héré*
tiques qui parurent en grand nombre dans la Phrygie,
province de l’Afie mineure, 6c qui étoient une
branchedes Montaniftes. Voye^G a t a p h r y g e s .
Ils avoient une extrême vénération pour Montan
6c pour fes deux prétendues prophétefles, Prifcille
6c Maximille. Le caraftere aiftin&if de cette fefte
étoit l’efprit de vertige ou d’enthoufiafme , dont
étoient agités fes partilans qui, de leur propre autorité
, s’érigeoient en prophètes à l’exemple de leur
chef. C’eft mal-à-j)ropos que M. Chambersles prétend
orthodoxes fur le myftere de la Trinités Montan
l’attaquoit ouvertement, en difant qu’il étoit lui-
même le S. Efprit ; 6C il y a grande apparence que les
Phrygiens l’ en croyoient fur fa parole.
P h r y g i e n , adj. {Mujique.) mode phrygien, eft un
des principaux 6c des-plus anciens modes de la mufique
des Grecs ; le carafrere en étoit fier 6c guerrier,
aufli étoit-ce, félon Athenée, fur le ton phrygienmie
l’on fonnoit les trompettes 6c autres inftrumens militaires.
Ce mode occupe le milieu entre le lydien 6c
le dorien, & eft à un ton de l’un & de l’autre. Voyeç
M o d e . ( S )
PHRYGIENNE, P i e r r e , (Hijl. nat.) lapis phry-
gius ; nom donné par Pline 6c par Diofcoride, à une
pierre qui fe trouvoit, dit-on, en Phrygie 6c en Gap-
padoce. On la faifoit rougir & on l’éteignoit par trois
fois dans du vin pour la teinture. Diofcoride' dit
qu’elle étoit d’une couleur pâle, d’un pois médiocre,
d’un tiffu peu compafte, 6c traverfée de raies blanches
comme la cadmie. Galien dit que cette pierre
étoit un remede pour les maux d’y eu x, les ulcérés,
&c. Elle nous eft inconnue : de Boot là foupçonne
d’avoir été vitriolique. V?ye^ fon traité de lapidibus <S*
gemmis.
Quelques auteurs donnent aufli le nom de lapis
plirygius à une pierre qui fe trouve au royaume de
Naples, & qui produit des champignons. Les Italiens
lanomment pietrafongara. /'Vye^ F uN G iFER l a p i s . .
PHTHIES, (Géog. anc.) Phthia; ville de Grece,
dans la Phtiotide, fur le golfe Maliacus. Pline, A
c. vij. la donne comme une des plus célébrés villes
de la Phthiotidè. Pomponius Mêla, lib. II. c. iij. 6c
d’autres auteurs la connoiflent. Eh ! pouvoient-ils ne
pas connoître, au moins de nom, la patrie d’Achille?
Mais Procope dit que de fon tems cette ville ne fubfi-
ftoit plus, 6c qu’il n’en reftoit aucun veftige ; ce qui
ne favorife pas le fentiment de ceux qui prête ndent-
qu’onla nomme préfenteraent Pharfala. z°. Phthia,
port de la Marmarique. Ptolomée, lib. IV. c. v. le:
place entre la grande Cherfonnefe 6c Paliurus. On
veut que ce port s’appelle aujourd’hui Patriarchaf 3°.-
Phthia, ville d’Afie, au voifinage du Pont-Euxin.
Euftachius, in Dionyf. dit qu’elle avoit été fondée
par les Phthiotides Achéens. (D. J.)
PHTHIOTIDE, (Géog. anc.) Phthiotis ; province
de laTheflalie. Ptolomée y place plufieurs villes, en-
tr’autres Pégafie, Larifla, Coronia & Héraclia Phthio-
tidis. La Phthiotidè eft maintenant une partie de la Jau-
na qui borde au fud le golfe de Volo. «
PHTHIRIASE, f. f.(Médec.) phthiriajis, de
un pou; voye{ P é d i c u l a i r e , maladie: on dit que.
C’eft de cette maladie qu’eft mort le chancelier du
Prat, cet homme qui a introduit le premier en France
, la vénalité des charges de judicature ; qui a appris
l’art de mettre toutes fortes d’impôts, qui a di-
vifé l’intérêt du roi d’avec le bien public ; qui a mis