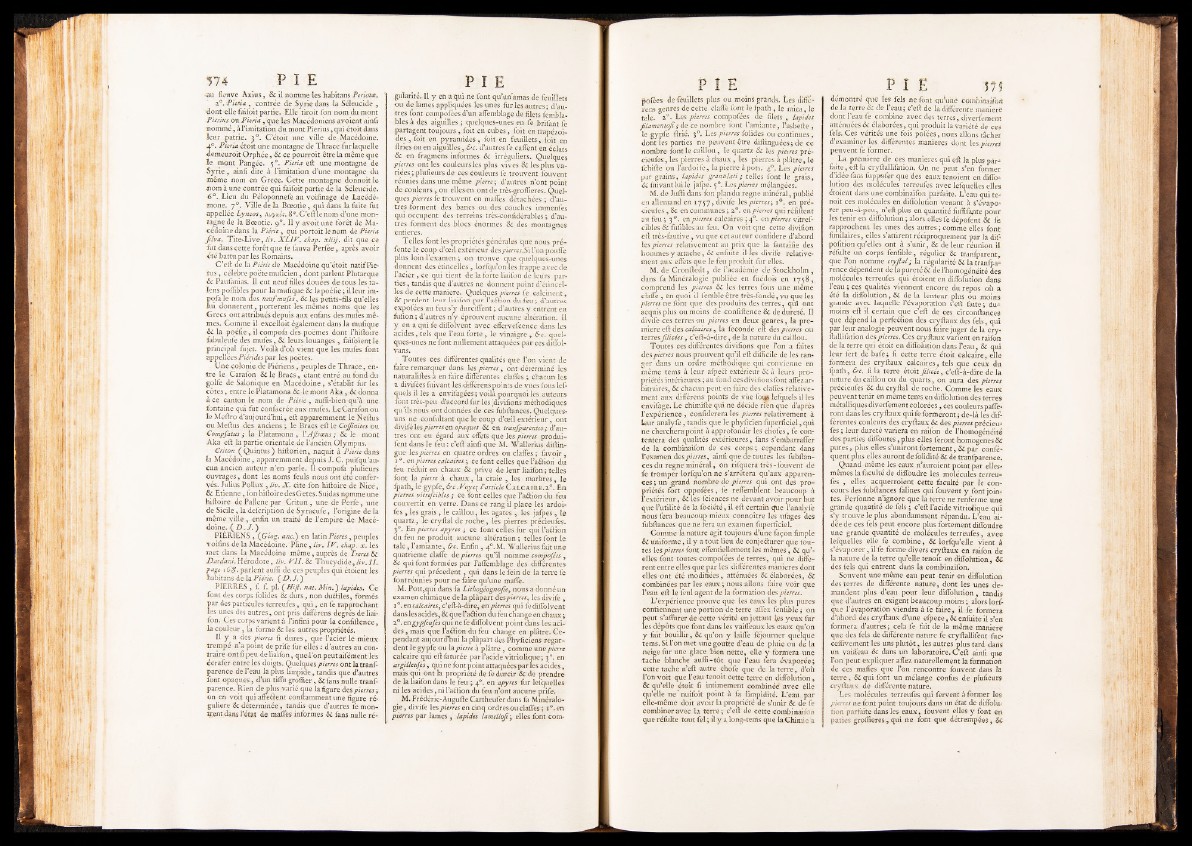
-ail fleuve Âxius, & il nomme les habitans Periotoe.
a0. Pieria , 'contrée de Syrie dans la Séleucide ,
dont elle faifoit partie. Elle tiroit fon nom du mont
Pieriuson Pieria , que les Macédoniens avoient ainfi
nommé, à l’imitation du mont Pierius ,qui étoit dans
leur patrie. 30. C’étoit une ville de Macédoine.
4°. Pieria étoit une montagne de Thrace fur laquelle
demeurait Orphée, & ce pourroit être la même que
le mont Pangée. 50. Pieria eft une montagne de
S y r ie , ainfi dite à l'imitation d’une montagne du
même nom en Grece. Cette montagne donnoitle
nom à une contrée qui faifoit partie de la Séleucide.
<>0..Lieu du Péloponnefe au voifmage de Lacédémone.
7 0. Ville de la Boeotie, qui dans la fuite fut
appellée Lyncos, Avyios. 8Q.C ’eftlenom d’une montagne
de la Boeotie. 90. Il y avoitune forêt de Macédoine
dans la Piérie, qui portoit le nom de Pieria
filva. Tite-Live, liv. X L lV . chap. xliij. dit que ce
fut dans cette forêt que fe fauva Perfée, après avoir
été battu par les Romains.
C ’eft de la Piérie de Macédoine qu’étoit natif Pie-
tu s , célébré poète muficien , dont parlent Plutarque
& Paufanias. Il eut neuf filles douees de tous les ta-
ïens poffibles pour la mufique & lapoéfie; il leur im-
pofa le nom des neuf mufes, & les petits-fils qu’elles
lui donnèrent, portèrent les mêmes noms que les
Grecs ont attribués depuis aux enfans des mules mêmes.
Comme il excelloit également dans la mufique
& la poéfie , il compofa des poèmes dont l’hiftoire
fabuleufe des mufes, & leurs louanges , faifoient le
principal fujet. Voilà d’où vient que les mufes font
appeliées Piérides jpar les poètes.
Une colonie de Piériens , peuples de Thrace, entre
le Carafon & le Bracs, étant entré , au fond du
golfe de Salonique en Macédoine, s’établit fur les
côtes, entre le Platamona & le mont Aka , & donna
à ce canton le nom de Piérie -, auffi-bien qu’à une
fontaine qui fut confacrée aux mufes. Le Carafon ou
le Meftro d’aujourd’hui, eft apparemment je Neftus
ou Meftus des anciens ; le Bracs eft le CoJJinitts ou
Compfatus ; la Platamona , VAJirxus ; & le mont
Aka eft la partie.orientale-de l’ancien Olympus.
Cri ton (Quintus) hiftorien, naquit à Pierie dans
la Macédoine, apparemment depuis J. C. puifqu’aucun
ancien auteur n’en parle. Il compofa plufieurs
ouvrages, dont les noms feuls nous ont été confer-
vés. Julius Pollux, liv. X . cite fon hiftoire de Nice,
& Etienne, fon hiftoire des Getes. Suidas npmme une
hiftoire de Pallenepar Çriton , une de Perfe, une
de S icile, la defcription de Syracufe, l’origine de la
même v ille , enfin un traité de l’empire de Macédoine.
( D . J.')
PIÉRIENS , (Géog. and) en latin Pieres, peuples
voifins de la Macédoine. Pline, liv. IV. chap. x . les
met dans la Macédoine même, auprès de Treres &
Dardani. Hérodote, liv. VU. & Thucydide, liv.II.
page 168. parlent auffi de. ces peuples qui étoient les
habitans de la Piérie. ( D. J. )
PIERRES , f. f. pl. ( Hifl. nat. Min.') lapides. Ce
font des corps folides & durs, non ductiles, formés
par des particules terreufes , qui, en fe rapprochant
les unes des autres, ont pris différens degrés de liai-
fon; Ces corps varient à l’infini pour la confiftence,
la couleur , la forme & les autres propriétés.
Il y^ a des pierres fi dures, que l’acier le mieux
trempe n’a point de prife fur elles : d’autres au contraire
ont fi peu de liaifon, que J’on peut aifément les
écrafer entre les doigts. Quelques pierres ont latranf-
parence de l’eau la plus limpide, tandis que d’autres
font opaques, d’un tiffu groffier, & fans nulle tranf-
parence. Rien de plus varié que la figure des pierres ;
on en voit qui affeâent conftamment une figure régulière
& déterminée, tandis que d’autres fe montrent
dans l’état de maffes informes & fans nulle régularité.
Il y eh a qui rie font qu’unàmas de feuillets
ou de lames appliquées les unes fur les autres ; d’au-
très font compofées d’un affemblage de filets fembla-
bles à des aiguilles ; quelques-unes en fe brifant fe
partagent toujours , foit en cubes, foit en trapézoï-
d e s , foit en pyramides , foit en feuillets , foit en
ftries ou en aiguilles, &c. d’autres fe caftent en éclats
& en fragmens informes & irréguliers. Quelques
pierres ont les couleurs les plus vives & les plus variées
; plufieurs de ces couleurs fe trouvent fouvent
réunies dans une même pierre ; d’autres n’ont point
de couleurs , ou elles en ont de très-groflieres. Quelques
pierres fe trouvent en maftes détachées ; d’autres
forment des bancs ou des couches immenfes
qui occupent des terreins très-confidérables ; d’autres
forment des blocs énormes & des montagnes
entières.
T elles font les propriétés générales que nous pré-
fente le coup d’oeil extérieur des pierres.Si l’on pouffe
plus loin l’examen ; on trouve que quelques-unes
donnent des étincelles , lorfqu’on les frappe avec de
l’acier , ce qui tient de la forte liaifon de leurs parties
, tandis que d’autres ne donnent point d’étincelles
de cette maniéré. Quelques pierres fe calcinent,
& perdent leur liaifon par l’aftion du. feu ; d’autres
expofées au feu s’y durciffent ; d’autres y entrent en
fuiion ; d’autres n’y éprouvent aucune altération. Il
y en a qui fe diffolvent avec effervefcence dans les
acides, tels que l’eau forte, le vinaigre , &c. quelques
unes ne font nullement attaquées par ces diffol-
vans.
Toutes ces différentes qualités que l’on vient-de
faire remarquer dans les pierres, ont déterminé les
naturaliftes à en faire différentes claffes ; chacun les
a divifées fuivant les différens points de vues fous lef-
quels il les a envifagées; voilà pourquoi les auteurs
font très-pèu d’accord fur les [divifions méthodiques
qu’ils nous ont données de ces fubftances. Quelques-
uns ne confultant que le coup d’oeil extérieur, ont
divifé les pierres en opaques & en tranfparentes.; d’autres
ont eu égard aux effets que les pierres produi-
fent dans le feu : c’eft ainfi que M. Wallerius diftin-
gue les pierres en quatre ordres ou claffes ; favojr ,
1 °. en pierres calcaires ; ce font celles que l’aâion du
feu réduit en chaux & prive de leur liaifon ; telles
font la pierre à chaux, la craie , les marbres, le
fpath, le gypfe, &c .V oye[ Uarticle C a l c a i r e . z ° . En.
pierres vitrefcibles ; ce font celles que l’adion du feu
couvertit en verre. Dans ce rang il place les ardoi-
fe s , les grais, le caillou, les agates , les jafpes , le
quartz, le cryftal de roche, les pierres précieufes.
30. En pierres apyres ; ce font celles fur qui l’adion
du feu ne produit aucune altération ; telles font le
talc, l’amiante, Oc. Enfin , 40. M. Wallerius fait une
quatrième claffe de pierres qu’il nomme compofées,
&c qui font formées par l’affemblage des différentes
pierres qui précèdent, qui dans le fein de la terre fe
font réunies pour ne faire qu’une maffe.
M. Pott,qui dans fa Lithogéognofe, nous a donné un
examen chimique de la plupart des pierres, les divife ,
i° . en calcaires, c’eft-à-dire, en pierres qui fe diffolvent
dans les acides, & que l’adion du feu change en chaux ;
20. engypfeufes qui ne fe diffolvent point dans les aci-;
des, mais que l’adion du feu change en plâtre. Cependant
aujourd’hui la plûpart des Phyficiens regardent
le gypfe ou la pierre à plâtre, comme une pierre
calcaire qui eftfaturée par l’acide vitriolique; 30. en
argilleufes, qui ne font point attaquées par les acides,
mais qui ont la propriété de fe durcir & de prendre
de la liaifon dans le feu ; 40. en apy tes liir lelquelles
ni les acides, ni l’adion du feu n’ont aucune prife.
M. Frédéric-Augufte Cartheufer dans fa Minéralogie
, divife les pierres en cinq ordres ou claffes ; i° . en
pierres par lames , lapides lamelloji ; elles font compofées
de féiullets plus ou moins grands. Lès tü'fîe-
rens genres de cette claffe font le fpath , le mica, le
talc. 20. Les pierres compofées de filets , lapides
filamentofi >• de ce nombre font l’amiante, l’asbefte ,
le gypfe ftrié. 30. Les pierres folides ou continues,
dont les parties ne peuvent être diftinguées ; de ce
nombre font le caillou, le quartz & les pierres précieufes
, les pierres à chaux, les pierres à plâtre, lé
fehifte ou l’ardoife, la pierre à pots. 40. Les pierres
par grains, lapides granulati; telles font le grais,
ÔC fuivant lui le jafpe. 50. Les pierres mélangées.
M..de Jufti dans fon plan du régné minéral, publié
en allemand en 175 7 , divife les pierres ; i° . en précieufes
, & en communes ; 20. en pierres qui réfiftent
au feu ; . 3°. en pierres calcaires ;4°. en pierres vitrefcibles
& fufibles au feu. On voit que cette divifion
èft très-fautive, vu que cet auteur confidere d’abord
les pierres relativement au prix que la fantaifie des
hommes y attache , & enfuité il les divife relativement
aux effets que le feu produit fur elles.
M. de Gronftedt, de l’académie de Stockholm ,
dans fa Minéralogie publiée en fuédois en 1758,..
comprend les pierres 6c les terres fous une même
claffe , en quoi il femble être très-fondé, vu que les
pierres ne font que des produits des terres, qui ont
acquis plus ou moins de confiftence & de dureté. Il
divife ces terres ou pierres en deux genres, la première
eft des calcaires, la fécondé eft des pierres ou
terres filicées , c’eft-à-dire, de la nature du caillou.
Toutes ces différentes divifions que l’on a faites
des pierres nous prouvent qu’il eft difficile de les ranger
dans un ordre méthodique qui convienne en
même tems à leur afp eft extérieur & à leurs propriétés
intérieures ; au fond ces divifions font affez arbitraires,
& chacun peut en faire des claffes relative-
merit aux différens points de vue foi^s lefquels il les
envifage. Le chimifte qui ne décide rien que d’après
l’expérience, eonfiderera les pierres relativement à
leur analyfe, tandis que le phyficien fuperficiel, qui
ne cherchera point à approfondir les chofes, fe contentera
des qualités extérieures , fans s’embarraffer
de la conibinaifon de ces corps ; cependant dans
l’examen des.pierres y ainfi que de toutes les fubftances
du régné minéral, on ril’quera très-foüvent de
fe tromper lorfqu’on ne s’arrêtera qu’aux apparences;
un grand nombre de pierres qui ont des propriétés
fort oppofées., fe reffemblent beaucoup à
l'extérieur , & les fciences ne devant avoir pour but
que l’utilité de la fociété, il eft certain que l’ahalyfe
nous fera beaucoup mieux connoître les ufages des
fubftances que ne fera un examen fuperficiel.
Comme-la nature agit toujours d’une façon fimple
& uniforme, il y a tout lieu de conjefturer que toutes
les pierres font effentiellement les mêmes, & qu’elles
font toutes compofées de terrés, qui ne .diffe-
rent entre elles que par les différentes maniérés dont
elles ont été modifiées, atténuées & élaborées, &
combinées par les eaux ; nous allons faire voir que
l’eau eft le feul agent de la formation des pierres.
L’expérience prouve que les eaux les plus pures
contiennent une portion de terre affez fenfible ; on
peut s’affurer de cette vérité en jettant les yeux fur
les dépôts que font dans les vaiffeauxles eaux qu’on
y fait bouillir, & qu’on y laiffe féjourner quelque
tems. Si l’oh met une goutte d’eau de pluie ou de la
neige fur une glace bien nette, elle y formera une
■ tache blanche auffi-tôt que l’eau fera évaporée;
cette tache n’eft autre chofe que de la terre, d’où
l’on vo it que Beau tenoit cette terre en diffolution,
& qu’elle étoit fi intimement combinée’ avec elle
qu’elle ne nuifoit point 4 là limpidité. L’eau par
elle-même doit avoir la propriété de s’unir & de fe
combiner avec la terre ; c’ eft de cette combinaifon
que réfulte tout fel ; il y a long-tenis que la Chimie à
démontré que les fels ne font qu’uriè combiriaifori
de la terre & de l’eau; c’eft de la différente maniéré
dont l ’eau fe combine avec des terres, diverlement
atténuées & élaborées, qui produit la Variété de ces
fels. Ces vérités une fois pofées, nous allons tâcher
d’examiner les différentes maniérés dont les pierres
peuvent fe former.
La première de ces maniérés qui eft la pius par*»
faite, eft la èryftallifation. On ne peut s’en former
d’idée fans fuppofer que des eaux tenoient en diffolution
des molécules terreufes avec lefquelles elles
étoient dans une combinaifon parfaite. L ’eau qui tenoit
ces molécules en diffolution venant à s’évapo*
rer pèu-à-peu, n’eft plus en quantité fuffifajite pouf
les tenir en diffolution ; alors elles fe dépofent & fe
rapprochent les unes des autres ; comme elles font
fimilaires, elles s’attirent réciproquement par la dif-
pofition qu’elles ont à s’unir, & de leur réuriion il
réfulte un corps fenfible, régulier & tranfparent,
que l’on nomme cryjlal; la régularité & la tranfpa*
rence dépendent de lapureté &: de l’homogénéité des
molécules terreufes qui étoient en diffolution dans
l’eau ; ces qualités viennent encore du repos où a
été la diffolution, & de la lenteur plus ou moins
grande avec laquelle l’évaporation s’eft faite ; du-
moins eft il certain que c’eft de ces circonftances
que dépend la perfeftion des cryftaux des fels, qui
par leur analogie peuvent nous faire juger de la cry-
ftallifation des pierres. Ces cryftaux varient en raifon
de la terre qui étoit en diffolution dans l’eau, & qui
leur fert de bafe; fi cette terre étoit calcaire, elle
formera des cryftaux calcaires, tels que ceux du
fpath, &c. fi la terre étoit Jilicée, c’eft-à-dire de la
nature du caillou ou du quarts, on aura des pierres
précieufes & du cryftal de roche. Comme lés eaux
peuvent tenir en même tems en diffolution des terres
métalliques diverfement colorées, ces couleurs paffè*
ront dans les cryftaux quife formeront; de-là les différentes
couleurs des cryftaux & des pierres précieu»
fes ; leur dureté variera en raifon de l’homogénéité
des parties diffoutes, plus elles feront homogènes &
pures, plus elles s’uniront fortement, & par conféa
quent plus elles auront defolidité & de tranfparence.
Quand -même les eaux n’auroient point par elles-*
mêmes la faculté de diffoudre les molécules terreufes
, elles acquerroient cette faculté par le concours
des fubftances falines qui fouvent y font jointes.
Perfonne n’ignore que la terre ne renferme une
grande quantité de fels ; c’eft l’acide vitrioiique qui
s’y trouve le plus abondamment répandu. L’eau ai-*
dée de ces fels peut encore plus fortement diffoudre
une grande quantité de molécules terreufes, avec
lefquelles elle fe combine, & lorfqu’elle vient à
s’évaporer, il fe forme divers cryftaux en raifon de
la nature de la terre qu’elle tenoit en diffolution, &
des fels qui entrent dans la coiribinaifon.
Souvent une même eau peut tenir en diffolution
des terres de différente nature, dont les unes demandent
plus d’eau pour leur diffolution, tandis
que d’autres en exigent beaucoup moins ; alors lorfr
que l’évaporation viendra à fe faire , il fe formera
d’abord des cryftaux d’une efpece, & enfiiite il s’en
formera d’autres ; cela fe fait de la même maniéré
que des fels de différente nature fe cryftallifent fuc-*
ceffiveirient les uns plutôt, les autres plus tard dans
un vaiffeau & dans un laboratoire. C’eft ainfi qus
l’on peut expliquer affez naturellement la formatioà
de ces maffes que l’on rencontre fouvent dans la
terre, & qui font un mélange confus de plulîèurs
cryftaux de différente nature.
Les molécules terreufes qui fervent à former les
pierres ne font point toujours dans un état de diffolu-
tion parfaite dans les eaux, fouvent elles y font en
paties groffieres., qui ne font que détrempées, &