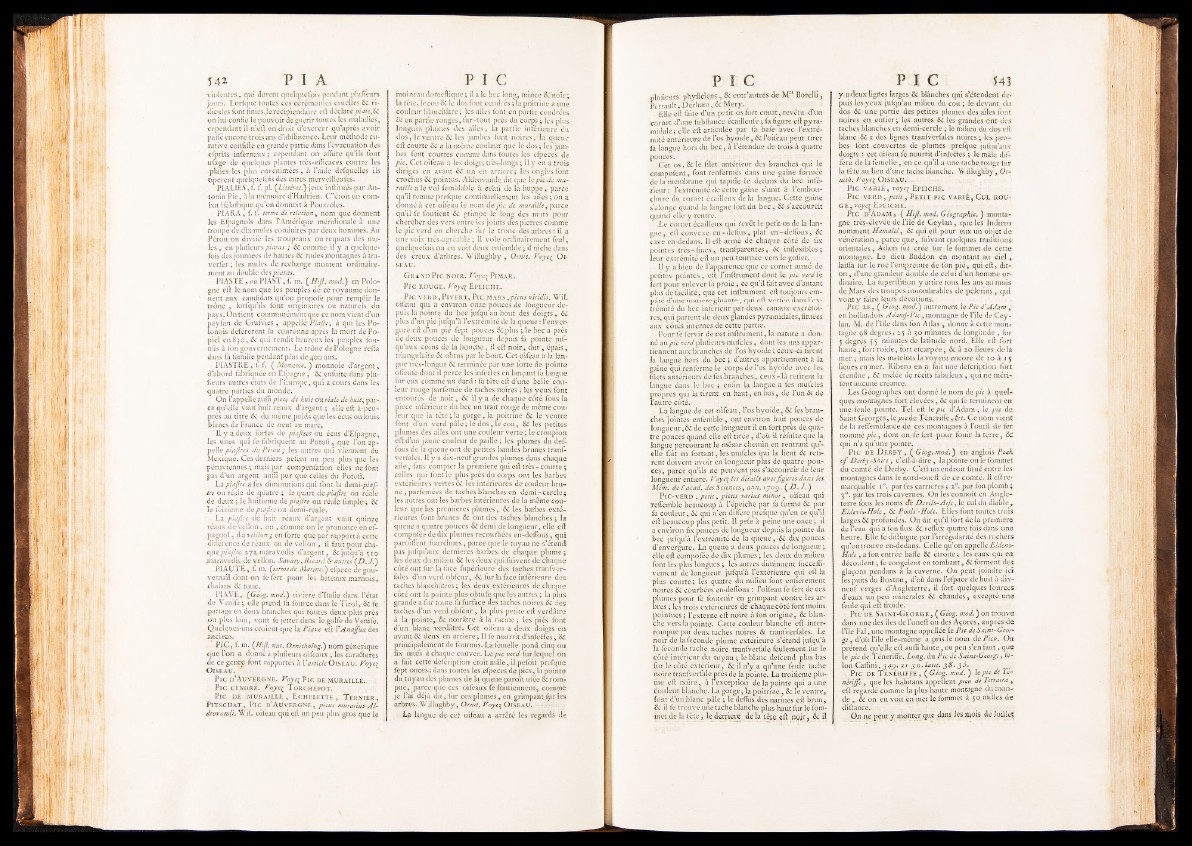
5 4* P I A
violentes, qui durent quelquefois pendant plufieurs
jours. Lorfque toutes ces ceremonies cruelles & ridicules
font finies,le récipiendaire eft déclaré piaie,}6c
on lui confie le pouvoir de guérir toutes les maladies,
cependant il n’eft en droit d’exercer qu’après avoir
paffé encore trois ans d’abftinence. Leur méthode curative
confifte en grande partie dans l’évacuation des
elprits infernaux ; cependant on affure qu’ils font
ufage de quelques plantes très-efficaces contre les
plaies les plus envenimées, à l’aide defqu elles ils
opèrent quelquefois des cures merveilleules.
PIALIES, 1. f. pl. (Littérat.) jeux inftitués par An-
tonin Pie, à la memoire d’Hadrien. C” étoit un combat
ifélaftique qu’on donnoit à Pouzzoles.
PIARA , f. f. terme de relation, nom que donnent
les Efpagnols dans l’Amérique méridionale à une
troupe de dix mules conduites par deux hommes. Au
Pérou on divife les troupeaux ou requats des mules
, en plufieurs piaras ; 6c comme il y a quelquefois
des journées de hautes 6c rudes montagnes à tra-
verfer ; les mules de rechange montent ordinairement
au double des piaras.
PI ASTE, ou P IAST, f. m. ( Hiß. mod.') en Pologne
eft le nom que les peuples de ce royaume donnent
aux candidats qu’on propofe pour remplir le
trône , lorfqu’ils font originaires ou naturels du
pays. On tient communément que ce nom vient d’un
payfan de Crufvies , appelle Piaße, • à qui les Po-
lonois déférèrent la couronne après la mort de Po-
pieTenBjo, & qui rendit heureux les peuples fournis
à fon gouvernement. Le trône de Pologne refia
dans fa famille pendant plus de 400 ans.
PIASTRE, f. f. ( Monnoie. ) monnoie d’argent,
d’abord fabriquée en Efpagne , & enfuite dans plufieurs
autres états de l’Europe, qui a cours dans les
quatre parties du monde.
On l’appelle auffi /jzecc de huit ou réale de huit, parce
qu’elle vaut huit réaux d’argent ; elle efi à-peu-
près au titre 6c du même poids que les écus ou louis
blancs de France de neuf au marc,
Il y a deux fortes de, piafives ou écus d’Efpagne,
les unes qui fe fabriquent au Potofi, que l’on appelle
piaflres du Pérou ; les autres qui viennent dit
Mexique. Ces derniers pefent un peu plus que les
péruviennes ; mais par compenfation elles ne font
pas d’un argent auffi pur que celles du Potofi.
La piaflre a fes diminutions qui font la demi-piaf-
tre ou réale de quatre ; le quart de piaflre ou réale
de deux ; le huitième de piaflre ou réale fimple ; 6c
le feizieme de piaflre ou demi-réale.
La piaflre de nuit réaux 'd’argent vaut quinze
réaux de vellon , ou , comme on le prononce en espagnol
, de veißon ; en forte que par rapport à cette
différence de réaux ou de vellon , il faut pour chaque
piaßre 2.7z maravedis d’argent, & jufqu’à 510
maravedis de vellon. Savary, Ricard & autres (JD. J.")
PIAUTE, f. m. (termede Marine.') efpece de gouvernail
dont on fe fert pour les bateaux marnois,
chalans 6c toue.
PIAVE, ( Géog. mod.) riviere d’Italie dans l’état
de Venife ; elle prend fa fource dans le T irol, 6c fe
partage en deux branches qui toutes deux plus près
ou plus loin, vont fe jetter dans le golfe de Yenife.
Quelques-uns croient que la Piave eft YAnajfua des
anciens.
' PIC, f . m. (Hift. nat. Ornitholog.) nom g én é r iq u e
q u e l’on a d o n n é à p lu fieu r s o i fe a u x ; le s c a r a f te r e s
d e c e g e n r e fo n t r a p p o rté s à Y article O i s e a u . Voye^
O i s e a u .
P ic d ’A u v e r g n e . Voye^Pic d e m u r a i l l e .: .
P ic c e n d r é . Voye[ T o r c h e p o t .
P i c d e m u r a i l l e , E c h e l e t t e , T e r n i e r ,
P i t s c h a t , Pic d ’A u v e r g n e , picus mur anus A l-
drovandi. W il, oifeau qui eft un peu plus gros que le
P I C
moineau domeftique ; il a le bec long, mince &fnoir;
la tête, le cou 6c le dos font cendrés ; la poitrine a une
couleur blanchâtre ; les ailes font en partie cendrées
6c en partie rouges, fur-tout près du corps ; les plus
longues plumes des ailes, la partie inférieure du
dos, le ventre 6c les jambes font noires, J la queue
eft courte 6c a la même couleur que le dos ; les jambes
font courtes comme dans toutes les efpeces de
pic. Cet oifeau a les doigts très-longs ; il y en a trois
dirigés en avant 6c un en arriéré ; les ongles font
crochus 6c pointus. Aldrovande dit que le pic de muraille
a le vol femblable à eelui de la huppe, parce
qu’il remue prefque continuellement les ailes ; on a
donné à cet oifeau le nom de pic de muraille, parce
qu’il fe foutient 6c grimpe le long des murs pour
chercher des vers entre les joints des pierres comme
le pic verd en cherche fur le tronc des arbres : il a
une voix très-agréable ; il vole ordinairement feu!,
quelquefois ou en voit deux enfemble; il niche dans
des creux d’arbres. W illughby , Omit. Voye^ Ois
e a u .
G rand Pic no ir. Voye{ Pimar.
P i c r o u g e . Voye^ E p e i c h e .
P i c v e r d , P i v e r t , P i c m a r s ,picus viridis. ‘Wïl.
oifeau qui a environ onze pouces de longueur depuis
la pointe du bec jufqu’au bout des doigts, 6c
plus d’un pié jufqu’à l’extrémité de la queue : l’envergure
eft d’un pie fept pouces ,&plus ; le bec a près
de deux pouces de longueur depuis fa pointe juf-
qu’aux coins de la bouche, il eft noir, dur , épais ,
triangulaire 6c obtus par le bout. Cet oifeau a la langue
très-longue 6c terminée par une forte de pointe
offeufe dont il perce les infeftes en lançant fa langue
fur eux comme un dard : fa tête eft d’une belle couleur
rouge parfemée de taches noires ; les yeux font
entourés de noir, & il y a de chaque côté fous la
piece inférieure du bec un trait rouge de même couleur
que la tête ; la gorge, la poitrine 6c le ventre
font d’un verd pâle; le d o s ,le cou, 6c les petites
plumes des ailes ont une couleur verte ; le croupion
eft d’un jaune couleur de paille ; les plumes du def-
fous de la queue ont de petites bandes brunes tranf-
verfales. Il y a dix-neuf grandes plumes dans chaque
aile, fans compter la première qui eft très - courte ;
celles qui font le plus près du corps ont les barbes
extérieures vertes & les intérieures de couleur brun
e , parfemées de taches blanches en demi-cercle;
les autres ont les barbes intérieures de la même couleur
que les premières plumes, 6c les barbes extérieures
font brunes 6c ont des taches blanches ; la
queue a quatre pouces 6c demi de longueur, elle eft
compofée de dix plumes recourbées en-deffoùs,, qui
paroiffent fourchues, parce que le tuyau ne s’étend
pas jufqu’aux dernieres barbes de chaque plume ;
les deux du milieu 6c les deux qui fuivent de chaque
côté ont fur la face fupérieure des taches tranfver-
fales d’un verd obfcur, 6ç fur la face inférieure des
taches blanchâtres ; les deux extérieures de chaque
côté ont la pointe plus obtufe que les autres ; la plus
grande a fur toute fafurface des taches noires 6c des
taches d’un verd obfcür, la plus petite eft verdâtre
à la pointe, ,6c noirâtre à la racine ; les piés font
d’un blanc verdâtre. Çet oifeau a deux doigts en
avant & deux en arriéré ; Il fe nourrit d’infeétes, 6c
principalement de fourmis. La-femelle pond cinq ou
fix oeufs à chaque couvée. Le pic verd fur lequel on
a fait cette defcription éti>it mâle, il pefoit prefqùe
fept onces; dans toutes les efpeces de pies, la pointe
du tuyau des plumes de la queue paroît ufée 6c rompue;
parce que ces oifeaux fe fo-utiennent, comme
je l’ai déjà dit, fur ces plumes; en grimpaiitiurles
arbres. AVillughby, Omit. Voyt{ O i s e a u .
L a : langue de cet oifeau a arrêté les regards dè
P I C
plufieurs' phyficiens , 6c entr’autres de M” Borèlli,
Perrault, Derham, 6c Mer,y. : ' . .
Elle eft faite d’un petit os.fort court; revêtu d’un
cornet d’une fubftance écaiileufe ; fa figure eft pyramidale
; elle eft articulée par fa bafe avec l’extrémité
antérieure de l’os hyoïde, 6c l’oifeau peut tirer
fa langue hors du bec, à l’étendue de trois à quatre
pouces.
Cet o s , 6c le filet antérieur des branches qui le
compofent, font renfermés dans une game formée
de la membrane qui tapiffele dedans, du bec inférieur
: -l'extrémite de cette gaine s’unit à l’embour
chure dit cornet écailleux de, la langue. Cette gaine
s’alonge quand la'langue fort du b e c , 6c s’accourcit
qudnd elle y rentre.
Le cornet écailleux qui l’evêt le petit os de la langue,
eft convexe en - deflus, plat en - deffoiis, 6c
cave en-dedans. Il eft armé de chaque côté de fix
pointes très - fines ., tranfparentes, 6c inflexibles ;
leur extrémité eft un peu tournée vers le gofier.
Il y a bien de l’apparence que ce cornet armé de
petites pointes , eft l’inftrument dont le pic verd fe
fert pour enlever fa proie , ce qu’il fait avje.cd’autant
plus de facilité, que cet infiniment eft toujours empâté
d’une matière gluante, qui eft verfée dans l’extrémité
du bec inférieur par deux canaux- excrétoires,
qui partent de deux glandes pyramidales,fituées
aux côtés internes de cette partie. .
Pour.fé fervir de cet infiniment, la nature a donné
au pic verd plufieurs mufcles, dont les uns appartiennent,
aux branches de l’os hyoïde ; ceux-ci tirent
la langue hors du bec ; d’aiïtres appartiennent à la
gaine qui renferme le corps de l’os hyoïde avec les
filets antérieurs de fes branches, ceux-là retirent la
langue dans le bec ; enfin la langue a fes mufcles
prppres qui la tirent en haut , en bas, de l’un & de
l’autre côté.
La langue de cet oifeau, l’os hyoïde, 6c fes branches
jointes enfemble , ont environ huit pouces de
iongueur,& de cette longueur il en fort près de quatre
pouces quand elle eft tiré e , d’où il réfulte que la
langue parcourant le même chemin en rentrant qu’elle
fait en fortant, les mufcles qui la lient 6c retirent
doivent avoir en' longueur plus de quatre pouces
, parce qu’ils ne peuvent pas s’accourcir de leur
longueur entière. Voye^ les détails avec figures dans les
Mém. de V ac ad. des Sciences, ann. ipoc). (D .J . )
Pic-VERD , petit, picus varias minor, oifeau qui
reffemble beaucoup à l’épeiche par fa forme 6c par
fa couleur, 6c qui n’en différé prefque qu’en ce qu’il
eft beaucoup plus petit. Il pefe à peine une once ; il
a environ fix pouces de longueur depuis la pointe du
bec jufqu’à l’extrémité de la queue, 6c dix pouces
d’envergure. La queue a deux pouces de longueur ;
elle eft compofée de dix plumes ; les deux du milieu
font les plus longues ; les autres diminuent fucceffi-
vement de longueur jufqu’à l’extérieure qui eft la
plus courte ; les quatre du milieu font entièrement
noires 6c courbées en-deffous : l’oifeau fe fert de ces
plumes pour fe foutenir en grimpant contre les arbres
; les trois extérieures de chaque côté font moins
pointues ; l’externe eft noire à fon origine, 6c blanche
vers la pointe. Cette couleur blanche eft interrompue
par deux taches noires & tranfverfales. Le
noir de la fécondé plume extérieure s’étend jufqu’à
la fécondé tache noire tranfverfale feulement fiir le
côté intérieur du tuyau ; le blanc defcend plus bas
fur le côté extérieur, 6c il n’y a qu’une feule tache
noire tranfverfale près de la pointe. La troifieme plu-
ihe eft noire, à l’exception de la pointe qui a. une
couleur blanche. La gorge, la poitrine, 6c le ventre,
font d’un blanc pâle ; le deflus des narines eft brun,
6c il fe trouvé une tache blanche plus haut fur le fom-
met de la tête ; le derrière d e là tête e f t noir, 6c il
P I C 543
y a deux ligrtes larges 6c blanches qui s’étendent depuis
les yeux jufqu’au milieu du cou ; le devant du
dos; 6c une partie des. petites plumes des, ailes font
noires en entier; les autres 6c les grandes ont des
taches blanches en demi-cercle ; le milieu du dos eft
blanc 6c a des lignes tranfverfales noires ; les jambes
font, couvert es de plumes .prefque jufqu’aux
doigts : çet oifeau,fe nourrit d’infeûes ; le mâle différé
de la femelle,. en ce qu’il a une tache rouge fur
la tête au lieu d’une taçhe blanche. W illughby, Or-
nith. Hoye{ OlSE^U. -
P ic v a r i é , voye[ E p e i c h e .
. Pic v e r d , petit, P e t i t p i c v a r i é , C ul r o u g
e , yoye{ E p e i c h e .
P i c d ’A d a m , ( Hifl. mod. Géographie. ) montagne
très-élevée d e l’île de Ceylan , que les Indiens
nomment Hamalel, 6c qui eft pour eux un objet de
vénération, parce que, fuivant quelques traditions
orientales ; Adam fut ; créé fur le fommet de cette
montagne. Le dieu Buddon en montantau c ie l,
laiffa lur le roc l’empreinte de fon pié; qui eft, dit-
on , d’une grandeur double de celui d’un homme ordinaire.
La fuperftition y attire tous les ans au mois
de Mars des troupes innombrables de pèlerins, qui
vont y faire leurs dévotions.
, P ic l e , ( Géog. mod.) autrement le Pic d'Adam
en hollandôis Adamf-Pïc^ montagne de l’île de Ceylan,
M. de l’ille dans fon Atlas , donne à cette montagne
98 degrés, 25 a 30 minutes de longitude , fur.
5 degrés 5 5 minutes de latitude nord.. Elle eft fort
haute, fortroide, Fort efearpée, & à 20 lieues delà
rner ;, mais les matelots la voyent encore de 10 à 17
lieues en mer. Ribero en a fait une defcription fort
étendue , 6c mélée de récits fabuleux, qui ne méritent
aucune créance.
Les Géographes Ont donné le nom de pic k quelques
montagnes fort élevées, 6c qui fe terminent en
une feule pointe. T el eft 1 e pic d’Adam , le pic de
Saint Georges, le pic de Téneriffe ,& t. Ce nom vient
de la reflemblance de ces montagnes "à, l’outil de fer
nommé p ic , dont on fe fert pour fouir la terre, 6c
qui n’a qu’une pointe.
P ic d e D e r b y , ( Géog. mod. ) en anglois Peak
o f Derby-Shire , cîeft-à-dire, la pointe ou le fommet
du comté de Derby. G’eft un endroit fitué entre les
montagnes dans le nord-oueft de ce comté. Il eft remarquable
i° . par fes carrières ; 20. par fon plomb ;
3°. par fes trois cavernes. On les connoît en Angleterre
fous les noms de Devils-ArJ'e, le cul du diable ,
Eldevis-Hole, 6c Pools'-Hole. Elles font toutes trois
larges 6c profondes. On dit qu’il fort dé la première
de l’eau qui a fon flux 6c reflux quatre fois dans une
heure. Elle fediftingue par l’irrégularité des rochers
qu’on trouve en-dedans. Celle qu’on appelle Eldens-
Hole, a fon entrée baffe 6c étroite ; les eaux qui en
découlent, fe congèlent en tombant, 6c forment des
glaçons pendans à la caverne. On peut joindre ici
les puits du Boxton, d’où dans l’efpace de huit à dix-
neuf verges d’Angleterre, il fort quelques fourçes
d’eaux un peu minérales 6c chaudes., excepté une
feule qui eft froide.
Pic d e S a i n t -G e o r g e , (Géog. mod.) on,trouve
dans une des îles.de l’oueft ou des A çores, auprès de
l’île Fal, une montagne appe-llée le Pic de Saint-George
, d’où l’île elle-même a pris le nom de Pico. On
prétend qu’elle eft auffi haute, ou peu s’en faut, que
le pic de Téneriffe. Long, du Pic de Saint-George, félon
Caffini,345). z i 3 0. latit. j8 . j J .
P ic d e T é n e r i f f e , (Géog. mod. ) le pic de Te-
nériffe , que les habitans appellent pico de Terraira ,
éft regardé comme la-plus haute montagne du monde
, 6c o.n en voit en mer le fommet à 5 0. milles de
diftarice. ■ . -V
On ne peut y monter que dans les mois de Juillet