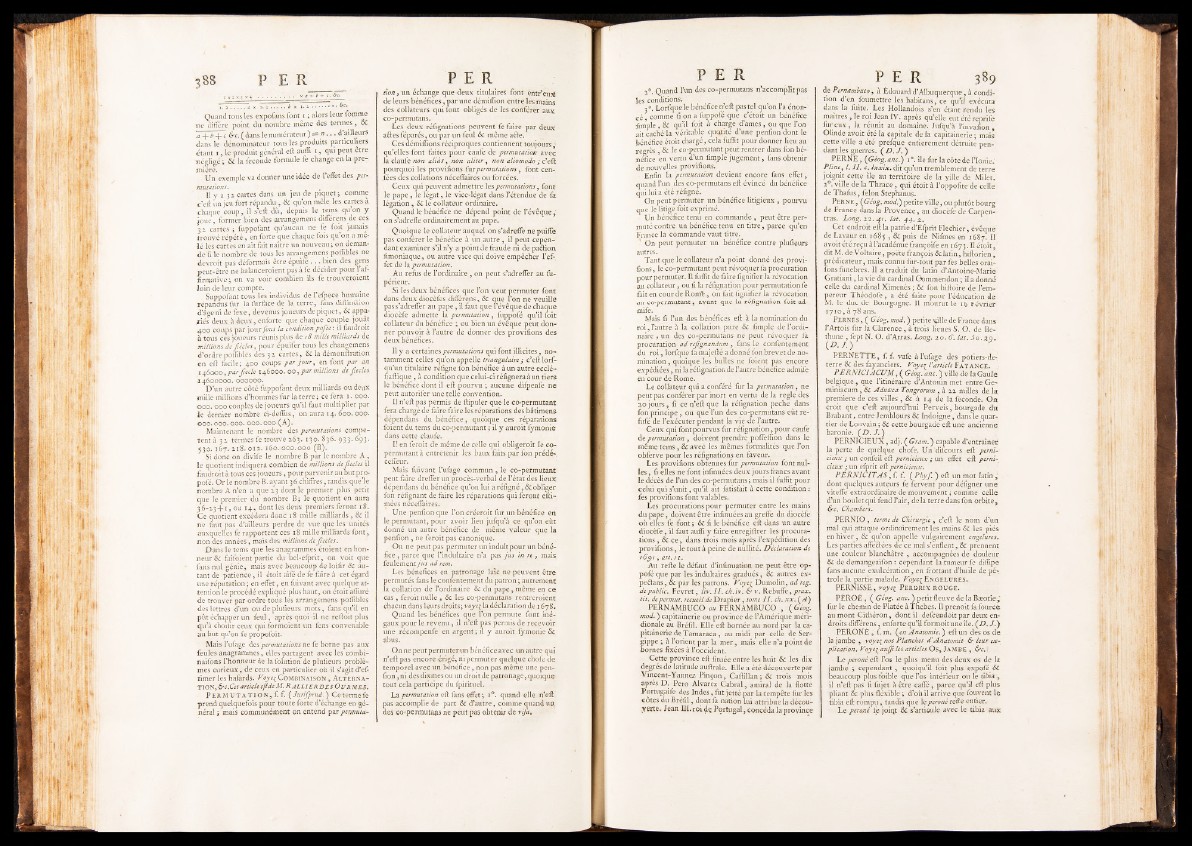
3 8 8 P E R
Quand tous les expofans font 1 ; alors leur fomme
Tie diffère point du nombre même des termes, ôc
a _j_ /> + c &c. ( dans le numérateur) — n . . . d’ailleurs
dans le dénominateur tous les .produits particuliers
étant 1 , le produit général eft aufli 1 , qui peut etre
•négligé ; Si la fécondé formule fe change en la premiére.
BHjBBS
Un exemple va donner une idee de 1 eftet des permutations.
'
H y a 32 cartes dans un jeu de piquet ; comme
c ’eft un jeu fort répandu , & qu’on mêle les cartes à
chaque coup, il s’eft dû, depuis le tems qu’on y
joue, former bien des arrangemens différens de ces
32 cartes ; fuppofant qu’aucun ne fe foit jamais
trouvé répété, en forte que chaque fois qu’on a mêlé
les cartes en ait fait naître un nouveau; on demande
fi le nombre de tous les arrangemens poffibles ne
devroit pas déformais être épuifé . . . bien des gens
peut-être ne balançeroient pas à fe décider pour l’affirmative
; on va voir combien ils fe trouveroient
loin de leur, compte.
Suppofant tous les individus de l’efpece humaine
répandus fur la furface de la terre, fans diftinftion
d’âge ni de fexe, devemis joueurs de piquet, & appariés
deux à deux, enforte que chaque couple jouât
400 coups par jour fous la condition pofee : il faudroit
à torts ces joueurs réunis plus de 18 mille milliards de
millions Je Jzécles, pour.épuifer tous leschangemens
d’ordre poffibles des 31 cartes, & la démonftration
en eft facile; 400 coups par jour, en font par an
146000, parjîecle 146000. 00, par millions de Jiecles
a 4600000. 060000.
D ’un autre côté fuppofant deux milliards ou deux
mille millions d’hommes fur la terre ; ce fera 1. 000.
•000. 000 couples de joueurs qu’il faut multiplier par
le dernier nombre ci-defliis, on aura 14. 600.000.
eoo. 000. opo. oqo. 000 (A).
Maintenant le nombre des permutations competent
à 32 termes fe trouve 163. 130. 836. 933. 693.
530. 167. 218.012.160-060.060 (B).
Si donc on divife le nombre B par le nombre A ,
le quotient indiquera combien de millions de Jiecles il
faudroit â tous ces joueurs, pour parvenir au but pro-
pofé. Or le nombre B. ayant 3 6 chiffres, tandis quele
nombre A n’en a que 23 dont le premier plus petit
que le premier du nombre B ; le quotient en aura
ou 14, dont les deux premiers feront 18.
C e quotient excédera donc 18 mille milliards, & il
ne faut pas d’ailleurs perdre de vue que les unités
auxquelles fe rapportent ces 18 mille milliards font,
non des années, maisàesmillions de Jiecles:
Dans le tems que les anagrammes étoient en honneur
& faifoient partie du bel-efprit, on voit que
fans nul génie, mais avec beaucoup de loifir & autant
de patience, il étoit aifé de fe faire à cet égard
une réputation ; en effet, en fuivant avec quelque attention
le procédé expliqué plus haut, on etoit affuré
de trouver par ordre tous les arrangemens poffibles
des lettres d’un ou de plufieurs mots, fans qu’il en
pût échapper un feul, après quoi il ne reftoit plus
qu’à choifir ceux qui formoient un fens convenable
au but qu’on fe propofoit.
Mais l’ufage des permutations ne fe borne pas aux
feules anagrammes, elles partagent avec les combi-
naifons l’honneur de la folution de plufieurs problèmes
curieux, de ceux en particulier oii il s’agit d’efi
timer les hafards. Voye^ Combinaison , Alternat
io n , &c.Cet article eflde M. R a l l i e r d e s O u r m e s .
P e r m u t a t io n , f. f. ( Jurifprud.) Ce terme fe
prend quelquefois pour toute forte d’échange en général
; mais communément on entend par permuta-
P E R
lion y un échange que deux titulaires font entr’eujô
de leurs bénéfices, par une démiflion entre les mains
des collateurs qui font obligés de les conférer aux
co-permutans.
Les deux réfignations peuvent fe faire par deux
aftesféparés, ou par un feul & même afte.
Ces démiflüons réciproques contiennent toujours;
qu’elles font faites pour caufe de permutation avec
la claufe non alias, non aliter, non aliomodo ; c’eft
pourquoi les provifions fur permutations, font censées
des collations néceffaires ou forcées.
Ceux qui peuvent admettre les permutations, font
le pape, le légat, le vice-légat dans l’étendue de fa
légation, & le collateur ordinaire.
Quand le bénéfice ne dépend point de l’évêque
on s’adrefle ordinairement au pape.
Quoique le collateur auquel on s’adreffe ne puiffe
pas conférer le bénéfice à un autre , il peut cependant
examiner s’il n’y a point de fraude ni de pa&ion
fimoniaque, ou autre vice qui doive empêcher l’effet
de la permutation.
Au refus de l’ordinaire, on peut s’adreffer au fu-
périeiir.
Si les deux bénéfices que l’on veut permuter font
dans deux diocèfes différens, & que l’on ne veuille
pass’adreffer au pape, il faut que l’évêque de chaque
diocèfe admette la permutation , fuppofé qu’il foit
collateur du bénéfice ; ou bien un évêque peut donner
pouvoir à l’autre de donner des provifions des
deux bénéfices.
Il y a certaines permutations qui font illicites, notamment
celles qu’on appelle triangulaire ; c’eft lorsqu’un
titulaire refigne fou bénéfice à un autre ecclé-
fiaftique , à condition que celui-ci réfigneraàun tiers
le bénéfice dont il eft pourvu ; aucune difpenfe ne
peut autorifer une telle convention.
Il n’eft pas permis de ftipuler que le co-permutant
fera chargé de faire faire les réparations des bâtimens
dépendans du bénéfice, quoique ces réparations
foient du tems du co-permutant ; il y auroit fymonie
dans cette claufe.
Il en feroit de même de celle qui obligeroit le co-
permutant à entretenir les baux faits par fon prédé-
ceffeur.
Mais fuivant l’ufage commun, le co-permutant
peut faire dreffer un procès-verbal de l’état des lieux
dépendans du bénéfice qu’on lui a réfigné ,& obliger
fon réfignant de faire les réparations qui feront éfti-
méés neceffaires.-
Une penfion que l’on créeroit fur un bénéfice en
le permutant, pour avoir lieu jufqu’à ce qu’on eût
donné un autre bénéfice de même valeur que la
penfion, ne feroit pas canonique.
On ne peut pas permuter un induit pour un bénéfice
, parce que l’indultaire n’a pas jus in re , mais
feulement jus ad rem.
Les bénéfices en patronage laïc ne peuvent être
permutés fans le confentement du patron ; autrement
la collation de l’ordinaire & du pape, même en ce
cas , feroit nulle , & les co-permutans rentreroient
chacun dans leurs droits; voye^ la déclaration de 1678.
Quand les bénéfices que l’on permute font inégaux
pour le revenu, il n’eft pas permis de recevoir
une récompenfe en argent ; il y auroit fymonie &
abus.
Onnepeutpermuterun bénéfice avec un autre qui
n’ eft pas encore érigé, ni permuter quelque chofe de
temporel avec un bénéfice, non pas même une penfion
, ni des dixmes ou un droit de patronage, quoique
tout cela participe du fpirituel.
La permutation eft fans effet; i°. quand elle n’eft
pas accomplie de part & d’autre, comme quand un
des co-permufàfls ne peut pas obtenir de v if a»
P E R
i° . Quand l’un des co-permutans n’accomplit pas
les conditions.
3°. Lorfquele bénéfice n’eft pastel qu’on l’a énoncé
? comme fi on a fuppofé que c’étoit un bénéfice
fimple , & qu’il foit à charge d’ames, ou que l’on
ait caché la véritable quotité d’une penfion dont le
bénéfice étoit chargé, cela fuffit pour donner lieu au
regrès , & le co-permutant peut rentrer dans fon bénéfice
en vertu d’un linjple jugement, fans obtenir
de nouvelles provifions.
Enfin la permutation devient encore fans effet,
quand l’un des co-permutans eft évincé du bénéfice
qui lui a été réfigné.
On peut permuter un bénéfice litigieux , pourvu
que le litige foit exprimé.
Un bénéfice tenu en commande , peut être permuté
contre un bénéfice tenu en titre, parce qu’en
France la commande vaut titre.
' On peut permuter un bénéfice contre plufieurs
autres.
Tant que le collateur n’a point donné des provifions
, le co-permutant peut révoquer fa procuration
pour permuter. Il fuffit de faire lignifier la révocation
au collateur, ou fi la réfignation pour permutation fè
fait en cour de Ronrë, on fait lignifier la révocation
au co-permutant, avant que la réfignation foit ad-
mife.
Mais fi l’un des bénéfices eft à la nomination du
roi, l’autre à la collation pure & fimple de l’ordinaire
, un des ço-permutans ne peut révoquer fa
procuration ad rejignandum , fans le confentement
du ro i, lorfque là majefté a donné fon brevet de nomination,
quoique les bulles ne foient pas encore
expédiées, ni la réfignation de l’autre bénéfice admifie
en cour de Rome.
Le collateur qui a conféré fur la permutation, ne
peut pas conférer par mort en venu de la réglé des
2.0 jours, fi ce n’eft que la réfignation peçhe dans
fon principe, ou que l’un des co-permutans eût re-
fiifé de l’exécuter pendant la vie de l’autre.
Ceux qui font pourvus fur réfignation, pour caufe
de permutation , doivent prendre poffeffion dans le
même tems, & avec les mêmes formalités que l’on
obferve pour les réfignations en faveur.
Les provifions obtenues fur permutation font milles
, fi elles ne font infinuées deux jours francs avant
le décès de l’un des co-permutans ; mais il fuffit pour
celui qui s’unit, qu’il ait fatisfait à cette condition :
fes provifions font valables.
Les procurations pour permuter entre les mains
du pape j doivent être infinuées au greffe du diocèfe
où elfes fe font ; & fi le bénéfice eft dans un autre
diocèfe, il faut aufli y faire enregiftrer les procurations
, & c e , dans trois mois après l’expédition des
provifions, le tout à peine de nullité. Déclaration de
/6V)/, art. i l .
Au refte le défaut d’infinuation ne peut être op-
pofé que par les indultaires gradués, & autres ex-
peftans, & par les patrons. Voye{ Dumolin, ad reg.
de public. Fevret ; liv. I I . ch.iv. & v. Rebuffe, prax.
tit. de permut. recueil de D rapier, tome II. ch. x x. ( J )
PERNAMBUCO ou FERNAMBUCO , ( Géog.
mod. ) capitainerie ou province de l’Amérique méridionale
au Bréfil. Elle eft bornée au nord par la capitainerie
de Tamaraca , au midi par celle de Ser-
gippe ; à l’orient par la mer, mais elle n’a point de
bornes fixées à l’occident.
Cette province eft fituée entre les huit & les dix
degrés de latitude auftrale. Elle a été découverte par
Vincent-Yannez Pinçon, Caftillan; & trois mois
après D. Pero Alvarez Cabrai, amiral de la flotte
Portugaife des Indes, fut jetté par la tempête fur les
cotes du Brefil, dont fa nation lui attribue la découverte.
Jean III. roi çlç Portugal, concéda la province
P E R 389
de Pernambuco, à Édouard d’Albuqtièf qtte, à condition
d en foumettre les habitans, ce qu’il exécuta
dans la fuite. Les Hollandois s’en étant rendu les
maîtres, le roi Jean IV. après qu’elle eut été reprife
fur eu x, la réunit au domaine. Jufqu’à l’invafion
Olinde avoit été la capitale de la capitainerie ; mais
cette ville a été prefque entièrement détruite pendant
les guerres. ( D .J . ) PERNE, (Géog.anc.) i°* île fur la côte de l’Ionie; P line, l. II. c. Ixxix. dit qu’un tremblement joignit cette île au territoire de la yille ded eM teilrerte. 2d0e. Tvihlalef udse, lfaé lTohn rSatceep,h aqnuuis é.toit à l’oppofite de celle
Perne , (Géog. mod.) petite ville, ou plutôt bourg
de France dans la Provence, au diocèfe de Carpen-
tras. Long. 2.2.41. lat. 4 4 .2 .
Cet endroit eft la patrie d’Efprit Flechier, évêque
de Lavaur en 1685 , & puis de Nifmes en 1687. Il
avoit été reçu à l’académie françoife en 1673. Il étoit,
dit M. de Voltaire, poète françois & latin, hxftorien ,
prédicateur, mais connu fiir-tout par fes belles orai-
fons funèbres. Il a traduit du latin d’Antoine-Marie
Gratiani, la vie du cardinal Gommendon ; il a donné
celle du cardinal Ximenès ; & fon hiftoire de l’empereur
Théodofe, a été faite pour l’éducation de
M. le duc de Bourgogne. Il mourut le 16 Février
1710, à 78 ans.
P e r n e s , ( Géog. mod. ) petite-fille de France dans
l’Artois fur la C larence, à trois lieues S. O. de Be-
thune , fept N. O. d’Arras. Long. 20 .6 . lat. 5o. 20.
( D . J . )
PERNETTE, f . f . v a f e à l ’u fa g e d e s p o tie rs -d e-'
t e r r e & d e s fa y a n c ie r s . Voye^Varticle F a y a n c e .
P ERNICIACUM, (Géog. anc. ) ville dé la Gaule
belgique, que l’itinéraire d’Antonin met entre Ge-
miniacum, & Aduoeca Tongrorum , à 22 milles de la
première de ces villes , & à 14 de la fécondé. On
croit que c’eft aujourd’hui Perveis, bourgade du
Brabant, entre Jemblours & Indoigne, dans le quartier
de Louvain ; & cette bourgade eft une ancienne
baronie. ( D. J. ) la PpEerRteN IdCe IEquUeXlq,u aed jc. h(oGfer.a mUn.) dcaifpeaobulres d ’eefnt trpaeîrnneir
cieux ; un confeil eft pernicieux ; un effet eft pernicieux
; un efprit eft pernicieux.
PE RN IC IT A S , f. f. ( Phyf. ) eft un mot latin ,
dont quelques auteurs fe fervent pour défigner une
viteffe extraordinaire de mouvement ; comme celle
d’un boulet qui fend l’air, delà terre dans fon orbite,
&c. Chambers.
PERNIO , terme de Chirurgie , c’eft le nom d’un
mal qui attaque ordinairement les mains Sc les piés
en hiver, & qu’on appelle vulgairement engelures.
Les parties affeftées de ce mal s’enflent, & prennent
une couleur blanchâtre , accompagnées de douleur
& de demangeaifon : cependant la tumeur fe diffipe
fans aucune exulcération, en frottant d’huile de pétrole
la partie malade. Voye^ E n g e l u r e s .
PERNISSE, voyei P e r d r i x r o u g e .
PÉROÉ , ( Géog. anc. ) petit fleuve de la Bæotie ,
fur le chemin de Platée àTnebes. Il prenoit fafource
au mont Cithéron, dont il defeeadoit par deux endroits
différens, enforte qu’il formoituneîle. (D . J .)
PÉRONÉ , f . m. (en Anatomie. ) e ft un dès os de
la jam b e , voye^ nos Planches d'Anatomie & leur explication.
Voye{ aujji les articles O s, JAMBE , &c. J
Le péroné eft l’os le plus menu des deux os de la
jambe ; cependant , quoiqu’il foit plus expofé &
beaucoup plus foible que l’os intérieur ou le tibia ,
il n’eft pas fi fujet à être caffé, parce qu’il eft plus
pliant & plus flexible ; d’où il arrive que fou vent le
tibia eft rompu, tandis que le péroné refte entier. Le péroné fe joiqt & s’articule avec le tibia aux