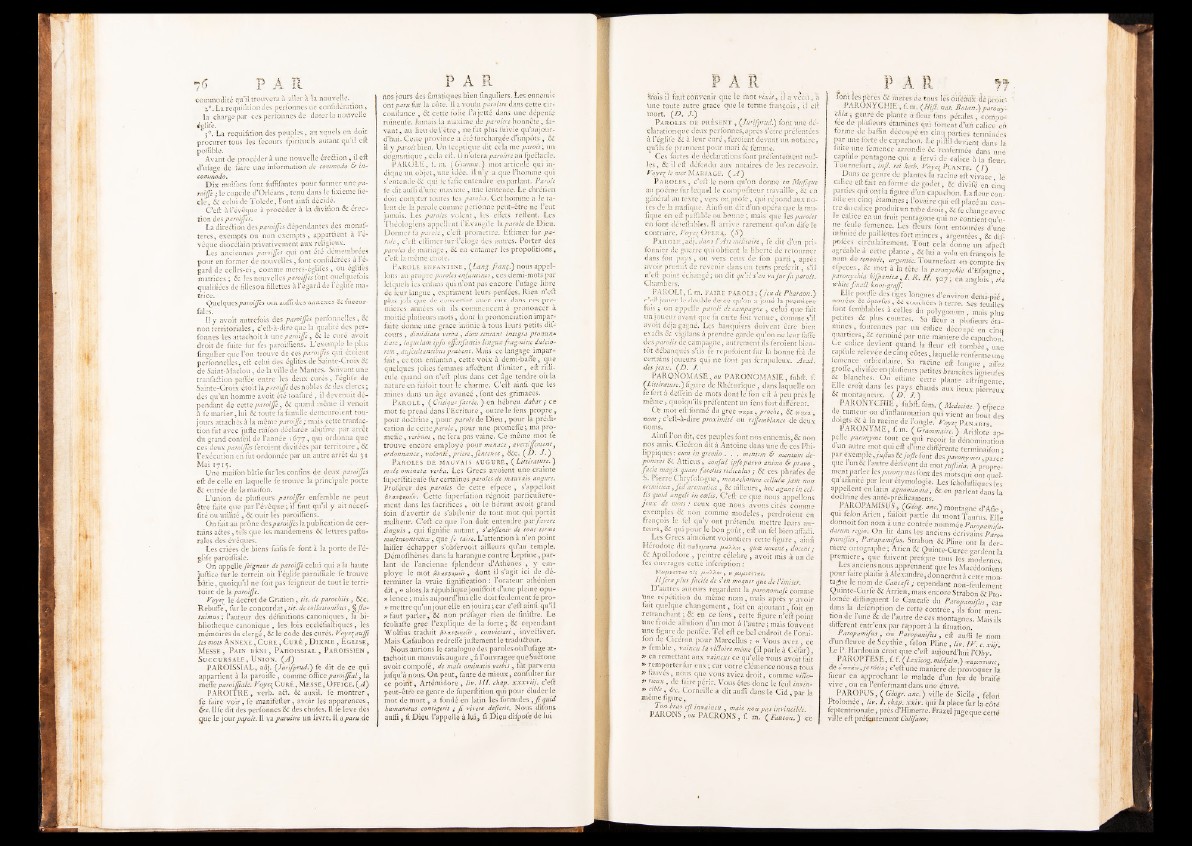
commodité qu’il trouvera à aller à la nouvelle. R
z°. La requifitiondes perfonnes de confidération,
la charge par ces perionnes de doter la nouvelle
cglife.
3°. La requifition des peuples, au xquels on doit
procurer tous les fecours fpirituels autant qu'il efl
poffible. ' .
Avant de procéder à une nouvelle érettion, il eu
d’ufage de faire une information de commodo & in-
commodo.
D ix maifons font fuffifantes pour former une paroijfe
; le coqcile d’Orléans, tenu dans le fixieme fie-
c le , & celui de Tolede, l’ont ainfi décidé.
C ’efl à l’évêqüe à procéder à la divifion & érection
des paroijfes.
La dire dion des paroijfes dépendantes des monaf-
teres, exempts ou non exempts, appartient à l’e-
vêque diocéfain privativement aux religieux.
Les anciennes paroijfes qui ont été démembrées
pour en former de nouvelles, font confiderees à 1 e-
gard de celles-ci, comme meres-églifes , ou églifes
matrices ; & les nouvelles paroijjes font quelquefois
qualifiées de filles ou fillettes à l’ egard de 1 eglife matrice.
Quelques paroijfes ont aufii des annexes & fuccur-
fales.
Il y avoit autrefois des paroijfes perfonnelles , &
non territoriales, c’efl-à-dire que la qualité des perfonnes
les attachoit à une paroijje, & le cure avoit
droit de fuite fur fes paroifîiens. L’exemple le plus
fingulier que l’on trouve de ces paroijfes qui étoient
perfonnelles, efl celui des églifes de Sainte-Croix &
de Saint-Maclou, de la ville de Mantes. Suivant une
tranfadion paffée entre les deux curés, l’eglife de
Sainte-Croix étoit laparoijfe des nobles &C des clercs ;
dès qu’un homme avoit été tonfuré, il devenoit de-
pendant de cette paroijfe, & quand même il venoit
à fe marier, lui & toute fa famille demeuroient toujours
attachés à la même paroijfe; mais cette tranfac-
tion fut avec jufle raifon déclarée abufive par arrêt
du grand conféil de l’année 16 7 7 , qui ordonna que
ces deux paroijfes feroient divifées par territoire , &
l’exécution en fut ordonnée par un autre arrêt du 31
Mai 1715.
Une maifon bâtie fur les confins de deux paroijfes
eft de celle en laquelle fe trouve la principale porte
& entrée de la maifon.
L’union de plufieurs paroijfes enfemble ne peut
être faite que par l’évêque ; il faut qu’il y ait necef-
fité ou utilité , & ouir les paroiffiens. _
On fait au prône des paroijfes la publication de certains
aétes, tels que les mandemens & lettres pafto-
rales des évêques.
Les criées de biens fâifis fe font à la porte de -l’é-
glife paroiffiale.
On appelle feigneur de paroijfe celui qui a la haute
juftice fur le terrein oîi l’églife paroiffiale fe trouve
bâtie, quoiqu’il ne foit pas feigneur de tout le territoire
de la paroijfe.
Foye^ le decret de Gratien, tit. de parochiis, &c.
Rebuffe, fur le concordat, tit. de collationibus, § Jia-
tuimus ; l’auteur des définitions canoniques, la bibliothèque
canonique, les lois eccléfiaftiques, les
mémoires du cierge, & le code des curés. Voye^aujji
les mots Annexe , C ure , Curé , D ixme , Eglise,
Messe, Pain béni , Paroissial , Paroissien ,
Su c cu r sa l e , Union. (A )
PAROISSIAL, adj. (Jurifprud.'y fe dit de ce qui
appartient à la paroiffe, comme office paroijjîal, la
méfiéparoiffiale. Foye{Cu ré, Messe,O ffice. (A~)
PAROITRE, verb. aû. & auxil. fe montrer,
fe faire v o ir , fe manifefler, avoir les apparences,
&c. Ilfe dit des perfonnes & des chofes. Il fe leve dès
que le jourpajoh. Il ya paraître un livre. Il aparu.de
ftos jours des fanatiques bien finguliers. Les ennemis
ont paru fur la côte. Il a voulu paroitre dans cette cir-
conitance , & cette folie l’ajetté dans une dépenfè
mineufe. Jamais la maxime de paroître honnête, fa-
vant, au lieu de l’être, ne fut plus fiiivie qu’aujôur-
d’hui. Cette province a été furchargée d’impôts , ôc
il y paroît bien. Un lceptique dit cela me parole ; un
dogmatique , cela efl. Ll n’oiera paroitre au fpeélacle.
PAROLE, i. m. (Grammf mot articule qui indique
un objet, une idée. Il n’y a que l’homme qui
s’entende & qui le fafiè entendre en parlant. Parole
fe dit auffi d’une maxime, une fentence. Le chrétien
doit compter toutes fes paroles. Cet homme a le talent
de la parole comme perlonne peut-être ne l’eut
jamais. Les paroles volent, les effets relient. Les
Théologiens appellent l’Evangile la parole de Dieu*
Donner fa parole, c’ell promettre. Eftimer fur pa
tôle, c’ell ellimer fur -l’éloge des autres. Porter des
paroles de mariage, & en entamer les propolitions,
c’ell la même chofe.
Parole enfantine, ( Lang.franç.) nous appelions
au propre paroles enfantines, ces demi-mots par
lelquels les enfans qui n’ont pas encore l’ufage libre
de leur langue , expriment leurs penfées. Rien n’ell
plus joli que de converfer avec eux dans ces premières
années 011 ils commencent à prononcer à
moitié plulieurs mots, dont la prononciation imparfaite
donne une grâce infinie à tous leurs petits difr
cours , diniidiata verba , dîirn tentant integra prônun*
tiare 3 loquelam ipfo offenfantis lingtue fragmine dulcio-
rem, aufcultantibus preebent. Mais ce langage impars
fa it , ce ton enfantin, cette voix à demi-baffe , que
quelques jolies femmes affectent d’imiter, ell ridicule
quand on n’ell plus dans cet âge tendre où la
nature en faifoit tout le charme. C ’en ainfi que les
mines dans un âge avancé , font des grimaces.
Pa r o l e , (Critiquefacrée. ) en hébreu dabar; ce
mot le prend dans l’Ecriture, outre le fens propre ,
pour do&rine , pour parole de D ieu , pour la prédication
de cette parole, pour une promeffe; ma promette
, verbum, , ne fera pas vaine. Ce même mot fe
trouve encore employé pour menace, avertijfement,
ordonnance y volonté, prière y fentence y ÔCc. (D . A )
Paroles de mauv ais augu re, ( Littérature. )
male ominata verba. Les Grecs avoient une crainte
fuperllitieufe fur certaines paroles de mauvais augure.
Proférer des paroles de cette efpece , s’appelloit
Cette fuperfiition régnoit particulièrement
dans les facrifices , où le héraut avoit grand
foin d’avertir de s’abllenir de tout mot qui portât
malheur. C ’ell ce que l’on doit entendre yaxfavere
linguis , qui lignifie autant, s'abflenir de tout terme
malencontreux, que fe taire. L’attention à n’en point
laiffer échapper s’obfervoit ailleurs qu’au temple.
Démollhènes dans la harangue contre Leptine, parlant
de l’ancienne fplendeur d’Athènes , y employé
le mot !&X'j.<r<p-,\fAiïv, dont il s’agit ici de déterminer
la vraie lignification : l’orateur athénien
d it , « alors,la république jouiffoit d’une pleine opu-
» lence ; mais aujourd’hui elle doit feulement fe pro-
» mettre qu’un jour elle en jouira; car c’ell ainfi qu’il
» faut parler,' & non préfager rien de finillre. Le
fcolialle grec l’explique de la forte ; & cependant
"Wolfius traduit P\cfs<pa/j.i7v , conviciari, inveéliver.
Mais Cafaubon redreffe jullementle traduéleur.
Nous aurions le catalogue des paroles où l’ufage at-
tachoitun mauvais augure, fi l’ouvragee queSuetone
avoit compofé, de mate ominatis verbis, fut parvenu
jufqu’à nous. On peut, faute de mieux, conlulter fur
ce point, Artémidore , liv. 111. chap. xxxviij. c’ell
peut-êtr*e ce genre de fuperflition qui pour éluder le
mot de mort, a fondé en latin les formules ,J i quid
humanitus contigerit ; f i vivere defierit. Nous difons
auffi, fi Dieu l’appelle à lui, fi Dieu difpofe de lui
P A R P À R w
friais il faùl convenir qit'e le mot v i x i t il a veèit, â
fine toute autre grâce que le terme françois, il cil
friort. (D . ƒ.)
Paroles de présent , (furïjprud.) foiit Une déclaration
que deux perfonnes, après s’être préfentées
à l’églife & à leur curé, feroient devant un notaire;
qu’ils fe prennent pour mari & femme.
Ces fortes de declarations'font préfentement milles
, & il ell défendu aux notaires de les recevoir.
Voye{ le mot Mariage-. ( A )
Paroles , c’ell le nom qu’on donne en Mufiqve
au poème fur lequel le compofiteur travaille , & en
général au texte, vers ouprofe, qui répond aux notes
de la mufique. Ainfi on dit d’un opéra que la mu-
fique en ell paffable ou bonne ; mais que les paroles
en font détellables. Il arrive rarement qu’on dife le
contraire. Voye{ O per^. ( i 1)
Parole , adj. dans L'Art militaire ; fe dit d’uh pri-
fonnier de guerre qui obtient la liberté de retourner
dans fon p a y s , ou vers ceux de fon parti, après
avoir promis de revenir dans un tems preferit, s’il
n’ell point échangé; on dit quiis'eji va furfaparole.
Chambers.
PAROLI, f. m. faire PAROLi ; ( jeu de Phardon.')
c’ell jouer le double de> ce qu’On a joué la première
fois ; on appelle paroli de campagne , celui que Fait
un joueur avant que fa carte foit venue, comme s’il
avoit déjà gagné. Les banquiers doivent être bien
exaéls & vigilans à prendre garde qu’on ne leur faffe
desparolis de campagne, autrement ils feroient bientôt
débanqùés s’ils le repofoient fur la bonne foi de
certains joueurs qui ne font pas fcrupuleux; Acad.
des jeux. ( D . J. 1
PARONOMASE, ou PARONÔMASIE, fubll. f.
(Littérature.) figure de Rhétorique, dans laquelle on
fe fert à d'effein de mots dont le fon ell à peu près le
même > quoiqu’ils préfentent un fens fort différent.
Cfe mot ell formé du grec wapa, proche, & ovo/xa
nom ; c’e'll-à-dire proximité ou refjemblance de deux
noms-,
Ainfi l’on dit, ces peuples font nos ennemis, & non
nos amis. Cicéron dit à Antoine dans une de ces Phi-
lippiques: curn in gremio . . . rnentern & mentum de-
poneres & Atticus , conful ipfeparvo animo & p'ravo
fade magis quant facetiis ridiculus ; & ces phrafes de
S. Pierre Chryfologue, monachomm cêlluloe jarn non
eremiticæ,fed arematicoe , & ailleurs, hoc agant in cel-
lis quod angeli incoelis. C’ell ce que nous appelions
jeu x de mots : ceux que nOus avons cités comme
exemples & non comme modèles , perdroient en
françois le fel qu’y ont prétendu mettre leurs auteurs,
& qui pour le bon goût; ell un fel bien affadi.
Les Grecs aimoient volontiers cette figure , ainfi
Hérodote dit 7ra6ii//.cnet /xttXXov, qiice hoceht, dotent ;
& Apollodore , peintre célébré , avoit mis à un de
fes ouvrages eetté infeription :
Mut/J.wra.1 t/ç fxaXMv , » /xi/xciriTctr.
IlJ'era plus facile de s'en 'moquer que de-f initier i
D auti es auteurs regardent la paronomaft comme
fine répétition du même nom, mais après y avoir
fait quelque changement, foit 'en ajoutant, foit en
retranchant ; & en ce fens , cette figure n’ell point
une froide allufion d’un mot à l’autre ; mais fouvent
une figure de penfée. T el ell ce bel endroit de l’orai-
fon de Cicéron pour Mareellus : « Vous avez - ce
» femble , vaincu la victoire même (il parle à Céfar),
» en remettant aux vaincus ce qu’elle vous avoit fait
» remporter fur eux; car votre clémence nous a tous
» fauves, nous que vous aviez droit, comme victo-
V ncux > cle faire périr. Vous êtes donc le feul invin-
i Wm ï- ^c‘ C ° rneide a dit auffi dans le Cid , par la
meme figure,
■ ■ 1 1 imaiitm , m4iï non pas H M H M 1
PARONS, ôü PACRONS, f. m. (lançon.) 'ci
lôïit p § péfës & mères de tous lès ôiféâûx: tlè broie’.
PARONYCHIE ; f. m. (Hifbc nai. Botarif parony-
-chia ; genre de planté à fleur fans pétales , comno-
fee de plufieürs étamines qui fortent d’un calice* eA
forme de baffin découpé en cinq parties terminées
par une forte de capucheii. Lé.pillil devient dans la
lune une femenee arrondie & renfermée dans une
capfule pentagone qui a lèrvi de calice à la fleur.
Tournefort, infl. rei herb. Voye{ Planter ( / )
Dans ce genre de plantes là racine ell vivacé ; lé
eahee ell fait en forme de godet, & divifé en cinq
parties qui ont la figure d’un capuchon. La fleur con-
filte en cinq étamines ; l’ovaire qui ell placé au centre
du calice produit un tube d roit, & fe change avec
le calice en un fruit pentagone qui ne contient qu’u-
ne foule femenee. Les fleurs font entourées d’une
infinité de paillettes fort minces , argentées, & dif-
polees circfulairement. Tout cela donne un afpeél
agréable à cette plante , & lui a valu en françois lé
nom. de renonce, argentée. Tournefort; en dompte fix
elpeces, & met a la tête la paronychie d’Efpagne
ÿspmhite fmÊ ccÊll kÊnotÊ-grBaJJB. u m W - , W H
Elle pouffe des tiges langues d’environ denii-pié t
nouees & eparles , & couchées à terré. Ses feuilles
font femblables à ceUeâ'du polygonum , mais plus
petites & plus courtes. Sa fleur a plufieurs étamines,
ioutenues par un calice découpé en cinq
quartiers, & terminé par urie maniéré de capuchon
Ce calice devient quand la fleur eft tombée une
capfule relevée de-cinq côtes,laquelle renfermetiné
femenee orbiculaire: Sa racine eft longue, affez
greffe, divifee en plufieurs petites branches ligrieufes
& blanches. On eftime cette plante aftringente-
Elle croit dans les pays chauds aux lieux, pierreux
& montagneux. ( D . J. )
PARONYCHIE , fubft. fem. ( Médecine. ) efpece
de tumeur ou d’inflammation qui vient au bout des
doigts & à la racine de l’ongle. Foyer Panaris
PARONYME, f. m. •( Grammaire. ) Arilfote ap-
peUe paronyme tout ce qui reçoit fa dénomination
d un autre mot qui eft d’une différente terminaifon ;
par exemple yjuflus & jujle font des paronymes parce
que 1 un & l’autre dérivent du mot juftitià. A propre-
B B I H n mots qui ont quel-
qu afnmte par leur étymologie. Les feholaftiques les
appellent en latin agnomïnaia, & en parlent dans la
doctrine des anté-prédicamens.
PAROPAMISUS, (Géog. ancf montagne d’Afie ■
qui félon Anen, faifoit partie dit mont Taurus Elle
donnoit fon nom à une contrée nommée Parôpamira.
darunt regto. On lit dans les anciens écrivains Paro-
pamifus, Parapamifus. Strabon & Pline ont la der
mere ortographe ; Arien & Quinte-Curce gardent la
première, que fuivent prefque tous lés modernes'
Les anciens nous apprennent que les Macédoniens
pour faire plaifir à Alexandre, donnèrent à cette mon- 111 doe Cauçafe; cependant non-feulement
Quinte-Curfe & Arrien, mais encore Strabon & Pto-
lomee diflinguent le Gaucafe du Paropamifus car
dans la deferiptiori de cette contrée, ils font Mention
de Tune & de l’autre de ces montagnes. Mais ils
different entr’eux par rapport à la fituatiori.
Paropamifus, ou Paropanifùs, efl auffi lé rioni
d un fleuve de Scythie , félon Pline , liv. IF . c. xiij.
Le P. Hardouin croit que c’efl aujourd’hui fObv.
. PARpPTESE, f. f. (Lexicog. rnédicinf
de o nrrcito y je rôtis; c’efl urie maniéré de provoquer là
fueur en approchant le malade d’un feu de braifé
vive , ou en l’enfermant dans une étuve.
PAROPUS, ( Géôgr. aiic f ville de Sicile , felorl
Ptolomée , liv. I. chdp. xxivi qui la place fur la côté
feptentrionale ; près d’Himerre. Frazel juge que cetté
ville efl préfontement Colifano-,