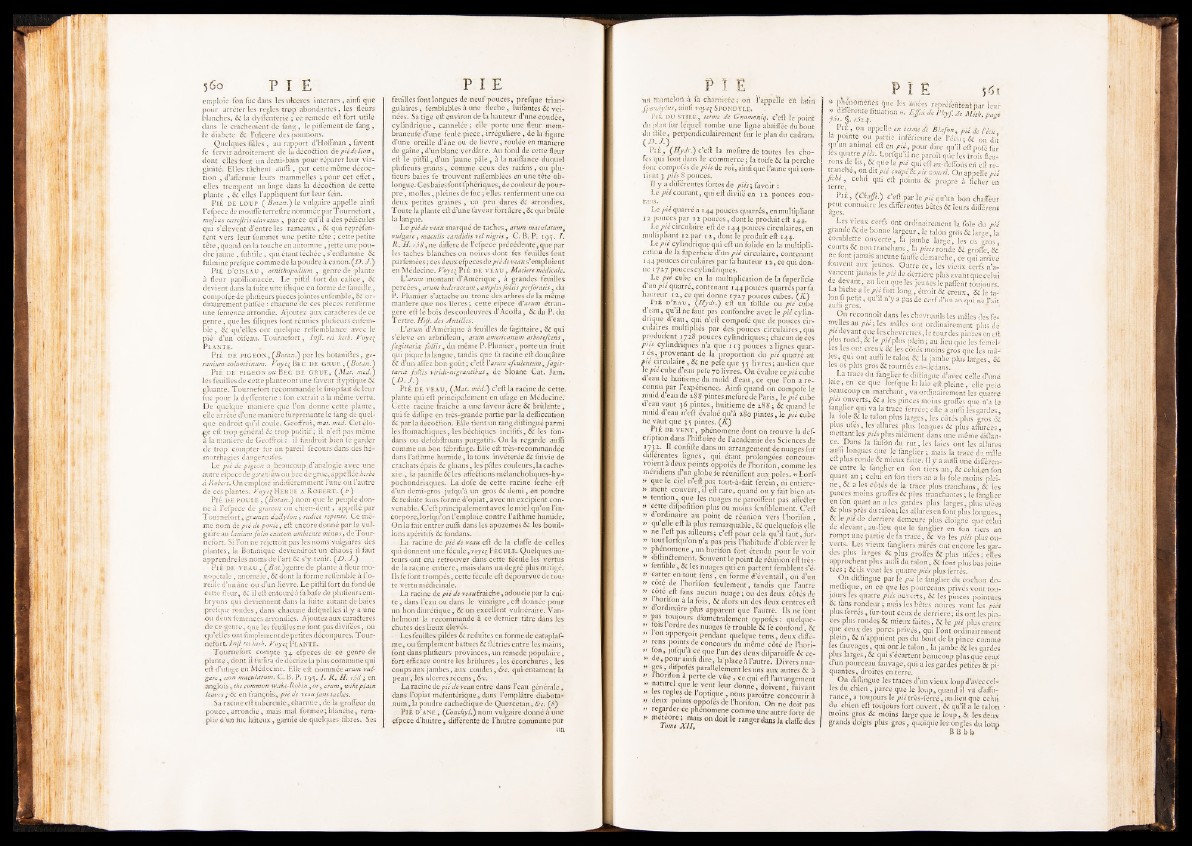
emploie Ion lue dans les ulcérés internes , ainfi que
pour arrêter les réglés trop abondantes, les fleurs
blanches, & la dyflenterie ; ce remede eft fort utile
dans le crachement de fang , le piffement de fang,
le diabete & l ’iflcere des poumons.
Quelques filles, au rapport d’Hoffman , favent
fe fervir adroitement de la décoûion de pié de lion,
dont elles font un demi-bain pour réparer leur virginité.
Elles tâchent alifli, par cette même décoction
, d’affermir leurs mammelles ; pour cet effet,
elles trempent un linge dans la déco&ion de cette
plante , & elles l’appliquent fur leur fein.
P i i d e l o u p ( Botan.') le vulgaire appelle ainfi
l’efpece de moufle terreftre nommee parTournefort,
mojeus terrejlris clavatus , parce qu’il a des pédicules
qui s’élèvent d’entre les rameaux , Sc qui repréfen-
tent vers leur fommet une petite tête ; cette petite
tê te , quand on la touche en automne , jette une poudre
jaune , fubtile, qui étant féchée , s’enflamme &
fulmine prefque comme de la poudre à canon.(Z>. J.)
P i i d’o ise a u , ornithopodium , genre de plante
à fleur papilionacée. Le piftil fort du ca lice, &
devient dans la fuite une filique en forme de faucille,
compofée de plufieurs pièces jointes enfemble, & ordinairement
pliffée : chacune de ces pièces renferme
une femence arrondie. Ajoutez aux carafteres de ce
genre , que les filiques font réunies plufieurs enfemble
, & qu’ elles ont quelque reffemblance avec le
pié d’un oifeau. Tournefort, Injl. rei herb. Voyei
P l a n t e .
PiÉ d e PIGEON, (Botan.') par les botaniftes, géranium
columbinum. Ÿoye^ BfiC DE GRUE , (Botan.)
Pié d e p ig e o n ou Be c d e g r u e , (Mat. med.')
les feuilles de cette plante ont une faveur ftyptique Sc
gluante. Tournefort recommande le firopfait de leur
nie pour la dyflenterie : l'on extrait a la même vertu.
De quelque maniéré que l’on donne cette plante,
elle arrête d’une maniéré furprenante le fang de quelque
endroit qu’il coule. Geoffroi, mat. med. Get éloge
eft trop général 5c trop poiitif ; il n’eft pas même
à la maniéré de Geoffroi : il faudroit bien fe garder
de trop compter lïir un pareil fecours dans des hémorrhagies
dangereufes. .
Le pié de pigeon a beaucoup. d’analogie avec une
autre efpece de géranium ou bec de grue, appellée herbe
à Robert. On emploie indifféremment l’une ou l’autre
de ces plantes. Roye\ He r b e a R o b e r t . ( b )
Pié d e p o u l e , (Botan.') nom que le peuple donne
à l’efpece de gramen ou chien-dent, appelle par
Tournefort, gramen daclylon, r'adice repente. Ce même
nom de pié de poule, eft encore donné par le vulgaire
au lanium folio enutem ambiente minus, de Tournefort.
Si l’on ne rejettoit pas les noms vulgaires des
plantes, la Botanique deviendroit un chaos; il faut
apprendre.les noms de l’art & s’y tenir. (D . J .)
P i É d e v e a u , ( Bot.)genre de plante à fleur monopétale
, anomale, Sc dont la forme reflemble à l’oreille
d’un âne ou d’un lievre. Le piftil fort du fond de
cette fleur, 6z il eft entouré à fa bafe de plufieurs embryons
qui deviennent dans la fuite autant de baies
prefque rondes, dans chacune defquelles il y a une
ou deux femencés arrondies. Ajoutez aux caraéteres
de ce genre, que les feuilles ne font pasdivifées, ou
qu’elles ont Amplement de petites découpures. Tournefort.
In(l rei herb. Voye{ PLANTE.
Tournefort compte 34 efpeces de ce genre de
plante ; dont il fuffira de décrire la plus commune qui
eft d’ufage en Médecine. Elle eft nommée arumvul-
gare, non rnaculatum. C. B. P. 195. I. R. H. 1S8 ; en
anglois, the common wake-Robin , or , arum, wiht plain
leaves ; Sc en françois, pie de veau Jans taches.
Sa racine eft tubéreufe, charnue, de la groffeurdu
pouce, arrondie, mais mal formée ; blanche, rem-
. plie d’un lue laiteux, garnie de quelques fibres. Ses
feuilles font longues de neuf pouces, prefque triangulaires
, femblables à une fléché, luifantes & veinées.
Sa tige eft environ de la hauteur d’une coudée,
cylindrique , cannelée ; elle porte une fleur mem-
braneufe d’une feule piece, irrégulière, de la figure
d’une oreille d’âne ou de lievre, roulée en maniéré
de gaine, d’un blanc verdâtre. Au fond de cette fleur
eft le piftil, d’un jaune pâle, à la naifl'ance duquel
plufieurs grains, comme ceux des raifins, ou plufieurs
baies fe trouvent raffemblées en une tête ob-
longue. Ces baies font fphériques, de couleur de pourpre
, molles, pleines de fuc ; elles renferment une ou
deux petites graines , un peu dures Sc arrondies.
Toute la plante eft d’une faveur fort âcre, Sc qui brûle
la langue.
Le pié de veau marqué de taches, arum rnaculatum,
vulgare, maculis candidis vel nigris , C .B . P. i ÿ f /.
R. H. iS8,ne différé de l’efpece précédente, que par
les taches blanches ou noires dont fes feuilles font
parfemées ; ces deux efpeces de pié de veau s’emploient
en Médecine. Voye{ P i é d e v e a u , Matière médicale.
U arum montant d’Amérique, à grandes feuilles
p e r c é e sarum hederactum, amplis foliisperforatis, du
P. Plumier s’attache au tronc des arbres de la même
maniéré que nos lieres ; cette efpece d’arum étrangère
eft le bois des couleuvres d’Acofta, & du P. du
T ertre. Hiß. des Antilles.
U arum d’Amérique à feuilles de fagittaire, & qui
s’élève en arbriffeau, arum americanum arborefeens,
fagittarice foliis, du même P. Plumier, porte un fruit
qui pique la langue, tandis que fa racine eft douçâtre
St d’un afléz bon goût; c’eft Y arum efculentum, fagittarice
foliis viridi-nigrantibus, de Sloane Cat. Jam. mÊm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Pié d e v e a u , (Mat. méd.) c’eft la racine de cette\
plante qui eft principalement en ufage en Médecine.'
Cette racine fraîche a une faveur âcre Sc brûlante,
qui fe diflipe en très-grande partie par la defliccation
Sc par la décoûion. Elle tient un rang diftingué parmi
les ftomachiques, les béchiques incififs, Sc les fon-
dans ou defobftruans purgatifs. On la regarde aufîi
comme un bon fébrifuge. Elle eft très-recommandée
dans l’afthme humide, la toux invétérée Sc fuivie de
crachats épais Sc gluanß, les' pâles couleurs, la cachexie
, la jaunifle&les affeâions mélancholiques-hy-
pochondriaques. La dofe de cette racine feche eft
d’un demi-gros jufqu’à un gros Sc demi, en poudre
& réduite fous forme d’opiat, avec un excipient convenable.
C’eft principalement avec le miel qu’on l’incorpore,
lorfqu’on l’emploie contre l’afthme humide.
On la fait entrer aufli dans les apozemes Sc les bouillons
apéritifs Sc fondans.
La racine de pié de veau eft de la claffe de celles
qui donnent une fécule,voye^ F é c u l e . Quelques auteurs
ont cru retrouver dans cette fécule les vertus
de la racine entière, mais dans un degré plus mitigé.
Ils fe font trompés, cette fécule eft dépourvue de toute
vertu médicinale.
g La racine de pié de veau fraiche, adoucie par la cuite
, dans l’eau ou dans le vinaigre, eft donnée pour
un bon diurétique, Sc un excellent vulnéraire. Van-
helmont la recommande à ce dernier titre dans les
chutes des lieux élevés.
Les feuilles pilées Sc réduites en forme de cataplaf-
me, ou fimplement battues Sc flétries entre les mains,
font dans plufieurs provinces, un remede populaire,
fort efficace contre les brûlures, les écorchures, les
coups aux jambes, aux coudes ,& c . qui entament la
peau, les ulcérés récens, &c.
La racine de pié de veau entre dans l’eau générale,
dans l’opiat méfentérique, dans l’emplâtre diabota-
num, la poudre cacheèlique de Quercetan, &c. (b)
P i é d ’ a n e , (Conchyl.) n om v u lg a ir e d o n n é à u n e
e fp e c e d’h u i t r e , d iffé r en te de l’h u it re com m u n e p a r
un
tort mâffièlôrt a fa c h àm ie f e ; o n ï ’a p p è î îè e h la tin
fpondylus, ainfi voye^ S p o n d y l e .
P i é d u STILE-, terme de GnOmohiq. 'c’ e ft le p o in t
du plan fu r le q u e l tom b e u n e lig n é ab a iffé e du b o u t
du ftile j p e rp e n d icu la ir em e n t fu r le p lan du c a d ra n .
( O. J .) . . .
Pié , (Hydr.) e’eft la mefure de toutes les cho-
fes qui font dans le commerce ; la toife Sc la perche
font compofés de pies de roi, ainfi que l’aune qui contient
3 pies 8 pouces.
Il y a différentes fortes de pies; faveir :
Le pu courant, qui eft divifé en i 2 pouces eou-
ïans.
Le pié quàrré a 144 pouces qtiarrés, en multipliant
.i 2 pouces par 12 pouces, dont le produit eft 144.
Le piécirculaire eft de 144 pouces circulaires, en
multipliant 12 par 12 , dont le produit eft 144.
Le pu cylindrique qui eft un folide en la multiplication
de la fuperficie d’ün pié circulaire, contenant
144 polices Circulaires par fa hauteur 12, ce qui donne
1717 pouces cylindriques.
} Le pie cube en la multiplication de la fuperficie
d’un pie qiiarré, contènant 144 pouces quarres par fa
hauteur 12, ce qui donne 1727 pouces cubes. (K )
^ Pié d ’ e a u , (Hydr.) eft un folide ou pié cube
d’eau, qu’il ne faut pas confondre avec le pié cylindrique
d’eau, qui n’eft conypofé quë de pouces circulaires
multipliés par des pouces circulaires, qui
produisent 1728 pouces cylindriques; chacun décès
pies cylindriques n’a que 113 pouces 2 lignes quar-
r es, provenant de la proportion du pié quarré ait
pié circulaire, & ne pefe que 5 5 livres ; au-lieu que
le pie cubé d’eau pèfe 70 livres. On évalue ce pié cube
d’eau le huitième du muid d’eaii, ce que l’on a reconnu
par l’expérience. Ainfi quand on compofe le
muidd’èaudë 288 pintes mefure de Paris, ie pié cube
d’eau vaut 36 pintes, huitième de 288 ; & quand le
muid d’eau n’eft évalué qu’à 280 pintes, le pié cube
he vàüt que 3 5 pintes. (K )
P i e d e v e n t , phénomenè dont on trouve la def-
cnption dans l’hiftoire de i’académie des Sciences de
173 2. Il confifte dans un arrangement de nuages fur
differentes lignes, qui étant prolongées concour-
Toient à dëhx points oppofes de i’horifon, comme les
méridiens d’un globe fë réunifient aux pôles. « Lorf-
i> que le ciel n’eft pas tout-à-fait ferein, ni entiere-
f> ment couvért, il eft rare, quand on y fait bien at-
» tention, qim les nuages ne paroiflent pas affeûer
» cétte difpofition plus ou moins fenfiblement. C’eft
» d ordinaire au point de réunion vers l’horifon,
»> qu elle eft la plus remarquable, & quelquefois elle
» ne 1 eft pas ailleurs; c’eft pour cela qu’il faut, fur-
» tout lorfqu’on n’a pas pris l’habitude d’obferver le
M PhAénomene 1 un horifon fort étendu pour le voir
» diftinâement. Souvent le point de réunion eft très-
» fenfible, & les nuages qui en partent femblent s’é-
carter en tout fens, en formé d’éventail, ou d’un
» cote de l’horifon feulement, tandis que l’autre
w ;e^ fans aucun nuage ; oii. des deux côtés de
| or.1fon. a fa fois, & alors uh des déux centres eft
» d ordinaire plus apparent que l’aütrè. Ils ne font
» pas toujours diamétralement oppofés : quelqué-
» rois 1 ordre des nuages fe tfouble & fe confond, &
» 1 on apperçoit pendant quelque tenis, deux diffé-
» rens points de concours du même côté de l’hori-
» Ion, julqu à cé que l’un des dellx difpàroifîe & ce-
w de »pour ainfi dire, la'place à l’autre. Divers nua--
1 § f s » difpofes parallèlement les uns au je autres & à
>> 1 honfon à perte de vûe , cè qui eft l’arrangement
>> naturel que le vent leur donné, doivent, fuivànt
« les réglés de 1 optique , nous paroître concourir à
» d e u x p o in t s o p p o fe s de l’h o r ifo n . O n rte d o i t pas
» regarder ce phenomeiie Comme Une autre forte dé
» meteore ; mais on doit le ranger dans la claffe des
Tomt XIR
» p^ienômèriês Sjue lès niiées rèp:
» ciifïercïite fiînatioè >>■. -Efjai de ï\
P ’ -
Pie , on appelle en terme dé BL
lâ pointe ou paitié inférieurê dé
qu’un animal eft en pié, pour dire
fés quatre pié's. Lorfqu’il ne paroît
rons dé lis, & que le pié qui eft au-
tranché > on dit pié coupé de pié nout
fiché, 'celui qui éft pointu & pr
terre.
fefftèrft par leur
hyf de Mét/t. page
tfof; pié de Pécii;
l’écu ; & on dit
: qu’il eft pôfé fur
q u e les trois fleu^
'déffoùs en eft re-
n. On appelle pié
opré à ficher en
Pié , (f'hàjft.) c’eft par le pié qu’un bon chaffèur
peut connoitre les différentes bêtes & leurs différens
âges.
Les vieux cerfs ont Ordinairement la fôlé du p ié
grande & de bonné largeur, le talôn gros & Iàrae, là
comblette ouverte, la jambe large, les Os gros ;
courts & non tranchans, la piece ronde & gróffe, &
ne font jamais aucune faiiflè démarche, ce qui arrivé
louvént aux jeûnes. Outre c è , lés vieux cerfs n’avancent
jamais le p ié de derrière plti's avant qiie celui
de devant, au lieu que lès jeunes lepâffent toujours.
La biche a l e p t e fort long, étroit & creux, & le talon
fi petit, qu’il n’y a pas de cerf d’un an qui ne l’ait
aulii gros.
On reconnoît dans les chevreuils les mâles dès femelles
aii p ie ; les mâles Ont Ordinairement plus dé
p ie devant que les chevrettes, le tour des pinces en eft
plus rond, & le p ié plus plein ; au lieu qiie les femelles
les ont creux & les côtés moins gros que les mâles
, qui Ont aufli le talon & là jambe plus larges, &
les Os plus gros & tournés en-dédarts.
La trace du fanglier fe diftingué d’avec celle d’üné
laie, en ce que lorfqUe la laie eft pleine > elle pefé
beaucoup en marchant, va ordinairement les quatré
p ié s ouverts, & a les pinces moins greffes que n’a le
fanglier qui va la trace ferrée; eüe a aufli les gardes,
la iole & le talon plus larges, les Côtés plus gros Sc
plus ufés, les'allures plus longues & plusaffurées,
mettant les plus âilement dans une même diftan-
ee. Dans la faifôn du fut , les laies Ont lés allures
aufli longues que le'fartglier ; mais la tracé dii mâle
eft plus ronde & mieux faitè; 11 ÿ â aufli Une différence
entre le fanglier en fon tiers an, & celui.en fon
quart ah ; celui en fôn tiers an a la foie moins pleine,
& a les cotés de la trace plus tranchans, & les
pinces moins groffes&-p!us tranchantes; le fanglier
en fdn quart an a-Ies- gardes plus larges, plus ufées
& plus près du talon; les allures en font plus longues,
& le p ié de derrière demeure plus éloigné que celui
de devant; au-lieu que le fanglier en fon tiers an
rompt Une partie delà trace, & va les piés plus ouverts.
Les vieux -fangliers mires ont encore les gardes
plus larges & plus groffes & plus ufées ; elles
approchent plus aufli du talon, & font plus bas join-*
teès ; & ils. vont les quatre p ié s plus ferrés.
On diftingué par le p ié le fanglier du cochon do-
meftique, en ce que les pourceaux privés vont toujours
les quatre p ie s ouverts, & les pincés pointues
& fans rondeur ; niais les bêtes noires vont les p ié s
plus ferres , fur-tout ceux de derrière; ils ont les pinces
plus rôndés & rnieiix faites, S t le p ié plus creux
que ceux des porcs privés, qui l’oht ordinairement
plein, & n’appuient pas du bout de là pince comme
les fauvages, qui ont le talon, la jambe Si les gardes
plus larges, & mii s’écartent beaucoup plus qüe ceux
d un pourceaii faUvàgè, qui a les gardes petites & piquantes
, droites en terré.
On diftingué les traces d’ iin vieux loup d’avec celles
dü chien , parce que lé loup, quand il và d’affu-
rancë, a toujours le p ié très-fërré, aii-lieu que celui
du chien eft toujours fort ouvert, & qu’il a lé taloii
ttioinS gros & moins large que lé loup, & lès deux
grands doigts plus gros, quoique les ongles du lottp
B B b b