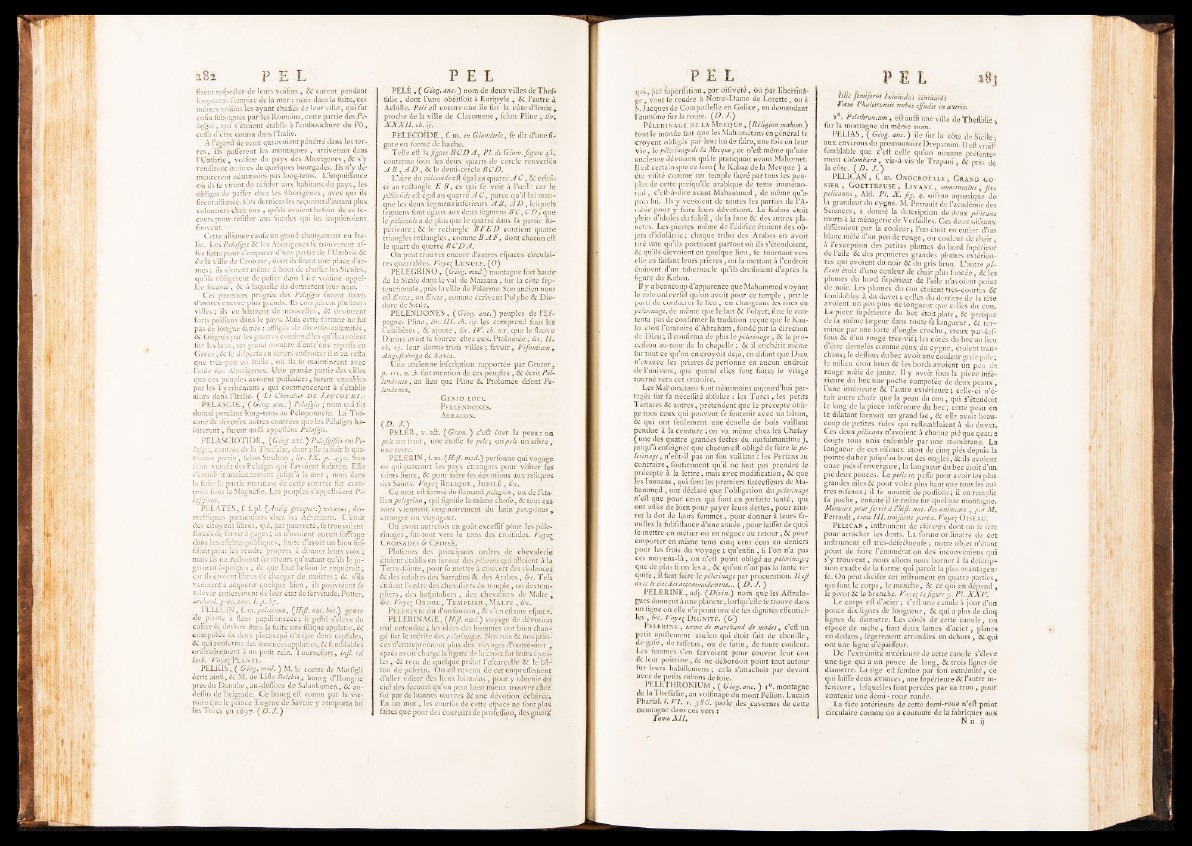
firent refpeéler de leurs voifins , & eurent pendant
long-teahfc l’empire de la mer : mais dans la fuite, ces
mêmes voifins les ayant chafl’és de leur v ille, qui fut
enfin fubjuguée par les Romains, cette partie des Pélafges
, qui s’étoient établis à l’embouchure du P ô ,
cefla d’être connu dans l’Italie.
A l’égard de ceux qui avoient pénétré dans les terres
, ils pafl'erent les montagnes , arrivèrent dans
rUmbrie , voifine du pays des Aborigènes , &c s’y
rendirent maîtres de quelques bourgades. Ils n’y demeurèrent
néanmoins pas long-tems. L’impuiflance
où ils fe virent de réfifter aux habitans du pays, les
obligea de paffer chez les Aborigènes, avec qui ils
firent alliance. Ces derniers les reçurent d’autant plus
volontiers chez eu x, qu’ils avoient befoin de ce fe-
cours pour réfifter aux Sicules qui les inquiétoient
fouvent.
Cette alliance caufa un grand changement en Italie.
Les Pelafges & les Aborigènes fe trouvèrent af-
fez forts pour s’emparer d’une partie de I’Umbrie &:
de la ville de Crotone, dont ils firent une place d’armes
; ils vinrent même à-bout de chaffer les Sicules ,
qu’ils obligèrent de paffer dans l’île voifine appel- 16e Sicanie, 6z à laquelle ils donnèrent leur nom.
Ces premiers progrès des Pelafges furent fuivis
d’autres encore plus grands. Ils conquirent plufieurs
villes ; ils en bâtirent de nouvelles, & devinrent
forts puiffans dans le pays. Mais cette fortune ne fut
pas de longue durée : affligés de diverfes calamités ,
& fatigués par lés guerres continuelles qu’ils avoient
fur les bras, un grand nombre d’entr’eux repaffa en
G rèce, & fe dilperfa en divers endroits : il n’en refia
que très-peu en Italie, où, ils fe maintinrent avec
l’aide des Aborigènes. Une grande partie des villes
que ces peuples avoient poffédées, furent envahies
par les Tyrrhéniens , qui commencèrent à s’établir
alors dans l’ Italie. ( Le Chevalier d e Ja u c o u r t .)
PÉLASGIE, ( Géog. anc. ) Pdafgia ; nom qui fut
donné pendant "long-tems au Péioponnèfe. La Tof-
cane & diverfes autres contrées que les Pélafges habitèrent
, furent aufîi appeilées Pélafgie.
PÈLASGIOTIDE, (Géog ànc.) Pelafgijlis ouPe-
lafgi contrée de la Thefi'alie, dont elle fàilôit la quatrième
partie , félon Strabon , liv. IX . p. qg&'.Son
nom venpit des Pélafges qui l’avoient habitée. Elle
s’étendoit anciennement jùfqu’à la mer ; mais dans
la fuite la partie maritime de cette contrée fut com-
prife fous laMagnéfie. Les peuples s’appelloient Pc-
PELATES , f. f. pl. (Antiq. grecques.') 'nïKa.-ia.i, do-
meftiques particuliers chez les Athéniens. C ’étoit
des citoyens libres, qui, par pauvreté, fe trou voient
forcés de fervir à gages ; iis n’avoient aucun fuffrage
dans les affaires publiques, fauté d’avoir un bien fuf-
fifant pour les "rendre propres à donner leurs voix ;
mais ils ne reftoient ferviteurs qu’autant qu’ils le'jü-
geoient à-propos , & que leur"befoin le requérait;
car ils étoient libres de changer de maîtres; &z s’ils
venoient à acquérir quelque bien , ils pouvoient fe
relever entièrement de leur état de fervitude. Potter,
archaol. graç,toTm. I. p. $y.
PELÊCIN, f. m. pelecinus, (Hifi. nat. bot.) genre
de plante à fleur papillonaçée; lè piftil. s’élève du
calice & devient dans la fuite unefilique applatie, &
compofee de deux pièces qui n’a, que deux capfules,
& qui renferme des femenc'es applaties, & femblables
ordinairement à un petit réin. Tournefort, injl. ni
herb. Voyez( PLANTE.
PELKIS, ( Géog. mod. ) M. le comte de Marfigli
écrit ainfi, & M. de Lille Belckis ; boura d’Hongrie
près; du Danube ,au-dèffous de Salankemen, & au-
defliis de Belgrade. Ce bourg eft connu par la victoire
que le prince Eugene de Savoie y remporta fur
les Turcs en 1(397. (D . J. )
PELÉ , ( Géog. anc. ) nom de deux villes de Thef»
falie , dont l’une obéiffoit à Euripyle , & l’autre à
Achille. Pelé eft encore une île fur la côte d’Ionie ,
proche de là ville de Clazomene, félon Pline , liv«
X X X I I . ch. ij.
PÉLÉCOÏDE , f. m. en Géométrie, fe dit d’une figure
en forme de hache.
Telle eft la figure B C D A , Pl. de Géom. figure
. contenue fous les deux quarts de cercle renverfés
A B , A D , & le demi-cercle B CD.
L’aire dupéléco'ide eft égal au quarré A C , & celui-
ci au re&angle E B , ce qui fe voit à l’oeil : car le
péléco'ide eft égal au quarre A C , parce qu’il lui manque
les deux legmens inférieurs A B , A D , lefquels
fègmens font égaux aux deuxfegmens B C, C D , que
le péléco'ide a de plus que le quarré dans fa partie fupérieure;
& le rectangle B F E D contient quatre
triangles rectangles, comme B A F , dont chacun eft
le quart du quarré B C D A.
On peut trouver encore d’autres efpaces circulai-1
res quarrables. Voye[ L unule. (O)
PELEGRINO, (Géog. mod.) montagne fort haute
de la Sicile dans le val de Mazzara , fur la côte fep-
tentrionale, près la ville de Palerme. Son ancien nom
eft Ereta, ou Eretts, comme écrivent Polybe & Dio-
dore de Sicile,
PELENDONES , ( Géog. anc. ) peuples de l’Ef-
pagne. Pline, liv. III. ch. iij. l^s comprend fous les
Celtibères, & a joute, liv. LT. ch. x x . que le fleuve
Darius avoit fa fource chez eux. Ptolomée, liv. IL
ch. vj. leur donne trois villes ; favoir, Vifontium,
Angufiobriga & Savia.
Une ancienne infeription rapportée par Gruter ,
p. m . n. 5. fait mention de ces peuples , & écrit Pél-
lendones, au lieu que Pline & Ptolomée difent PelendonesV
G enio loci.
Pellendones.
A reacon.
{d . / .) 1
PELER, v. act. (Gram.) c’eft ôter la peau: on
pele un fruit, une étoffe fe pele ; onpele un arbre,
une terre.
PÈLERIN, f. m. (Hifi. mod.) perfonne qui vogage
ou qui parcourt les pays étrangers pour vifiter les
faints lieux, & pour faire fes dévotions aux reliques
des Saints. Voye^ Relique , Jubilé , 6’c.
Ce mot eft formé du flamand pelegrin, ou de l’italien
pdegrïno , qui fignifie la même chofe, &tous ces
mots viennent/originairement du latin p&r&grinus ,
étranger ou voyageur.
On avoit autrefois-un goût exceflîf pour les pèlerinages
, fur-tout vers le tems des croifades. Voyez
C roisades & Croisé.
Plufieurs des principaux ordres de chevalerie
étoient établis en faveur des pèlerins qui alloiént à la
Terre-fainte, pour fe mettre à couvert des violences
& des infultes des Sarrafins & des Arabes, &c. Tels
étoient l’ordre des chevaliers du temple, ou destempliers
, des hofpitaliers , des chevaliers de Malte -
&c. Voyei Ord re, T emplier , Malte , &c.,
Pèlerin fe dit d’un faucon , & c’en eft une efpepe.
PÈLERINAGE, (Xifi- mod.) voyage dé dévotion
mal entendue ; les idées des hommes ont bien changé
fur le'mérite des pèlerinages. Nos rois & nos princes
n’entreprennent plus des voyages d’ontrè-iner ,
après avoir chargé la figure de la croix fur leiirs épaii-?
les, & reçu de quelque prélat l’efcarcelle & le bâton
de pèlerin. On eft revenu de cet empreftèment
d’aller vifiter; dés lieux lointains ? pour y obtenir du
ciel des fecours qu’on peut bien mieux trouver Chez
foi par de bonnes oeuvres & une dévotion éclairée.
En un m o t, les courfes de cette efjjece ne font plùi
faites qùê pour "dé's coureurs de profeftion, des gueûsf
T E L
Êpii, jjâî füpêrftition-, par ôifivëte -, ôü par îibèrtinâ*
g e , vont fe rendre à Notre-Dame de Lorët'te -, Ou à
S. Jacques de Compoftelle èh Galice t en demandant
l’aunlône fur la route. ( D . J . )
Pèlerinage de là Mecqùè ; (R e lig io n m ahomé)
tout lé monde fait que les Mahométans en général fe
feroyent obligés par leur loi de faire, une fois en leur
Vie, le pèlerinage de la Mecque ; ce n’eft même qu’une
Ancienne dévotion quife pratiquoit avant Mahomet;
Il eft certain que ce fieu ( le ICabaa de la Mecque ) a
été vifité comme un temple facré par tous les peu*
pies de Cette prefqu’île arabique de tems immémorial
, c’eft-a-dire avant Mahammed, de même qu’a-
près lui. Ils y venOient de toutes les parties de l’A rabie
pour y faire leurs dévotions. Le Kabaa étoit
plein d’idoles du foleil, de là lune & des autres planètes.
Les pierres même de l’édifice étoient des objets
d’idolâtrie ; chaque tribu des Arabes en avoit
tiré une qu’ils portoient partout où ils s’étendoient,
& qu’ils èîevoient en quelque lieu, fe tournant vers
elle en faifant leurs prières, ou la mettant à l’endroit
éminent d’un tabernacle qu’ils drefloient d’après la
figure du Kabaa.
Il y a beaucoup d’apparence que Mahammed voyant
le zele univerfel qu’on avoit pour ce temple , prit le
parti de confacrer le lieu, en changeant les rites du
pèlerinage, de même que le but & l’objet; il ne fe corn
tenta pas de confirmer la tradition reçue que leKaa-
ba étoit l’oratoire d’Abraham, fondé par la direction
de Dieu ; il confirma de plus le pèle rin a ge, & la pro-
cefîion air-tour de la chapelle ; Sc il enchérit même
fur tout ce qu’on enCroyoit déjà, en difant que Dieu
n’exauce les prières de perfonne en aucun endroit
de l’univers, que quand elles font faites le vilage
tourné vers cet oratoire.
Les Mahométans font néanmoins aujourd’hui partagés
fur fa néceflité abfolue : les Turcs, les petits
Tartares & autres, prétendent que le précepte oblige
tous ceux qui peuvent fe foùtenir avec un bâton,
& qui ont feulement une écuelle de bois vaillant
pendue à la ceinture ; on va même chez les Chafay
( une des quatre grandes feftes du mufulmanifme ),
julqu’à enfeigner que chaCun eft obligé de faire le p è lerinage
, n’eût-il pas un fou vaillant : les Perfans au
contrairé, foutiennent qu’il ne faut pas prendre le
précèpte à la lettre, mais avec modification, & que
les Immans, qui font les premiers fuccefleurs de Mahammed
, ont déclaré que l’obligation du pèlerinage
n’eft que pour ceux qui font en parfaite lànté, qui
ont allez de bien pour payer leurs dettes, pour allu-
rer la dot de leurs femmes, pour donner à leurs familles
la fubfiftance d’une année, pour laifler de quoi
fe mettre en métier ou en négoce au retour, & pour
emporter en même tems cinq cens écus en deniers
pour les frais du voyage ; qu’enfîn, fi l’on n’a pas
ces moyens-là, on n’eft point obligé au pèlerinage;
que de plus fi on les a , & qu’on n’ait pas la fanté re-
quife, il faut faire le pèlerinage par procuration. I l ejl
avec le c iel des accommodement... ( D . J . )
PELERINE, adj. (D i v in . ) nom que les Aftrolo-
gues donnent à une planete, lorfqu’elle fe trouve dans
un figne où elle n’a point Une de les dignités eflëntiel-
les j & c . V o y e { DIGNITÉ; ( G )
P eLe r ine , terme de marchand de m odes, c’eft un
petit ajuftement ancien qui étoit fait de chenille,
de gafe, de taffetas, ou de fatin, de toute couleur;
Les femmes s’en fervoient pour couvrir leur cou
& leur poitrine , & ne débordoit point tout autour
fur leurs habillemens ; cela s’attachoit par devant
avec de petits rubans de l'oie.
PELETHRONIUM , ( Géog. anc. ) i° ; montagné
i au voifinage du mont Pélion. Lucain
Pharfal. I. V I . v . g 8G. parle des cavernes de cette
montagne dans ces vers ;
Tome X I I ,
P I L »Bj
ïllic jimiferoi Ixionid'às 'ceniàürÔi
Foetà Phalelroniis hubes effudit m ûntnsi
, à i PdethŸohiùrh. j ëft ai'ifli ünè viÜë dè Theflailè-"
fur la montagne du même nom.
PELIAS , ( Géog. anc. ) île fut là èôtë de Sicile *
aux environs du promontoire Drepanùrru II eft vraif-
femblable qile e’eft Cellé qu’on nomiiie préfentè-
ment Golombara , vis-à-vis de Trapani ; & près dè
la côte. ( D . J . )
PELICAN > f. ni. Ô nôc'rotale ; G rànô gosier
, GOETTREUSEj LlVANE, onOcrotalus ; fivc
pelicanus, Aid. PL. X . fig . 4. oifeau aqiiatiqlte dé
la grandeur du cygne. M. Perrault de l’académie des
Sciences * a donné la defeription de deux pélicans
morts à la ménagerie de Verfailles. Ces deux oifeaiix
différaient par la couleur; l’un étoit en entier d’un
blanc mêlé d’un peu de rouge, Ou couleur de chair,
à l’exception des petites plumes du bord fupérièur
de l’aîle & des premières grandes plumes extérieures
qui avoient du noir & du gris brun. L’autre pélican
étoit d’une couleur de chair plus foncée, &c les
plumes du bord fuperieur de l’aîle n’avoient point
de noir-. Les plumes du cou étoient très-courtes &è
femblables à du duvet; celles du derrière de la tété
avoient un peu plus de longueur que celles du coin
La piece fupérieure du bec étoit plate, & prefqué
de la même largeur dans toute fa longueur, & terminée
par une forte d’ongle crochu * creux par-def-
fous & d’un rouge très^vif; les côtés du bec au lieu
d’être dentelés comme ceux du cygne, étoient tran-
ehans; le défions du bec avoit une couleur grife pâle;
le milieu etoit brun & les bords avoient un peu dé
rouge mêlé de jaune. Il y avoit fous la piecé inférieure
du bec une poche eompofée de deux peaux*
l’une intérieure & l’autre extérieure ; celle-ci n’ é-
toit autre chofë que la peaii du cou * qui s’étendoit
le long de la piece inférieure du bec; cette peau en
fè dilatant formoit un grand fac, & elle avoit beaucoup
de petites rides qui reïïemblqient à du duvet;
Ces deux pélicans n’avoient à chaque pié que quatre
doigts tous unis enfemble par une membrane. La
longueur de ces oifeaux étoit de cinq piés depuis la
pointe du bec jufqu’aü bout des ongles, & ils avoient
onze piés d’en vergure ; la longueur du bec étoit d’un
pié deux pouces. L e-pélican paffe pour avoir les plus
grandes aîles &c pour voler plus haut que tous les autres
oifeaux ; il fe nourrit de poiffons ; il en remplit
fa poche, enfuite il fe retire fur quelque montagne;
Mémoire pour fervir à l'hifi. nal. des animaux , par M*
Perrault, tomé III. troifieme partie. Voye[ O is e a u .
Pé l ic a n , infiniment de chirurgie dont on fe fert
pour arracher les dents. La forme ordinaire de cet
inllrument eft très-défeélueufe ; notre objet n’étant
point de faire l’énumération des inconvéniens qui
s’y trouvent, nous allons nous borner à la defeription
exa£le de la forme qui paraît la plus avantageu-
fe. On peut divifer Cet infiniment en quatre'parties*
qui font le corps * le manche, & ce qui en dépend ,
le pivot &: la branche. Vjyeç la figure § . PL X X V .
Le;corps eft d’acier ; c’eft une canule à jour d’un
pouce dix lignes de longueur * & qui a plus de cinq
lignes de diamètre. Les côtés de cette canule , ou
efpeee de niche , font deux lames d’acier , planes
en dedans, légèrement arrondies en dehors , &c qui
ont une ligne d'épaiffeür;
Dé l’extrémite antérieure de Cette canule s’élevé
une tige qui a un pouce de long, & trois lignes dé
diamètre. La tige eft fendue par fon extrémité, ce
qui laifle deux avances, une fupérieure & l’autre inférieure
, lefquelles font percées par un trou, pou?
contenir une demi - roue ronde.
La face antérieure de cette demi-rôiiê n’eft point
Circulaire comme on a coutuoie de la fabriquer aux
N n ij