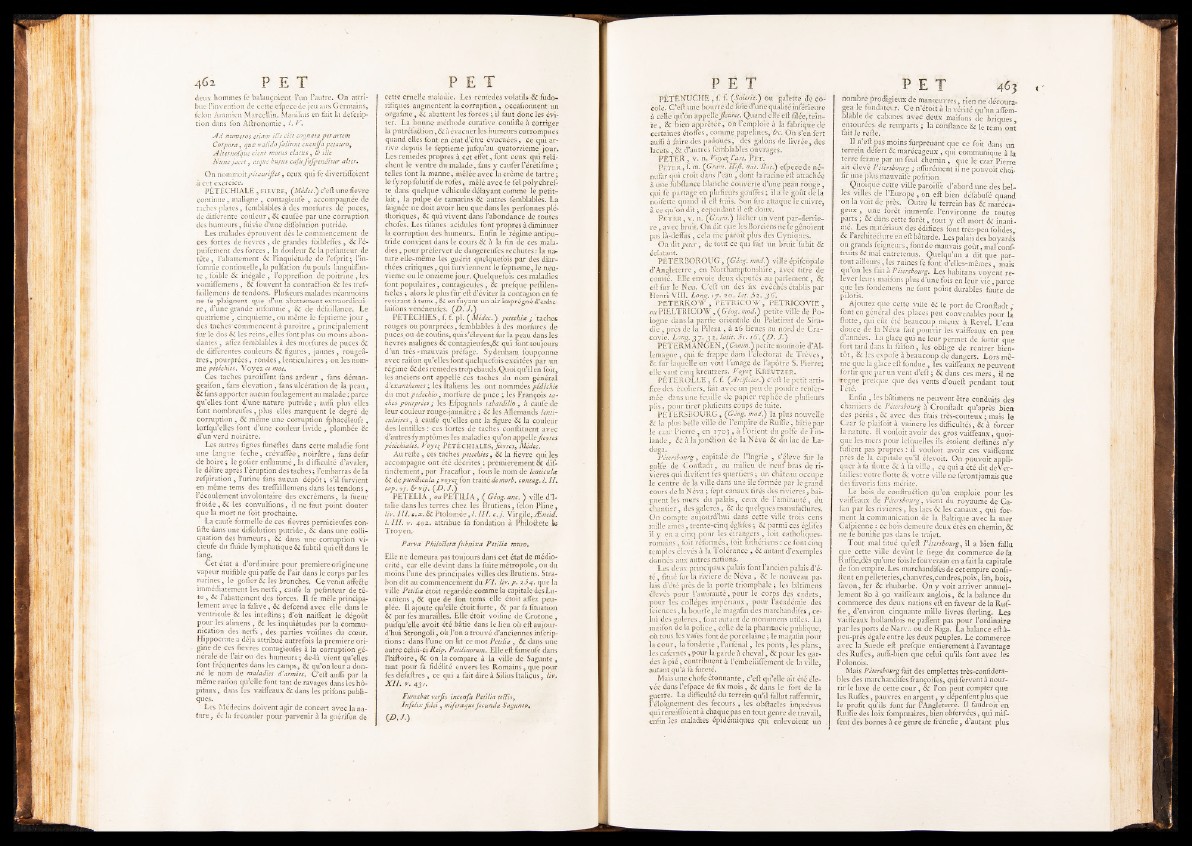
deux hommes fe balançoient l’un l’autre. On attribue
l’invention de cette efpecede jeu aux Germains,
félon Ammien Marcellin. Manilius en fait la defcrip-
tion dans fon Agronomie, /. V.
A d numéros etiam ille d it cogna ta perartem
Corpora, quce validofaliunt excufia petauro,
Alternofque dent motus clatus, & ille
Nunc jacet, atque hujus çafu fufpenditur alter.
On nommoitpétaurifies, ceux qui fe divertiffoient
à cet exercice.
PÉTÉCHIALE, f i e v r e , ([Médec.) c’eft une fievre
continue, maligne , contagieufe , accompagnée de
taches plates, femblables à des morfures de puces,
de différente couleur, 6c caufée par une corruption
des humeurs, fuivie d’une difl'olution putride.
Les malades éprouvent dès le commencement de
ces fortes de fievres , de grandes foibleffes , 6c l’é-
puifement des forces, la douleur 6c la pefanteur de
tê te , l’abattement 6c l’inquiétude de l’efprit ; l’in-
fomnie continuelle, la pulfation du pouls languiflan-
te , foible 6c inégale , l’oppreffion de poitrine , les
Yomiflemens , 6c fouvent la contraûion & les tref-
faillemens de tendons. Plufieurs malades néanmoins
ne fe plaignent que d’un abattement extraordinaire
, d’une grande infomnie, 6c de défaillance. Le
quatrième , cinquième, ou meme le feptieme jour ,
des taches-commencent à paroître , principalement
fur le dos 6c les reins, elles font plus ou moins abondantes
, allez femblables à des morfures de puces 6c
de différentes couleurs 6c figures, jaunes , rougeâtres
, pourprées, rondes, lenticulaires ; on les nomme
pétéchies. Voyez ce mot.
Ces taches pàroiflent fans ardeur , fans déman-
geaifon, fans élévation , fans ulcération de la peau,
6c fans apporter aucun foulagement au malade ; parce
qu’elles font d’une nature putride ; aufîi plus elles
font nombreufes, plus elles marquent le degré de
corruption , 6c même une corruption fphacéleufe ,
lorfqu’elles font d’une couleur livide , plombée 6c
d’un verd noirâtre.
Les autres fignes funeftes dans cette maladie font
une langue feche, crévaffée , noirâtre , fans defir
de boire; le golier enflammé, la difficulté d’avaler,
le délire après l’éruption des taches; l’embarras delà
refpiration , l’urine fans aucun dépôt ; s’il furvient
en même tems des treffaillemens dans les tendons ,
l’écoulement involontaire des excrémens, la fueur
froide , 6c les convulfions, il ne faut point douter
que la mort ne foit prochaine.
La caufe formelle de ces fievres pernicieufes con-
fifte dans une difl'olution putride, 6c dans une colli-
quation des humeurs, 6c dans une corruption vi-
cieufe du fluide lymphatique 6c fubtil qui eft dans le
fang.
Cet état a •d’ordinaire pour première origine une
vapeur nuifible qui paffe de l’air dans le corps par les
narihes, le gofxer 6c les bronches. Ce venin affeéle
immédiatement les nerfs , caufe la pefanteur de têt
e , & l’abattement des forces. Il fe mêle principalement
avec la falive, 6c defcend avec elle dans le
ventricule & les inteftins; d’où naiflent le dégoût
pour les. alimens , 6c les inquiétudes par la communication
des nerfs , des parties voifines du coeur.
Hippocrate a déjà attribue autrefois la première origine
de ces fievres contagieufes à la corruption générale
de l’air ou des humeurs ; de-là vient qu’elles
font fréquentes dans les camps, 6c qu’on leur a donné
le nom de maladies d'armées. C’eft auffi par la
même raifon qu’elle font tant de ravages dans les hôpitaux,
dans les vaifleaux 6c dans les prifons publiques.
Les Médecins doivent agir de concert avec la na- '
tare, 6c la leconder pour parvenir à la guérifon de
cette cruelle maladie. Les rem’edes volatils 6c fudo-
rifiques augmentent la corruption, oocafionnent un
orgalme, 6c abattent les forces ; il faut donc les éviter.
La bonne méthode curative confifle à corriger
la putréfa&ion, 6c à évacuer les humeurs corrompues
quand elles font, en état d’être évacuées, ce qui arrive
depuis le feptieme jufqu’au quatorzième jour.
Les remedés propres à cet effet, font ceux qui relâchent
le ventre du malade, fans y cauferl’érétifme ;
telles font la manne, mêlée avec la crème de tartre ;
le fyropfolutif de rofes, mêlé avec4e fel polychref-
te dans quelque véhicule délayant comme le petit-
lait , la pulpe de tamarins 6c autres femblables. La
faignée ne doit avoir lieu que dans les perfonnes pléthoriques
, 6c qui vivent dans l’abondance de toutes
chofes. Les tifanes acidulés font propres à diminuer
la corruption des humeurs. Enfin le régime antiputride
convient dans le cours & à la fin de ces .maladies
, pour préferver de dangereufes rechutes : la nature
elle-même les guérit quelquefois par des diarrhées
critiques, qui lurviennent le feptieme, le neuvième
ou le onzième jour. Quelquefois ces maladies
font populaires, contagieufes , 6c prefque peftilen-
tieles ; alors le plus fur eft d’éviter la contagion en fe
retirant à tems, 6c en fuyant un air imprégné d’exhe-
laifons venéneufes. (D. J.)
PÉTÉCHIES, f.. f. pl. ( Médec.) petechice ; tache«
rouges ou pourprées, femblables à des morfures de
puces^ou de coufins, qui s’élèvent fur la peau dans les
fievres malignes 6c contagieufes,& qui font toujours
d ’un très -'mauvais préfage. Sydenham foupçonne
avec raifon qu’elles font quelquefois excitées par un
régime 6c des remedes trop chauds.Quoi qu’il en foit,
les anciens ont appellé ces taches du nom général
à'ex an thèmes ; les Italiens les ont nommées pèdéchie
du mot pedeckio, morfure de puce ; les François taches
pourprées ; les Efpagnols tabardillo , à caufe de
leur couleur rouge-jaunâtre ; 6c les Allemands lenticulaires
, à caufe qu’elles ont la figure 6c la couleur
des lentilles : ces fortes de taches conftituent avec
d’autres fymptômes les maladies qu’on appelle fievres
pétéchiales. Voye{ PÉTÉCHIALES, fievres, Médec.
Aurefte, ces taches petechies,, 6c la fievre qui les
accompagne ont été décrites ; premièrement 6c dif-
tinclement, par Fracaftor, fous le nom de lenticulce
6c de punclicula ; voyeç fon traité deritorb. contag. I. II,
cap. vj. & vij. {JD. J.')
PETELIA , ou PETILIA, ( Géog. anc. ) ville d’Italie
dans les terres chez les Brutiens, félon Pline,
liv. III. c. x..6c Ptolomée, l. I I I . c .j. Virgile,Æneid.
I. III. v. 402. attribue fa fondation à Philo&ete le
Troyen.-
Parva Philocletcc fubnixa P édita muro.
Elle ne demeura pas toujours dans cet état de médiocrité,
car elle devint dans la fuite métropole, ou du
moins l’une des principales villes des Brutiens. Stra-
bon dit au commencement du V I. liv. p. 264. que la
ville Petilia étoit regardée comme la capitale des Lu-
caniens, 6c que de fon tems elle étoit allez peuplée.
Il ajoute qu’elle étoit forte, 6c par fa fîtuation
6c par fes murailles. Elle étoit voifxne de Crotone ,
puifqu’elle avoit été bâtie dans le lieu oii eft aujourd’hui
Strongoli, où Fon a trouvé d’anciennes infcrip-
tions : dans l’une on lit ce mot Petilia , 6c dans une
autre celui-ci Reip. Petilinorum. Elle eft fameufe dans
l’hiftoire, & on la compare à la ville de Sagunte ,
tant pour fa fidélité envers les Romains, que pour
fes défaftres , ce qui a fait dire à Silius Italiçus, liv.
X I I . v. 431.
Fumabat verfis incenfa Petilia teclis,
Infelix fidei , rniferoeque fecunda Sagunto,
m m
PÉTENÜCHE, f. f (Solide.') ou galette cfe côtoie
« C ’éft iuie bourré de foie d’une qualité inferieure
à celle qù’ôii appelle fleûïet. Quand elle eft filée, teinte
, & bieïi àpprêtée, ô‘n remploie à là fabriqué dé
certaines étoffes, comme papelinçs, &c. On s’en fert
auffi à faire des pado'ués , dés galons de livrée, des
lacets, 6c d’autres femblables ouvrages.
PÉ TE R , v . h . Poye{ Tàrt. P e t .
P e t e r , f. m. (Grain. îïifi. fiat. Bot.) e lp e c è d e n é—
n u fa r q u i c r o î t dans l’ e a u , d o n t lâ r a c in e è ft a t ta c h é e
à u n e fu b fta n c e b la n c h e c o u v e r te d ’u n e p e a u r ô ù g e ,
q u i f e p a r ta g é e n p lu fié û r s goufifes ; il a le g o û t d e la
n o i fe t tè q u an d i l e ft fr a is . S o n fu c a t ta q u e le 'c u iv r e ,
à c e q u ’o n d it ; c e p en d a n t i l e ft d o u x .
P e t e r , v. n. (Gram.) lâcher un vent par-derrié-
r e , avec bruit. On dit que lesBorciénshefe gênôient
pas là-deffus , cela me pâroît plus des Cyniques.
On ‘dit peter, de tout ce qui fait lin bruit fubit &
éclatant.
PÉTERBOROUG, (Géog. mod.) ville épifcôpale
d’Angleterre, en Northamptonshire, avec titre de
comté. Elle envoie deux députés au parlement, 6c
eft fur le Neu. C ’eft un des fix évêchés établis par
Henri VIII. Long. \y. 20. lat. 62. j6 \ •
PETERKO \V , PETR ICOW , PETRICOVIE,
oit P1EL TR ICOW , (Géog. mod.) petite ville dè Pologne
dans la partiè Orientale du Palâtinât dè Sira-
die , près de la Pileza , â 26 lieues au nord de Cra-
covie. Long. 37 . 32. ladt. S i. (G. (D . J.)
PETERMANGEN, (Commi)fietne monnoie d’Allemagne
, qui fe frappe dans l’éleûorat de Trêves,
6c fur laquelle on voit l’image de l’apôtre S. Pierre;
elle vaut cinq kreutzers-. Voye\ K r e u t z e r .
PÉTEROLLE, f. f. (Artificier.) c’eft le petit artifice
des écoliers, fait avec un peu de poudre renfermée
dans une feuille de papier repliée de plufieurs
plis, pour tirer plufieurs coups de fuite.
PÉTERSBOURG, (Géog. mod.) la plus nouvelle
6c la plus belle ville de l’empire de Ruffiè, bâtie par
le czar Pierre , en 1703 , à l’orient du golfe dè Finlande,
6c à la jonction de la N é va 6c du lâcd è Ladoga.
Pètersboufg, capitale de l’ïngrie -, s’élève fur le
golfe de Conftadt, au milieu de neuf bras de rivières
qui divifent fes quartiers ; un château occupe
le centre de la ville dans une île formée par le grand
cours de la Néva ; fept canaux tirés des rivierès, baignent
les murs du palais, ceux de l’àmxrauté, du
chantier, des galeres, & de quelques manufàéhires.
On compte aujourd’hui dans cette ville trois cens
mille âmes, trente-cinq églifes ; 6c parmi ces églifés
il y eh a cinq pour les étrangers , foit catholiques-
romains , foit reformés , foit luthériens : ce font cinq
temples élevés à la Tolérance , 6c autant d’exemples
donnés aux autres nations.
Les deux principaux palais font l’ancien palais d’été
, fitué fur la l'iviere de N év a , 6c le nouveau palais
d’été près de la porté triomphale ; les bâtimens
élevés pour l’amirauté, pour le corps des cadets,
pour les collèges impériaux, pour l’académie des
îciences, la bourfe ,.le magafin des marchandifés, celui
des galeres, font autant de monumens utiles. La
maifon de la police, celle de la pharmacie publique,
où tous les vafes font de porcelaine ; le magafin pour
la cour , la fonderie ,1’arfenal, les ponts, les plans,
les cafernes, pour la gaxde à cheval, 6c pour les gardes
à pié, contribuent à l’embeiliflement de la ville,
autant qu’à fa fureté.
Mais une chofe étonnante, c’éft qu’elle ait été élevée
dans l’efpace de fix mois , 6c dans le fort de la
guerre. La difficulté du terrein qu’il fallut raffermir,
l ’éloignement des fecours , les obftacles imprévus
quirenaiflbient à chaque pas en tout genre de travail,
enfin les maladies épidémiques qui enlevoient un .
n om b r e p r o d ig ie u x d e m a n o e u v r e s , r ie n n e d é co u ra *
fo n d a te u r . C e n ’e tô iL à là v é r it é q u ’u n afTemblàble
de cabanes avec deux maifons de briques
entourées de remparts'; la confiance 6c le tems ont
fait le réfie.
Il p’eft pas moins furprenant que ce foit dans un
terrein delert 6c marécageux , qui communique à la
terre ferme par un feul chemin , que le czar Pierre
'PMèrsbibftrg ; affurément il ne pouvoit chôi.-
fir une plus mauvaife pofition.
Quoique cette ville paroiffe d’abord une des bel-
les villes de l’Europe, on eft bien défabufé quand
on là voit de près. Outre le terrein bas 6c marécageux
, une foret immenfe l ’environne de toutes
parts ; 6c dans cette forêt, tout y eft mort & inani»
me- Les matériaux des édifices font très-peu folides,:
6c 1 architechire en eft bâtarde. Les palais des boyards
où grands feigneurs, font de mauvais goût, mal conf-
frùits 6c mal entretènus. Quelqu’un a dit que partout
ailleurs^, les ruines fe font d’elles-mêmes, mais
qu on les fait à Pétersbourg. Les habitans voyent relever
leurs maifons plus d’une Fois en leur v ie , parce
'que les fondemens ne font point durables faute de
pilotis. -
Ajoutez que cette ville 6c le port de Cronftadt;
font en général des places peu convenables pour la
flotte, qui eût été beaucoup, mieux à Revel. L’eau
dôùce^ de la Néva fait pourrir les vaifleaux en peu
d’années. La glace qui ne leur permet de fortir que
fort tard dans la faifon, les oblige de rentrer bien-
tô t , 6c les expofe à beaucoup de dangers. Lors même
que la glace eft fondue, les vaifleaux ne peuvent
fortir que par un vent d’eft ; 6c dans ces m ers, il ne
-régné prefque que des vents d’oueft pendant tout
leté.
Enfin , les bâtimens ne peuvent être conduits des
chantiers de Petersbourg à Cronftadt qu’après bien
des périls , 6c avec des frais très-couteux ; mais le
Czar fe-plaifoit à vaincre les difficultés, & à forcer
là nature. Il voûloit avoir des gros vaiffeaux, quoique
les mers pour lefquelles ils étoient deftinés n’y
fuflent pas propres : il vouloit avoir ces vaifleaux
pires de la, capitale qu’il élevoit. On pouvoit appliquer
à fa flotte 6c à fa v ille , ce qui a été dit de Ver-
failles : votre flotte 6c votre ville ne feront jamais que
des favoris fans mérite.
Le bois de conftruttion qu’on emploie pour les
vaifleaux de P étersbourg, vient du royaume de Ca-
fan par les rivières, les lacs & les canaux, qui forment
la communication de la Baltique avec la mer
Cafpienne : ce bois demeure deux étés en chemin, &
ne fe bonifie pas dans le trajet.
Tout mal fitue qu’eft Pétersbourg, il a bien fallu
que cette ville devînt le fiege du commerce de la
Ruffie,dès qu’une fois le foùverain en a fait la capitale
de fon empire. Les marchandifés de cet empire confi-
ftent en pelleteries, chanvres,cendres,poix, lin, bois,
favon, fer 6c 'rhubarbe. On y voit arriver annuellement
80 à 90 vaifleaux anglois, 6c la balance du
commerce des deux nations eft en faveur de la Ruf-
f ie , d’environ cinquante mille livres fterling. Les
vaifleaux hollandois ne paflent pas pour l’ordinaire
par les ports de Narva ou de Riga. La balance e ftà-
peu-près égale entre les deux peuples. Le commerce
avec la Suede eft prefque entièrement à l’avahtage
des Rafles, auffi-bien que celui qu’ils font avec les
Polonois.
Mais Pétersbourg foit des emplettes très-confidera-
bles des marchandifés françoifes, qui fervent à nourrir
le luxé de cette cour, 6c l’on peut compter que
les Rufles, pauvres en argent, y dépenfentplus que
le profit qu’ils font fur l’Angleterre. Il faudroit en
Rùffie des loix fomptuaires, bien obfervées, qui mif-
fènt des bornes à ce genre de frénefie, d’autant plus