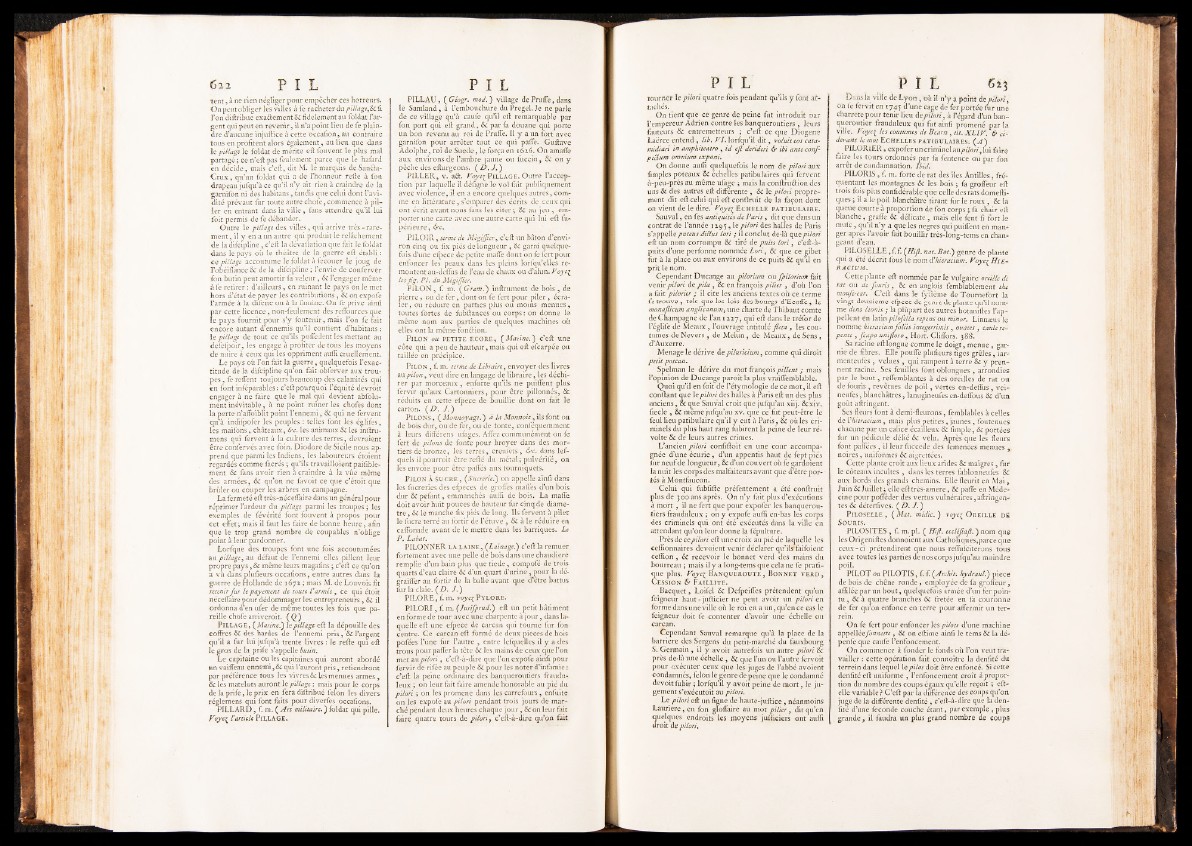
tent, à ne rien négliger pour empêcher ces horreurs.
On peut obliger les villes à fe racheter du pillcigt,& fi
l’on diftribue exactement 6c fidelemént au foldat l’argent
qui peut en revenir, il n’a point lieu de fe plaindre
d’aucune injuftice à cette occafion, au contraire
tous en profitent alors également, au lieu . que . dans
le pillait le foldat de mérite eft fouvent le plus mal
partagé ; ce n’eft pas feulement parce que le hafard
en décide, mais c’eft, dit M. le marquis de Sanôa-
C ru x , qu’un foldat qui a de l’honneur refte à fon
drapeau jufqu’à ce qu’il n’y ait rien à craindre de la
garnifon ni des habitans, tandis que celui dont l’avidité
prévaut fur toute autre choie, commence à piller
en entrant dans la ville , fans attendre qu’il lui
l'oit permis de fe débander.
Outre le pillage des villes, qui arrive très - rarement
, il y en a un autre qui produit le relâchement
de la difcipline, c’eft la dévaluation que fait le foldat
dans le pays où le théâtre de la guerre eft établi :
ce pillage accoutume le foldat à fecouer le joug de
l’obéiffance 6c de la difcipline ; l’envie de conferver
fon butin peut amortir fa valeur, 6c l’engager même
à fe retirer : d’ailleurs, en ruinant le pays on le met
hors d’état de payer les contributions, & on expofe
l’armée à la difette ou à la famine. On fe prive ainfi
par cette licence, non-feulement des reflources que
le pays fournit pour s’y foutenir, mais l’on fe fait
encore autant d’ennemis qu’il contient d’habitans :
le pillage de tout ce qu’ils poffedent les mettant au
defefpoir, les engage à profiter de tous les moyens
de nuire à ceux qui les oppriment aufli cruellement.
Le pays où l’on fait la guerre, quelquefois l’exactitude
de la difcipline qu’on fait obferver aux troupes
, fe refient toujours beaucoup des calamités qui
en font inféparables : c’eft pourquoi l’équité devroit
engager à ne faire que le mal qui devient abfolu-
ment inévitable, à ne point ruiner les chofes dont
la perte n’affoibiit point l’ennemi, 6c qui ne fervent
qu’à indifpofer les peuples : telles font les églifes,
les maifons, châteaux, &c. les animaux & les înftru-
mens qui fervent à la culture des terres, devroient
être confervés avec foin. Diodore de Sicile nous apprend
que parmi les Indiens, les laboureurs étoient
regardés comme facrés ; qu’ils travailloient paifible-
ment 6c fans avoir rien a craindre à la vue même
des armées, 6c qu’on ne favoit ce que c’étoit que
brûler ou couper les arbres en campagne.
La fermeté eft très-néceffaire dans un général pour
réprimer l’ardeur du pillage parmi les troupes ; les
exemples de févérité font fouvent à propos pour
cet effet ; mais il faut les faire de bonne heure, afin
que le trop grand nombre de coupables n’oblige
point à leur pardonner.
Lorfque des troupes font une fois accoutumées
au pillage, au défaut de l’ennemi elles pillent leur
propre pays, 6c même leurs magafins ; c’eft ce qu’on
a vu dans plufieurs occafions, entre autres dans la
guerre de Hollande de 1672 ; mais M. de Louvois fit
retenir fur le payement de toute l ’armée , ce qui étoit
néceffaire pour dédommager les entrepreneurs, & il
ordonna d’en ufer de même toutes les fois que pareille
chofe arriveroit. (Q )
P i l l a g e , (Marine.') le pillage eft la dépouille des
coffres & des hardes de l’ennemi p r is , 6c l’argent
q u ’il a fur lui jufqu’à trente livres : le refte qui eft
le gros de la prife s’appelle butin.
Le capitaine ou les capitaines qui auront abordé
im vaiffeau ennemi, 6c qui l’auront pris, retiendront
par préférence tous les vivres 6c les menues armes,
& les matelots auront le pillage : mais pour le corps
de la prife, le prix en fera diftribué félon les divers
réglemens qui font faits pour diverfes occafions.
PILLARD, f. m. ( Art militaire. ) foldat qui pille,
Foye{ Üartiçle Pillag e.
PILLAU, ( Géogr. mod. ) village de Pruffe, dans
le Samland, à l’embouchure du Pregel. Je ne parle
de ce village qu’à caufe qu’il eft remarquable par
fon port qui eft grand, 6c par fa douane qui porte
un bon revenu âu roi de Pruffe. Il y â un fort avec
garnifon pour arrêter tout ce qui paffe. Guftave
Adolphe, roi de Suede, le força en 1626. On amaffe
aux environs de l’ambre jaune ou fuccin, & on y
pêche des efturgeons. ( D . J .)
PILLER, v. a£t. Voyè^ Pil l ag e . Outre l’acception
par laquelle il défigne le vol fait publiquement
avec v iolence, il en a encore quelques autres, comme
en littérature, s’emparer des écrits de ceux qui
ont écrit avant nous fans les citer ; 6c au jeu , emporter
une carte avec une autre carte qui lui eft fu-
périeure, &c,
PILOIR, terme de Mégiffier, c’eft un bâton d’environ
cinq ou fix piés de longueur , 6c garni quelquefois
d’une efpece de petite maffe dont on fe fert pour
enfoncer les peaux dans les pleins lorfqu’elles remontent
au-deffus de l’eau de chaux ou d’alun. Voye^
les fig. PI. du Mégiffier.
PILON, f. m. ( Gram. ) infiniment de bois , de
pierre, ou de fe r , dont on fe fert pour piler, écrà-
fè r , ou réduire en parties plus ou moins menues,
toutes fortes de fubftances ou corps : on donne le
même nom aux parties de quelques machines où
elles ont la même fonction.
P il o n ou p e t it e e c o r e , (Marine.) c’eft une
côte qui a peu de hauteur, mais qui eft efearpée ou
taillée en précipice.
Pil o n , f. m. terme de Libraire, envoyer des livres
au pilon, veut dire en langage de libraire, les déchirer
par morceaux, enforte qu’ils ne puiffent plus
fervir qu’aux Cartonniers, pour être pillonnés, &
réduits en cette efpece de bouillie dont on fait le
carton. (D . J .)
Pil o n s , ( Monnayage.) à la Monnoie, ils font ou
de bois dur, ou de fer, ou de fonte, conféquemment
à leurs différens ufages. Affez communément ôn fe
fert de pilons de fonte pour broyer dans des mortiers
de bronze, les terres, creufets, &c. dans lef-
quels il pourroit être refté du métal ; pulvérifé, on
les envoie pour être paffés aux tourniquets.
P ilon à Su c r e , (Sucrerie.) on appelle ainfi dans
les fucreries des efpeces de groffes maffes d’un bois
dur & pefant, emmanchés aufli de bois. La maffe
doit avoir huit pouces de hauteur fur cinq de diamètre
, 6c le manche fix piés de lorig. Ils fervent à piler
le fucre terré au fortir de l’étuve , 6c à le réduire en
caffonade avant de le mettre dans les barriques. Le
P. Labat.
PILONNER l a l a in e , (Lainage?) c’eft la remuer
fortement avec une pelle de bois dans une chaudière
remplie d’un bain plus que tiede, compofé de trois
quarts d’eau claire 6c d’un quart d’urine , pour la de-
graiffer au fortir de la balle avant que d’être battus
fur la claie. (D . J .)
PILORE, f. m. voyei Pylo r e .
PILORI, f. m. (Jurifprud.) eft un petit bâtiment
en forme de tour avec une charpente à jour, dans laquelle
eft une efpece de carcan qui tourne fur fon
centre. Ce carcan eft formé de deux pièces de bois
pofées l’une fur l’autre , entre lefquelles il y a des
trous pour paffer la tête 6c les mains de ceux que l’on
met au pilori, c’eft-à-dire que l’on expofe ainfi pour
fervir de rifée au peuple 6c pour les noter d’infamie :
c’eft la peine ordinaire des banqueroutiers fraudu-i
leux ; on leur fait faire amende honorable au pié du
pilofi ; on les promene dans les carrefours, enfuite
on les expofe au pilori pendant trois jours de marché
pendant deux heures chaque jou r, 6c on leur fait
faire quatre tours de pilori, c’eft-à-dire qu’on fait
'tourner le pilori quatre fois pendant qu’ils y font attachés.
On tient qlie ce genre de peine fut introduit oar
l’empereur Adrien contre les banqueroutiers , leurs
fauteurs 6c entremetteurs ; c’eft ce que Diogene
Laërce entend, lib. VI. lorfqu’il dit, voluit eos cata-
midiari in amphheatro , id efl derideri & ibi ante conf-
peclum omnium exponi.
Oh donne aufti quelquefois le nom de pilori aux
fimples poteaux 6c échelles patibulaires qui fervent
à-peu-près au même ufage ; mais la conftruCtion des
uns & des autres eft differente , 6c le pilori proprement
dit eft celui qui eft conftruit de la façon dont
on vient de le dire. Voye^ Echelle pat ibu laire.
Sauvai, en fes antiquités de Paris, dit que dans un
contrat de l’année 1295, le pilori des halles de Paris
s’appelle puteus diclus lori ; il conclut de-là que pilori
eft un nom corrompu & tiré de puits lori, c’eft-à-
puits d’une perfonne nommée Lori, & que ce gibet
fut à la place ou aux environs de ce puits & qu’il en
prit le nom.
Cependant Dücange au pilorium ou fpiloriurh fait
venir pilori de pila , 6c en françois pilier , d’où l’on
a.fait pilorier ; il cite les anciens textes où ce terme
fe trouve, tels que les lois des bourgs d’Ecoffe, le
monafticum anglicanum, une charte de Thibaut comte
de Champagne de l’an 1227, qui eft dans le tréfor de
l’églife de Meaux, l’ouvrage intitulé jleta , les coutumes
de Nevers , de Melun, de Meaux, de Sens,
d’Auxerre.
Ménagé le dérive de piluricium, comme qui diroit
petit poteau.
Spelman le dérive du mot françois pillent ; mais
l’opinion de Ducange paroît la plus vraiffemblable.
Quoi qu’il en foit de l’étymologie de ce mot, il eft
confiant que le pilori des halles à Paris eft un des plus
anciens, & qu e Sauvai croit qïie julqu’au xiij. & x iv.
fiecle , 6c même jufqu’au xv. que ce fut peut-être le
feul lieu patibulaire qu’il y eut à Paris, 6c où les criminels
du plus haut rang lubirent la peine de leur révolte
6c de leurs autres crimes.
L’ancien pilori confiftoit en une cour accompagnée
d’une écurie , d’un appentis haut de fept piés
fur neuf de longueur, 6c d’un couvert où fe gardoient
la nuit les corps des malfaiteurs avant que d’être por- -
tés à Montfaucon.
Celui qui fiibfifte préfentement a été conftruit
plus de 300 ans après. On n’y fait plus d’exécutions
à mort , il ne fert que pour expofer les banqueroutiers
frauduleux ; on y expofe aufli en-bas les corps
des criminels qui ont été exécutés dans la ville en
attendant qu’on leur donne la fépulture.
Près de ce pilori eft une croix au pié de laquelle les
ceflionnaires dévoient venir déclarer qu’ils?faifoient
ceflion, & recevoir le bonnet verd des mains du
bourreau ; mais il y a long-tems que cela ne fe pratique
plus. Voye{ Banqueroute , Bonnet verd ,
C ession & Fa illite.
Bacquet, Loifel 6c Defpeiffes prétendent qu’un
feigneur haut - jufticier ne peut avoir un pilori en
forme dans une ville où le roi en a un, qu’en ce cas le
feigneur doit fe contenter d’avoir une échelle ou
carcan.
Cependant Sauvai remarque qu’à la place de la
barrière des Sergens du petit-marché du fauxbourg
S. Germain , il, y avoit autrefois un autre pilori &
près de-là une échelle , 6c que l’un ou l’autre fervoit
pour exécuter ceux que les juges de l’abbé avoient
condamnés, félon le genre de peine que le condamné
devoit fubir ; lorfqu’il y avoit peine de mort, le jugement
s’exécutoit au pilori.
Le pilori eft un ligne de haute-juftice, néanmoins
Lauriere, en fon gloffaire au mot pilier, dit qu’en
uelques endroits les moyens jufticiers ont aufli
roit de pilori,
Dans la ville de Lyon 9 bit il n’y à point de pilori t
on fe fervit en 1745 d’une cage de fer portée fui* une
charrete pour tenir lieu de pilori ^ à l’égard d’un banqueroutier
frauduleux qui fut ainfi promené par la
ville. V?ye{ les coutumes de Bearn, tit. X LIV. & ci-
devant le mot Echelles patibulaires. (A )
PILORIER, expoferun criminel au pilori, lui fairè
faire les tours: ordonnés par fa fentence Ou par fon
arrêt de condamnation. Ibid.
PILORIS , f. m. forte de rat des îles Antilles, fréquentant
les montagnes 6c les bois ; fa groffeur eft
trois fois plus confidérable que celle des rats domefti-
ques ; il a le poil blanchâtre tirant fur le roux , 6c la
queue courte à proportion de fon corps ; fa chair eft
blanche, graffe 6c délicate , mais elle fent fi fort le
mule, qu’il n’y a que les negres qui puiffent en man-
ger apres l’avoir fait bouillir très-long-tems en changeant
d’eau.
PILOSELLE,f.f. (Hiß. nat.Bot.) genre de plante
qui a ete décrit fous le nom d’hieracium. Voye[ H i e r
a c i u m .
Cette plante eft nomméé par le Vulgaire oreille de
rat ou de fouris, 6c en anglois femblablement thé
moufe-ear. C’eft dans le fyftème de Tournefort la
vingt-deuxieme efpece de genre de plante qu’il nomme
dens leonis; la plupart des autres botamftes l’appellent
én latin pilofella repens ou minor. Linnæus le
nomme hieraciumfoliis integerrirais , ovates , caule rt-
pente , feapo unifioro, Hort. Cliffors. 38#.
Sa racine eft longue comme le doigt, menue, garnie
de fibres. Elle pouffe plufieurs tiges grêles, làr-
menteufes , velues , qui rampent à terre & y prennent
racine. Ses feuiîfes font oblongues , arrondies
par le bout, reffemblantes à des oreilles de rat ou
de fouris , revêtues de p o il, vertes en-deflùs , vei-
neufes,blanchâtres, lanugineüfesen-deffous 6c d’un
goût aftringent.
Ses fleurs font à demi-fleurons, femblables à celles
de l’hieracium, mais plus petites, jaunes, foutenues
chacune par un calice écailleux 6c fimple, & portées
fur un pédicule délié 6c velu. Après que les fleurs
font paffées , il leur fuccede des lemences menues ,
noires, uniformes 6c aigrettées.
Cette plante croît aux lieux arides 6c maigres, fur
le coteaux incultes , dans les terres fablonneufes 6c
aux bords des grands chemins. Elle fleurit en Mai,
Juin 6c Juillet ; elle eft très-amere, 6c paffe en Médecine
pour pofféder des vertus vulnéraires, aftringentes
6c déterfives. (D . J .)
PlLOSELLE , ( Mat. médic. ) .. voye[ OREILLE DE
Souris.
PILOSITES , f. m. pl. ( Hiß. eccUßdß. ) nom que
les Origeniftes donnoientaux Catholiques jparce que
ceux-ci prétendirent que nous reffufeiterons tous
avec toutes les parties de nos corps jufqii’ait moindre,
poil.
PILOT ou P ILOTIS, fi f. (Archit: hydraùlïf pièce
de bois de chêne ronde * employée de fa groffeur,
affilée par un bout, quelquefois armée d’un fer pointu
, & à quatre branches 6c frétée en fa Couronne
de fer qu’on enfonce en terre pour affermir un ter-
rein.
On fe fert pour enfoncer les pilots d’une machine
appelléeyo/z/zetfc , & on eftime ainfi le tems & la dé-
penfe que caufe l’enfoncement.
On commence à fonder le fonds où l’on veut travailler
: cette opération fait connoître la denfité du
terrein dans lequel le pilot doit être enfoncé. Si cette
denfité eft uniforme , l’enfoncement croît à proportion
du nombre des coups égaux qu’elle reçoit ; eft*
elle variable ? C’eft par la différence des coups qu’on
juge de la différente denfité , c’eft-à-dire que la denfité
d’une fécondé couche étant, par exemple , plus
grande, il faudra un plus grand nombre de eoupâ