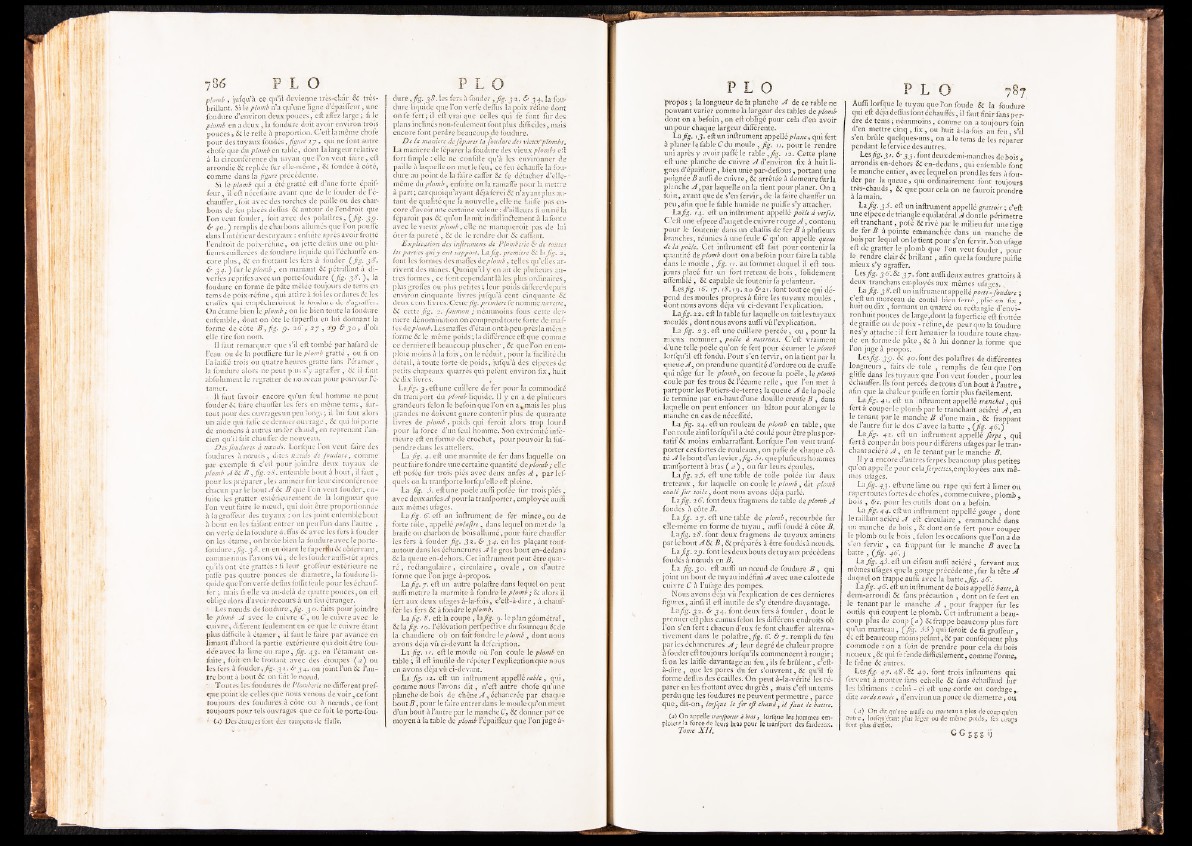
plomb , jufqu’à ce qu’il devienne très-clair 6c très-
brillant. Si le plomb n’a qu’une ligne d’épaiffeur, une
foudure d’environ deux pouces, eft affez large ; fi le
plomb en a deux, la foudure doit avoir environ trois
pouces, & le refte à proportion. C’eft la même chofe
pour des tuyaux Coudés , figuré 27 » CIU*ne f ° nt autre
chofe que du plomb en table, dont la largeur relative
à la circonférence du tuyau que l’on veut faire, eft
arrondie 6c repliée fur elle-même, 6c foudée à côté,
comme dans la figure précédente.
Si le plomb qui a été gratté eft d’une forte épaif-
feur, il eft néccffaire avant que de le fouder de l’échauffer
, foit avec des torches de paille ou des charbons
de feu placés deflus 6c autour de l’endroit que
l’on veut fouder, foit avec des polaftres, ( fig. 35».
& 40. ) remplis de charbons allumés que l’on pouffe
dans l’intérieur des tuyaux : enfuite apres avoir frotté
l’endroit de poix-réfine, on jette defi'us une ou plu-
fieurs cuillerées de foudure liquide qui l’échauffe encore
plus, 6c en frottant les fers à fouder (fig. 38.
& 3 4. ) fur le plomb, en maniant 6c pétrifiant à di-
verfes reprifes avec un porte-foudure (fig. $8. ) , la
foudure en forme de pâte mêlée toujours de tems en
teins de poix-réfine, qui attire à foi les ordures 6c les
craffes qui empêcheroient la foudure de s’agraffer.
On étame bien le plomb; on lie bien toute la foudure
enfemble, dont on ôte le fuperflu en lui donnant la
forme de côte B , fig. 3 . a 6',- 2 7 ,2 9 & g o , d’oii
elle tire fon nom.
Il faut remarquer que s’il eft tombé par hafard de
l’eau ou de la pouffiere fur le plomb gratté , ou fi on
l ’a laiffé trois ou quatre heures gratté fans l’étamer,
la foudure alors ne peut plus s’y agraffer, 6c il faut
abfolument le regratter de nouveau pour pouvoir l’étamer.
. Il faut favoir encore qu’un feul homme ne peut
fouder 6c faire chauffer les fers en même tems, fur-
tout pour des ouvrages un peu longs; il lui faut alors
un aide qui faffe ce dernier ouvrage, 6c qui lui porte
de momens à autres un fer chaud, en reprenant l’ancien
qu’il fait chauffer de nouveau.
Des foudures à noeuds. Lorfque l’on veut faire des
foudures à noeuds, dites nxuds de Joudure, comme
par exemple fi c’eft pour joindre deux tuyaux de
plomb A 6c B ,fig. 28. enfemble bout à bout, il faut,
pour les préparer, les amincir fur leur circonférence
chacun par le bout A 6c B que l'on veut fouder, en-
fuite les gratter extérieurement de la longueur que
l’on veut faire le noeud, qui doit être proportionnée
à la groffeur des tuyaux ; on les joint enfemble bout
à bout en les faifant entrer un peu l’un dans l’autre ,
on verfe de la foudure deflus 6c avec les fers à fouder
on les étame, on broie bien la foudure avec le porte-
foudure ,fig. 38. en en ôtant le fuperffu 6cobfervant,
comme nous l’avons v u , de les fouder aufli-tôt après
qu’ils ont été grattés : fi leur groffeur extérieure ne
paffe pas quatre pouces de diamètre, la foudure liquide
que l’onverle deflus fuffit feule pour les échauffer
; mais fi elle va au-delà de quatre pouces, on eft
obligé alors d’avoir fecours à un feu étranger.
Les noeuds de foudure ,fig. 3 o. faits pour joindre
le plomb A avec le Cuivre C , ou le cuivre avec le
cuivre, different feulement en ce que le cuivre étant
plus difficile à étamer, il faut le faire par avance en
limant d’abord la partie extérieure qui doit être foudée
avec la lime ou râpe, fig. 43. en l’étamant en-
fuite, foit^enle frottant avec des étoupes (a ) ou
les fers à fonder , fig. 3 2. & 34. on joint l’un & l’autre
bout à bout 6c on tait le- noeud,
m Toutes les foudures de Plomberie ne different pref-
que point de celles que noiis venons devoir, ce font
toujours des foudures à côte ou à noeuds, ce font
toujours pour tels ouvrages que ce foit le porte-fou-
(.r) Des étoupes font des tampons de filaffe.
dure ,fig. 38. les fers à fonder, fig. 32. & 34. la foudure
liquide que l’on verfe deflus la poix réfine dont
on fe fert ; il eft vrai que celles qui fe font fur des
plans inclinés non-feulement font plus difficiles, mais
encore font perdre beaucoupsde foudure.
De la maniéré de Jeparer la joudure des vieux'plombs*
La maniéré de féparer la foudure des vieux plombs eft
fort fimple : elle ne confifte qu’à les environner de
paille à laquelle on met le feu, ce feu échauffe la foudure
au point de la faire caflér 6c fe détacher d’elle-
même du plomb, enfuite on la ramaffe pour la mettre
à part; carquoiqu’ayant déjafervi6c n’ayantplusautant
de qualité que la nouvelle, elle ne laiffe pas encore
d’avoir une certaine valeur : d’ailleurs fi on né la
féparoit pas 6c qu’on la mît indiftin&cment à la fonte
avec le vieux plomb, elle ne manqueroit pas de lui
ôter fa pureté , 6c de le rendre dur 6c caflant.
Explication des infirumens de Plomberie & de toutes
les parties qui y ont rapport. La fig. première 6c la fig. 2.
font les formes desmaffes de plomb, telles qu’elles arrivent
des mines. Quoiqu’il y en ait de plufieurs autres
formes , ce font cependant là les plus ordinaires,
plus groffes ou plus petites ; leur poids differe'depuis
environ cinquante livres jufqu’à cent cinquante 6c
deux cens livres. Cette fig. première fe nomme navette.,
6c cette fig. 2. fiaumon ; néanmoins fous cette dernière
dénomination on comprend toute forte de maf-
fes de plomb. Les maffes d’étain ont à-peu-près la même
forme 6c le même poids ; la différence eft que comme
ce dernier eft beaucoup plus cher, 6c que l’on en emploie
moins à la fois, on le réduit, pour la 'facilité du
détail, à toute forte de poids, jufqu’à des efpeces de
petits chapeaux quarrés qui pefent environ fix, huit
6c dix livres. ,
La fig. 3. eft une cuillère de fer pour la commodité
du tranfport du plomb liquide. Il y en a de plufieurs
grandeurs félon le befoin que l’on en armais les plus
grandes ne doivent guere contenir plus de quarante
livres de plomb, poids qui feroit alors trop lourd
pour la force d’un feul homme. Son extrémité inférieure
eft en forme de crochet, pour pouvoir la fuf-
pendre dans les atteliers.
La fig. 4. eft une marmite de fer dans laquelle on
peut faire fondre une certaine quantité de plomb ; elle
eft pofée fur trois piés avec deux anfes A , par lefi
quels on la tranfporte lorfqu’elle eft pleine.
La fig. S. eft une poêle aufli pofee fur trois piés,
avec deux anfes A pour la tranfporter, employée aufli
aux mêmes ufages.
La fig. 6. eft un infiniment de fer mince, ou de
forte tôle , appelle polafire, dans lequel on met de la
braife ou charbon de bois allumé, pour faire chauffer
les fers à fouder fig. 32 . & 34. en les plaçant tout-
autour dans les échancrures A le gros bout en-dedans
& la queue en-dehors. Cet infiniment peut être quar-
r é , reélangulaire , circulaire, ovale , ou d’autre
forme que l’on juge à-propos.
La fig. 7 . eft un autre polafire dans lequel on peut
aufli mettre la marmite à fondre le plomb ; 6c alors il
fert aux deux ufages à-la-fois, c’eft-à-dire , à chauffer
les fers 6c à fondre leplomb.
La fig. 8. eft la coupe , la fig. 0. le plan géométral,
6c la fig. 10. l’élévation perfpeftive du fourneau & de
la chaudière oh on fait fondre le plomb, dont nous
avons déjà vu ci-devant la defeription.
La fig. 11. eft le moule oh l’on coule le plomb en
table ; il eft inutile de répéter l’explication que nous
en avons déjà vu ci-devant.
La fig. 12. eft un infiniment appellé rable, qui,
comme nous l’avons dit, n’eft autre chofe qu’une
planché de bois de chêne A , échancrée par chaque
bout B , pour le faire entrer dans le moule qu’on meut
d’un bout à l’autre par le manche C, 6c donner parce
moyen à la table de plomb l’épaifleur que l’on juge àpropos
; la longueur de la planche A de ce rable ne
pouvant varier comme la. largeur des tables de plomb
dont on à befoin, on eft obligé pour cela d’en avoir
un pour chaque largeur différente.
La fig. 13. eft un infiniment appellé plane, qui fert
à planer le fable C du moule , fig. u. pour le rendre
uni après y avoir pafle le rable ,fig. 12. Cette plane
eft une planche de cuivré ^ d’environ fix à huit lignes
d’épaiffeur, bien unie par-deffous, portant une
poignée B aufli de cuivre , 6c arrêtée à demeure fur la
planche ^ ,pa r laquelle on la tient pour planer. On a
foin, avant que de s’en fervir, de la faire chauffer un
peu, afin que le fable humide ne puiffe s’y attacher.
La fig. 14. eft un infiniment appellé poêle à ver fer.
C ’eft une efpece d’auget de cuivre rouge A , contenu
pour le foutenir dans un chaflis de fer B à plufieurs
branches, réunies à une feule C qu’on appelle queue
de la poêle-. Cet infiniment eft fait pour contenir la
quantité de plomb dont on a befoin pour faire la table
dans le moule , fig. u. au fômmet duquel il eft toujours
placé fur un fort treteau de bois , folidement
affemblé, & capable de foutenir fa pefanteur.
L es fig. i6~.iy. 18; ic). 20 &21. font tout ce qui dépend
des moules propres à faire les tuyaux moulés ,
dont nous avons déjà vû ci-devant l’explication.
La fig. 22. eft la table fur laquelle on fait les tuyaux
moulés, dont nous avons aufli vu l’explication.
La fig. 23. eft une cuillère percée, ou , pour la
mieux nommer, poêle à marrons. C ’eft vraiment
-d’une telle poêle qu’on fe fert pour écumer le plomb
lorfqu’il eft fondu. Pour s’en fervir, on la tient par la
queue A^ on prend une quantité d’ordure ou de craffe
qui nage fur le plomb, on fecoue la poêle, le plomb
coule par fes trous 6c l’écume refte, que l’on met à
partpour les Potiers-de-terre ; laquelle A de la poêle
fe termine par en-haut d’une douille creufe B , dans
laquelle on peut enfoncer un bâton pour alonger le
manche en cas de néceflité.
La fig. 24. eft im rouleau de plomb en table, que
l’on roule ainfi lorfqu’il a été coulé pour être plus portatif
6c moins embarraflant. Lorfque l’on veut transporter
ces fortes de rouleaux, on pafle de chaque .côté
A le bout d’un levier ,fig. 5i. que plufieurs hommes
tranfportent à bras ( a ) , ou fur leurs épaules.
La fig. 26. eft une table de toile pofée fur deux
tréteaux , fur laquelle on coule le plomb, dit plomb
coule fur toile, dont nous avons déjà parlé.
La fig. 2 6. font deux fragmens de table de plomb A
fou dés à côte B.
La fig. 27. eft une table de plomb, recourbée fur
elle-même en forme de tuyau, aufli fondé à côte B.
La fig. 28. font deux fragmens de tuyaux amincis
par le bout A 6c B , 6cpréparés à être fondés ànoeuds-
La fig. 23. font les deux bouts de tuyaux précédens
foudés à noeuds en B.
La fig. 3 o. eft aufli un noeud de foudure B , qui
joint un bout de tuyau indéfini A avec une calotte de
cuivre C à l’ufage des pompes.
Nous avons déjà vu l’explication de ces dernieres
figures, ainfi il eft inutile de s’y étendre davantage.
Lnfig. 32. & 34- font deux fers à fouder , dont le
premier eû plus camus félon les différens endroits oh
l’on s’en fert : chacun d’eux fe font chauffer alternativement
dans le polafire, fig. <8. & 7 . rempli de feu
parles échancrures A ; leur degré de chaleur propre
à fouder eft toujours lorfqu’ils commencent à rougir;
fi on les laifle davantage au feu , ils fe brûlent, c’eft-
à-dire , que les pores du fer s’ouvrent, & qu’il fe
forme demis des écailles. On peut à-la-vérité les réparer
en les frottant avec du grès, mais c’eft un tems
perdu que les foudures ne peuvent permettre, parce
que, dit-on, lorfque le fer ejl chaud, i l faut le battre.
(a) On appelle tranfporter à bras, lorfque les hommes emploient
la force de leurs bras pour le tranfport des fardeaux. ■
Tome X II,
Aufli lorfque le tuyau que l’on foude & la foudurê
qui eft déjà deflus font échauffes, il faut finir fans perdre
de tems ; néanmoins, comme on a toujours loin
d’en mettre cinq , f ix , ou huit à-la-fois au feu, s’il
s’en brûle quelques-uns, on a le tems de les réparer
pendant le fervice des autres.
Les fig. 31. & 3 3 . font deux demi-manches de bois ,
arrondis en-dehors 6c en-dedans, qui enfemble font
le manche entier, avec lequel on prend les fers à fouder
par la queue, qui ordinairement font toujours
très-chauds, 6c que pour cela on ne fauroit prendre
à la main.
La fig. 36. eft un infiniment appellé grattoir ; c’eft
une efpece de triangle équilatéral A dontle périmètre
eft tranchant, pôle & rivé par le milieu fur une tige
de fer B à pointe emmanchée dans un manche de
bois par lequel on le tient pour s’en fervir. Son ufage
eft de gratter le plomb que l’on veut fouder, pour
le rendre clair 6c brillant, afin que la foudure puifle
mieux s’y agraffer.
L fig- 3 6 * & 3 7 ' f011* aufli deux autres grattoirs à
deux tranchons employés aux mêmes ufages. „
La fig. 38. eft un infiniment appellé porte - foudure ;
c’eft un morceau de coutil bien ferré, plié en fix ,
huit ou dix , formant un quarré ou reêtangie d’environ
huit pouces de large,dont la fuperficie eft frottée
de graille ou de poix Xréfine, de peur que la foudure
ne s’y attache : il fert à manier la foudure toute chaude
en forme de pâte, 6c à lui donner la forme que
l’on juge à propos.
Lzsfig- 39- 6c 40.font des polaftres de différentes
longueurs, faits de tôle , remplis de feu que l’on
s;lifle dans les tuyaux que l’on veut fouder, pour les
échauffer. Us font perces de trous d’un bout à l’autre ,
afin que la chaleur puifle en fortir plus facilement.
La fig. 41. eft un infiniment appellé tranchel, qui
fert à couper le plomb par le tranchant aciéré A , en
le tenant par le manche B d’une main, 6c frappant
de l’autre fur le dos C avec la batte , (fig. 46'.')
La fig. 42. eft un infiniment appellé fe rp e , qui
fert à couper du bois pour différens ufages par le tranchant
aciéré A , en le tenant par le manche B.
Il y a encore d’autres ferpes beaucoup plus petites
qu’on appelle pour celaferptttes,employées aux mêmes
ufages.
La fig. 43. eftune lime ou râpe qui fert à limer ou
râper toutes fortes de ehofes, comme cuivre, plomb ,
bois , &c. pour les outils dont on a befoin.
La fig. 44. eft un infiniment appellé gouge , dont
le taillant aciéré A eft circulaire , emmanché dans
un manche de bois , &: dont on fe fert pour couper
le plomb ou le bois , félon les occafions que l’on a de
s?en fervir , en frappant fur le manche B avec la
batte , (fig. 46. )
La fig. 46. eft un cifeau aufli aciéré , fervant aux
mêmes ufages que la gouge précédente, fur la tête A
duquel on frappe aufli avec la batte ,fig. 4 (T.
La fig. 46. eft un infiniment de bois appellé batte, à
demi-arrondi 6c fans précaution , dont on fe fert en
le tenant par le manche A , pour frapper fur les
outils qui coupent le plomb. Cet infiniment a beaucoup
plus de coup (a ) & frappe beaucoup plus fore
qu’ un marteau, (fig. 66 ) qui feroit de fa groffeur ,
6c eft beaucoup moinspefant,& par conféquent plus
commode : on a foin de prendre pour cela dubois
noueux, 6c qui fe fende difficilement, comme l’orme,
le frêne 6c autres.' 1 Les fig. 47. 48. 6c 49. font trois infirumens qui
fervent à monte.r-fans echelle & fans échaffaud fur
les bâtimens : celui - ci eft une corde ©u cordage
dite corde nouée, d’environ un pouce de diamètre, ou
( a) On dit q autre, lorfqu’ét u’une mafle ou marteau a plus de coup qu'un font plus d’effet.2nt plus léger ou de même poids, fes coups
G G g g g ij