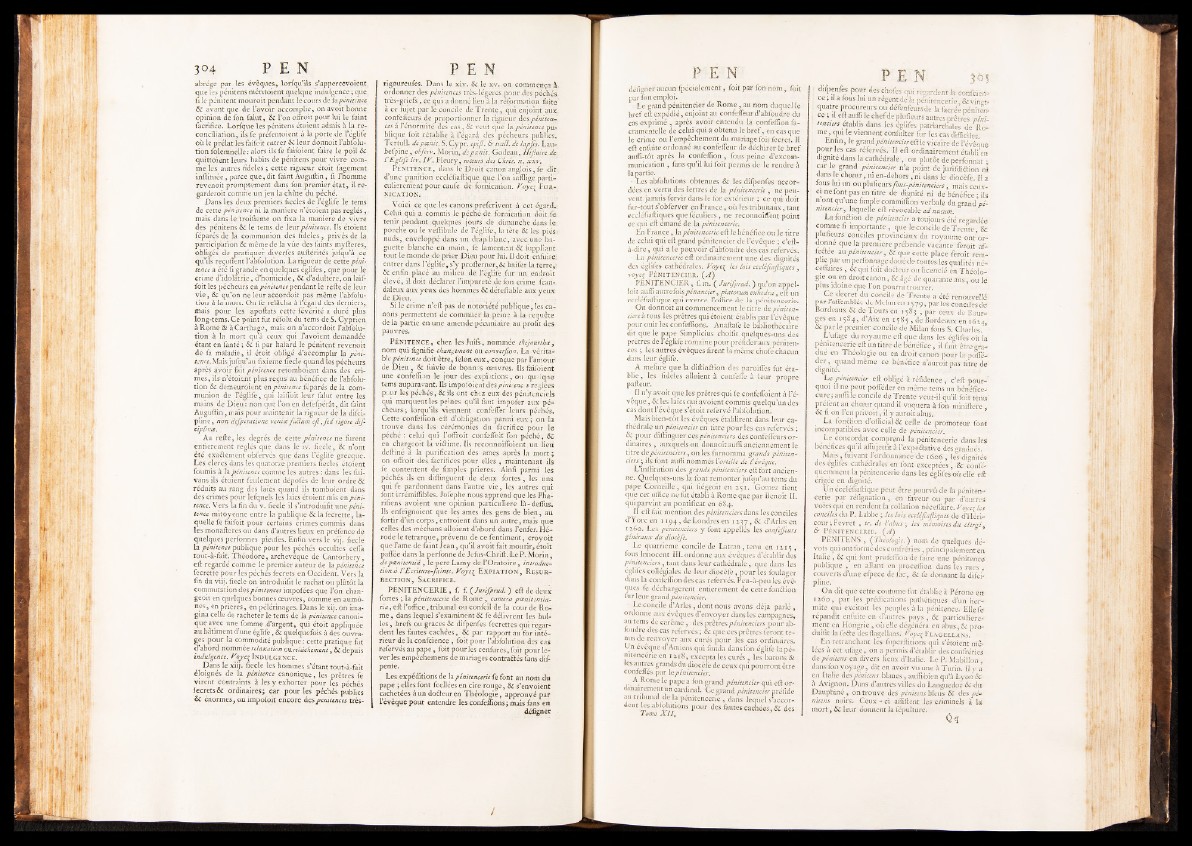
abrège par les évêques, lorfqu’ils s’appercevoient,
que les pénitens méritoient quelque indulgence ; que
fi le pénitent mouroit pendant le cours de iapénitmcc
& avant que de l’avoir accomplie, on avoit bonne
opinion de fon falut, & l’on offroir pour lui le faint
facririee. Lorfque les pénitens étoient admis à la réconciliation,
ils fe préfentoient à la porte de l’égiile
où le prélat les faifoit entrer 8c leur donnoit l’abfolu-
tion folemnelle : alors ils fe faifoient faire le poil &
quittoient leurs habits de pénitens pour vivre comme
les autres fideles ; cette rigueur étoit fagement
inftituée, parce que, dit faint Auguftin, fi l’homme
revenoit promptement dans fon premier.état, il re-
garderoit comme un jeu la chute du péché.
Dans les deux premiers fiecles de l’églife le tems
de cette pénitence ni la maniéré n’étoient pas réglés,
mais dans le troifieme on fixa; la maniéré de vivre
des pénitens 8c le teins de leur pénitence. Ils étoient
féparés de la communion des fideles , privés de la
participation & même de la vue des faints myfteres,
obligés de pratiquer diverfes auflérités jufqu’à ce
qu’ils reçulTent l ’abfolution. La rigueur de cette péni--
tence a été fi grande en quelques églifes, que pour le
crime d’idolâtrie, d’homicide, 8c d’adultere,on laif-
foit les pécheurs en pénitence pendant le relie de leur
v ie , & qu’on ne leur accordoit pas même l’abfolution
à la mort. On fe relâcha à l’égard des derniers,
mais pour les apoftats cette féyérité a duré plus
long-tems. Ce point fut réfolu du tems de S. Cyprien
à Rome & à Carthage, mais on n’accordoit l’abfolution
à la mort qu’à ceux. qui l’avoient demandée
étant en fanté ; 8c fi par halard le pénitent revenoit
de fa maladie , il étoit obligé d’accomplir la pénitence.
Mais jufqu’au fixieme fiecle quand les pécheurs
après avoir Fait pénitence retomboient dans des crimes,
ils n’étoient plus reçus' au bénéfice de l’abfolu-
tion 8c demeurôiént en pénitence féparés de la communion
de l’églife, qui laifloit leur falut entre les
mains de Dieu: non que l’on en defefpérât, dit faint
Auguftin, mais pour maintenir la rigueur de la discipline
, non defperatione venicé faclutn ejl^fed rjgore dtf-
ciplina.
Au refie, les degrés de cette pénitence ne furent
entièrement réglés que dans le iv. fiecle, 8c n’ont
été exactement obfervés qpg dans l’églife grecque.
Les clercs dans les quatorze premiers fiecles étoient
fournis à la pénitence comme les autres : dans les fui-
vans ils étoient feulement dépofés de leur ordre &
réduits au rang des laïcs quand ils tomboient dans
des crimes pour lefquels les laïcs étoient mis en pénitence.
Vers la fin du v . fiecle il s’introduifit'une pénitence
mitoyenne entre la publique &lafecrette, laquelle
fe faifoit pour certains crimes commis dans
les monafteres ou dans d’autres lieux en préfence de
quelques perfonnes pieufes. Enfin vers le vij. fiecle
la pénitence publique pour les péchés occultes cefla
tout-à-fait. Théodore, archevêque de Cantorbery,
eft regardé comme le premier auteur de la pénitence
fecrette pour les pèches fecrets en Occident. Vers la
fin du viij. fiecle on introduifit le rachat ou plutôt la
commutation des pénitences impofées que l’on changent
en quelques bonnes oeuvres, comme en aumônes,
en prières, en pélérinages. Dans le xij. on imagina
celle de racheter le tems de la pénitence canonique
avec une fomme .d’argent, qui étoit appliquée
au batiment d’une églife, & quelquefois à des ouvrages
pour la commodité publique : cette pratique fut
d’abord nommee relaxation on relâchement, 8c depuis
indulgence. Voye[ INDULGENCE.
Dans le xiij. fiecle les hommes s’étant tout-à-fait
éloignés de la pénitence canonique, les prêtres fe
virent Contraints à les y exhorter pour les péchés
fecrets & ordinaires; car pour les péchés publics
& énormes, on impolbit encore d es pénitences très-
; rigoureufes. Dans le xiv. 8c le xv. on commença à
ordonner des pénitences très-légeres pour des péchés
très-griefs, ce qui a donné lieu à la reformation faite
a ce iùjet par le concile de Trente , qui enjoint aux
i confefièurs de proportionner la rigueur des pénitences
à l’énormité des cas, & veut que \a pénitence pu-
blique loit .rétablie à l’égard des pécheurs publics.
Tertull. de pccnit. S. Cypr. epijl. & tracl. de lapjîs. Lau-
befpine, obferv. Morin, de partit. Godeau, Hijhire.de
, l'Eglife liv. IP . Fleury, moeurs des Chrét. n. xxv.
P é n i t e n c e , dans le Droit c a n o n ’ a n g lo i s , f e d it
; d’u n e p u n it io n e c c lé fia ftiq u e . q u e l’o n in fîlig e p a r t i -
; c u lie r em e n t p o u r ç a u f e . de* fo rn ic a t io n . Voye{ ,Fo r -
• NIÇATION.
Voici ce que les canons preferivent à cet égard»;
: Celui qui a commis le péché de fornication doit.fe.
tenir pendant quelques jours de .dimanche dans le.
porche ou le veftibule de l’églife, la tète & les piés;
nuds, enveloppé dans un drap blanc, avec une baguette
blanche en main, fe lamentant 8c fuppliant
tout le monde de prier Dieu pour lui. Il doit, enfuit e;
! entrer dans l ’églile, s’y profterner,8c baifer la terre,:
& enfin placé au milieu dé; Péglife fur un endroit
élevé, il doit déclarer l’impureté de fon crime fean-
daleux aux yeux des hommes 8c déteftable aux yeux
de Dieu.
Si le crime n’eft pas de notoriété publique, les canons
permettent de commuer la-peine à la requête
de la partie en une amende pécuniaire au. profit des-
pauvres.
P ÉN ITEN C E , chez les Juifs, nommée thejourtha,
nom qui fignifie changement ou converjion. La véritable
pénitence doit être, félon eux, conçue par l’amour-
de D ie u , 8c fuivie de bonnes oeuvres. Ils faifoient
une confeffion le jour des expiations, ou qudqne
tems auparavant. Ils impoloient despèni.enc s réglées-
pour les péchés, & ils ont chez eux des pénitenciels
qui marquent les peines qu’il faut impoier aux pécheurs
; lorqu’ils viennent confeffer leùrs péchés.
Cette confeflion efi d’obligation parmi eux ; on la
trouve dans les cérémonies du facrifice pour le
péché : celui qui l’ofiroit confeffoif Ton péché, &•
en chargeoit la victime. Ils reconnoifloient un lieu
deftiné à la purification des âmes après la mort;
on ofifoit des facrifices pour elles , maintenant ils
fe contentent de fimples prières. Ainfi parmi les
péchés ils en diftinguent de deux fortes, les uns
qui fe pardonnent dans l’autre v ie , les autres qui
font irrémiflibles. Jofephe nous apprend que les Pha-
rifiens avoient une opinion particulière là-deffiis.
Ils enfeignoient que les âmes des gens de bien, au
fortir d’un corps, entroient dans un autre, mais que
celles des méchans ail oient d’abord dans l’enfer. Hé-
rode le tetrarque, prévenu de ce fentiment, croyoit
que l’ame de faint Jean, qu’il avoit fait mourir, étoit
pafleë dans la perfonnede Jefus-Chrift.LeP. Morin,
depanitentiâ, le pere Lamy de l’Oratoire, introduction
à l ’Ecriture-fainte. Voye^ E x p i a t i o n , R é s u r r
e c t i o n , S a c r i f i c e .
PÉNITENCERIE, f. f. (Jurifprud.) eft de deux
fortes ; la pénitencerie de Rome , caméra poenitentiai
ria,e(t l’office, tribunal ou confeil de la cour de Rome
, dans lequel s’examinent 8c fe délivrent les bulles
, brefs ou grâces & difpenfes fecrettes qui regardent
les fautes cachées, 8c par rapport au for intérieur
de la confcience , foit pour l’abfolution des cas
refervésau pape, foit pour les cenfures, foit pour lever
les empechemens de mariages contraâés fans dif-
penfe.
Les expéditions de la pénitencerie fe font au nom du
pape ; elles font fcellées en cire rouge, & s’envoient
cachetées à un do&euren Théologie, approuvé par
l’évêque pour entendre les confeffions ; mais fans en
déftgner
défigner ■ aucun fpécialement, foit par fon nom, foit
par fon emploi.
Le grand pénitencier de Rome, au nom duquel le
bref eft expédié, enjoint au confeffeur d’abfoudre du
cas exprimé , après avoir entendu la confeflion fa-
cramentelle de celui qui a obtenu le b ref, en cas que
le crime ou l’empêchement du mariage foit fecret. Il
efi enfuite ordonné au confeffeur de déchirer le bref
auffi-tôt après la confeflion , fous peine d’excommunication
, fans qu’il lui foit permis de le rendre à
la partie.
- Les abfoiutions obtenues & les difpenfes accordées
en vertu des lettres de la pénitencerie , ne peuvent
jamais fervir dans le for extérieur ; ce qui doit
fur-tout s’obferver en France, où les tribunaux, tant
eccléfiafticpies que féculiers, ne reconnoiffent point
ce qui eft émané de la pénitencerie.
En France, la pénitencerie eft le bénéfice ou le titre
de celui qui eft grand pénitencier de l’évêque ; c’eft-
à-dire, qui a le pouvoir d’abfoudre des cas refervés.
La pénitencerie eft ordinairement une des dignités
des églifes cathédrales. Voye^ les lois eccléfiajiiques,
Voye[ PÉNITEN CIER. {A')
PÉNITENCIER, f. m. ( Jurifprud. ) qu’on appel-
loit auflî autrefoispenancier, piatorum exhedra, eft un
eccléfiaftique qui exerce l’office de la pénitencerie.
On donnoit au commencement le titre de pénitenciers
à tous les prêtres qui étoient établis par l’évêque
pour ouir les confeffions. Anaftafe le bibliothécaire
dit que le pape Simplicius choifit quelques-uns des
prêtres de l’églife romaine pour préfider aux pénitences
; les autres évêques firent la même chofe chacun
dans leur églife.
A mëfure que la diftin&ion des paroiffes fut établie
, les fidèles alloient à confeffe à leur propre
pafteur.
Il n’y avoit que les prêtres qui fe confeffoient à l’évêque
, &les laïcs qui avoient commis quelqu’un des
cas dont l’évêque s’étoit refervé l’abfolution.
Mais bien-tôt les évêques établirent dans leur cathédrale
un pénitencier en titre pour les cas refervés ;
& pour diftinguer ces pénitenciers des confeffeurs ordinaires
, auxquels on donnoit auffi anciennement le
titre depénitenciers, on les furnomma grands pénitenciers
; ils font auffi nommés l’oreille de Vévêque.
L’inftitution des grands pénitenciers eft fort ancienne.
Quelques-uns la font remonter, jufqu’au tems du
pape Corneille, qui fiégeoit en 251. Gomez tient
que cet office ne fut établi à Rome que par Benoît IL
qui parvint au pontificat en 684.'
Il eft fait mention des pénitenciers dans les conciles
d’Yorc en 1 19 4, de Londres en 12.3 7 , & d’Arles en
12.60. Les pénitenciers y font appellés les confeffeurs
généraux du diocèfè.
Le quatrième concile de Latran, tenu en 1 2 1 ç ,
fous Innocent III. ordonne aux évêques d’établir des
pénitenciers, tant dans leur cathédrale, que dans les
eglifes collégiales de leur diocèfe , pour les foulager
dans la confeflion des cas refervés. Peu-à-peu les évêques
fe déchargèrent entièrement de cette fonriion
fur leur grand pénitencier.
Le concile d’Arles, dont nous avons déjà parlé ,
ordonne aux évêques d’envoyer dans les campagnes,
au tems de carême , des prêtres pénitenciers pour ab- i
foudre des cas refervés ; 8c que ces prêtres feront te-
nus de ƒ envoyer aux curés pour les cas ordinaires.
Un evêque d Amiens qui fonda dans fon églife lapé-
mtencérie en 1 1 18 , excepta les curés , les barons &
^/r^S ëranc^s diocèfe de ceux qui pourront être
confefles par le pénitencier,
j..A.R°me Ie pape a fon grand pénitencier qui eft or-1
dmairementun cardinal. Ce grand pénitencier préfide
au tribunal de la pénitencerie , dans lequel s’accordent
les abfoiutions pour des fautes cachées, & des
Tome X I I ,
• difpenfes polir des chofes quireeardentiaconfciert-
j ce ; il a tous Im un régent de la peniténeerie, & vingt*
! T atf e ^ocufeurs ou défenfeursde lafacréepénitën*
. ce , il eft auffi le chef de plusieurs autres prêtres péni-
’ un~lcrs établis dans les êglin-i patriarchales dé Ro*
, me., qui le viennent coiifulter for les'cas difficiles;.
Enfin, le grandpéfiianchreftW vicaire de l’évêque
Ppnc les cas refervés. Il eft ordinairement établi en
| dignité dans la cathédrale , ou plutàt de perfonnat ;
| car le grand péniimcier n’a point de jurifdiaion ni
dans le choeur, ni en-dehors , ni dans le diocèfe. Il a
5 “ ^ “ ‘ «h ouplufteuts^lâ-^nÜMaéri, niais ceux*
et nefont pas en titre dè dignité ni de Bénéfice ; ils
■ H qu’une fimple commiffiori verbale du grand W.
nittneicr -ji'iaquelle eft révocable ad nutuni: - ■ f
La fonétion de pénitencier a toujours'été regardée
comme fi importanteiqiièteconcile de Trente &
plufièurs'vcoriciles provmciaux dirroÿaiime
donné que la première prébende vacante ’féréit àf*
fettee au pénitencier, Sc que cette place feroit rém*
plie par unperfonnage doué de toutes les qualités né*
ceffaires , & qui foit doéteur ou licencié en Thébib*''
8|* °.u, en droitcanon, & â g é de quarante ans, ou lé
plus idoine que l’on pourra trouver; ' • ' *
Ce decret du concile de Trente a été renouvelle
par rafiemblée de Melun en 1 579, parles conciles de
cordeaux 8c de Tours en 1583 , par ceux de Bourj
ges en 1584, d’A ix en 1585 » fie Bordeaux en 1624
8c parlé premier concile de Milan fous S. Charles. |
( L’ufage du royaume eft que dans les églifes'où la
pénitencerie eft un titre de bénéfice, il faùt être gradué
en Théologie ou en droit canon pour là poffé-
fier, cjuanfi même ce bénéfice n’auroit-pas titre de
dignité.
Le pénitencier eft obligé à réfidencé, c’eft pourquoi
il ne peut pofleder en même tems im bénéfice^
cure; auffile concile de Trente veut-il qu’il foit tenu
préfent au choeur quand il vaquera à fon miniftere ,
8c fi on l’en privoit, il y adroit abus.
La fonûion d’official 8c celle de promoteur font
incompatibles avec celle de pénitencier.
I Ée concordat comprend la pénitencerie dans les
bénéfices qu il affiijettit à J’expeéfative des gradués.
Mais , fuivant l’ordonnance'de 1606 , les dignités
des églifes cathédrales en font exceptées ^ & confé*
(juemment la pénitencerie dans les eglifes où elle eft
erigée en dignité.
Un eccléfiaftique peut être pourvu de la périitèn-»
Cerie par réfignation, en faveur ou par d’autres
voies qui en rendent la collation néceflaire. Toyei les
conciles du P. Labbe ; les lois eccléjîaftïquès de d’Héri-
cour ; Fevret , tr. de l’abus ; les mémoires du clergé i
6 PÉNITENCERIE. (X )
PÉNITENS , {Théologie. ) nom de quelques dé-*'
vots qui ont forme des confréries , principalement en
Italie , 8c qui font profeffion de faire une pénitence
publique , en allant en proceffion dans les rues ,
couverts d’une efpece de fac, 8c fe donnant la difei--
pline.
On dit que cette coutume fut établie à Péroné éri
12.60, par les prédications pathétiques d’un her-
mite qui excitoit les peuples à la pénitence. Ellefë
répandit enfuite en d’autres pays , 8c particulière-*
ment en Hongrie , où elle dégénéra en abus, 8c pro-*
duifit la feéfe des flagellans. Voyc^ Flagellans.
En retranchant les fuperftitions qui s’étoient me*
lées à cet ufage, on a permis d’établir des confréries
de pénitens en divers lieux d’Italie. Le P. Mabillon ,
dans fon voyage, dit en avoir vu une à Turin. Il y »
en Italie des pénitens blancs, auffi-bien qu’à Lyon cC-
à Avignon. Dans d’autres villes du Languedoc & du
Dauphiné , on trouve des' pénitens bleus & des pé*
nitens noirs/ C e u x - c i affiftent les criminels à la
mort, 8c leur donnent la fépulture.