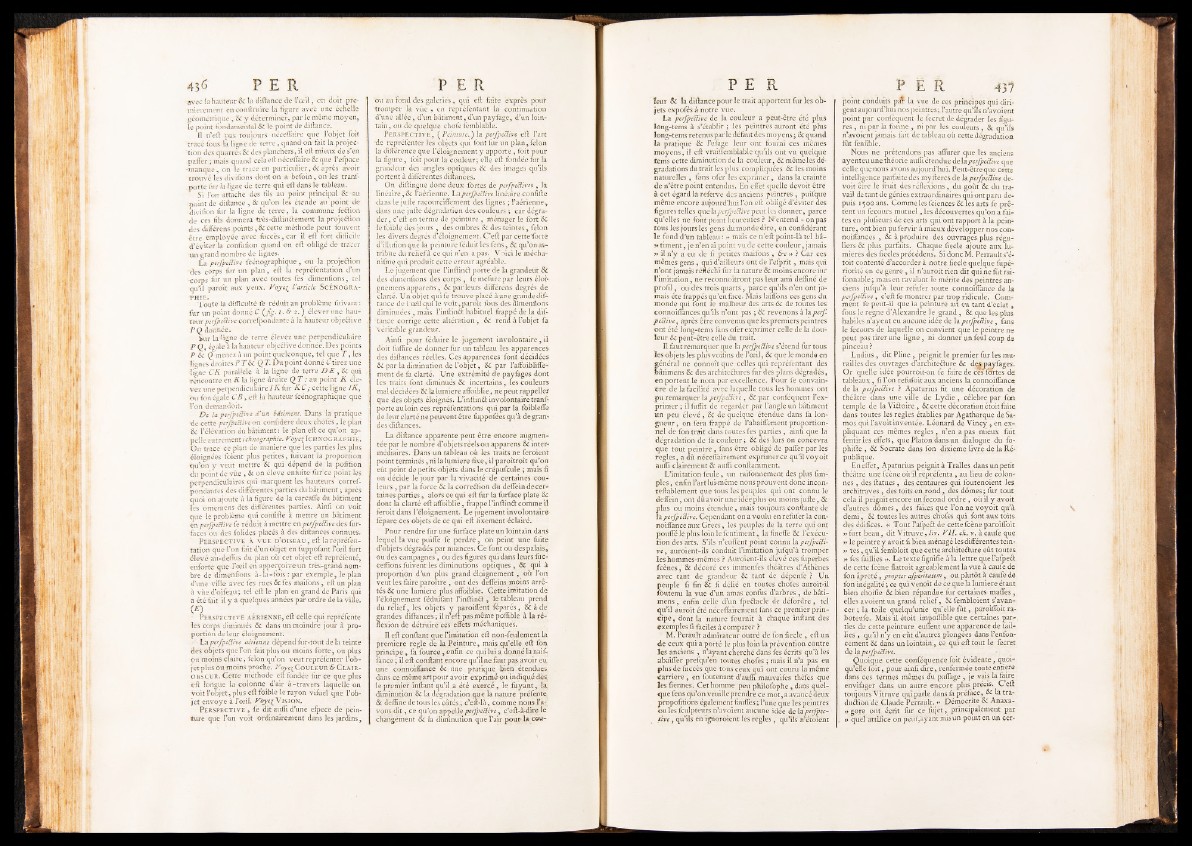
avec la hauteur 8c la diftance de l’oe il, on doit premièrement
en conftru-ire la figure ave'c une échelle
géométrique , 8c y déterminer, par le même moyen,
le point fondamental 8c le. point de diftance.
Il n’eft'pas toujours néceflaire que l’objet fok
-tracé fous la ligne de terre, quand on fait la. projection
des quarres & des planchers-, il eft mieux de s’en
paffer ; mais quand cela eft néceflaire 8c que Pefpace
-manque, on le trace en particulier, & après avoir
trouvé les divifions dont on a befoin, on les tranf-
porte fur la-ligne de terre qui eft dans le tableau.
Si l’on attache des fils au point principal 8c • au
•point de diftance , & qu’on les étende au point de
divifton fur la ligne de terre , la commune feêtion
de ces fils donnera très-diftindement la. projection
des différens points, & cette méthode peut fouvent
être employée avec fuccès, car il eft fort difficile
d’éviter la confufion quand on eft obligé de tracer
un grand nombre de lignes.
La ptrfpecüvt fcénographique, ou la .projedion
des corps fur un plan, eft la repréfentation d’un
-corps fur un plan avec toutes fes dimenfions, tel
qu’il paroît aux yeux. Voye^ L'article SCÉNOGRAPHIE.
Toute la difficulté fe réduit au problème fuivant:
fur un point donné C (j%\ i. & 2. ) élever-une hauteur
perfpeclive correfpondante à la haütéur objedive
P Q dôWîée.
Sur la'ligne de terre élevez une perpendiculaire
p égale à la hauteur objedive donnée. Des points
P Sc Q menez à im point quelconque, tel que T , les
lignes droites P T& cQ T . D u point donné C tirez une
-ligne CK paraMele à la ligne de terre D E , 8c qui
•rencontre en K la ligne droite Q T : au point K élevez
une perpendiculaire IK fur K C ; cette ligne J K ,
"du fon égale CB , eft la hauteur fcénographique que
l ’on demandeit.
De la perfpeclive d'un bâtiment. Dans la pratique
de cette perfpeclive on confidere deux chofés, le plan
& l'élévation du bâtiment: le plan eft ce qu’on appelle
autrement ichnographie. Voye£ICHNOGRAPHIE.
On trace ce plan de maniéré que les parties les plus
éloignées foient plus petites, fuivant la proportion
qu’on y veut mettre & qui dépend de la pofition
du point de vue , & on éleve enmite fur1 ce point les
perpendiculaires qui marquent les hauteurs corref-
pondantes des différentes parties du bâtiment ; après
quoi on ajoute à là figure de la carcaflfe du bâtiment
les omemens des différentes parties. Ainfi on voit
que le problème qui confifte à mettre im bâtiment
en perfpeülive fe réduit à mettre en perfpeclive des fur-
faces ou des folides placés à des diftances connues.
' P e r s p e c t i v e à v u e d ’o i s e a u , eft la repréfentation
que l’on fait d’un objet en fuppofant l’oeil fort
élevé ati-deffus du plan oït cet objet eft repréfenté,
enforte que l’oeil en apperçoive un très-grand nombre
de dimenfions à-la-fois : par exemple, le plan
d’une ville avec fes rues & fes maifons , eft un plan
à vue d’oifeau; tel eft le plan en grand de Paris qui
a été fait il y a quelques années par ordre de la ville.
(£ )
■ P e r s p e c t i v e a é r i e n n e , e ft c e lle q u i rep r é fen te
les co rp s diminués 8c dans u n m o in d r e jo u r à p r o p
o r t io n de leu r é lo ig n em e n t .
La perfpeclive aerienne dépend fur-tout de la teinte
des objets que l’on fait plus ou moins forte, ou plus
ou moins claire, félon qu’on veut repréfenter l’objet
plus ou moins proche. Voye^ C o u l e u r & C l a i r -
o bsçur. Cette méthode eft fondée fur ce que plus
eft longue la colonne d’air à-travers laquelle on
voit l’objet,plus eft foible le rayon vifuel que l’objet
envoyé à l’oeil. Vryeç V i s io n ..
P e r s p e c t i v e , f e d it au fii d’u n e e fp e c e d e p e in tu
r e q u e l’o n v o i t o rd in a ir em e n t dans le s ja rd in s ,
ou au fond des.galeriés, qui eft faite exprès pouf
-tromper la vue , en repréfentant la continuation
d’une allée, d’un bâtiment, d’un payfage, d’un lointain
, ou de quelque choie femblable.
P e r s p e c t i v e , ( Peinture. ) la perfpeclive e f t l’aft
-de repréfenter les objets qui font fur un plan, félon
la différence que l’éloignement y apporte,Toit pouf
la figure, Toit pour la couleur ; elle eft fondée fur la
grandeur des angles optiques 8c des images qu’ils
portent à différentes diftances.
On diftingue donc deux fortes de perfpeclives , la
linéaire,& l’aérienne. Laperfpeclive. linéaire confifte
dans le jufte racourciflement des lignes ; l’aérienne,
dans une jufte dégradation des couleurs ; car dégrader
, c’eft en terme de peinture , ménager le fort 6C
le foible des jours , des ombres 8c des teintes, félon
les divers degrés d’éloignement. C ’eft par cette forte
d’illufion que la peinture féduit les fens, 8c qu’on attribue
du relief à ce qui n’en a pas. Voici le mécha-
nilme qui produit cette erreur agréable.
Le jugement que l’inflinCt porte de la grandeur 8c
des dimenfions des corps , fe mefure par leurs éloi*
gnemens apparens, 8c par leurs différens degrés de
clarté. Un objet qui fe trouve placé à une grande diftance
de l’oerl qui le voit-, paroît fous des dimenfions
diminuées , mais l’inftinât habituel frappé de la dil-
• tance corrige cette altération -, 8c rend à l’objet fa
'véritable grandeur.
Ainfi pour féduire le jugement involontaire, il
doit fuffire de donner fur un tableau les apparences
des diftances réelles. Ces apparences font décidées
8c par la diminution de l’objet, 8c par l’affoibliffe-
ment de fa clarté. Une extrémité de payfages dont
les traits font diminués 8c incertains, les couleurs
mal décidées & la lumière affaiblie, ne peut rappellef
que des objets éloignés. L’inftinêt involontaire transporte
au loin ces repréfentations qui par la foibleffe
de leur clarté ne peuvent être fuppofées qu’à de grandes
diftances.
La diftance apparente peut être encore augmentée
par le nombre d’objets réels ou apparens 8c intermédiaires.
Dans un tableau où les traits ne feroient
point terminés, ni la lumière fixe, il paroîtroît qu’on
eût peint de petits objèts dans le crépufcule ; mais fi
en décide le jour par la vivacité de certaines couleurs
, par la force 8c la correûion du deflein de certaines
parties, alors ce qui eft fur la furface plate 8c
dont la clarté eft affoiblie, frappe l ’inftinâ comme il
feroit dans l ’éloignement. Le jugement involontaire-
fépare ces objets de ce qui eft fixement éclairé.
Pour rendre fur une furface plate un lointain dans
lequel la vue puiffe fe perdre , on peint une fuite
d’objets dégradés par nuances. Ce font ou des palais,
ou des campagnes , ou des figures qui dans leurs fuc-
ceffions fuivent les diminutions optiques , & qui à
proportion d’un plus grand éloignement, où l’on
veut les faire paroître , ont des deffeins moins arrêtés
8c une lumière plus affoiblie. Cette imitation de
l’éloignement féduifant l’inflinêt, le tableau prend
du relief, les objets y paroiffent féparés, & à de
grandes diftances ; il n’eft pas même poffible à la réflexion
de détruire ces effets méchaniquès.
Il eft confiant que l’imitation eft non-feulement la
première réglé de la Peinture, mais qu’elle eft fon,
principe , fa fource, enfin ce qui lui a donné la naifr
lance ; il eft confiant encore qu’il ne faut pas avoir eu
ijne connoiflance 8c line ptatiquq bien étendues,
dans ce même art pour avoir exprimé ou indiqué dès,
le premier inftant qu’il a été exercé, le fuyant, la,
diminution 8c la dégradation que la nature préfente
& deffine de tous les côtés.; c’eft-là, comme nous l’a-
vqns d it, ce qu’on appelle perfpeclive, c’eft-à-dire le
changément 8c la diminution que l’air pour la couleur
8c la diftance pour le trait apportent fur les objets
expofés à notre vue.
La perfpeclive de la couleur a peut-être été plus
long-tems à s’établir ; les peintres auront été plus
long-tems retenus par le défaut des moyens ; 8c quand
la pratique 8c l’ufage leur ont fourni ces mêmes
moyens, il eft vraiffemblable qu’ils ont vu quelque
tems cette diminution de la couleur, 8c même les dégradations
du trait les plus compliquées 8c les moins
naturelles , fans ofer les exprimer, dans la crainte
de n’être point entendus. En effet quelle devoit être
à cet égard la referve des anciens peintres , puifque
même encore aujourd’hui l’on eft obligé d’éviter des
figures telles que la perfpeclive peut les donner, parce
qu’elles ne font point heureui’es ? N’entend - on pas
tous les jours les gens du monde dire, en confidérant
le fond d’un tableau : » mais ce n’eft point-là tel bâ-
» riment, je n’en ai point vu de cette couleur, jamais
» il n’y a eu de fi petites maifons , &c » ? Car ces
mêmes gens , qui d’ailleurs ont de l’efprit, mais qui
n’ont jamais réfléchi fur la nature 8c moins encore fur
l’imitation, ne reconnoîtront pas leur ami defliné de
profil, ou des trois quarts , parce qu’ils n’en ont jamais
été frappés qu’en face. Mais laiffons ces gens du
monde qui font le malheur des arts & de toutes les
connoiflances qu’ils n’ont pas ; 8c revenons à la perfpeclive,
après être convenus que les premiers peintres
ont été long-tems fans ofer exprimer celle de la douleur
8c peut-être celle du trait.
Il faut remarquer que la perfpeclive s’étend fur tous
les objets les plus voifins de l’oeil, 8c que le monde en
général ne connoît que celles qui repréfentant des
bâtimens 8c des architectures fur des plans dégradés,
en portent le nom par excellence. Pour fe convaincre
de la facilité avec laquelle tous les hommes ont
pu remarquer la perfpeclive , 8c par conféquent l’exprimer
; il fuffit de regarder par l ’angle un bâtiment
iin peu é le v é , & de quelque étendue dans fa longueur
, on fera frappé de l’abaiflèment proportionnel
de fon trait dans toutes les parties , ainfi que la
dégradation de fa couleur ; 8c dès-lors on concevra
que tout peintre , fans être obligé de paffer par les
réglés, a dû néceflairement exprimer ce qu’il voyoit
auffi clairement & auffi conftamment.
L’imitation feule, un raifonnement des plus {impies
, enfin l’art lui-même nous prouvent donc.incon-
feftablement que tous les peuples qui ont connu le
deflein, Ont du avoir une idée plus ou moins jufte, &
plus ou moins étendue, mais toujours confiante de
la perfpeclive. Cependant on a voulu en refùfer la con-
noiflance aux Grecs, les peuples de la terre qui ont
pouffé le plus loin le fentiment, la fîneffe 8c l’exéeuf
îion des arts. S’ils n’euffent point connu la perfpeclive
, auroient-ils conduit l’imitation jufqu’à tromper
les hommes-mêmes ? Auroient-ils élevé ces fuperbes
fcènes, & décoré ces immenfes théâtres d’Athènes
avec tant de grandeur 8c tant de dépenfe ? Un
peuple fi fin & fi délié en toutes chofes auroit-il
ïoutenu la vue d’un amas confus d’arbres, de bâtimens,
enfin celle d’un fpeftacle de défordre, tel
qu’il auroit été néceflairement fans ce premier principe,
dont la nature fournit à chaque inftant des
exemples fi faciles à comparer ?
M. Peràult admirateur outré de fon fiecle , eft un
de ceux qui a porté le plus loin la prévention contre
les anciens , n’ayant cherché dans fes écrits qu’à lès
àbaifler prefqu’en toutes chofés ; mais il n’a pas eu
plus de fuccès que tous ceux qui ont couru là même
carrière , en foutenant d’aüffi mauvaifes thèfès que
les fiennes. Cet homme peu philofophe , dans quelque
fens qu’on veuille prendre ce mot, a avancé deux
propofitions également fauffesyl’une que les peintres
ou les fculpteurs n’avoient aucune idee de la perfpec-
ùve, qu’ils en ighoroient les réglés, qu’ils n’-étoient
point conduits pa* la vue de ces principes qui dirigent
aujourd’hui nos peintres ; l’autre qu’ils n’avoient
point par conféquent le fecret de dégrader les figures
, ni par la forme , ni par les couleurs , & qu’ils
n’avoient jamais fait de tableau où cette dégradation
fût fenfîble.
Nous ne prétendons pas affurer que les anciens
ayent eu une théorie auffi étendue delà perfpeclive que
celle que nous avons aujourd’hui. Peut-être que cette
intelligence parfaite des myftereS de la perfpeclive devoit
être le fruit des réflexions , du goût & du travail
de tant de génies extraordinaires qui ont paru depuis
1500 ans. Comme les fciences 8c les arts fe prêtent
un fecours mutuel, les découvertes qu’on a faites
en plufieurs de ces arts qui ont rapport à la peinture,
ont bien pufervir à mieux développer nos con-
noiffances , & à produire des ouvrages plus réguliers
8c plus parfaits. Chaque fiecle ajoute aux lumières
des fiecles précédens. Si donc M. Perraults’é-
toit contenté d’accorder à notre fiecle quelque fupé-
riorité en ce genre , il n’auroit rien dit qui ne fût rai-
fonnable ; mais en ravalant le mérite des peintres anciens
jufqu’à leur refùfer toute connoiflance de la
perfpeclive , c’eft fe montrer par trop ridicule. Comment
fe peut-il que la peinture ait- eu tant d’éclat ,
fous le régné d’Alexandre le grand, 8c que les plus
habiles n’ayent eu aucune idée de la perfpeclive , fans
le fecours de laquelle on convient que le peintre ne
peut pas tirer une ligne, ni donner un feul coup de
pinceau?
Ludius , dit Pline, peignit le premier fur les murailles
des ouvrages d’architeèlure & de$ payfages.
Or quelle idée pourroit-on fe faire de ces fortes de
tableaux, fi l’on refufoit aux anciens la connoiflance
de la perfpeclive ? Apaturius fit une décoration de
théâtre dans une ville de L y d ie , célébré par fon
temple de la Victoire , 8c cette décoration étoit faite
dans toutes les réglés établies par Agatharque de Sa-
mos qui l’avoit inventée. Léonard de Viney , en expliquant
ces mêmes réglés , n’en a pas mieux fait
ientir les effets, que Platon dans un dialogue du fo-
phifte , 8c Socrate dans fon dixième livre de la République.
En effet, Apaturius peignit à Tralles dans un petit
théâtre une fcène oùJil repréfenta , au lieu de colonnes
, desftatues, des centaures qui foutenoient les
architraves , des toits en rond, des dômes; fur tout
cela il peignit encore un fécond ordre , où il y avoit
d’autres dômes , des faites que l’on ne voyoit qu’à
demi, & toutes les autres chofes qui font aux toits
des édifices. « T outl’afpeclde cette fcène paroiffoit
» fort beau, dit Vitruv.e 3 Hv. V IL ch. v. à caufe que
» le peintre y avoit fi bien ménagé les différentes tein-
» te s , qu’il lembloit que cette architeéhire eût toutes
» fes faillies ». Le texte lignifie à la lettre que l’afoeél
de cette fcène flattoit agréablement la vue à caule de
fon âpreté, propter afperitatern, ou plutôt à caufe de
fon inégalité ; ce qui venoit de ce que la lumière étant
bien choifie 8c bien répandue fur certaines mafles ,
elles avoientun grand relief, 8c fembloient s’avancer
; la toile quelqu’unie qu’elle fu t , paroiffoit ra-
boteufe. Mais il étoit impoffible que certaines par-,
ties de cette peinture enflent une apparence de faillies
, qu’il n’y en eût. d’autres plongées dans l’enfoncement
8c dans un lo in ta in c e qui eft tout le fecret
de la perfpeclive.
Quoique cette conféquence foit évidente, quoi-?
qu’elle foit, pour ainft dire, renfermée toute entière
dans ces termes mêmes du paflage , je vais la faire
envifager dans un autre encore plus précis. C’eft
toujours Vitruve qqîparle dans fa préface, 8c la traduction
de Claude Perrault. « Démocrite 8c Anaxa-
» gore ont écrit fur ce füjetprincipalement par
, » quel artifice on peuf,ayant mis un point en uri cer-
V