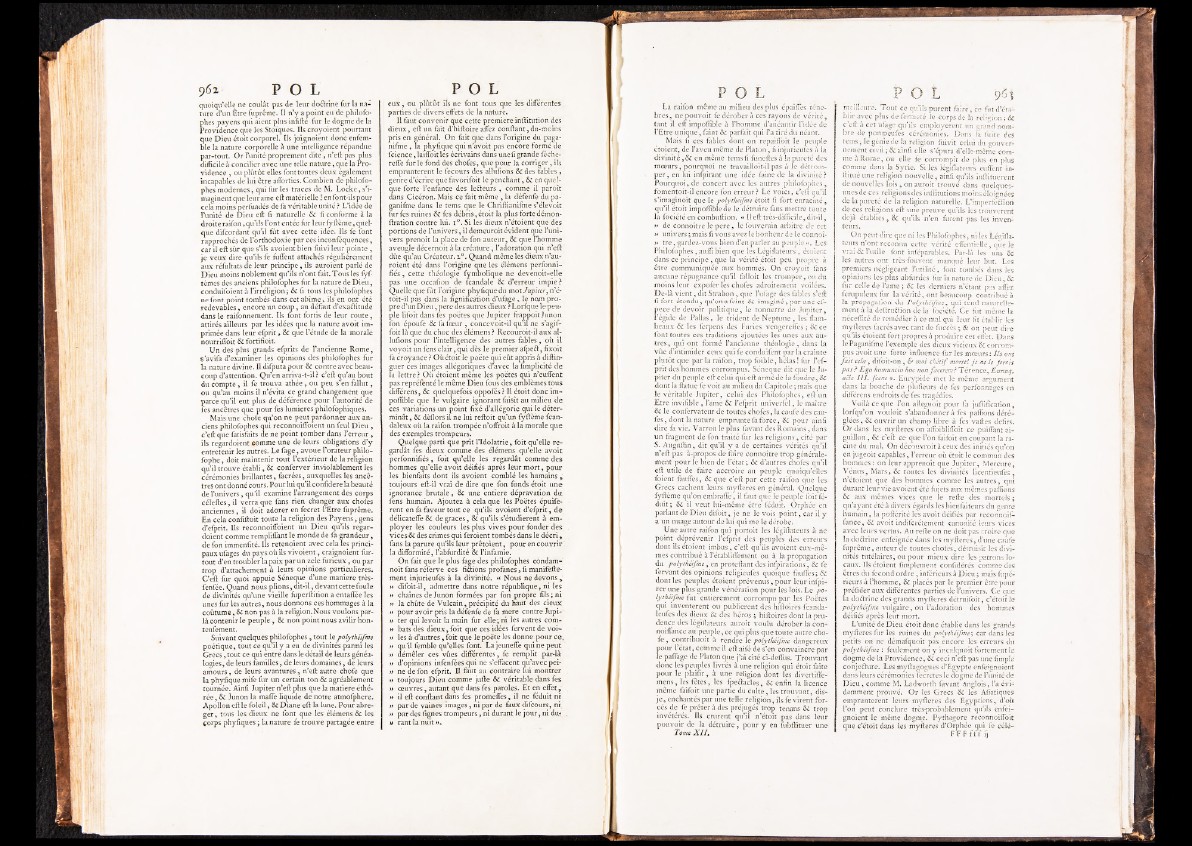
quoiqu’elle ne coulât pas de leur doélrine fur la nature
d’un Être fuprême. Il n’y a point eu de philofo-
phes payens qui aient plus infifte fur le dogme de la
Providence que les Stoïques. Ils croyoient pourtant
que Dieu étoit corporel. Ils joignoient donc enfem-
ble la nature corporelle à une intelligence répandue
par-tout. Or l’unité proprement dite, n’eft pas plus
difficile à concilier avec une telle nature, que la Providence
, ou plutôt elles font toutes deux également
incapables de lui être afl'orties. Combien de philofo-
phes modernes, qui fur les traces de M. Locke, s’imaginent
que leurame eft matérielle ! en font-ils pour
cela moins perfuadés de fa véritable unité ? L’idée de
l’unité de Dieu eft fi naturelle Si fi conforme à la
droite raifon, qu’ils l’ont entée fur leurfyftème, quelque
difcordant qu’il fut avec cette idée. Ils fe font
rapprochés de l’orthodoxie par ces inconféquences,
car il eft sur que s’ils avoient bien fuivi leur pointe ,
je veux dire qu’ils fe fuffent attachés régulièrement
aux réfultats de leur principe, ils auroient parlé de
Dieu moins noblement qu’ils n’ont fait. Tous les fyfi
tèmes des anciens philofophes fur la nature de D ieu,
conduifoient à l’irréligion; Si fi tous les philofophes
ne font point tombés dans cet abîme, ils en ont été
redevables, encore un coup, au défaut d’exaélitude
dans le raifonnement. Ils font fortis de leur route,
attirés ailleurs par les idées que la nature avoit imprimée
dans leur efprit, & que l’étude de la morale
nourriffoit Si fortifioit.
Un des plus grands efprits de l’ancienne Rome,
s ’avifa d’examiner les opinions des philofophes fur
la nature divine. Il difputa pour Si contre avec beaucoup
d’attention. Qu’en arriva-t-il? c’eft qu’au bout
du compte, il fe trouva athée, ou peu s’en fallut,
ou qu’au moins il n’évita ce grand changement que
parce qu’il eut plus de déférence pour l’autorité de
fes ancêtres que pour fes lumières philofophiques.
Mais une chofe qu’on ne peut pardonner aux anciens
philofophes qui reconnoiffoient un feul D ieu ,
c’eft que fatisfaits de ne point tomber dans l’erreur,
ils regardoient somme une de leurs obligations d’y
entretenir les autres. Le fage, avoue l’orateur philo-
fophe, doit maintenir tout l’extérieur de la religion
qu’il trouve établi, Si conferver inviolablement les
cérémonies brillantes, facrées, auxquelles les ancêtres
ont donné cours. Pour lui qu’il confidere la beauté
de l’univers, qu’il examine l’arrangement des corps
céleftes, il verra que fans rien changer aux choies
anciennes, il doit adorer en fecret l’Etre fuprême.
En cela confiftoit toute la religion des Payens, gens
d’efprit. Ils reconnoiffoient un Dieu qu’ils regardoient
comme rempliffant le monde de la grandeur,
de fon immenfité. Ils retenoient avec cela les principaux
ufages du pays où ils vivoient, craignoient fur-
tout d’en troubler la paix par un zele furieux, ou par
trop d’attachement a leurs opinions particulières.
C’eft fur quoi appuie Séneque d’une maniéré très-
fenfée. Quand nous plions, dit-il, devant cette foule
de divinités qu’une vieille fuperftition a entaffée les
unes fur les autres, nous donnons ces hommages à la
coûtume, Si non pas à la religion.Nous voulons par-
là contenir le peuple, Si non point nous avilir hon-
teufement.
Suivant quelques philofophes, tout le polythèifme
poétique, tout ce qu’il y a eu de divinités parmi les
Grecs, tout ce qui entre dans le détail de leurs généalogies,
de leurs ramilles, de leurs domaines, de leurs
amours, de leurs avantures, n’eft autre chofe que
la phyfique mife fur un certain ton Si agréablement
tournée. Ainfi Jupiter n’eft plus que la matière éthé-
rée , S i Junon la maffe liquide de notre atmofphere.
Apollon eft le foleil, & Diane eft la lune. Pour abréger,
tous les dieux ne font que les élémens Si les
<orps phyfiques ; la nature fe trouve partagée entre
eu x, ou plutôt ifs ne font tous que les différentes
parties de divers effets de la nature.
Il faut convenir que cette première inftitution des
dieux, eft un fait d’hiftoire affez confiant, du-moins
pris en général. On fait que dans l’origine du paga-
nifme , Ta phyfique qui n’avoit pas encore formé de
fcience, laiffoitles écrivains dans une fi grande féche-
reffe fur le fond des chofes, que pour la corriger, ils
empruntèrent le fecours des allufions Si des fables,
genre d’écrire que favorifoit le penchant, & en quelque
forte l’enfance des leéleurs , comme il paroît
dans Cicéron. Mais ce fait même , la défenfe du pa-
ganifme dans le tems que le Chriftianifme s’élevoit
liir fes ruines Si fes débris, étoit la plus forte démon-
ftration contre lui. i° . Si les dieux n’étoient que des
portions de l’univers, il demeuroit évident que l’univers
prenoit la place de fon auteur, Si que l’homme
aveugle décernoit à la créature, l’adoration qui n’eft
due qu’au Créateur. 20. Quand même les dieux n’au-
roient été dans l’origine que les élémens perfonni-
fiés, cette théologie fymbolique ne devenoit-elle
pas une occafion de fcandale Si d’erreur impie?
Quelle que fut l’origine phyfique du mot Jupiter, n’é-
toit-il pas dans la fignification d’ufage, le nom propre
d’un Dieu, pere des autres dieux ? Lorfque le peuple
lifoit dans fes poètes que Jupiter frappoit Junon
fon époufe Si fa foeur , concevoit-il qu’il ne s’agif-
foit là que du choc des élémens? Recouroit-il aux allufions
pour l’intelligence des autres fables, oii il
voyoit un fens clair, qui dès le premier afpeét, fixoit
fa croyance ? O ù étoit le poète qui eût appris à diftin-
guer ces images allégoriques d’avec la fimplicité de
la lettre ? Où étoient même les poètes qui n’euffent
pas repréfènté le même Dieu fous des emblèmes tous
différens, Si quelquefois oppofés ? Il étoit donc im-
poffible que le vulgaire ignorant faisît au milieu de
ces variations un point fixé d’allégorie qui le déterminât
, Si dèflors il ne lui reftoit qu’un fyftème fean-
daleux où la raifon trompée n’offroit à la morale que
des exemples trompeurs.
Quelque parti que prît l’Idolâtrie, foit qu’elle regardât
fes dieux comme des élémens qu’elle avoit
perfonnifiés, foit qu’elle les regardât comme des
hommes qu’elle avoit déifiés après leur m ort, pour
les bienfaits dont ils avoient comblé les humains ,
toujours eft-il vrai de dire que fon fonds étoit une
ignorance brutale, Si une entière dépravation du
fens humain. Ajoutez à cela que les Poètes épuife-
rent en fa faveur tout ce qu’ils avoient d’efprit, de
délicateffe Si de grâces, Si qu’ils s’étudièrent à employer
les couleurs les plus vives pour fonder des
vices & des crimes qui feroient tombés dans le décri,
fans la parure qu’ils leur prêtoient, pour en couvrir
la difformité, l’abfurdité Si l’infamie.
On fait que le plus fage des philofophes côndam-
noit fans réferve ces fixions profanes, fi manifefte-
ment injurieufes à la divinité. « Nous ne devons ,
» difoit-il, admettre dans notre république, ni les
» chaînes de Junon formées par fon propre fils ; ni
» la chute de Vulcain, précipité du haut des deux
» pour avoir pris la défenfe de fa mere contre Jupi- •
» ter qui levoit la main fur elle; ni les autres com-
» bats des dieux, foit que ces idées fervent de voi-
» les à d’autres, foit que le poète les donne pour ce,
» qu’il femble qu’elles font. La jeuneffe qui ne peut
» démêler ces vues différentes, fe remplit par-là
» d’opinions infenfées qui ne s’effacent qu’avec pei-
» ne de fon efprit. Il faut au contraire lui montrer
» toujours Dieu comme jufte Si véritable dans fes
» oeuvres, autant que dans fes paroles. Et en effet,'
» il eft confiant dans fes promeffes, il ne féduit ni
» par de vaines images, ni par de faux difeours, ni
» par des lignes trompeurs , ni durant le jour, ni du-
» rant la nuit ».
■ ■ H W
P O L
La raifon même au milieu des plus épaiffes ténèbres
, ne pouvoit fe dérober à ces rayons de vérité,
tant il eft impoffible à l’homme d’anéantir l’idée de
l’Etre unique, faint Si parfait qui l’a tiré du néant.
Mais fi ces fables dont on repaiffoit le peuple
étoient, de l’aveu même de Platon, fi injurieufes à la
divinité, Si en même tems fi funeftes à la pureté des
moeurs, pourquoi ne travailloit-il pas à le détromper
, en lui infpirant une idée faine de la divinité ?
Pourquoi, de concert avec les autres philofophes,
fomentoit-ilencore fon erreur? Le* voici, c’eff qu’il
s’imaginoit que le polythèifme étoit fi fort enraciné,
qu’il étoit impoffible de le détruire fans mettre toute
la fociété en combuftion. « Il eft très-difficile, dit-il,
» de connoître le pere, le fouverain arbitre de cet
» univers ; mais fi vous avez le bonheur de le connoî-
» tre, gardez-vous bien d’en parler au peuple». Les
Philofophes, auffi bien que les Légillateurs , étoient
dans ce principe , que la vérité étoit peu propre à
etre communiquée aux hommes. On croyoit fans
aucune répugnance qu’il falloit les tromper,ou du
moins leur expofer les chofes adroitement voilées.
De-là v ient, dit Strabon, que l’ufage des fables s’eft
fi fort étendu, qu’on a feint & imaginé, par une ef-
pece de devoir politique, le tonnerre de Jupiter,
l’égide de Pallas, le trident de Neptune, les flambeaux
Si les ferpens des Furies vengereffes ; & ce
font toutes ces traditions ajoutées les unes aux autres
, qui ont formé l’ancienne théologie, dans la
Vue d’intimider ceux qui fe conduifent par la crainte
plutôt que par la raifon, trop foible, hélas ! fur l’ef-
prit des hommes corrompus. Séneque dit que le Jupiter
du peuple eft celui qui eft armé de la foudre, Si
dont la ftatue fe voit au milieu du Capitole ; mais que
le véritable Jupiter, celui des Philofophes, eft un
Etre invifible , Lame Si l’efprit univerfel, le maître
Si le confervateur de toutes chofes, la caufe des cau-
fes, dont la nature emprunte fa force, & pour ainfi
dire fa vie. Varron le plus favant des Romains, dans
lin fragment de fon traité fur les religions, cité par
S. Augüftin, dit qu’il y a de certaines vérités qu’il
n’eft pas à-propos de faire connoître trop généralement
pour le bien de l’état ; Si d’autres chofes qu’il
eft utile de faire accroire au peuple quoiqu’elles
foient fauffes, S i que c’eft par cette raifon que les
Grecs cachent leurs myfteres en général. Quelque
fyftème qu’on embraffe, il faut que le peuple foit féduit;
Si il veut lui-même être féduit. Orphée en
parlant de Dieu difoit, je ne le vois point, car il y
a un nuage autour de lui qui me le dérobe;
Une autre raifon qui portoit les légillateurs à né
point déprévenir l’efprit des peuples des erreurs
dont ils etoient imbus, c’eft qu’ils avoient eux-mêmes
contribué à l ’établiffement ou à la propagation
du polythèifme, en proteftant des infpirations, Si fe
fervant des opinions religieufes quoique fauffes ; Si
dont les peuples étoient prévenus, pour leur infpi-
rer une plus grande vénération pour les lois. Le polythèifme
fut entièrement corrompu par les Poètes
qui inventèrent ou publièrent des hiftoires feanda-
leufes des dieux S i des héros ; hiftoires dont la prudence
des légillateurs auroit voulu dérober la con-
noiffance au peuple, ce qui plus que toute autre chofe
, contribuoit à rendre le polythèifme dangereux
pour l’etat, co’mme il eft aifé de s’en convaincre par
le paffage de Platon que j’ai cité ci-deffus. Trouvant
donc les peuples livrés à une religion qui étoit faite
pour le plaifir, à une religion dont les divertifl’e-
mens, les fêtes, les fpeélacles, Si enfin la licence
même faifoit une partie du culte, les trouvant, dis-
je , enchantés par une telle religion, ils fe virent forcés
de fe prêter à des préjugés trop tenans Si trop
invétérés. Ils crurent qu’il n’étoit pas dans leur
pouvoir de la détruire, pour y en lubftituer une
Tome X I I .
meilleure. Tout ce qu’ils purent faire , ce fut d’établir
avec plus de fermeté le corps de la religion ; Si
c ’eft à cet ufage qu’ils employèrent un grand nombre
de pompeufes cérémonies. Dans la fuite des
tems, le génie de la religion fuivit celui du gouvernement
civil ; Si ainfi elle s’épura d’elle-même comme
à Rome, ou elle fe corrompit de plus en plus
comme dans la Syrie. Si les légillateurs euffent in-
ftitué une religion nouvelle, ainfi qu’ils inftituerent
de nouvelles lois, on auroit trouve dans quelques-
unes de ces religions des inftitutions moins éloignées
de la pureté de la religion naturelle. L’imperfeélioii
de ces religions eft une preuve qu’ils les trouvèrent
déjà établies, Si qu’ils n’en furent pas les inventeurs.
On peut dire que ni les Philofophes, ni les Légifla-
teurs n’ont reconnu cette vérité effentielle, que le
vrai Si l’utile font inféparables. Par-là les uns Si
les autres ont très-fouvent manqué leur but. Les
premiers négligeant l’utilité, font tombés dans les
opinions les plus abfurdes fur la nature de Dieu, Si
fur celle de l’ame ; Si les derniers n’étant pas allez
fcrupuleux fur la vérité, ont beaucoup contribué à
la propagation du Polythèifme, qui tend naturellement
à la deftruftion de la fociéte; Ce fut même la
néceffité de remédier à ce mal qui leur fit établir les
myfteres facrés avec tant de fuccès ; & on peut dire
qu’ils étoient fort propres à produire cet effet. Dans
le Paganifme l’exemple des dieux vicieux Si corrompus
avoit une forte influence fur les moeurs : Ils ont
fait cela, difoit-on, & moi chétif mortel je ne le Jercis
pas? Ego homuncio hoc non facerem? Térence, Eunuq.
acte 111. feenev. Eurypide met le même argument
dans la bouche de plufieurs de fes perfonnages en
différens endroits de fes tragédies.
Voilà ce que l’on alleguoit pour fa juftification,
lorfqu’on vouloit s’abandonner à fes paffions déréglées
, Si ouvrir un champ libre à fes vaftes defirs.
Or dans les myfteres on affoibliffoit ce puiffant aiguillon
, Si c’eft ce que l’on faifoit en coupant la racine
du mal. On décoiivroit à ceux des initiés qu’on
en jugeoit capables, l’erreur où étoit le commun des
hommes : on leur apprenoit que Jupiter, Mercure,
Vénus, Mars, Si toutes les divinités licentieufes ,
n’étoient que des hommes comme les autres, qui
durant leur vie avoient été fujets aux mêmes paffions
Si aux mêmes vices que le refte des mortels ;
qu’ayant été à divers égards les bienfaiteurs du genre
humain, la poftérité les avoit déifiés par reconnoif-
fance, Si avoit indiferétement canonifé leurs vices
avec leurs vertus. Au refte on ne doit pas croire que
la doârine enfeignée dans les myfteres, d’une caufe
fuprême, auteur de toutes chofes, détruisît les divinités
tutélaires, ou pour mieux dire les patrons locaux.
Ils étoient Amplement confidérés comme des
êtres du fécond ordre , inférieurs à Dieu ; mais fupé-
rieurs à l’homme, Si placés par le premier être pour
préfider aux différentes parties de l’univers. Ce que
la doélrine des grands myfteres détruifoit, c’étoit lé
polythèifme vulgaire, ou l’adoration des hommes
déifiés après leur mort.
L’unité de Dieu étoit donc établie dans les grands
myfteres fur les ruines du polythèifme ; car dans les
petits on ne démafquoit pas encore les erreurs du
polythèifme : feulement on y inculquoit fortement le
dogme de la Providence, Si ceci n’eft pas ùne fimplé
conjeêlure. Les myftagogues d’Egypte enfeignoient
dans leurs cérémonies lècretes le dogme de l’unité de
D ieu , comme M. Ladworth favant anglois, l’a évidemment
prouvé. Or les Grecs Si les Afiatiquè9
empruntèrent leurs myfteres des Egyptiens, d’où
l’on peut conclure très-probablement qu’ils enfeignoient
le même dogme. Pythagore reconnoiffoit
que c’étoit dans les myfteres d’Orphée qui fe célé-
F F F f f f ij