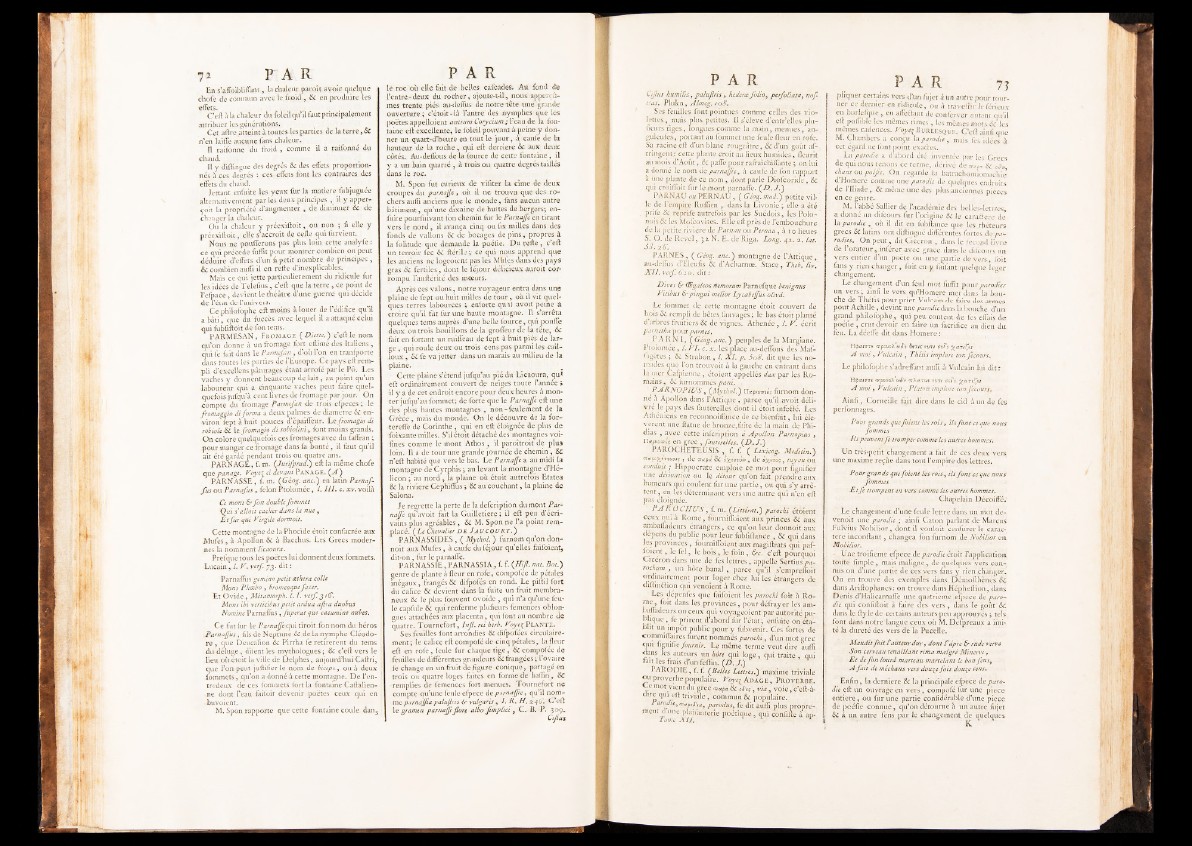
7 a P A R
En s’affoibUffant,. la chaleur paraît avoir quelque
chofe de commun avec le fr.oid , Ôc en produire les
effets.
' C’eft à la chaleur du foleil qu’il faut principalement
attribuer les générations.
Cet aftre atteint à toutes les,parties de la terre, ôc
n’en laiffe aucune fans chaleur.
Il raifonne du froid , comme il a raifonné du
chaud. - ’ ... . \ >s - ; . ,
Il y diftingue des degrés Sc des effets proportionnés
à ces deores • ces effets font les contraires des
effets du chaud. r
Jettant enfuite les yeux fur la matière fubjuguee
alternativement par les deux principes , il y apper-
çoit la propriété d’augmenter , de diminuer 6c de
changer la chaleur.
Ou la chaleur y préexiftoit, ou non ; fi elle y
préexiftoit, elle s’accroît de celle qui furvient.
Nous ne poufferons pas plus loin cette analyfe :
ce qui précédé fuffit pour montrer combien on peut
déduire d’effets d’un fi petit nombre de principes ,
& combien aufli il en relie d’inexplicables.
Mais ce qui jette particulièrement du ridicule fur
les idées de Telefius , c’eft que la terre , ce point de
l ’efpace, devient le théâtre d’une guerre qui décide
de l’état de l’univers.
Ce philofophe eft moins à louer de l’édifice qu’il
a bâti, que du fuccès avec lequel il a attaqué celui
qui fubfiftoit de fon tems.
PARMESAN, F r o m a g e ( Dieite.) c’eft le nom
qu’on donne à un fromage fort eftimé des Italiens ,
qui fe fait dans le Parmefan , d’où l’on en tranfporte
dans toutes les parties de l’Europe. Ce pays eft rempli
d’excellenspâturages étant arrofé parle Pô. Les
vaches y donnent beaucoup de lait, au point qu’un
laboureur qui a cinquante vaches peut faire quelquefois
jufqu’à cent livres de fromage par jour. On j
compte du fromage Parmtfan de trois .efpeces ; le j
fromaggio di forma a deux palmes de diamètre & en- ;
viron fept à huit pouces d’epaiffeur. Le fromagïo di
robiole ÔC le fromagïo di robialini, font moins grands. ;
On colore quelquefois ces fromages avec du laffran ; j
.pour manger ce fromage dans fa bonté, il faut qu’il ;
ait été gardé pendant trois ou quatre ans.
P ARN AGE, f. m. (’ Jurifprud.) eft la même chofe ’
que partage. Voyt{ ci-devant P a n AGE. (A )
PARNASSE, f. m. (Gkog.anc.) en latin Parnaf- !
fus ou Parnafus, félon Ptolomée, l. I II. c. xv. voilà ’
Ce mont G fon double fommet
Qui s'alloit cacher dans la nue ,
Et fur qui Virgile dormoit.
Cette montagne de la Phocide étoit confacrée aux
Mufes, à Apollon ôc à Bacchus. Les Grecs modernes
la nomment licaoura.
Prefque tous les poëtes lui.donnent deux fommets.
Lucain, l. V. verf. 73. dit :
Parnaffus gemino petit cethera colle
Mons Phcebo , bromeoque facer.
Et Ovide , Métamorph..L. I. verf. 3/6*.
Mons ibi verticibus petit ardua aflra duobus
Nomine Parnaffus , fuperat que cacumine nubcs.
Ce fut fur le Parnajfe qui d roit fon nom du héros
Parnaffus, fils de Neptune ôc.de la nymphe Cléodo-
re , que Deucalion ôc Pirrha fe retirèrent du tems
du deluge , difent les mythologues ; ÔC c’eft vers le
lieu où étoit la ville de Delphes, aujourd’hui Caftri,
que l’on peut juftifier le nom de biceps, ou à deux
lommets, qu’on a donné à cette montagne. De l’ entredeux
de ces fommets fort la fontaine Caftalien-
ne dont l’eau faiioir devenir poëtes ceux qui en
-buvoient.
M. Spon rapporte que cette fontaine coule. dans
P A R
le roc oit elle fait de belles cafcades. Au fond dte
l’entre.-deux du rocher, ajoute-t-il, nous apperçû-
mes trente, pies. a.u-deffus de notre tête une grande
ouverture ;; c’étoit-là l’antre des nymphes que les
poëtes appeIl.oie.ni antrum Corycium } l’eau de la fontaine
eft excellente, le. foleil pouvant- à peine y donner
un quart-d’heure en tout le j,our, à caufe de la
hauteur de la roche, qui eft derrière ôc aux deux
côtés. Àu-deffous de la fource de cette fontaine , il
y a un bain quarré ? à trois ou quatre degrés taillés
dans le roc.
M. Spon fut curieux de vifiter la cîme de deux
croupes d,u parnajfe , .011 il ne trouva que des rochers
aufli anciens que le monde, fans aucun autre
bâtiment, qu’une dixaine de huttes de bergers; en-
fuite pomrfuivant fon chemin fur le Parnajfe en tirant
vers le nord, i l avança cinq ou fix milles dans des
fonds de vallons ôc de bocages de pins, propres à
la folitude que demande la poéfie. Du yefte | c’ eft
un terroir fec ôc ftérifo ;■ ce qui npus apprend qqe
les anciens ne logeoient pas les Milles dans des pays
gras ôc fertiles, dont le lejour délicieux auroit corrompu
l’auftérité des moeurs.
Après ces valons, notre voyageur entra dans une
plaine de fept ou huit milles de tour, où il vit quelques
terres labourées ; enforce qu’il avoit peine à
croire qu’il fut fur une haute montagne. Il s’arrêta
quelques tems auprès d’une belle fource, qui pouffe
deux ou trois bouillons de la groffeur de la tête, ôc
fait en fortant un ruiffeau de fept à huit pies de large
, qui roule deux ou trois cens pas parmi les cailloux
, & fe va jetter dans un marais au milieu de la
plaine.
Cette plaine s’étend jufqu’au pié du Licapura, qu*
eft ordinairement couvert dp neiges toute l’année »
il y a de cet endroit encore pour deux heures à monter
jufqu’au fommet; de forte que le Parnajfe eft une
des plus hautes montagnes , non - feulement de la
Grèce , mais du monde. On le découvre de la for-
tereffe de Corinthe , qui en eft éloignée de plus de
foixante milles. S’il étoit détaché des montagnes voi-
fines comme le mont Athos , il paroîtroit de plu9
loin. Il a de tour une grande journée de .chemin , ÔC
n’eft habité que vers le bas. Le Parnajfe a au midi la
montagne de Cyrphis ; au levant la montagne d’Hé-
licon ; au nord, la plaine où étoit autrefois Etatea
& la riviere Cephiffus ; ÔC au couchant, la plaine de
Salona.
Je regrette la perte de la defeription du mont Par*
naffe qû’avoit fait la Guilletiere ; il eft peu d’écrivains
plus agréables, 6c M. Spon ne l’a point remplacé.
( Le Chevalier DE J A U COU RT.}
PARNASSIDES, ( Mythol. ) furnom qu’on don-
noit aux Mufes , à caufe du féjpur qu’elles faifoient,
dit-on, fur le parnaffe.
PARNASSIE, PARNASSIA, f- f- { ^ ifl. nat. B ot.)
genre de plante à fleur en rofe, compofee de pétales
inégaux, frangés ÔC difpofés en rond. Le piftil fort
du calice ôc devient dans la fuite un fruit membraneux
ôc le plus fouvent ovoïde , qui n’a qu’une feule
capfule ôc qui renferme plufieurs femences oblon-
gues attachées aux placenta, qui font au nombre de
quatre. Tournefort, Injl. rei herb. V oytç Plante.
Ses feuilles font arrondies ôc difpofées circulaire-
ment; le calice eft compofé de cinq pétales, la fleur
eft en rofe, feule fur chaque tige , ôc compofée de
feuilles de différentes grandeurs ôc frangées ; l’ovaire
fe change en un fruit défiguré conique, partagé en
trois ou quatre loges faites en forme de baffin, ôc
-remplies ae femences fort menues. Tournefort ne
compte qu’une feule efpece de parnafjie, qu’il nomme
parnajjia paluflris 6* vulgaris , I. R. H. 24C. C ’eft
le gramen parnajflflore albo Jimplici , C. B. P. 3° 9*
P A R
Ci fu s humilis, paluflris , hederoe folio, perfoliata,
tras. Plukn, Alrneg, 108.
Ses feuilles font pointues comme celles des violettes
, mais plus, petites. Il s’élève d’entr’elles plufieurs
tiges, longues comme la main, menues, an-
guleufes, portant au fommet une feule fleur en rofe.
Sa racine eft d’un blanc rougeâtre, ôc d’un goût af-.
tringent.: cette plante croît au lieux humides., fleurit
au mois d’Août,. ôc paffe pour rafraîchiffante ; on lui
a donné le nom de parnaffu, à caufe de fon rapport
à une plante .de ce nom, dont parle Diofcoride , ôc
qui croiffoit fur le mont parnaffe. (D . J.)
PARNAU ou PERNAU, ( Géog. mod.) petite ville
de l ’empire Ruflien , dans la Livonie ; elle a été
. prife ôc reprife autrefois par les Suédois, les Polo-
nois ôc les Mofcovîtes. Elle eft près de l’embouchure
de la petite riviere de Parnau ou Pernau, à 10 lieues
S. O. de Revel, 32 N. E. de Riga. Long. 42. 2. Lat. 58; 2 6".
PARNES , ( Géog. anc. ) montagne de l’Attique,
au-deffus d’Eleufis ôc d’Acharnoe. Stace, Theb. liv.
X I I . verf 620 . dit :
Dives & CEgaleos riemorum Parnefque benignus
Vitibus & pingui melior Lycabeffus olivâ.
Le fommet de cette montagne étoit couvert de
bois ôc rempli de bêtes fauvages ; le bas étoit planté
d’arbres fruitiers ôc de vignes. Athenée, /. V. écrit
parnetha pour parnes.
P A R N I , (G éog. anc. ) peuples de la Margiane.
Ptolomée, L VI. c. x. les place au-deffous des Maf-
fàgètes ; ôc Strabon , /. XI. p. 508. dit que les nomades
que l’on trouvoit à la gauche en entrant dans
la mer.Cafpienne, étoient appellés dax par les Ro.-r
nîains, ÔC furnommés pani.
P A RN O P IU S , (Mythol.) riapyorniç furnom donne
a Apollon dans l’Attique , parce qu’il avoit délivré
le pays des fauterelles dont il étoit infeéfé. Les
Athéniens en reconnoiffance de ce bienfait , lui éle-
verent une ftatue de bronze,faite de la main de Phidias
, avec cette infeription à Apollon Parnopius ,
T\a.pvomtiç en grecfJctutereUes. (D .J .)
PAROCHETEÜSIS , f. f. ( Lexicog. Medicin.)
r7r*po‘)(t-TUjtTiç , de 1reepd. ÔC o’Xi-rtvca , de «%tToç, tuyau ou
conduit ; Hippocrate emploie ce mot pour fignifier
line déri vdtiàn ou le détour qu’on fait prendre aux
humeurs qui coulent fur une partie, ou qui s’y arrêtent
, en les déterminant vers une autre qui n’en eft
pas éloignée.
I A R O C H U S , f. m. (Littéral.) parochi étoient
ceux qui a Rome, fourniffoient aux princes ôc aux
ambaffadeurs étrangers, ce qu’on leur donnoit aux
dépens du public pour leur fubfiftance , ôc qui dans
les provinces , fourniffoient aux magiftrats qui paf-
foien t, le fe l, le bois, le foin, &c. c’eft pourquoi
Cicéron dans une de fes lettres, appelle Sertius pa-
Tochum , un hôte banal , parce qu’il .s’empreffoit
ordinairement pour loger chez lui les étrangers de
diftinttion qui venoient à Rome.
Les depenfes que faifoient les parochi foit à Rom
e , foit dans les provinces, pour défrayer les ambaffadeurs
ou ceux qui vOyageoient par autorité pu-
blique , fe prirent d abord fur l’état; enfuite on établit
un impôt public pour y fubvenir. Ces fortes de
commiffaires furent nommés parochi, d’un mot grec
qui fignifie fournir. Le même terme veut dire aufli
dans les auteurs un hôte qui loge, qui traite , qui
lait les frais d’un feftin. (D. J.)
PARODIE, f. f. (Belles Lettres.) maxime triviale
ou proverbe populaire. Voye{ Ad a g e , Proverbe.
e mot vient du grec avctpa. ôc oS'oç, via, vo ie , c’eft-à-
dire qui eft triviale, commun ôc populaire.
Parodie, 'Grapefu, parodus, fe dit aufli plus propre-
ment d une plananterie poétique, qui cÔnfifte à ap-
l omê A U . . ■ • ■
P A R 7 3
pliquer certains vers d’un fiijet à tm autre poiif tourner
ce dernier en ridicule, ou à traveftir le férieux
en burlefque, en affeftant de conferver autant qu’il
eft^poflîble les memes rimes , les mêmes mots ôc les
memes cadences. Voye^ Burlesque. C ’eft ainfi que
M. Chambers a conçu la parodie, mais fes idées à
cet egard ne font.point exaéfes.
La parodie a d’abord été inventée par les Grecs
de qui nous tenons Ce terme, dérivé de ™P« ôc oé't,
chant ou poéfie. On regarde la batrachomiomachie,
d’Hortiere comme une parodie de quelques endroits
de l’Iliade, ôc même une des plus anciennes pièces
en ce genre.
M. l’abbé Sallier de l’académie des belles-lettres,
a donné un difeours fur l’origine ôc le cara&ere de
la parodie , où il dit en l’ubftance que les rhéteurs
grecs ôc latins ont diftingué différentes fortes de y*?*-
rodits. On peut, dit Cicéron , dans le fécond livre
de l’orateur, inférer avec grâce dans le difeours un
vers, entier d’un poète ou une partie de vers foit
fans y rien changer, foit en y faifant quelque leger
changement.
Le changement d’un feul mot fuffit pour parodier
un vers ; ainfi le vers qu’Homere met dans la bouche
de Thétis pour prier Vulcain de faire des armes
pour Achille, devint une parodie dans la bouche d’un
grand philofophe, qui peu content de fes effais de
poéfie , crut devoir en faire un facrifice au dieu du
feu. La déefte dit dans Hpmere :
Hipaum 'æpouoX utS't ùtnç vint <rt~0 yartiGt
A moi, V'ücain , Thetis implore ton fecours.
Le philofophe s’adreffant aufli à Vulcain lui dit :
Hçst/fT* 'WpoUoA (ùét TrXcnhv au o Và-tiCiï
A ihoi, Vuledin, Platon implore ton fecours.
Ainfi, Corneille fait dire dans le cid à un de fes
perfonnàges..
Pour grands que foitnt les rois, ils font ce que nous
fommes
Ils peuvent Je tromper comme les autres hommes.
Un très-petit'changement a fait de ces deux vers
une maxime reçue dans tout l’empire des lettres.
Pour grands que foient les rois , ils font ce que nous
fommes M)
Etfe trompent en vers comme les autres hommes.
Chapelain Décoiffe.1
Le changement d’une feule lettre dans un mot de-
ven.oit une parodie ; ainfi Caton parlant de Marcus
Fulviîis Nobilior, dont il youloït cenlurer le caractère
inconftant, changea fon furnom de Nobilior en
Mobilior.
• _ Une troificme efpece de parodie étoit l’application
toute fimple, mais maligne, de quelques vers connus
ou d’une partie de ces vers fans y rien .changer.
On en trouve des exemples dans Dcmofthènes ôc
dans Ariftophanes : on trouve dans Hépheftion, dans
Denis d’Halicarnaffe une quatrième l:efpece de parodie
qui confiftoit à faire des v e r s , dans le goût ÔC
dans le ftyle de certains auteurs peu approuvés ; tels
font dans notre langue ceux où M. Defpreaux a imité
la dureté des vers de la Pucelle.
Maudit foit C auteur dur, dont Câpre G rude Verve
Son cerveau tenaillant rima malgré Minerve,
E t de fon lourd marteau martelant le bon fens,
A fait de méchans vers douçe fois douçe cens.
Enfin, la derniere ôc la principale efpece de parodie
eft un ouvrage en vers , compofé fur une piece
entière, ou fur une partie confidérable d’une piece
de poéfie connuè, qu’on détourne à un autre fujet
ôc à un autre fens par le changement de quelques