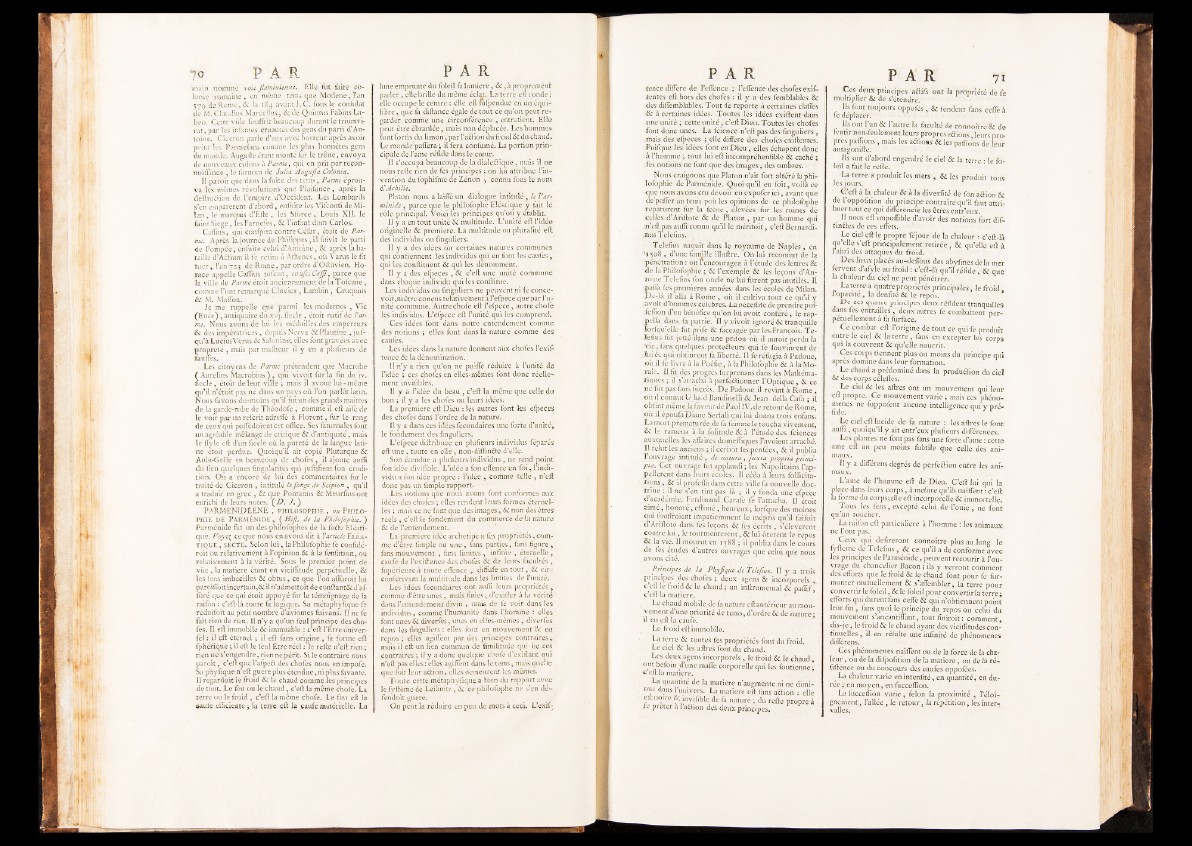
'main, nommé voie fiamihitnnt. Elle Rit faite colonie
romaine , en même tems que Modene., l’an
579 de Rome, & la 184 avant J. C . fous le confulat
de M. Claudius Marcelius, & de Quintus Fabius La-
beo. Certe ville fouffrit beaucoup durant le triumvirat,
par les infâmes cruautés des gens du parti d^Antoine.
Cicéron parle d’eux avec horreur après avoir
peint les Parmefahs comme les plus honnêtes gens
du monde. Augufte étant monté fur le trône, envoya
de nouveaux colons à Parme, qui en prit par recoh-
lioiffance , le furnom de Julio. Augiifià Colonia.
Il paroît qite dans la fuite des tems, Parme éprouva
les mêmes révolutions que Plaifance, après la
deftruétiôn de l’empire d’Occident. Les Lombards
s’en emparerent d’abord, enfuite les Vifconti de Milan
, le marquis d’Efte, les Sfbrce, Louis XII. le
faint Siégé, les Farnefes, & l’infant dom Carlos.
Calîius, qui confpira contre Céfar, étoit de Parme.
Après la journée de Philippes, il fuivit le parti
de Pompée, enfuite celui d’Antoine, & après la bataille
d’Actium il fe retira à Athènes, où Varlis le fit
tuer, l’an 7Z3 de Rome, par ordre d’O&avien. Horace
appelle Caffins tofcaii, etrufei Cajfi, parce que
la ville de Parme étoit anciennement de laTofcane,
comme l’ont remarqué Cluvier , Lambin, Cruquiüs
& M. Maffon.
Je me rappelle que parmi les modernes , Vie
(Enée) , antiquaire du xvj. fiecle , étoit natif de Parme.
Nous avons de lui les médailles des empereurs
& des impératrices, depuis Nerva & PlaUtine , juf-
qu’à LuciusVeriis ôcSalonine; elles font gravées avec
propreté , mais par malheur il y en a plufieurs de
faunes.
Les citoyens de Parme prétendent qué Macrobe
( Aurelius Macrobius ) , qui vivoit fur la fin du iv.
fiecle , étoit de leur ville ; mais il avoue lui-même
qu’il n’étoit pas né dans un pays où l’on parlât latin.
Nous favons du-moins qu’il fut un des grands maîtres
de la garde-robe de Théodofe , comme il eft aifé de
le voir par Un refèrit adreffé à Florent, fur le rang
de ceux qui poffédoient cet office. Ses fatürnales font
un agréable mélange de critique & d’antiquité, mais
le ftyle eft d’un fiecle où la pureté de la langue latine
etoit perdue. Quoiqu’il ait copié Plutarque &
Aulu-Gelle en beaucoup de chofes , il ajoute auffi
du fien quelques fingularités qui juftifient fon érudition.
On a encore de lui des commentaires fur le
traité de Cicéron , intitulé le fonge de Scipion , qu’il
a traduit en grec , & que Pontaniis & Meurfius ont
enrichi de leurs notes. ( D . J.')
PARMÉNIDÉENE , philosophie , ou Philo-
PHIE DE PARMÉNIDE , ( Hljl. de la Philofophie. )
Parménide fut un des philofophes de la fefte Eléati-
que. Voye%_ ce que nous en avons dit à Y article ÉLÉAi
tique , secte. Selon lu i, la Philofophie fe confidé-
roit ou relativement à l’opinion & à la fenfation, ou
relativement à la vérité. Soiis le premier point de
vue , la matière étant en viciffitude perpétuelle, &
les fens imbécilles & obtus, ce que l’on aflùroit lui
paroiffoit incertain,& il n’admettoit de conftant&d’af-
îïïré que ce qui étoit appuyé fur le témoignage de la
raifon : c’eft-là toute fa logique. Sa métaphyfique fë
réduifoit au petit nombre d’axiomes fuivans. Il ne fe
fait rien de rien. Il n’y a qu’un feul principe des chofes.
Il eft immobile & immuable : c’eft l’Etre univer-
fel : il eft éternel ; il eft fans origine , fa forme eft
fphérique ; il eft le feul Etre réel : le refte n’eft rien ;
rien ne s’engendre, rien ne périt. Si le contraire nous
paroît, c’eft que l’afpeft des chofes nous en impofe.
Sa phyfique n’eft guere plus étendue, ni plus favante.
Il regardoit le froid & le chaud comme les principes
de tout. Xe feu ou le chaud, c’eft la même choie. La
terre ou le froid, c’eft la'même chofe. Le feu eft la
saule efficiente ; la terre eft la caufe matérielle. La
lune emprunte du foleil fa lumière, & , à proprement
parler, elle brille du même éclat. La terre eft ronde :
elle occupe le cehtre : elle eft fufpendue en un équilibre
, que fa diftance égale de tout ce qu’on peut regarder
comme une circonférence , entretient. Elle
peut être ébranlée, mais non déplacée. Les hommes
font fortis du limon, par l’aftion du froid & du chaud.
Le monde paffera ; il fera confumé. La portion principale
de l’ame réfide dans le coeur.
Il s’occupa beaucoup de la dialeftiqüe , mais il ne
nous refte rien de fes principes : on lui attribue l’invention
dii fophifmé de Zénon -, Connu fous le nom
d’Achille.
Platon nous alaifféun dialogue intitulé , le Parménide
, parce que le philofophe Elcatïque y fait le
rôle principal. Voici les principes qu’on y établit.
Il y a en tout unité & multitude. L’unité eft l’idée
Originelle & première. La multitude ou pluralité eft
des individus ou finguliers.
Il y à des idées où certaines natures communes
qui contiennent les individus qui en font les caufes ,
qui les conftitüent & qui les dénomment.
Il y a des efpeCes , & .c’eft une unité commune
dans chaque individu qui les conftitue.
Les individus ou finguliers ne peuvent ni fe concevoir,
ni être conçus relativementàl’ëfpece que par l’unité
commune. Autre chofe eft l’efpece, autre chofe
les individus. L’ ëfpece eft l’qnité qui les comprend;
Ces idées font dans notre entendement comme
des notions ; elles font dans la nature comme des
eaufes.
Les idées dans la nature donnent aüx chofes l’exif-
fence & la dénomination.
Il n’y a rien qu’on ne puiflé réduire à l’unité de
l’idée ; ces choies en elles-mèrtîes font donc réellement
invifibles.
Il y à l’idée du béait, c’ eft la même que celle du
bon ; il y a les chofes ou leurs idées;
La première eft D ieu : les autres font les efpeces
des chofes dans f ordre de la nature.
Il y a dans ces idées fecondaires une forte d’unité,
le fondement des finguliers.
L’efpece diftribuée en plufieurs individus féparés
eft une, toute en elle , non-diftinfte d’elle.
Son étendue a plufieUrs individus , rte rend point
fon idée divifible. L’idée a fon effence en fo i, l’individu
a fon idée propre : l’idée , Comme telle , n’eft:
donc pas un fimple rapport.
Les notions que nous avons font conformes aux
idées des chofes ; elles rendent leurs formes éternelles
; mais ce ne font que des images, & non des êtres
réels , c’eft le fondement dii commerce de la nature
& de l’entendement.
La première idée archetipe a fes propriétés, comme
d’être fimple ou une , fans parties, fans figure,
fans mouvement , fans limites, infinie , éternelle,
caufe de l’exiftehee des chofes & de leurs facultés ,
fupérieure â toute effence , diffufe en tout, & cir-
Confcrivant la multitude dans les limites de l’imité;
Les idées fecondaires ont auffi leurs propriétés*,
comme d’être unes, mais finies, d’exifter à la vérité
dans l’entendement divin , mais de fe voir dans les
individus, comme l’humanité dans l’homme : elles
font unes & diverfes, unes en elles-mêmes , diverfes
dans les finguliers : elles font en mouvement &c en
repos ; elles agiffent par des principes contraires ,
mais il eft un lien commun de fimilitude qui lie ces
contraires ; il y a donc quelque chofe d’exiftant qui
n’eft pas elles: elles agiffent dans le tems, mais quelle
que foit leur aêtion, elles demeurent les mêmes.
Toute cette métaphyfique a bien du rapport avec
le fyftème de Leibnitz, & ce philofophe ne s’en dé-
fendoit guere.
On peut la réduire en peu de mots à ceci. L’exifr
ïence différé de l’effence ; l’effence des chofes exif-
tentes eft hors des chofes : il y a des femblables &
des diffemblables. Tout fe reporte à certaines claffes
& à certaines idées. Toutes les idées exiftent dans
une unité ; cette unité, c ’eft Dieu. Toutes les chofes
font donc unes. La fcience n’eft pas des finguliers ,
mais des efpeces ; elle diffère des chofes exiftentes.
Puifque les idées font en Dieu, elles échapent donc
à l’homme ; tout lui eft incompréhenfible & caché -;
fes notions ne font que des images ; des ombres. '
Nous craignons que Platon n’ait fort altéré la philofophie
de Parménide. Quoi qu’il en foit, voila ce
que nous avons cru devoiren expoferici, avant que
de-paffer au tems poù les opinions de ce philofophe
reparurent fur la fcène, elëvées : fur les ruines de
celles d’Ariftote & de Platon, par un homme qui
-n’eft pas auffi connu qu’il le méritoit, c’eft Bernardi-
.nus Telefius.
Telefius naquit dans le royaume de Naples , en
>1508 , d’une famille illuftre. On lui reconnut de la
pénétration : on r encouragea à l’étude des lettres &
' de la Philofophie ; & l’exemple & les leçons d’Antoine
Telefius fon oncle ne lui Rirent pas inutilés. Il
paffa fés premières années dans les écoles de Milan.
De-là il alla à Rome , où il cultiva tout ce qu’il'y
. avoit d’hommes célébrés. Lanéceffité de prendre pof-
feffion d’un bénéfice qu’on lui avoit conféré, le rap-
pella dans, fa patrie. Il y vivoit ignoré & tranquille
lorfqu’elle fut prife & faccagée par les François. Te-
ïefius fut jetté dans une prilon où il auroit perdu la
v ie , fans quelques protecteurs qui fe fouvinrent de
; lui & qui obtinrent fa liberté. Il fe réfiigia à Padoue,
où il fe livra à la Poéfie, à la Philofophie & à laMo-
raie. Il fit des progrès furprenans dans les Mathématiques
; il s’attacha à perfectionner l’Optique , & ce
ne fut pas fans fuccès. De Padoue il revint à Rome ,
.où il connut U baid Bandinelli &.Jean délia Cafa ; il
obtint même lafaveur de Paul IV. de retour de Rome,
ou il epoufa Diane Serfali qui lui donna trois enfans.
La mort prématurée de fa femme le toucha vivement,
& le ramena â la folxtude & à l’étude des fciences
auxquelles les affaires domeftiques l’avoient arraché.
Il relut les anciens ; il écrivit fes penfées, & il publia
l’ouvrage intitule, de natura , juxta propria princip
e Cet ouvrage Rit applaudi ; les Napolitains l’ap-
pellerent dans leurs écoles. Il céda à leurs follicita-
tions, & il profeffa dans cette ville fa nouvelle doctrine
: H ne' s*en tint pas là ; il y fonda une efpece
d’académie. Ferdinand Carafe fe l’attacha. Il étoit
aime, honore, eftimé, heureux; lorfque des moines
qui foudroient impatiemment le mépris qu’il faifoit
d Ariftote dans fes leçons & fes écrits , s’élevèrent
contre lu i, le tourmentèrent, & lu i ôterent le repos
& la vie. Il mourut en 1588 ; il publia dans le cours
de fes etudes d’autres ouvrages que celui que nous
avons cité.. -
Principes de la Phyfique de Telefius. Il y a trois
principes des chofes ; deux agens & incorporels
c ’eft le froid & le chaud ; un inftrumental & paffif,
c’eft la matière.
Le chaud mobile de fa nature eftantérieur au mouvement
d’une priorité de tems, d’ordre & de nature;
il en eft la caufe.
Le froid eft immobile.
La terre & toutes fes propriétés font du froid.
Le ciel & les aftres font du chaud.
Les deux agens incorporels , le froid & le chaud,
ont befom d’une maffe corporelle qui les foutienne;
c eft la matière.
La quantité de la matière n’augmente ni ne dimi-
nue dans l’univers. La matière eft fans aftion : elle I
elt noire &invifible de fa nature ; du refte propre à
Je prêter a 1 action des deux principes.
Ces deux principes aétifs ont la propriété de fe
multiplier & de s’étendre.
Ils font toujours oppofés, & tendent fans ceffe à
fe déplacer.
Ils ont l’un & l’autre la faculté de connoîtré & de
fentir nôn-leulement leurs propres aftions, leurs propres
paffions, mais les actions & les pallions de leur
antagonifte.
Ils ont d’abord engendré le ciel & la terre : le foleil
a fait le refte.
La terre a produit les mers , & les produit tous
les jours.
C’eft à la chaleur & à la diverfité de fon aétion &
de l’oppofition du principe contraire qu’il faut attribuer
tout ce qui différencie les êtres entr’eux.
Il nous eft impoffible d’avoir des notions fort dif-
tinâes de ces effets.
Le ciel eft le propre féjour de la chaleur : c’eft-là
qu’elle s’eft principalement retirée, & qu’elle eft à
l ’abri des attaques du froid.
Des lieux placés au-deffoiïs des âbyfines delà mer
fervent d’afyle au froid : c’eft-là qu’il réfide, &c que
la chaleur du ciel ne peut pénétrer.
La terre a quatre propriétés principales, le froid ,
1 opacité , la denfité & le repos. -A'
De ces quatre principes deux réfident tranquilles
dans fes entrailles , deux autres fe combattent perpétuellement
à fa furfaeè.
Ce combat eft l’origine- de tout ce qui fe produit
entre le ciel & la terre , fans en excepter les corps
qui la couvrent & qu’elle nourrit.
Ces corps tiennent plus ou moins du principe qui
après domine dans leur formation.
Le chaud a prédominé dans la production du ciel
& des corps celeftes.
Le ciel & les aftres ont un mouvement qui leur
eft propre. Ce mouvement varie ; mais ces phénomènes
ne fuppofent aucune intelligence qui y pré-
fide. J r
Le ciel eft lucide de fa nature : les aftres le font
auffi, quoiqu’il y ait entr’eux plufieurs différences.
Les plantes ne font pas fans une forte d’ame : cette
ame eft un peu moins fubtile que celle des animaux.
Il y a différens degrés de perfection entre les animaux.
L’ame de l’homme eft de Dieu. C’eft lui qui la
place dans leurs corps, à mefure qu’ils naiffent : c’eft
la forme du corps;elle eft incorporelle & immortelle.
Tous les fens, excepté celui de l’ouïe, ne font
' qu!un toucher.
La raifon eft particulière à l’homme ; les animaux
ne l’ont pas.
Ceux qui defireront connoîtré plus au long le
fyftème de Telefius , & ce qu’il a de conforme avec
les principes de Parménide, peuvent recourir à l’ouvrage
du chancelier Bacon ; ils y verront comment
des efforts que le froid & le chaud font pour fe fur-
monter mutuellement & s’affembler, la terre pour
convertir le foleil, & le foleil pour convertir la terre ;
efforts qui durent fans ceffe & qui n’obtiennent point
leur fin, fans quoi le principe du repos ou celui du
mouvement s’anéantiffant, tout finiroit: comment,
dis-je, le froid & le chaud ayant des viciffitudes con-
tinuelles, il en refulte une infinité de phénomènes
différens.
Ces phénomènes naiffent ou de la force de la chaleur
, ou de la difpofition de la matière, ou de la ré-
fiftence ou du concours des caufes oppofées. ■
^ La chaleur varie en intenfité, en quantité, en duree
; en moyen, en fucceffion.
La fucceffion varie, félon la proximité , l’éloignement
, l’allée, le retour, la répétition, les mter~
valles,