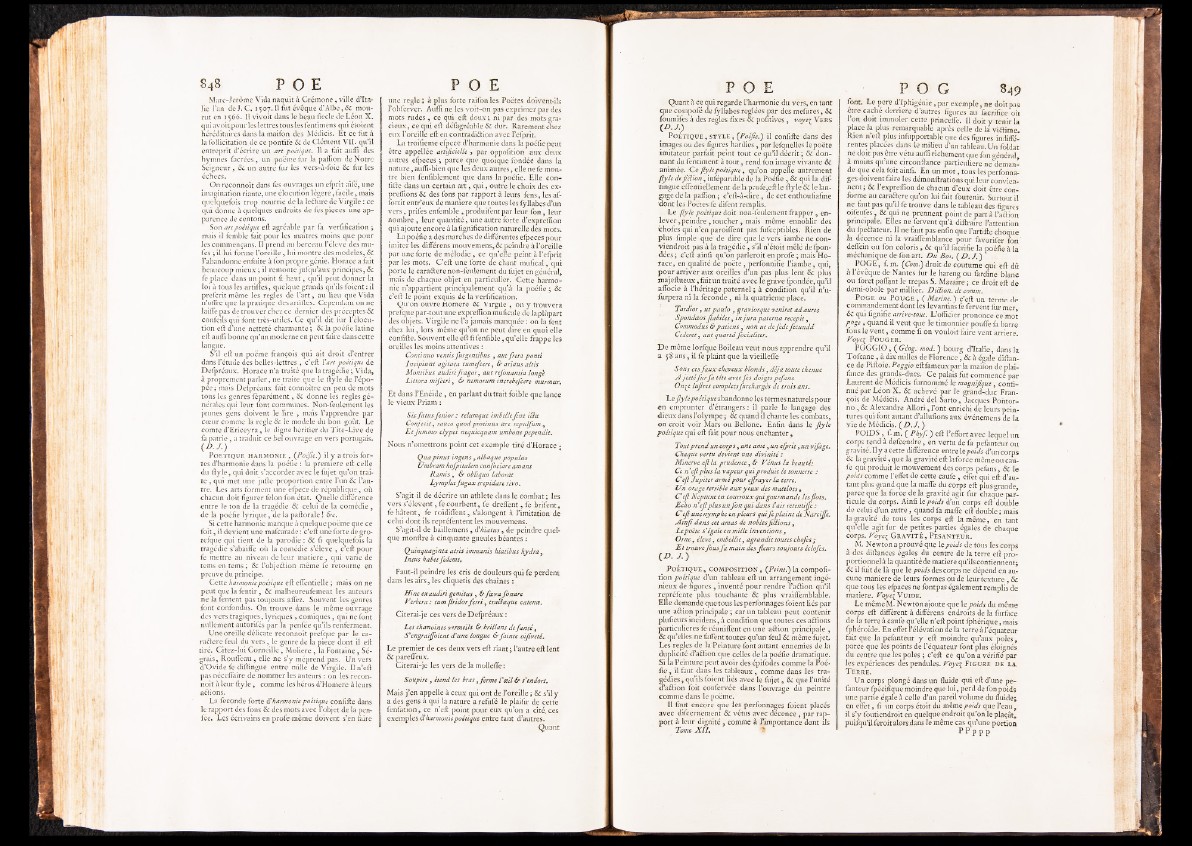
Marc-Jerôme Vida naquit à Crémone, ville d’Italie
l’an de J. C . 1507. Il fut évêque d’Albe, ôc mourut
en 1566. Il vivoit dans le beau fiecle de Léon X .
qui avoitpour les lettres tous les fentimens qui étoient
héréditaires dans la maifon des Médicis. Et ce fut à
la follicitation.de ce pontife & de Clément VII. qu’il
entreprit d’écrire un art poétique. Il a fait aufli des
hymnes facrées, un poëme fur la palîion de Notre
Seigneur, ôc un autre fur les vers-à-foie & fur les
échecs.
On reconnoît dans fes ouvrages un efprit àifé, une
imagination riante, une élocution légère, facile, mais
quelquefois trop nourrie de la lefture de Virgile : ce
qui donne à quelques endroits de fes pièces une apparence
de centons.
Son art poétique eft agréable par fa verfification ;
mais il femble fait pour les maîtres moins que pour
les commençans. Il prend au berceau l’éleve des mu-
fes ; il lui forme l’oreille, lui montre des modèles, &
l’abandonne enfuite à fon propre génie. Horace a fait
beaucoup mieux ; il remonte jufqu’aux principes, êc
fe place dans un point fi haut, qu’il peut donner la
loi à tous les artiftes, quelque grands qu’ils foient : il
prefcrit même les réglés de l’art, au lieu que Vida
n’offre que la pratique des artiftes. Cependant on ne
laiffe pas de trouver chez ce dernier des préceptes ôc
confeils qui font très-utiles. Ce qu’il dit fur l’élocution
eft d’une netteté charmante ; & la poéfie latine
efl: aufli bonne qu’un moderne en peut faire dans cette
langue.
S’il eft un poëme françois qui ait droit d’entrer
dans l’étude des belles-lettres , c’eft Y art poétique de
Defpréaux. Horace n’a traité que la tragédie ; Vida,
à proprement parler, ne traite que le ftyle de l’épo-
pee ; mais Defpréaux fait connoître en peu de mots
tous les genres féparément, ôc donne les réglés générales
qui leur font communes. Non-feulement les
jeunes gens doivent le lire , mais l’apprendre par
coeur comme la réglé ôc le modèle du bon goût. Le
comte d’Ericeyra, le digne héritier du Tite-Live de
fa patrie, a traduit ce bel ouvrage en vers portugais.
{D ■ ............................. ■
Poétique harmonie , (Poéfie.) il y a trois fortes
d’harmonie dans la poéfie : la première eft celle
du ftyle, qui doit s’accorder avec le fujet qu’on traite
, qui met une jufte proportion entre F un Ôc l’autre.
Les arts forment une efpece de république, où
chacun doit figurer félon fon état. Quelle différence
entre le ton de la tragédie ÔC celui de la comédie,
de la poéfie lyrique, de la paftorale ! &c.
Si cette harmonie manque à quelque poëme que ce
foit, il devient une mafcarade : c’eft une forte de gro-
tefque qui tient de la parodie : ôc fi quelquefois la
tragédie s’abaiffe où la comédie s’élève , c’eft pour
fe mettre au niveau de leur matière , qui varie de
tems entems; ôc l’objeérion même fe retourne en
preuve du principe.
Cette harmonie poétique eft effentielle ; mais on ne
peut que la fentir, ôc malheureufement les auteurs
ne la fentent pas toujours allez. Souvent les genres
font confondus. On trouve dans le même ouvrage
des vers tragiques, lyriques , comiques, qui ne font
nullement autorifés par la penfée qu’ils renferment.
Une oreille délicate reconnoît prefque par le ca-
raftere feul du v er s , le genre de la piece dont il eft
tiré. Citez-lui Corneille, Moliere, la Fontaine, Sé-
grais, Rouffeau, elle ne s’y méprend pas. Un vers
d’Ovide fe diftingue entre mille de Virgile. Il n’eft
pas néceffaire de nommer les auteurs : on les reconnoît
à leur ftyle, comme les héros d’Homere à leurs
aérions.
La fécondé forte d'harmonie poétique confifte dans
le rapport des fons ôc des mots avec l’objet de la penfée.
Les écrivains en profe même doivent s’en faire
une réglé ; à plus forte raifon les Poètes doivent-ils
l’obferver. Aufli ne les voit-on pas exprimer par des
mots rudes , ce qui eft doux ; ni par des mots gracieux,
ce qui eft défagréable ôc dur. Rarement chez
eux l’oreille eft en contradiérion avec l’efprit.
La troifieme efpece d’harmonie dans la poéfie peut
être appellée artificielle , par oppofition aux deux
autres efpeces ; parce que quoique fondée dans la
nature, aufli-bien que les deux autres, elle ne fe montre
bien fenfiblement que dans la poéfie. Elle confifte
dans un certain a rt, qui, outre le choix des ex-
preflions ôc des fons par rapport à leurs fens, les af-
fortit entr’eux de maniéré que toutes les fyllabes d’un
vers, prifes enfemble ,.produifentpar leur fon , leur
nombre , leur quantité, une autre forte d’expreflion
qiii ajoute encore à la fignification naturelle des mots.
La poéfie a des marches de différentes efpeces pour
imiter les différens mouvemens, ôc peindre à l’oreille
par une forte de mélodie , ce qu’elle peint à l’efprit
par les mots. C’eft une forte de chant mufical, qui
porte le caractère non-feulement du fujet en général,
mais de chaque objet en particulier. Cette harmonie
n’appartient principalement qu’à, la poéfie; ôc
c’eft le point exquis de la verfification.
Qu’on ouvre Homere ôc Virgile , on y trouvera
prefque par-tout une expreflionmuficale de la plupart
des objets. Virgile ne l’a jamais manquée : on la fent
chez lui, lors même qu’on ne peut dire en quoi elle
confifte. Souvent elle eft fifenfible, qu’elle frappe les
oreilles les moins attentives :
Continuo ventis furgentibus , aut fréta pond
Incipiunt agita ta tumefcere, & aridus altis
Montibus audiri fragor, aut rej'onantia longé
Littora rnifceri, & nemorum increbefcere murmur.
Et dans l’Enéide, en parlant du trait foible que lance
le vieux Priam :
Sip fa tus fenior : telumque imbelle fine iclu
Conjecit, rauco quod protinus are repulfum ,
E t fummo clypei nequicquam umbone pependit.
Nous n’omettrons point cet exemple tiré d’Horace *
Qua pi nus ingens , albaque populus
Unibram hofpitalem confociare amant
Ramis, & obliquo laborat
Lymphafugax trepidare rivo.
S’agit-il de décrire un athlete dans le combat; les
vers s’é lèvent, fe courbent, fe dreffent, fe brifent,
fe hâtent, fe roidiffent, s’alongent à l’imitation de
celui dont ils repréfentent les mouvemens.
S’agit-il de baillemens, d’hiatus, de peindre quelque
monftre à cinquante gueules béantes :
Quinqttaginta atris immanis hiatibus hydra,
Intus habet fedemt.
Faut-il peindre les cris de douleurs qui fe perdent
dans les airs, les cliquetis des chaînes :
Hinc ex audiri gemitus , & fceva fonare
Verbera : turn flridor ferri, tracloeque entente.
Citerai-je ces vers de Defpréaux :
Les chanoines vermeils & brillans de famé ,
S'engraifibient d'une longue & fainte oifiveté.
Le premier de ces deux vers eft riant; l’autre eft lent
ôc pareffeux.
Citerai-je les vers de la molleffe :
Soupire , étend les bras , ferme l'oeil & s'endort.
Mais j’en appelle à ceux qui ont de l’oreille ; ôc s’il y
a des gens à qui la nature a refufé le plaifir de cette
fenfation, ce n’eft point pour eux qu’oii a cité, ces
exemples d ' harmonie poétique entre tant d’autres.
Quant
Quant à ce qui regarde l’harmonie du vers, en tant
que compofé de fyllabes réglées par des mefures, ôc
foumifes à des réglés fixes & pontives, voyez V e r s
P o é t i q u e , s t y l e , (Poéfie.) i l confifte dans des
images ou des figures hardies , par lefquelles le poète
imitateur parfait peint tout ce qu’il décrit ; Re donnant
du fentiment à tout, rend fon image vivante ôc
animée. Ce fiylepoétique , qu’on appelle autrement
ftyle de fiction, inlëparable de la Poefie , ôc qui la distingue
efferitiellement de la profe,eft le ftyle ôc le langage
de la paflion ; c’eft-à-dire, de cet enthoufiafme
dont les Poètes fe difent remplis.
Le fiyle poétique doit non-feulement frapper , enle
v e r , peindre , toucher, mais même ennoblir des
chofes qui n’en paroiffent pas fufceptibles. Rien de
plus fimple que de dire que le vers iambe ne con-
viendroit pas à la tragédie , s’il n’étoit mêlé de fpon-
dées ; c’eft ainû qu’on parleroit en profe ; mais Horace,
en qualité de poète, perfoniïifie l’iambe, qui,
pour arriver aux oreilles d’un pas plus lent ôc plus
majeftueux, fait un traité avec le grave fpondée, qu’il
affocie à l’héritage paternel ; à condition qu’il n’u-
furpera ni la fécondé, ni la quatrième place.
Tardior, ut paulo , graviorque venir et ad aures
Spohdaos fiabiles, in jura paterna recep i t ,
Commodus & patiens, 'non ut de fede fecundâ
Cederet, aut quand focialiter.
De meme lorfque Boileau veut nous apprendre qu’il
a 58 ans, il fe plaint que la vieilleffe
Sous ces faux cheveux blonds, déjà toute chenue
A jettéfur fa tête avec fes doigts pej'ans
On^e lufirts complets furchargés de trois ans.
Le fiyle poétique abandonne les termes naturels pour
en emprunter d’étrangers : il parle le langage des
dieux dans l’olympe; ôc quand il chante les combats,
on croit voir Mars ou Bellone. Enfin dans le fiyle
poétique qui eft fait pour nous enchanter,
Tout prend un -corps, une ame, un efprit, un vifage..
Chaque vertu devient une divinité :
Minerve .ejl la prudence, & Vénus la beauté;
Ce n eft plus la vapeur qui produit le tonnerre :
C efl Jupiter armé pour effrayer la terre..
Un orage terrible aux yeux des matelots,
■ C'efi Neptune en courroux qui gourmande lès flots.
Echo n'efl plus unfon qui dans l'air retentiJJ'e :
C ’efi une nymphe en pleurs qui fe plaint de Narciffe..
Amfi dans cet amas de noblesfêlions ,
Le poète s'égaieen mille inventions ,
Orne, élève, embeilit, agrandit toutes chofes ;
E t trouve fous fa main des fleurs toujours éclofes.
( o - J . )
P o é t i q u e , c o m p o s i t i o n , (Peint.)lacompofi-
tion poétique d’un tableau eft un arrangement ingénieux
de figures , inventé pour rendre l’afüon qu’il
repréfente plus touchante ôc plus vraiffemblable.
Elle demande que tous lesperfonnages foient liés par
une aérion principale ; car un tableau peut contenir
plufieurs incidens, à condition que toutes ces aérions
particulières fe réunifient en une aérion principale ,
& qu’elles ne faffent toutes qu’un feul & même fujet.
Les réglés de la Peinture font autant ennemies de la
duplicité d’aérion que celles de la poéfie dramatique.
Si la Peinture peut avoir des épifodes comme la Poéfie
, il faut dans les tableaux , comme dans les tragédies
, qu’ils foient liés avec le fujet, & que l’unité
d’a&ion foit confervée dans l’ouvrage du peintre
comme dans le poëme.
Il faut encore que les perfonnages foient placés
avec difeernement & vêtus avec décence, par rapport
à leur dignité, comme à l’importance dont ils
Tome XII.
font. Le pere d’Iphigenie, par exemple, ne doit pas
être caché derrière d’autres figures au facrifice où
l’on doit immoler cette princeffe. Il doit y tenir la
place la plus remarquable après celle de la viftime.
Rien n’eft plus infupportable que des figures indifférentes
placées dans le milieu d’un tableau. Un foldat
ne doit pas être vêtu aufli richement que fon général
k moins qu’une circonftance particulière nedeman-
de que cela foit ainfi. En un m ot, tous les perfonnages
doivent faire les démonftrations qui leur conviennent
; & l’expreflion de chacun d’eux doit être conforme
au caraûere qu’on lui fait foutenir. Surtout il
ne faut pas qu’il fe trouve dans le tableaù des figures
oifeufes, & qui ne prennent point de part à l’aérion
principale. Elles ne fervent qu’à diftraire l’attention
du fjjedateur. Il ne faut pas enfin que l’artifte choque
la décence ni la vraiffemblance pour favorifer ton ’
deffein ou fon coloris, & qu’il facrifie la poéfie à la
méchanique de fon art. Du Bos. (D . J .)
POGE, f.m. (Corné) droit de coutume qui eft dû
à l’évêque de Nantes fur le hareng ou farcüne blanc
ou foret paffant le trépas S. Mazaire; ce droit eft de
demi-obole par millier. Diction, de comm.
P o g e ou P o u g e , (Marine.) c ’e ft u n t e rm e d e
■ commandement d o n t le s le v a n t in s fe fe r v e n t fu r m e r
& q u i fig n ifie arrive-tout. L ’o ffic ie r p ro n o n c e c e m o t
poge , q u a n d il v e u t q u e le t im o n n ie r p o u ffe fa b a r r e
fo u s le v e n t , com m e fi o n v o u lo i t f a i r e v e n t a r r ié r é .
Voyez P o u g e r i
POGGIO, (Géog. mod.) bourg d’Italie, dans la
Tofcane, à dix milles de Florence, & à égale diftan-
ce de Piftoie. Poggio eft fameux par la maifon de plai-
fance des grands-ducs. Ce palais fi.it commence par
Laurent de Médicis furnommé le magnifique, continué
par Léon X . & achevé par le grand-duc François
de Médicis. André del Sarto, Jacques Pontor-
n o , & Alexandre Allori, l’ont enrichi de leurs peintures
qui font autant d’allufions aux événemens de la
vie de Médicis. ( D .J '. )
POIDS , f. m. ( Phyf. ) eft l’effort avec lequel un
corps tend à defeendre, en vertu de fa pefantelir ou
gravité. Il y a cette différence entre [epoids d’un corps
& la g ravité, que la gravité eft laforce même ou cau-
fe qui produit le mouvement des corps pefans, & le
poids comme l’effet de cette caufe , effet qui eft d’autant
plus grand que la malle du corps eft plus grande,
parce que la force de la gravité agit fur chaque particule
du corps. Ainfi le poids d’un corps eft double
de celui d’un autre, quand fa maffe eft double ; mais
la gravité de tous les corps eft la même, en tant
qu’elle agit fur de petites parties égales de chaque
corps. Voyez G r a v i t é , P e s a n t e u r .
M. Newton a prouvé que le poids de tous les corps
à des diftances égales du centre de la terre eft proportionnel
à la quantité de matière qu’ils contiennent;
.& il fuit de là que le poids des corps ne dépend en aucune
maniéré de leurs formes ou de leur texture, Ôc
que tous les efpaces ne fontpas également remplis de
matière. Voyez V uide.
Le mêmeM. Newton ajoute-que le poids du même
corps eft différent à différens endroits de la furface
de la terre à caufe qu’elle n’eft point fphérique, mais
fphéroïde. En effet l’élévation de la terre à l’équateur
fait que la pefanteur y eft moindre qu’aux pôles,
parce que les points de l’équateur font plus éloignés
du centre que les pôles ; c’eft ce qu’on a vérifie par
les expériences des pendules. Voyez F i g u r e d e l a
T e r r e .
Un corps plongé dans un fluide qui eft d’une pefanteur
fpéeifique moindre que lui, perd de fon poids
une partie égale à celle d’un pareil volume du fluide;
en effet, fi un corps étoit du même poids que l’eau ,
il s’y foutiendroit en quelque endroit qu’on le plaçât,
puifqu’ilferoit alors dans le même cas qu’une portion