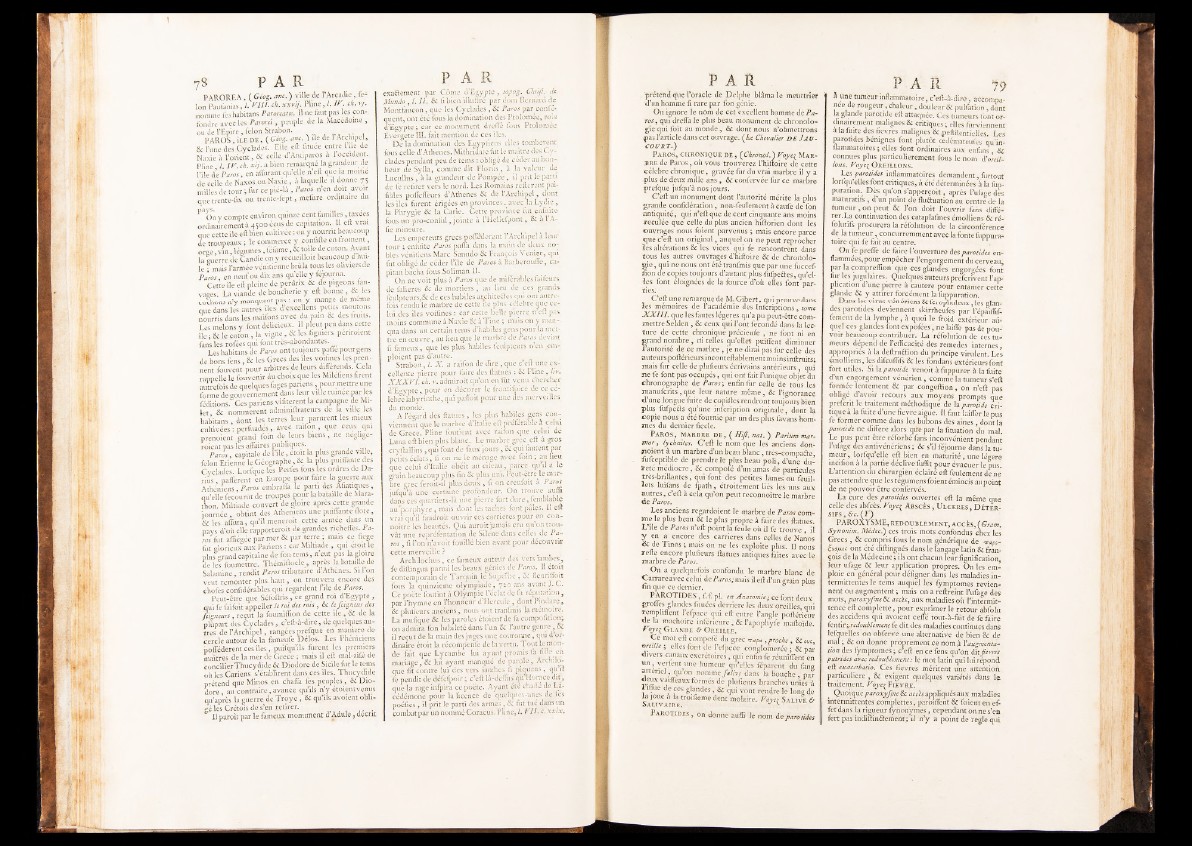
r P A R
PAROREA, ( Géog. anc. ) ville de l’Arcadie, félon
Paul'anias 1 L K g ch. xxvij Pline I /. IV ch. vj.
nomme les habitans Paroreatoe. Il ne faut pas les con-,
fondre avec les Parorei, peuple de la Macedoine ,
ou de l’Epire , félon Strabon. .
PAROS, ÎLE DE, ( Géog. anc. ) île de 1 Archipel,
& l’une des Cycladés. Elle eft fituee entre 1 île de
Naxie à l’orient., & celle d’Antiparos à 1 occident.
Pline l. IV. ch. xij. a bien remarque la grandeur de
Pile de Paros, en affurant qu’elle n’eft que la moitié
de celle de Naxos.ou N axie, à laquelle il donne 75
milles de tour ; fur ce pic-là , Paros n’en doit
que trente-fix ou trente-fept^mefure ordinaire du
^ O n y compte environ, quinze centfamillçs, taxées
ordinairement à 4500 écus de capitation. Il eft vrai
que cette île eft bien cultivée: on y nourrit beaucoup
de troupeaux ; I commerce y çonfifte en froment,
orae v in , légumes, féfame, 8c toile de coton. Ayant
la guerre.de Candie on y recueilJ,oit beaucoup d huile
- mais l’armée vénitienne brûla tous les oliviers de;
Paros, en neuf ou dix ans quelle y lcjourna.
Cette île eft pleine de perdrix U de pigeons lau-
vàges. La viande de boucherie y eft bonne , ■ les
cochons n’y manquent,pass. on y mange ■ même
que dans les-autres ,îlss. d’excellens petits moutons
nourris dans les ,maifonS avec.,du pain & desfWi» .
Les melons y font délicieux. Il pleut peu dans cette
île ; 8cle coton , la vigne , 8cles figuiers périraient
fans les rofces qui font très-abondantes.
Les habitans de Paros onttoujours paffe pour gens,
de bons fens, 8c les Grecs des îles vo.hr.es les pren
nent fouvent pour arbitres do leurs différends. .Cela
rappelle le fouvenir du choix que les Milefîens firent
autrefois de quelques fages panens pourmettre une
forme de gouvernement dans leur ville ruinee par les
féditions. Ces pariens vifiterent la campagne de Mi-
let 8c nommèrent adminiftrateurs de la ville les
habitans,; dont les, terres leur parurent les mieux
cultivées : perfuadés , avec taifon , que ceux qui
prcnoie.it grand foin de leurs biens, ne. negligeroient
pas les affaires publiques. , .
Paros, capitale de f i le , etott la plus grande « H
félon Etienne le Géographe, 8c la plus puiffantedes
Cycladés: Lorfque les Perles fous le^ordres de Darius
, pafférent en Europe pour faire la guerre aux
Athéniens, Paras- embralfa le parti des Ahatiqu.es,
qÙ’elïe fëcôurût de troupes pour la bataille de Marathon.
Miltiade, couvert de gloire apres cette grande
journée, obtint des Athéniens une paillante Ilote,
Scies affûta, qu’il mènerait cette armée dans un
pays d’oît elle rapporteroit de grandes richeffes. Pure/
fut affiégée par mer 8c par tente ; mais ce licge
fut glorieux, aux. Pariens : car Miltiade , qui etoit le
plus grand capitaine de fon teins, n eut pas là gloire
de les foumettre. Thémillocle, aptes la bataille de
Salamine, rendit Paros tributaire d’Athenes. Si 1 on
veut remonter plus haut I on trouvera encore des
chofes cônftdérables qui regardent file.de Paros. I ,
Peutiêtre que Séfoftris „ ce grand rot d Egypte ,
qui fe faifoit appeller h roi dis roif , 8c UJugnmr dis
feigniurs , reçut la foumiflïon de cette île , 8c de la
plûpart des Cycladés,, ç’eft-à-dire, de quelques autres.
de: l’Archipel, rangées prefque en maniéré de
cercle autour de la famèufé Delos. Les Phéniciens,
poffederent ces îles, puifqu’ils fiirentjes premiers
maîtres de la mer de Grèce ; mais i l ,eft mal-ailé de
concilier Thucydide 8c Diodore dé Sicile fur le tems
où les Cariens s’établirent dans ces îles. Thucydide
prétend que Mtnos en chaffa fes peuples,, 8c D10-
tlore, au contraire, avance qu’ils n’y,étoieatvenus
qu’après la guerre d eTrôye , 8c qu’ils avoient obligé
les Crptpis de s’en retirer.
Il paroitpar le fameux monument d’Adule, décrit
P A R
exa&ement par Corne d’Egypte, topog. Ghnfl.- de
Mundo , /. II. & fi bien illulire par dom Bernard de
Montfaucon, que les Cycladés Paros par çonfe*.
quent, ont été lous la domination des Ptolomée, rois
d’Egypte ; car ce monument dreffé fous Ptolomée
Evergete 111. fait mention de ces îles.
De la domination des Egyptiens elles tombèrent
fous celle d’Athenes. Mithridate fut le maître des C y-
clades pendant peu de tems : oblige de ceder au bonheur
de Sylla, comme dit Florus, à la valeur de
Lucullus , à la grandeur de Pompée, il prit le parti
de 1e retirer vers le nord. Les Romains relierent pai-
fibles poffeffeurs d’Athenes & de l’Archipel, dont
les îles dirent érigées en provinces. avec la Lydie,
la Phrygie & la Carie. Cette province fut enfuite
fous un pro-conl'ul, jointe à l’Hellefpont, & à l’A-
fie mineure.
Les empereurs grecs poffé'derent l’Archipel à leur
tour ; enluite Paros pafl'a dans la main de deux nobles
vénitiens Marc Sanudo & François V cnier, qui
fut obligé de céder l’île de P aros à Barberouffe, ca-
pitan bacha fous Soliman II.
On ne voit plus à Paros que de miférables faifeurs
de falieres & de mortiers , au lieu de ces grands
fculpteurs,& de ces habiles ay:hite£les qui ont autrefois
rendu le marbre de cette île plus célébré que ce-
luLdes îles yoidnes : car cette belle pierre n’eft pas
moins commune à Naxie &£ a T ine ; mais on y manqua
dans un certain tems d’habiles gens pour la mettre
en oeuvre, au lieu que le marbre de Paros devint
fi fameux, que les plus habiles fculpteurs n’en em-
. ploient pas d’autre.
Strabon, /. X . a raifon de dire , que c’ eft une excellente
pierre pour faire des ftatues : & Pline, Uv.
X X X V I . ch. v. admiroit qu’on en fût venu chercher
d’Eoypte, pour en décorer le frontifpice de ce célébré
labyrinthe, qui pafloit pour une des merveilles,
du monde.
A l’égard des ftatues , les plus habiles gens con-
! viennent que le marbre d’Italie eft préférable à ce.ui
de Grece. Pline foutient avec raifon que celui de
Luna eft bien plus blanc. Le marbre grec eft à gros
cryftallins, qui font de faux jours, & qui fautent par
petits éclats, fi on ne le ménage, avec foin ; au lieu
que celui d’Italie obéit au cifeaii, parce qu’il a le
grain beaucoup plus fin & plus uni. Peut-être le marbre
grec feroit-il plus doux , fi on creufoit à Paros
jufqu’à une certaine profondeur. On trouve auffi
dans ces quartiers-là une pierre fort dure, femblablè
au "porphyre , mais dont les taches font pales. Il eft
vrai qu’il faudroit ouvrir ces carrières pour en con-
noître les beautés. Qui auroit jamais cru qu’on trouvât
une repréfentation de Silène dans celles^ de Pa-
ros , fi l’on n’avoit fouillé bien avant pour découvrir
cette merveille ? „ ,
Archilochus , ce fameux auteur des vers ïambes,
fe diftingua parmi les beaux genies de P aros. Il ctoit
contemporain de Tarquin le Superbe , & fleuriffoit
fous la quinzième olympiade, 720 ans avant J. C.
Ce poète foutint à Olympie l’éclat de fa réputation ,
par l’hymne en l’honneur d’Hercule , dont Pindare ,
& plulieurs anciens, nous ont tranfmis la mémoire.
La mufique & les paroles étoient de fa compofition;
on admira fon habileté dans l’un &c l’autre genre, &
il reçut de la main des juges une couronne, qui d’ordinaire
étoit la récompenfe de la vertu. Tout le monde
fait que Lycambe lui ayant promis fa fille en
mariage, & lui ayant manqué de parole, Archilo-
que fit contre lui des vers ïambes îi piquans , qu’il
fe pendit de défefpoir ; c’eft là-defïiis qu’Horace dit ,
que la rage infpira ce poëte. Ayant été cbaffe de Lacédémone
pour la licence de quelqilès-unes de fés
poéfies , il prit le parti des armes, Sc fi.it tue dans un
combat par un nommé Coracus. Pline, l. VII. c. xxix.
P A R
prétend que l’oracle de Delphe blâma le meurtrier ■
d’un homme fi rare par fon génie.
On ignore le nom de cet excellent homme de P a- j
ros, qui drefla le plus beau monument de chronologie
qui foit au monde, & dont nous n’obmettrons
pas Particle dans cet ouvrage. (Æc Chevalier d e Ja v -
■c o u r t .)
Paros, chronique de , ( Chrohôl.) Voye^ Marbre
de Paros, où vous trouverez l’hiftoire de cette
■ célébré chronique, gravée fur du vrai marbre il y a
plus de deux mille ans , & confervée fur ce marbre
prefque jufqu’à nos jours.
C’eft un monument dont l’autorité mérite la plus
grande confidération, non-feulement à éaufe de fon
antiquité, qui n’eft que de cent cinquante ans moins
reculée que celle du plus ancien hiftorien dont les
ouvrages nous foient parvenus ; mais encore parce
que c’eft un original, auquel oii ne peut reprocher
ïes altérations & les vices qui fe rencontrent dans
tous les. autres ouvrages d’niftoire & de chronologie
, qui ne nous ont été tranfmis que par une fuccef-
fion de copiés toujours d’autant plus fufpeéles, qu’el-
les font éloignées de la fource d’où elles font parties;
C ’eft une remarque de M. Gibert, qui prouve dans
les mémoires de l’académie des Inicriptions, tome
X X I I I . que les fautes légères qu’a pu peut-être commettre
Selden , & ceux qui l’ont fécondé dans la lec- |
îure de cette chronique précieufe , ne font ni en '
grand nombre, rli telles qu’elle!; puiffent diminuer
l ’autorité de ce marbre, je ne dirai pas fui- celle des
auteurs poftérieurs inconteftablementmoinsinftruits-
mais fur celle de plufieurs écrivains antérieurs, qui
ne fe font pas occupés, qui ont fait l’unique objet du
chronographe de Paros ; enfin fur celle de tous les
manuferits, que leur nature même, & l’ignorance
d ’une longue fuite de copiftes rendront toujours bien
plus fufpeéls qu’une infeription originale, dont la
copie nous a été fournie par un des plus favans horm
mes du dernier fiecle.
PAROS, MARBRE DE, ( H{jl. nat. ) Parium mdr-
mor, lychnites. C’eft le nom que les anciens donnaient
à un marbre d’un beau blanc, très-compafte,
fufceptible de prendre le plus beau poli, d’une du-
îreté médiocre, &c compolé d’un amas de particules
très-brillantes, qui font des petites lames ou feuillets
luifans de fpath, étroitement liés les uns aux
autres, ç’eft à cela qu’on peut reconnoître le marbre
de Paros.
Les anciens regardoient le marbre de Paros comme
le plus beau oc le plus propre à faire des ftatues»
L ’île de Paros n’eft point là feule où il fe trouve , il
y en a encore des carrières dans celles de Nanos
& de Tinos ; mais on ne les exploite plus. Il nous
refte encore plufieurs ftatues antiques faites avec le
marbre de Paros.
On a quelquefois confondu le marbre blanc de
Carrare avec celui de Paros; mais il eft d’un grain plus
fin que ce dernier.
PAROTIDES, f.f. pi. en Anatomie ■ ce font deux
groffes glandes fituées derrière les deux oreilles, qui
î-emplifl'ent l’efpace qui ell entre l’angle poftérieur
de la mâchoire inférieure ,& l’apophyfe maftoïde.
Viyc{ G lande & O reille.
Ce mot eft conrpofé du grec * «p*, proche , & ouç,
meule ; elles font de l’efpece conglomérée ; & par
divers canaux excrétoires, qui enfin fe réunifient en
un | verfent une humeur qu’elles fépai-ent du fang
artériel, qu’on nomme falive dans la bouche , par
«jeux vaiffeaux formés de plufieurs branches unies à !
1 îüue de ces glandes , & qui vont rendre le long de
la joue à la troifieme dent molaire. Voyez Salivé fi*
Sa l iv a ir e . . . . , -
Parotides , on donné auffi le nom de parotides
P A R m
à unë tumeur inflammatoire, e’eft-à-dîrè , àccompa-
nee de rougeur, chaleur, douleur & pulfation, dont
la glande parotide eft attaquée. Ces tumeurs font ordinairement
malignes & critiques ; elles furviennent
à la fuite des fievres malignes & .peftilentielles. Les
parotides bénignes font plutôt oedémateufes qu’inflammatoires
; elles font ordinaires aux enfans &
connues plus particulièrement fous le nom cYoreillons.
Voye[ Oreillons.
Les parotides inflammatoires demandent, ftirtout
lorfqu’elles font critiques, à été déterminées à la fup-
puration. Dès qu’on s’apperçoit, après l’ufage des
maturatifs , d’un point de fluôuation au centré de la
tumeur , on peut & l’on doit l’ouvrir fans différer.
La continuation des cataplafmes émolliens & ré -
folütifs procurera la réfolution de la circonférence
de la tumeur, concurremment avec la fonte fuppura-
toire qui fe fait au centre.
On fe preffe de faire l ’ouverture des parotides enflammées,
pour empêcher l’engorgement du cerveau,
par la compreffion que ces glandes engorgées font
lur les jugulaires. Quelques auteurs preferivent l’application
d une pierre a cautere pour entamer cette
glande & y attirer forcément la fuppuration.
Dans les virus vénériens &fcrophuleux, les glandes
parotides deviennent skirrheufes par l’épaiffff-
fement de la lymphe , à quoi le froid extérieur auquel
ces glandes font expôfées, ne laiffe pas de pouvoir
beaucoup contribuér. La réfolution de ces tumeurs
dépend de l’efficacité des remedes internes,
appropries à la deftruélion du principe virulent. Les
émolliens, les difeuflifs & les fondans extérieurs font
fort utiles. Si la parotide venoit à fiippurer à la fuite
d’un engorgement vénérien, comme la tumeur s’eft
formée lentement &: par congeftion, on n’eft pas
obligé d’avoir recours aux moyens prompts que
preferit le traitement méthodique de la parotide critique
à la fuite d’une fievre aigue. Il faut laiffer le pus
fe former comme dans les bubons des aines, dont la
parotide ne différé alors qiîe par la fituation du mal*
Le pus peut etfe reforbe fans inconvénient pendant
l’ufàge des antivénériens ; & s’il féjourne dans la tu^
meur, lorfqu’elle eft bien en maturité, une légère
incifion à la partie déclive fuffit pour évacuer le pus.
L’attention du chirurgien éclaire eft feulement de ne
pas attendre que les tegumens foient émincis au point
de ne pouvoir être confervés.
La cure des parotides ouvertes eft la même que
celle des abfcès. Voyt{ A bscès, Ulc érés, D étersifs
, &c. (T )
PAROXYSME, REDOUBLEMENT, ACCÈS, {Gram.
Synonim. Médec.) ces trois mots confondus chez les
Grecs , & compris fous le nom générique de nupo-
Zvopoç ont été diftingués dans le langage latin & fran-
çois de la Médecine ; ils ont chacun leur fignification
leur ufage & leur application propres. On les emploie
en général pour défigner dans les maladies intermittentes
le tems auquel les fymptomes reviën-
nent ou augmentent ; mais on a reftreint l’ufage des
mots, paroxyfme&c accès, aux maladies où l’intermittence
eft complette, pour exprimer le retour abfolu
des accidens qui avoient ceflé tout-à-fait de fe faire
fentir ^redoublement fe dit des maladies continues dans
lefquelles on obfervè une alternative de bien & de
mal ; & on donne prqprement.ee nom à Y augmentation
fe s fymptomes ; .c’eft en ce fens qu’on dix.fievres
putrides avec redoublement: le mot latin qui lui répond
eft exacerbatio. Ces fievres méritent une attention
particulier,e , & exigent quelques variétés dans le
traitement. Voye{ Fievr.é.
Quoique paroxyfme & accès appliqués aux maladies
intermittentes .cômplettes, paroïffent & foient en e ffet
d^ns la rigueur fynonÿmes, cependant on ne s’en
fert pas indiîtinélement ; il n’y a point de réglé qui