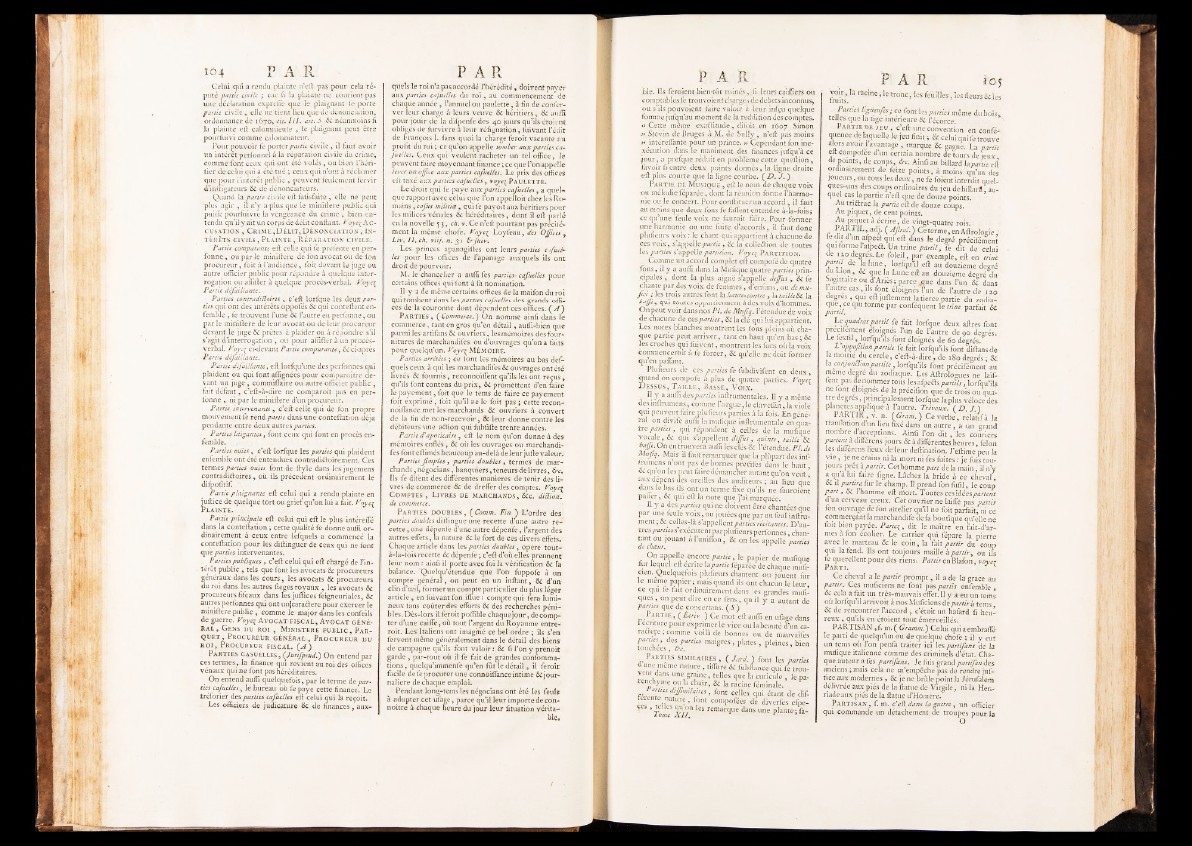
m m
i
Celui qui a rendu plainte n’eft pas pour Cela réputé
partie civile ; car fi. la plainte ne contient pas
une déclaration exprefie que le plaignant le porte
partie civile, elle ne tient lieu que de dénonciation,
ordonnance de 1670, tic. I I I . art. .5. & neanmoins fi
la plainte eft calomnieufe , le plaignant peut être
pourfiiivi comme calomniateur.
Pour pouvoir fe porter partie civile , il faut avoir
un intérêt perionnel à la réparation civile du crime,
comme font ceux qui ont été voles, ou bien l’héritier
de celui qui a été tué ; ceux qui n’ont à réclamer
que pour l’intérêt public , peuvent feulement fervir
d’infiigateurs & de dénonciateurs.
Quand la partie civile ell fatisfaite , elle ne peut
plus agir , il n’y a plus que le miniftere public qui
puiflë pourluivre la vengeance du crime , bien entendu
qu’il y ait un corps.de délit confiant. V ^ ^ A ccusation
, C r im e ,D élit,D én on cia tio n, Intérêts
civils , Plainte , R éparation civile.
Partie comparante eft celle qui fe préfente en per-
fonne , ou par le miniftere de fon avocat ou de Ion
procureur, foit à l’audience, foit devant le juge ou
autre officier public pour répondre à quelque interrogation
ou aflifter à quelque procès-verbal. Koye^
Partie défaillante.
Parties contradictoires , c’eft lorfque les deux parties
qui ont des intérêts oppofés & qui conteftent en-
femble , fe trouvent l’une & l’autre en perfonne, ou
par le miniftere de leur avocat ou de leur procureur
devant le juge & prêtes à plaider ou à répondre s ’il
s’agit d’interrogation , ou pour affifter à un procès-
verbal. l''bye^ ci-devant P ortie, comparante, & ci-après
Partie défaillante.
Partie défaillante, eft lorfqu’une des perfonnes qui
plaident ou qui font affignées pour comparoître devant
un juge , commiffaire ou autre officier public ,
fait défaut, c’eft-à-dire ne comparoît pas en perfonne
, ni par le miniftere d’un procureur.
Partie intervenante, c’eft celle.qui de fon propre
mouvement fe rend partie dans une conteftation déjà
pendante entre deux autres parties.
Parties luisantes , font ceux qui font en procès en-
fernble.
Parties ouïes., c’eft lorfque les parties qui plaident
enfemble ont été entendues contradiéloirement. Ces
termes parties ouïes font de ftyle dans les jugemens
contradiâoires, où ils précèdent ordinairement le
difpofitif.
Partie plaignante eft celui qui a rendu plainte en
jufticé dé quelque tort ou grief qu’on lui a fait. Poye{
Plainte.
Partie principale eft celui qui eft le plus intérefle
dans la conteftation ; cette qualité fe donne aufli ordinairement
à ceux entre lefquels a commencé la
conteftation pour les diftinguer de ceux qui ne font
que parties intervenantes.
( Parties publiques , c’eft celui qui eft chargé de l’intérêt
public , tels que font les avocats & procureurs
généraux dans les cours, les avocats & procureurs
du roi dans, les. autres fieges royaüx , les avocats &
procureurs fifeaux dans les juftices feigneuriales, &
autres perfonnes qui ont unjcaraclere pour exercer le
miniftere public , comme le major dans les confeils
de guerre. Voye^ Avo c a t f is c a l , A v o c a t génér
a l , Gens du roi , Ministère p u b l ic , Parq
u e t , Procureur g én é r a l , Pro cureur du
r o i , Procureur f isca l. ÇA)
Parties, casuelles , ÇJurifprud.) On entend par i
ces termes, la finance qui revient au roi des offices
vénaux qui ne font pas héréditaires.
On entend aufli quelquefois, par le terme de parties
cafudles., le bureau où fe paye cette finance. Le
tréforier tes parties cafuelles eft celui qui la reçoit.
Les officiers de judicature àc de finances, aux-
P A R
quels le roi n’a pas accordé l’hérédité, doivent payer
aux parties cajuell.es du ro i, ait commencement de
chaque année , l’annuel ou paulette, à fin de confer-
ver leur charge à leurs veuve & héritiers, & auflî
pour jouir de la difpenfe des 40 jours qu’ils ctoient
obligés de furvivre à leur réfignation, fuivant l’édit
de François I. fans quoi la charge feroit vacante au
profit du roi ; ce qu’on appelle tomber aux parties ca~
fueiles. Ceux qui veulent racheter un tel office, le
peuvent faire moyennant finance ; ce que l’on appelle
le ver un office aux parties cafuelles. Le prix des offices
eft taxé aux parties cafudles , voye^-PAULETTE.
Le droit qui fe paye aux parties cafuelles, a quelque
rapport avec celui que l’on appelloit chez les Romains
, cafus militice, qui fe payoit aux héritiers pour
les milices vénales & héréditaires, dont il eft parlé
en la novelle 53, ch. v. Ce n’eft pourtant pas précile-
ment la, même chofe. Voye^ Loyfeau, des Offices ,
Liv. II . ch. viij. n. 3 / & Juiv.
Les princes apanagiftes ont leurs parties c.fueb-
les pour les offices de l’apanage auxquels ils ont
droit de pourvoir.
M. le' chancelier a aitfli fes parties- cafuelles pour
certains offices qui font à fa nomination.
Il y a de même certains offices de la maifon du roi
qui tombent dans les parties cafuelles des grands offices
de la couronne dont dépendent ces offices. ( A )
Pa r t ie s , ( Commerce. ) On nomme ainli dans le
commerce, tant en gros qu’en détail , auffi-bien que
parmi les artifans & ouvriers, les mémoires des fournitures
de marchandifes ou d’ouvrages qu’on a faits
pour quelqu’un. Voyei^ Mémoire.
Parties arrêtées ; ce font les mémoires au bas défi*
quels ceux à qui les marchandifes & ouvrages ont été
livrés & fournis, reconhoiffent qu’ils les ont reçus ,
qu’ils font contens du prix* & promettent d’en faire
le payement, foit que le tems de faire ce payement
foit exprimé, foit qu’il 11e le foit pas ; cette recon-
noiflànce met les marchands & ouvriers à couvert
de la fin de non-recevoir, & leur donne contre les
débiteurs une aéfion qui fubfifte trente années.
Partie d’apoticaire, eft le nom qu’on donne à des
mémoires enflés , & où les ouvrages ou marchandifes
font eftimés beaucoup au-delà de leur jufte valeur*
Parties Jimples, parties doubles, termes de marchands
, négocians, banquiers, teneurs de livres, &c.
Ils fe difent des différentes maniérés de tenir des livres
de commerce & de dreffer des comptes, broyer
C omptes , Livres de marchands, & c. diction,
de commerce.
Parties doubles , ( Comm. Fin. ) L’ordre des
parties doubles diftingue une recette d’une autre recette
, une dépenfe d’une autre dépenfe, l’argent des
autres effets, la nature &: le fort de ces divers effets.1
Chaque article dans les parties doubles, opéré toiit-
à-la-fois recette & dépenfe ; c’eft d’où elles prennent
leur nom : ainli il porte avec foi la vérification & Ta
balance. Quelqu’étendüe que l’on fuppofe à un
compte général, on peut en un inftant, & d’un
clin d’oeil, former un compte particulier du plus léger
article , en fuivant fon ifliie : compte qui fera lumineux
lans coûter des efforts & des recherches pénibles.
Dès-lors ilferoit poffible chaque jour, de compter
d’une caille, où tout l’argent du Royaume entrer
roit. Les Italiens ont imaginé ce bel ordre ; ils s’en
fervent même généralement dans le détail des biens
de campagne qu’ils font valoir : & fi l’on y prenoit
garde , par-tout- où il fe fait de grandes confomma-
tions, quelqu’immenfe qu’en fût le détail, il feroit
facile de fe procurer une connoiflance intime & journalière
de chaque emploi.
Pendant long-tems les négocians ont été les feuls
à adopter cet ufage, parce qu’il leur importe de con-
noître à chaque heure du jour leur fituation véritable.
,l| ■
P A R
,ble. Iis ferorent bien-tôt ruinés, 'fi leurs caifîi'efs ou
•comptables fe trouvoient chargés de débets inconnus*
ou s’ils pouvoient faire valoir à. leur infçu quelque
fomme jufqu’au moment de la reddition des comptes.
« Cette même exaélitude-, difoit en 1607 Simon
» Stevin de Bruges à M. de S u lly ,. n’eft pas moins
» intérefîante pour un prince> >>r Cependant fon ine-
.xécution dans,le maniment.des finances jufqu’à ce
jour, a prefque, réduit en problème cette queftion,
favoir fi entre deux points donnés-, la ligne droite
eft plus courte que la ligne courbe. ( D . J .)
Partie de Musique , eft le nom de chaque voix
ou mélodie féparée, dont la réunion forme l’harmonie
ou le concert. Pour conftituer un accord, il faut
au moins que deux fons fe faflent entendre à-la-fois;
ce qu’une feule voix ne fauroit faire. Pour former
une harmonie ou une fuite d’accords, il faut donc
plufièurs voix: le chant qui appartient à chacune de
ces voix, s’appelle partie, & la colle&ion de toutes
les parties s’appelle partition. Voyeç PARTITION.
. Comme un accord complet eft compofé de quatre
fons, il y a aufli dans la Mufique quatre parties principales*
dont la. plus aiguë s’appelle deffius , & fe
chante par des yoix de femmes * d’ehfans, ou de mu-
fici ; les trois autres font la haiite-contre , la taille&L la
"ba(Je, qui toutes appartiennent à des voix d’hommes.
On peut voir dans nos PI. de Mujiq. l’étendue de voix
de chacune de c es parties, & la cie qui lui appartient.
Les notes blanches montrent les fons pleins où chaque
partie peut arriver* tant en haut qu’en bas; &
les croches qui fuivent, montrent les fons où la voix
commencerUit à fe forcer, & qu’elle pe doit former
qu’en paîFant.
Plusieurs, tic ces parties fe fubdivifent en, deux,
quand on compoft à plus de rm.tre panï<2 Voyez
D essus;, T a il le ,.B a s se, V o ix .
, H y a auffi despariiss mitrailler)taies. Il y .a même
desinftrùqsïjs, comme Pojgupÿj^.daveffin', la yM g !
qui peuvent faire plufieuys.parties'à là.fois., Éngénés
ral Ou divile aufli la inühcjue înltruincntale en quatre/
■ um«, qui répondent à celles de la mufique
vocale, ik qui s’appellent , qùinK ,ià iÜ e ic
iaffi. On entr’Qtgîera aufli les clés & l’ftènduV. PI. i f
Mijiq. Mais il fauîremarqucr que la plupart des inï*
trumens n’ont ip'SS^ë lldrh'és' prëcifès -diiÿlfe'haut',’
& qu’on iss peut faire démancher aman: qu’on veut ’
aux dép^^clès- Off illes Ifa- auditeurs ; au lieu1 due
dans le bas ils ont un terme fixe qu’ils né fauroient
paner, tV çiîêefi la dote que j’a i marquée.
■ Il y a des ptu'm oui ne doiver.l être chantées que
par une iêule voix, ou jouées que par un feu: infiniment;
& celles-là s’appellent parties récitantes. D ’atp
tres^rijess’exécùtehtparpliffieutsperfonnes chafftant
ou jouant àPimiffon, & on, les appelle parties
de chaur.
On appelle encore partie, le papier de mufique
1111 leqiief eft écrite Impartie féparée de chaque mufi-
çien. Quelqùefois plufièurs chantent ou jouent , fur
le même papiêigî mais quand ils ont chacun le leur,
çe qui fê lait ordinairement dans les grandes mufi'
qués. ; on peutflire en ce fens; qu'il y a autant de
parties que de concertais. (\S )
. P a r t ie , {Écrit ) Ce mot eft aufli. eliirfage dans
1 eçntà^e pour exprimer,le vice Oïl la beauté d’un eâ-
ra£te|-e ; comme voilé de bonnes ou de mauvaifes
famés des. parties, maigi;»,, plates, pleines, bien
touchées, &c.
Parties similaires , ( Jard. ) font les parties
<1 »ne meme nature, tiffure & fubftance qui fe trouvent
dans une graine, telles que la cuticule , lé pa-
renchymg q y a chair, & la racine féminale.
Marnes iiffîmUàtrer, Ænt celles qui étant de'difii
i U y H H H r a a dè diverfes efper
ç e s , telles qii on lès remarque dans une plantera-
lome X I I . r *
P A R roj
T°îr » tâcine, le tronc, les feuilles,, les fleurs & ie s
rrmts. -
telles que la tige intérieure & l’écorce.
- .Partie oE iEu. c’efb une,c9TOention eii èoaté*
: quencedelaquelle le jeu finit ; & celui quife trouve
: dors avoir 1 avantage , marque Sc gagne. La partie
eit compolee dün certain.nombre detolterde jeüx.
de points; de coups, frc. Ainfi au billard la »cm. eft
I Ordinairement de.feize pioints , à monis mi’un des
, joueurs, o utous its deux, ne fe foient inteniit <;u:’l-
ques-uns dés coups ordinaires du jeu de billard au-
quel cas la-partie n’eft que dé douze points.
Au triélrac la partie eft de douze coups.
Au piquet, de cent pointé-, : ?
Au piquet à écrire, de vingt-qüatrè rois.
PARTIL,adj. ( Afirol.) Ceterme,enAftroloeie; ie dit d un afpeft qui eft dans h degré précifément
qui forme 1 alpeél. Ün trine partit, fe dit de celui
de i2o degres.Le foleil, par exemple, eft en trine
parut de la lune, lorfqu’il eft au douzième degré
du Lion, & que la Lune eft au douzième degré du
sagittaire ou d’Ariès; parce .que dans l’un &; dans
1 autre cas , ils font éloignés l’un de l’autre de 120
degrés , qui eft juftement la tierce partie du zodiaque,
ce qui forme par conféquent le trine parfait Sc
partit. r
Le qiiadrdt pdrtil fe fait lorfque deux aftres font
precifement éloignés l’un de i’autre de 90 degrés-.
Le lextil, lorfqu’ité font éloignés de 60 degrés.°
Voppofition partile fe fait lorfqu’ils font diftans de
la moitié du cercle, c’eft-à-dire, de 180 degrés ; &
la conj onction partile , lorfqu’ils font précifément au
meme degre du zodiaque. Les Aftrologues ne laif-
fent pas de nommer tous les afpefts panils, lorfqu’ils
ne font éloignés de la précifiôn que de trois où quatre
degres, principalement lorfque la plus véloce des
planètes applique à l’autre. Trévoux. ( D. J .)
PARTIR, v. n. ( Gram. ) Ce verbe, relatif à là
tranflation d’un lieu fixé dans un autre , a ün errand
nombre d acceptions. Ainfi l’on dit , les couriers
partent h différens joürs & à différentes heures, félon
les differens lieux de leur deftination. J’eftime peu la
vie , je ne crains ni la mort ni fes fuites : je fuis toujours
prêt à partir. Cet homme part dé la main, il n’y
a qu’à lui faire figne. Lâchez là bride à ce cheval,
& il partira fur le champ. Il prerid fon fufil, le coup
part, & l’homme eft iriôrt. Toutes ces idées partent
d’un cerveau creux. Cet ouvrier ne laiflé pas partir
fon ouvrage de fon attelier qu’il ne foit parfait, ni cè
cdmmerçânt la marchandife dé fa boutique qu’elle ne
foit bien payée. Partes, dit le maître en Fait-d’ar-
mes àfon écolier. Le carrier qui fépare la pierre
avec le marteau & le coin, la fait partir du coup
qui la fend. Ils ont toujours maille à partir, ou ils
le querellent pour des riensi Partir en Blafon, voyez
Pa r t i . v
Ce cheval a le partir prompt, il a de la grâce au
partir. Ces muficiens ne font pas partis enfemble j
& cela a fait un très-mauvais effet. Il y a éii un tems
ou lorfqu il arrivoit à nos Muficiens de partir à tems
& de rencontrer l’accord , c’étôit lin hàfard fi heureux
, qu’ils en étoient tout émerveillési
P ARTISAN m. ( Gramni.) Celui quiaembrafle
le parti de quelqu’un ou de quelque chofe ; il y eut
un tems ou 1 on penla traiter ici les partifans de1 la
mufique italienne comme des criminels d’état. Chaque
auteur a fes partifàhs. Je fuis grand partifan des
anciens ; mais cela ne m’empêche pas dé rendre juf-
tice aux modernes , & je ne brûle point la Jérufalem
délivrée aux piés de la ftatue de Virgile, ni-la Hen-
riade aux piés de la ftatue d’Homere.
Partisan , f. m. c’eft dans la guerre , un officier
qui commande im détachement de troupes pour, la