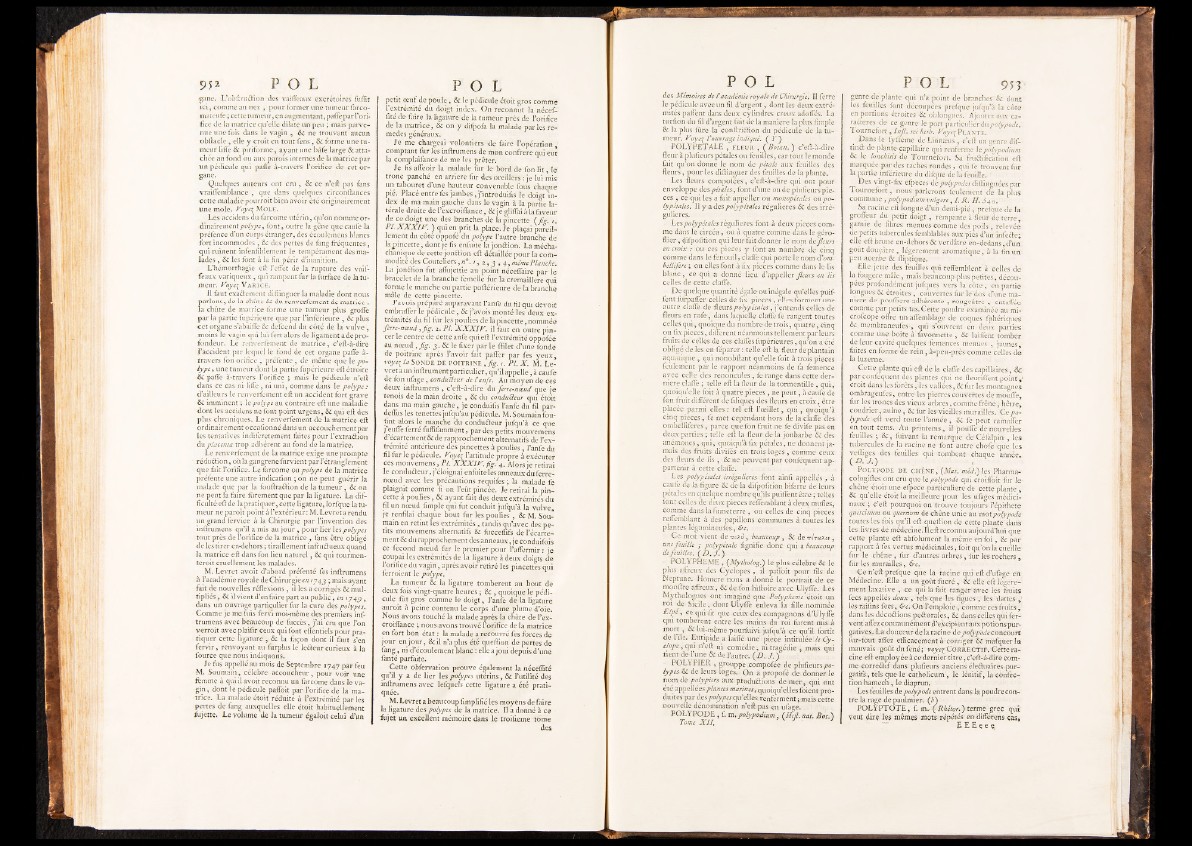
^gane. L’obftruâion des vaifléaux excrétoires fuftit
ic i, comme au nez , pour former une tumeur farco-
mateufe ; cette tumeur, en augmentant, paffe par l’orifice
de la matrice qu’elle dilate un peu ; mais parvenue
une fois dans le vagin , & ne trouvant aucun
•obftacle , elle y croît en tout l'ens, & forme une tumeur
liffe & piriforme, ayant une bâfe large & attachée
au fond ou aux parois internés de la matrice par
lin pédicule qui paffe à-travers l’orifice de cet organe.
Quelques auteurs ont crtt, & ce n’eft pas fans
vraiffemblance , que dans quelques circonftances
cette maladie pourroit bien avoir été originairement
Une mole. Voye{ Mo l e .
Les accidens du farcome utérin, qu’on nomme ordinairement
polype, font, outre la gêne que caul'e la
préfence d’un corps étranger, des écoulemens blancs
fort incommodes , & des pertes de fang fréquentes,
qui ruinent infenfiblement le tempérament des malades
, & les font à la fin périr d’inanition.
L’hémorrhagie eft l’effet de la rupture des vaif-
feaux variqueux, qui rampent fur la furface de la tumeur.
Voye^ V a r ic e .
Il faut exa&ement diftinguer la maladie dont nous
parlons, de la chute & du renverfement de matrice :
la chute de matrice forme une tumeur plus groffe
par la partie fupérieure que par l’inférieure , & plus
cet organe s’abaiffe & defcend du côté de la vulve ,
moins le vagin qui lui fert alors de ligament a de profondeur.
Le renverfement de matrice, c’eft-à-dire
l ’accident par lequel le fond de cet organe paffe à-
travers fon orifice , préfente, de même que le polype
, une tumeur dont la partie fupérieure eft étroite
& paffe à-travers l’orifice j mais le pédicule n’eft
dans ce cas ni liffe , ni uni, comme dans le polype :
d’ailleurs le renverfement eft un accident fort grave
& imminent ; le polype au contraire eft une maladie
dont les accidens ne font point urgens, & qui eft des
plus chroniques. Le renverfement de la matrice eft
ordinairement occafionné dans un accouchement par
les tentatives indifcretement faites pour l’extraôion
du placenta, trop adhérent au fond de la matrice.
Le renverfement de la matrice exige une prompte
réduâion, oii la gangrené furvient par l’étranglement
que fait l’orifice. Le farcome ou polype de la matrice
préfente une autre indication ; on ne peut guérir la
malade que par la fouftraftion de la tumeur, & on
ne peut la faire furement que par la ligature. La difficulté
eft de la pratiquer, cette ligature, lorfque la tumeur
ne paroît point à l’extérieur: M .Levretarendu
un grand fervice à la Chirurgie par l’invention des
inftrumens qu’il a mis au jour , pour lier les polypes
tout près de l’orifice de la matrice , fans être obligé
de les tirer en-dehors ; tiraillement infruéhieux quand
la matrice eft dans fon lieu naturel, & qui tourmen-
teroit cruellement les malades.
M. Levret avoit d’abord préfenté fes inftrumens
à l’académie royale de Chirurgie en iy43 ; mais ayant
fait de nouvelles réflexions , il les a corrigés & multiplies
, & il vient d’en faire part au public, en /740,
dans un ouvrage particulier fur la cure des polypes.
Comme je me fuis fervi moi-même des premiers inftrumens
avec beaucoup de fuccès, j’ai cru que l’on
verroit avec plaifir ceux qui font effentiels pour pratiquer
cette ligature, & la façon dont il faut s’en
fervir, renvoyant au furplus le letteur curieux à la
fource que nous indiquons.
Je fus appellé au mois de Septembre 1747 par feu
M. Soumain, célébré accoucheur, pour voir une
femme à qui il avoit reconnu un farcome dans le va- ;
gin, dont le pédicule paffoit par l’orifice de la matrice.
La malade etoit réduite à l’extrémité par les
pertes de fang auxquelles elle étoit habituellement
ïujette. Le yolume de la tumeur égaloit celui d’un
petit oeuf de poule, & le pédicule étoit gros comme
l’extrémité du doigt index. On reconnut la nécef-'
lité de faire la ligature de la tumeur près de l’orifice
de la matrice, & on y dilpofa la malade par les re-
medes généraux.
Je me chargeai volontiers de faire Popération I
comptant fur les inftrumens de mon confrère qui eut
la complaifance de me les prêter.
Je fis affeoir la malade fur le bord de fon l i t , le
tronc panché en arriéré fur des oreillers : je lui mis-
un tabouret d’une hauteur convenable fous chaque
pié. Placé entfe fes jambes, j’introduifis le doigt index
de ma main gauche dans le vagin à -la partie latérale
droite de l’excroiflànce, & je gliffai à la faveur
de ce doigt une des branches de lapincette (/g-. /.
PL X X X IV . ) qui en prit la place. Je plaçai pareillement
du côté oppofé du polype l’autre branche de
la jfincette, dont je fis enfuite la jon&ion. La mécha-
chanique de cette jonttion eft détaillée pour la commodité
des Couteliers, n°. /, 2 , 3 , 4 , même Planche.
La jon&ion fut affujettie au point néceffaire par le
bracelet de la branche femelle fur la cremaillere qui
forme le manche ou partie poftérieure de la branche
mâle de cette pincette.
Pavois préparé auparavant l’anfe du fil qui devoir
embraffer le pédicule, & j’avois monté les deux extrémités
du fil fur les poulies de lapincette,nommée
ferre-noeud, fig. 2. PL X X X IV . il faut en outre pincer
le centre de cette anfe qui eft l’extrémité oppofée
au noeud , fig. 3. & le fixer par le ftilet d’une fonde
de poitrine après l’avoir fait paffer par fes yeux,
voye{ la So n d e d e p o it r in e ,fig. 1. Pi. X. M. Levret
a un infiniment particulier, qu’il appelle, à caufe
de fon ufage, conducteur de Confie. Au moyen de ces
deux inftrumens , c’eft-à-dire du fierre-nceud que je
tenois de la main droite , & du conducteur qui étoit
dans ma main gauche, je conduifis l’anfe du fil par-
deffus les tenettes jufqu’au pédicule. M. Soumain fou-
tint alors le manche du condutteur jufqu’à ce que
j euffe ferre fuffifamment, par des petits mouvemens
d’écartement & de rapprochement alternatifs de l’extrémité
antérieure des pincettes à poulies, l’anfe du
fil fur le pédicule. Voye^ l’attitude propre à exécuter
ces mouvemens, Pl. X X X IV . fig. 4. Alors je retirai
le conducteur, j’éloignai enfuite les anneaux du ferre-
noeud avec les précautions requifes ; la malade fe
plaignit comme fx on l’eût pincée. Je retirai la pincette
à poulies, & ayant fait des deux extrémités du
fil un noeud fimple qui fut conduit jufqu’à la vulve,
je renfilai chaque bout fur les poulies , & M. Soumain
en retint les extrémités , tandis qu’avec des petits
mouvemens alternatifs & fucceffifs de l’écartement
& du rapprochement des anneaux, je conduifois
ce fécond noeud fur le premier pour l’affermir : je
coupai les extrémités de la ligature à deux doigts de
l’orifice du vagin, après avoir retiré les pincettes qui
ferroient le polype.
La tumeur & la ligature tombèrent au bout de
deux fois vingt-quatre heures ; & , quoique le pédicule
fût gros comme le doigt, l’anfe de la ligature
auroit à peine contenu le corps d’une plume d’oie.
Nous avons touché la malade après la chute de l’ex-
croiffance ; nous avons trouvé l’orifice de la matrice
en fort bon état : la malade a recouvré fes forces de
jour en jour, & i l n’a plus été queftion de pertes de
fang , ni d’écoulement blanc : elle a joui depuis d’une
fanté parfaite.
Cette obfervation prouve également la néceflïté
qu’il y a de lier les polypes utérins, & l’utilité des
inftrumens avec lefquels cette ligature a été pratiquée.
M. Levret a beaucoup fimplifîé les moyens de faire
la ligature des polypes de la matrice. Il a donné à ce
fujet un excellent mémoire dans le troiûeme tôme
des
des Mémoires de Vacadémie royale de Chirurgie. Il ferre
le pédicule avec un fil d’argent, dont les deux extrémités
paffent dans deux cylindres creux adoffés. La
torfion du fil d’argent fait de la maniéré la plus fimple
& la plus fûre la conftriérion du pédicule de la tumeur.
Voye{ l'ouvrage indiqué.
POLYPÉTALE , f l e u r , ( Botan. ) c’eft-à-dire
fleur à plufieurs pétales ou feuilles, car tout le monde
fait qu’on donne le nom de pétale aux feuilles des
fleurs, pour les diftinguer des feuilles de la plante.
Les fleurs compofées, c’eft-à-dire qui ont pour
enveloppe des pétales, font d’une ou de plufieurs pièces
, ce qui les a fait appeller ou monopètales ou po-
lypétales. Il y a des poly pétales régulières & des irrégulières.
Les poly pétales régulières font à deux pièces comme
dans le circéa, ou à quatre comme dans le géro-
flier, difpofition qui leur fait donner le nom defieurs
en croix : ou ces pièces y font au nombre de cinq
comme dans le fenouil, claflè qui porte le nom dW-
bellifiere ; ou elles font à fix pièces comme dans le lis
blanc, ce qui a donné lieu d’appelier fieurs en lis
celles de cette claffe.
De quelque quantité égale où inégale qu’elles pitif-
fent furpaffer celles de fix pièces, elles forment une
autre claffe de fleurs poly pétales, j’entends celles de
fleurs en rofe, dans laquelle claffe fe rangent toutes
celles qui, quoique du nombre de trois, quatre, cinq
ou fix pièces, different néanmoins tellement parleurs
fruits de celles de ces claffés fupérieures, qu’on a été
obligé de les en féparer : telle eft la fleur de plantain
aquatique , qui nonobftant qu’ elle foit à trois pièces :
feulement par le rapport néanmoins de fa femence
avec celle des renoncules ., fe range dans cette dernière
claffe ; telle eft la fleur de la tormentille , qui,
quoiqu’elle foit à quatre pièces, ne peut, à caufe de
fon fruit différent de filiques des fleurs en croix, être
placée parmi elles : tel eft l’oeillet, qui * quôiqli’à
cinq pièces, fe met cependant hors .de la claffe des
ombelliferes, parce que fon fruit ne fe divife pas en
deux parties ; telle eft la fleur de la jonbarbe & des
anémones, qui, quoiqu’à fix pétales, ne donnent jamais
des fruits divifés en trois loges , comme ceux
.des fleurs de lis , & ne peuvent par conféquent appartenir
à cette claffe.
Les poly pétales irrégulières font ainfi ap peliés,à
caule de la figure & de la difpofition bifarre de leurs
pétales en quelque nombre qu’ils puiffent être ; telles
font celles de deux pièces reffemblant à deux mufles,
comme dans la fumeterre , ou celles de cinq pièces
reffemblant à des papillons communes à.toutes.les
plantes légumineufes, &c. .. _
' C e mot vient de wo^ir, beaucoupi, & de mretXàf j
unefieuille ; poly pétale lignifie donc qui a beaucoup
de fieuilles. ( Z>. /. )
| POLYPHEME ,.(Mythologé) le pluscélebre & le
plus affreux des Cyclopes ii paffoit pour fils de
Neptune. Homere nous a donné le portrait, de ce
monftre affreux, & de fondiiftoire avec lilyffe. Les
Mythologues ont imaginé que Polyphénie etoit un
roi d e Sicile , dont Ulyflè enleva la fille .'nommée
Elpe^ ce:qui fit que ceux des .compagnons d’Ulyffe
qui tombèrent entre les mains du roi furent mis: à
mort, •& lui-même pourfuivi jufqu’à ce qu’il foftît
de l’ile. Euripide a laiffe. une piecé intitulée lie Cy-
clope, qui n’eft ni comédie * ni tragédie > mais qui
tient de l’une & de l’autre: j(D . J. ), -
POLYPIER , grouppe ;compofée de .plnfieurs/’o-
lypes & de leurs loges. , On à propofé de donner le
nom. dè polypiers aux^pfoduaions de mer, qui ont
été appel!ées plantes /^ri/ze5Vq,Uoiqu’ellesfoient produites
par despolypesqxi’elles renferment;;mais cette
nouvelle dénomination n’eft pas en ufage., :
POLYPODE , f. m. polypodium, (Hï(l. nat. Bot.')
Tome X I I . J J
genre déplanté qui n’a point de branches & dont
les feuilles font decoupeës prefque jufqu’à la côte
en portions étroites & oblongues. Ajoutez aux caractères
de ce genre le port particulier dupolypode.
Tourhefort, lujt. rei herb. Voye^ Plante.
Dans le lyftème de Linnæus , c’eft un genre dif-■
tinét de plante capillaire qui renferme le poly podium
& le lonchitis Üe Tournefort. Sa fructification eft
marquée par des taches rondes, qui fe trouvent fur
la partie inférieure du difqïie de la feuille. '
Des vingt-fix efpeces de polypodes diftinguées par
Tournefort , nous parlerons feiilemênt de la plus
commune , poly podium vulgare, /. R. H. 640.
Sa racine eft longue d-’im demi-pié, prefque de la
groffeur du petit doigt , rompante à fleur de terre,
garnie de fibres menues comme des poils , relevée
de petits tubercules femblables aux pies d’un infeCte;
elle eft brune en-dehors & verdâtre en-dedans, d’un
goût douçâtre, légèrement aromatique, à la fin un
peu acerbe & ftiptique.
Elle jette des feuilles qui reffemblent à celles de
la fougere mâle, mais beaucoup-pluspetites, découpées
profondément jufques vers la cô te, en partie
longues & étroites , couvertes fur le dos d’une maniéré
de poufliere adhérente , rougeâtre , entaffée
comme par petits tas. Cette poudre examinée âû mi-
crofcope offre un affemblage de coques fphériques'
& membraneufes-, qui s’ouvrent en deux parties
comme une boite à iavonnette , & laiflènt tomber
de leur cavité quelques femencés menues ,' jaunes,
faites .en forme de rein, à-peu-près comme celles de
la luzerne-. •
Cette plante qui eft de la claffe des capillaires, &■
par conféquent des plantes qui ne fleuriflènt point , 1
croit dans les forets ,'les vallees, & fu r les montagnes
ombrageufes, entre les pierres couvertes dé moufle,
fur les troncs des vieux arbres, comme frênè, hêtre,
coudrier, aulne, & fur les vieilles murailles. Ce polypode
eft verd touteTannée, & fe peut rahiaffer
en tout tems. Au printems, il poiïffé de nouvelles
feuilles ; & , fuivant la remarque de Céfalpin , les
tubercules de la racine ne font autre chofe que les
veftiges des-feuilles qui tombent chaque année.
(D./,),v ’ | |
Polypode de CHÊNEy '(Mdr. méd!) les Pharma-
cologiftes ont cru que le polypode qui croiffoit fur le-
chêne étoit une efpece particulière de cette plante ,
& qu’elle étoit la meilleure pour les ufages médicinaux
; c’eft pourquoi on trouve toujours l’épïthete
qiurcinumow quernumde chêne unie au mot polypode
toutes les fois qu’il eft queftion de cette planté dans
les livres de médecine. Ileft reconnu aujourd’hui que
cette plante eft abfolument la même en fo i , & par
rapport à'fes vertus médicinales, foit qu’on la cueille
fiir le Chêne , fur d’autres arbres, fur les.rbchers ,
fur les murailles, &c.
Ce n’eft prefque: que la racine qui eft d’ufage en
Médecine.'Elle a un goût fucré , & elle eft légèrement
laxative ,. ce qui la fait ranger-'iaVec- les fruits
fecs appellés doux, tels quë-les figues 'y les dattes-,:
lés foifins focs, 6*c..'On-l’emploie, comme césfruits,
dans les décodions peûorales, & dans Celles qui fervent
affez communément d^excipientàiixpotions purgatives^
La douceur de la racine de polypode concourt
hir-tout affez efficacement à; corriger ôê xn'âfquer la
mauvais goût du fené; voye( Co r rect if, Cette racine
eft: employée àce dernier titre, c’eft-à-dire comme
correâif dans plufieurs anciens éle&uairës-purgatifs,
tels que le càtholicum', Je lénitif, la eOnfec-
tion hamech , le diaprum -
Les feuilles de polypode entrent dans la poudre contre
la rage de paulmieri- (b')
POLYPTO TE , f. m.- fiRhétor.') terme grec qui
veut çlirç les mêmes mots répétés en différons cas,
E E E e e q