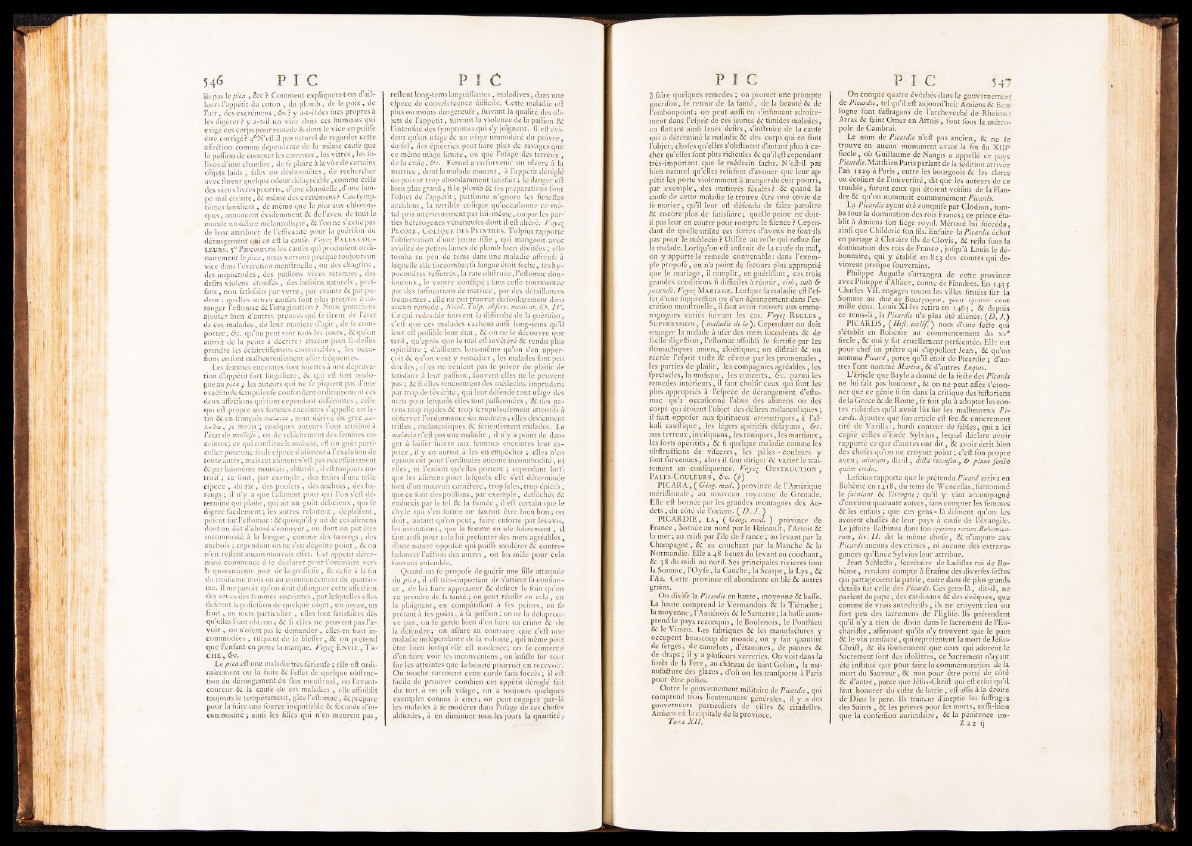
ils pas le pica , 6cc ? Comment expliquera-t-on d’ailleurs
l’appétit du coton , du plomb, de la poix, de
l’a ir , des excrémens , &c) y a-t-il des lues propres à
les digérer ? y a-t-il un vice dans ces humeurs qui
exige ces corps pour remede 6c dont le vice en puifle
être corrigé? 4°N’eft-il pas naturel de regarder cette
affeélion comme dépendante de la même caufe que
la paffion de compter les carreaux, les v itres, les fo-
lives d’une chambre, de le plaire à la vue de certains
objets laids , laies ou déshonnêtes, de rechercher
avec fureur quelque odeur defagreable, comme celle
des vieux livres pourris, d’une chandelle, d’une lampe
mal éteinte, & même des excrémens? Ces fymp--
tomes familiers , de même que le plca aux chlorotiques,
annoncent évidemment 6c de l’aveu de tout le
monde un délire mélancolique, 6c l’on ne s’avile pas
de leur attribuer de l’efficacité pour la guérifon du
dérangement qui en eft la caufe. Foye\ Pales couleurs.
50 Parcourons les caufes qui produifent ordinairement
lepica, nous verrons prelque toujours un
vice dans l’excrétion menftruelle , ou des chagrins ,
des inquiétudes , des pallions vives retenues , des
defirs violens étouffés , des befoins naturels , pref-
fans , non fatisfaits par vertu, par crainte 6c par pudeur
; quelles autres caufes font plus propres à déranger
l’eftomac 6c l’imagination ? Nous pourrions
ajouter bien d’autres preuves qui fe tirent de l’etat
de ces malades, de leur maniéré d’agir, de fe comporter
, &c. qu’on peut voir tous les jours, 6c qu’on
auroit de la peine à décrire : chacun peut là-defliis
prendre les éclairciffemens convenables , les occa-
fions en font malheureufement allez fréquentes.
Les femmes enceintes font fujettes à une dépravation
d’appétit fort finguliere, 6c qui eft fort analo-,
gue au pica ; lés auteurs qui ne fe piquent pas d'une
exaditude fcrupuleufe confondent ordinairement ces
deux affeftions qui font cependant différentes ; celle
qui eft propre aux femmes enceintes s’appelle en latin
6c en frànçois malacia , nom dérivé du grec /jlcl-
Aa-9-w, je moilis ; quelques auteurs l’ont attribué à
l’état de molleffe, ou de relâchement des femmes enceintes;
ce qui conftitue \e malacia, eft un goût particulier
pour une feule efpece d’aliment à l’exclufion de
toute autre ; mais cet aliment n’eft pas néceffairement
6c par lui-même mauvais, abfurde, il eft toujours nutritif
; ce font, par exemple , des fruits d’une telle
efpece , du riz , des poulets , des anchois, des harengs
; il n’y a que l’aliment pour qui l’on s’eft déterminé
qui plaife, qui ait un goût délicieux, qui fe
digéré facilement ; les autres rebutent, déplailent,
pefent fur l’eftomac : 6cquoiqu’il y ait de ces alimens
dont on dût d’abord s’ennuyer, ou dont on pût être
incommodé à la longue , comme des harengs, des
anchois ; cependant on ne s’en dégoûte point, 6c on
n’en relient aucun mauvais effet. Cet appétit déterminé
commence à fe déclarer pour l’ordinaire vers
le quarantième jour de la groffelfe, 6c celfe à la fin
du troifiemejnois ou au commencement du quatrième.
11 me paroît qu’on doit diftinguer cette affeétion
des envies des femmes enceintes , par lefquelles elles
défirent lapofi'eflion de quelque objet, un joyau, un
fru it, un mets particulier , elles font fatisfaites dès
qu’elles l’ont obtenu ; 6c fi elles ne peuvent pas l’avoir
, ou n’ofent pas le demander , elles en font incommodées
, rifquent de fe bleffer, & on prétend
que l’enfant en porte la marque. Voye[ Envie , T ac
h e , &c.
Le pica eft une maladie trës-férieufe ; elle eft ordinairement
ou la fuite 6c l’effet de quelque obftruc-
tion du dérangement du flux menftruel, ou l’avant-
coureur 6c la caufe de ces maladies , elle affoiblit
toujours le tempérament, gâte l’eftomac, 6c prépare
pour la fuite une fource inépuifable 6c féconde d’in-
çommodité ; ainfi les filles qui n’en meurent pas,
reftent long-tems languiflantes, maladives, dans une
efpece de conv,alefcqnce difficile. Cette maladie eft
plus ou moins dangereufe , fuivant la qualité des objets
de l’appétit, fuivant la violence de la paffion 6c
l’intenfité des l'ymptomes qui s’y joignent. 11 eft évident
qu’un ufage 6c un ufage immodéré du poivre,
du f e l, des épiceries peut faire plus de ravages que
ce même ufage limité, ou que l’ufage des terreux ,
de la craie, &c. Fernel a vufurvenir un ulcéré à la
matrice , dont la malade mourut, à l’appétit déréglé
du poivre trop abondamment fatisfait ; le danger eft
bien plus grand, fi le plomb 6c fes préparations font
l’objet de l’appétit ; perfonne n’ignore les funeftes
accidens, la terrible colique qu’occafionne ce métal
pris intérieurement par lui-même, ou par les parties
hétérogènes véneneufes dont il eft altéré. Foyer
Pl o m b , C o l iq u e d e s P e in t r e s . Tulpius rapporte
l’obfervation d’une jeune fille , qui mangeoit avec
avidité de petites lames de plomb bien divilées ; elle
tomba en peu de tems dans une maladie affreufe à
laquelle elle fuccomba ; fa langue étoit feche, fes hy-
pocondres refferrés, la rate obftruée, l’eftomac dou-
' loureux, le ventre conftipé ; fans ceffe tourmentée
par des fuffocations de matrice, par des défaillances
fréquentes , elle ne put trouver du foulagement dans
aucun remede , Nicol. Tulp. obferv. medicar. lib. IF .
Ce qui redouble fouvent la difficulté de la guérifon,
c’eft que ces malades cachent auffi* long-tems qu’il
leur eft poffible leur état, 6c on ne le découvre que
tard, qu’après que le mal eft invétéré 6c rendu plus
opiniâtre ; d’ailleurs lors-même qu’on s’en apper-
çoit 6c qu’on veut y remédier, les malades font peu
dociles, elles ne veulent pas fe priver du plaifir de
fatisfaire à leur paffion, fouvent elles ne le peuvent
pas ; 6c fi elles rencontrent des médecins imprudens'
par trop de févérité., qui leur défende tout ufage des
mets pour lefquels elles font pafîionnées, 6c des pare
ns trop rigides 6c trop fcrupuleufement attentifs à
obferver l’ordonnance du médecin, elles deviennent
triftes , mélancoliques 6c férieufement malades. Le
malacia n’ eft pas une maladie , il n’y a point de danger
à laifler fiiivre aux femmes enceintes leur caprice
, il y en auroit à les en empêcher ; elles n’en
éprouvent pour l’ordinaire aucune incommodité, ni
elles, ni l’enfant qu’elles portent ; cependant lorf-
que les alimens pour lefquels elle s’eft déterminée
font d’un mauvais carariere, trop fales, trop épicés,
que ce font des poiflons, par exemple, defiéenés 6c
endurcis par le fel 6c la fumée , il eft certain que le
chyle qui s’en forme ne fauroit être bien bon ; on
doit, autant qu’on peut, faire enforte par les avis,
les invitations, que la femme en ufe fobrement, il
faut auffi pour cela lui préfenter des mets agréables ,
d’une nature oppofée qui puifle modérer & contrebalancer
l’a&ion des autres , on les mêle pour cela
fouvent enfemble.
Quand on fe propofe de guérir une fille attaquée
du pica, il eft très-important de s’attirer fa confiance
, de lui faire approuvér 6c defirer le foin qu’on
va prendre de fa fanté ; on peut réuffir en cela, en
la plaignant, en compâtilfant à fes peines, en fe
prêtant à fes goûts, à fa paffion ; on ne la défaprou-
ve pas, on fe garde bien d’en faire un crime 6c de
la défendre; on aflure au contraire que c’eft une'
maladie indépendante de la volonté, qui même peut
être bien lorfqu'elle eft modérée; on fe contente
d’en.faire voir les inconvéniens, on infifte fur tout
fur les atteintes que la beauté pourroit en recevoir.
On touche rarement cette corde fans fuccès ; il eft
facile de prouver combien cet appétit déréglé fait
du tort à un joli vifage, on a toujours quelques
exemples connus à citer; on peut engager par-là
les malades à fe modérer dans l’ufage de ces chofes;
abfurdes, à en diminuer tous les jours la quantité,-
à faire quelques remedes ; On promet une prompte
guérifon, le retour de la fanté, de la beauté 6c de
l’embonpoint ; on peut auffi en s’infinuant adroitement
dans l’efprit de ces jeunes 6c timides malades,
en flattant ainfi leurs defirs, s’inftruire de la caufe
qui a déterminé la maladie 6c des corps qui en font
l’objet ; chofes qu’elles s’obftinent d’autant plus à cacher
qu’elles font plus ridicules 6c qu’il eft cependant
très-important que le médecin fâche. N ’eft-il pas
bien naturel qu’elles refufent d’avouer que leur appétit
les porte violemment à manger du cuir pourri,
par exemple, des matières fécales ? 6c quand la
caufe de cette maladie fe trouve être une envie de
fe marier, qu’il leur eft défendu de faire paroître
& encore plus de fatisfaire ; quelle peine ne doit-
il pas leur en coûter pour rompre le filence ? Cependant
de quelle utilité ces fortes d’aveux ne font-ils
pas pour le médecin ? Utilité au refte qui reflue fur
la malade. Lorfqu’ôn eft inftruit de la caufe du mal,
on y apporte le remede convenable : dans l’exemple
propofé, on n’a point de fecours plus approprié
que le mariage, il remplit, en guérifîant, ces trois
grandes conditions fi difficiles à réunir, citb, tutb &
jucundè. Foyei^ M a r i a g e . Lorfque la maladie eft l’ effet
d’une fuppreflion ou d’un dérangement dans l’excrétion
menftruelle, il faut avoir recours aux emme-
nagogués variés fuivant les cas. Foyeç R é g l é s ,
S u p p r e s s i o n , ( maladie delà'). Cependant on doit
engager la malade à ufer des mets fucculents 6c de
facile digeftion, l’eftomac affoibli fe fortifie par les
ftomachiques amers, aloétiques; on diftrait & on
récrée l’efprit trifte 6c rêveur par les promenades,
les parties de plaifir, les compagnies agréables, les
•fpeélacles, la mufique, les concerts, &c. parmi les
remedes intérieurs, il faut choifir ceux qui font les
plus appropriés à l’efpece de dérangement d’ efto-
mac qu’a occafionné l’abus des alimens ou des
corps qui étoient l’objet des délires mélancoliques ;
il faut oppofer aux fpiritueux aromatiques, à l’ai-
kali cauftique, les légers apéritifs délayans, &c:
aux terreux, invifquans, les toniques, les martiaux,.
les forts apéritifs ; 6c fi quelque maladie comme les
obftrudions de vifcereS, les pâles - couleurs y
font furvenues, alors il faut diriger 6c varier le traitement
en conféquence. Foye^ O b s t r u c t i o n ,
P a l e s -C o u l e u r s , &c. ( b)
PICARA, ( Géog. mod. ) province de l’Amérique
méridionale, au nouveau royaume de Grenade.
Elle eft bornée par les grandes montagnes des Au-
dets, du côté de l’orient. ( D . J. )
PICARDIE, l a , ( Géog. mod. ) province de
France, bornée au nord par le Hainault, l’Artois 6c
la mer; au midi par l’île de France ; au levant par la
Champagne, 6c au couchant par la Manche 6c la
Normandie. Elle a 48 lieues du levant aii couchant,
6c 38 du midi au nord. Ses principales rivières font
la Somme, l’O y fe , la Cauche, la Scarpe, la Lys , 6c
l’Aa. Cette province eft abondante en blé 6c autres
grains.
On divife la Picardie en haute, moyenne & bafle.
La haute comprend le Vermandois 6c la Tiérache ;
la moyenne, l’Amiénois 6c le Santerre; la bafle comprend
le pays reconquis, le Boulenois, le Ponthieu
6c le Vimeu. Les fabriques 6c les manufa&ures y
occupent beaucoup de monde; on y fait quantité
de ferges, de camelots, d’étamines, de pannes 6c
de draps ; il y a plufieurs verreries. On voit dans la
forêt de la Fere, au château de faint Gobin, la manufacture
des glaces, d’où on les tranfporte à Paris
pour être polies.
Outre le gouvernement militaire de Picardie, qui
comprend trois lieutenances générales, il y a des
gouverneurs particuliers de villes 6c citadelles.
Amiens eft la capitale de la province.
Tome X I I ,
On Compté quatre évêchés dans le gouvernement
de Picardie, tel qu’il eft aujourd’hui: Amiens 6c Boulogne
font fuffragans de l’archevêché de Rheims :
Arras & faint Orner en Artois, font fous la métropole
de Cambrai.
Le nom de Picardie n’eft pas ancien, 6c ne fe
trouve en aucun monument avant la fin du XIIIe
fiecle, où Guillaume de Nangis a appelle ce pays
Picardie. Matthieu Paris parlant de la (édition arrivée
l’an 1219 à Paris , entre les bourgeois & les clercs
ou écoliers de l’univerfité, dit que les auteurs de ce
trouble, furent ceux qui étoient voifins de la Flandre
6c qu’on nommoit communément Picards.
La Picardie ayant été conquife par C lodion, tomba
fous la domination des rois Francs; ce prince-établit
a Amiens fon fiege royal. Méroué lui fùccéda ,
ainfi que Childeric fon fils. Enfuite la Picardie échut
en partage à Clotaire fils de Clovis, 6c refta fous la
domination des rois de France , jufqu’à Louis le débonnaire,
qui y établit en 823 des comtes qui devinrent
prelque fouverains.
Philippe Augufte s’arrangea de cette province
avec Philippe d’Alface, comte de Flandres. En 143 $
Charles Vil. engagea toutes les villes fituées fur la
Somme au duc de Bourgogne, pour quatre cent
mille eeus. Louis XI les retira en 1463 , 6c depuis
ce tems-là, la Picardie n’a plus été aliénée. (D . /.)
^ PICARDS, ( Hijl. eccléf. ) nom d’une fe£te qui
s’établit en Bohème au commencement du xv*
fiecle, 6c qui y fut cruellement perfécutée. Elle eut
pour chef un prêtre qui s’appelloit Jean, & qu’on
nomma Picard, parce qu’il etoit de Picardie ; d’autres
l’ont nommé Martin, & d’autres Loquis.
L’article que Bayle adonné de la fefte des Picards
ne lui fait pas honneur, 6c on ne peut aflez s’étonner
que ce génie fi fin dans la critique des hiftoriens
de la Grece 6c de Rome, fe foit plu à adopter les contes
ridicules qu’il a voit lus fur les malheureux Picards.
Ajoutez que fon article eft fec & entièrement
tiré de Varillas, hardi conteur de fables, qui a ici
copié celles d’Enée Sylvius, lequel déclare avoir
rapporté ce que d’autres ont dit, & avoir écrit bien
des chofes qu’on ne croyoit point ; c’eft fon propre
aveu ; aliorurn , dit-il, dicta recenfeo , & plura feribo
qnàm credo;
Lafitius rapporte que le prétendu Picard arriva en
Bohème en 1418, du tems de W enceflas, furnommé
le fainéant 6c l’ivrogne ; qu’il y vint accompagné
d’environ quarante autres, fans compter les femmes
6c les enfans ; que ces gens - là difoient qu’on les
avoient chafles de leur pays à caufe de l’évangile.
Le jéfuite Balbinus dans fon epitome rerum Bohemica-
rum> l iv .l l. dit la même chofe, & n’impute aux
Picards aucuns des crimes , ni aucune des extravagances
qu’Enée Sylvius leur attribue.
Jean Schlefta , fecrétaire de Ladiflas roi de Bohème
, rendant compte à Erafme des diverfes fe&es
qui partageoient la patrie, entre dans de plus grands
détails fur celle des Picards. Ces gens-là, dit-il, ne
parlent du pape, des cardinaux 6c des évêques, que
comme de vrais antechrifts, ils ne croyent rien ou
fort peu des facremens de l’Eglife. Ils prétendent
qu’il n’y a rien de divin dans le facrement de l’Eu-
chariftie , affirmant qu’ils n’y trouvent que le pain
6c le vin confacré, quirepréfentent la mort de Jéfus-
Chrift, 6c ils foutiennent que ceux qui adorent le
Sacrement font des idolâtres, ce Sacrement n’ayant
été inftitué que pour faire la commémoration de la
mort du Sauveur, 6c non pour être porté de côté
6c d’autre, parce que Jéfus-Chrift qui eft celui qu’il
faut honorer du culte de latrie, eft affis à la droite
de Dieu le pere. Ils traitent d’ineptie les fiiffrages
des Saints , 6c les prières pour les morts, aufli-bien
que la confeflion auriculaire, 6c la pénitence im-
Z z z ij