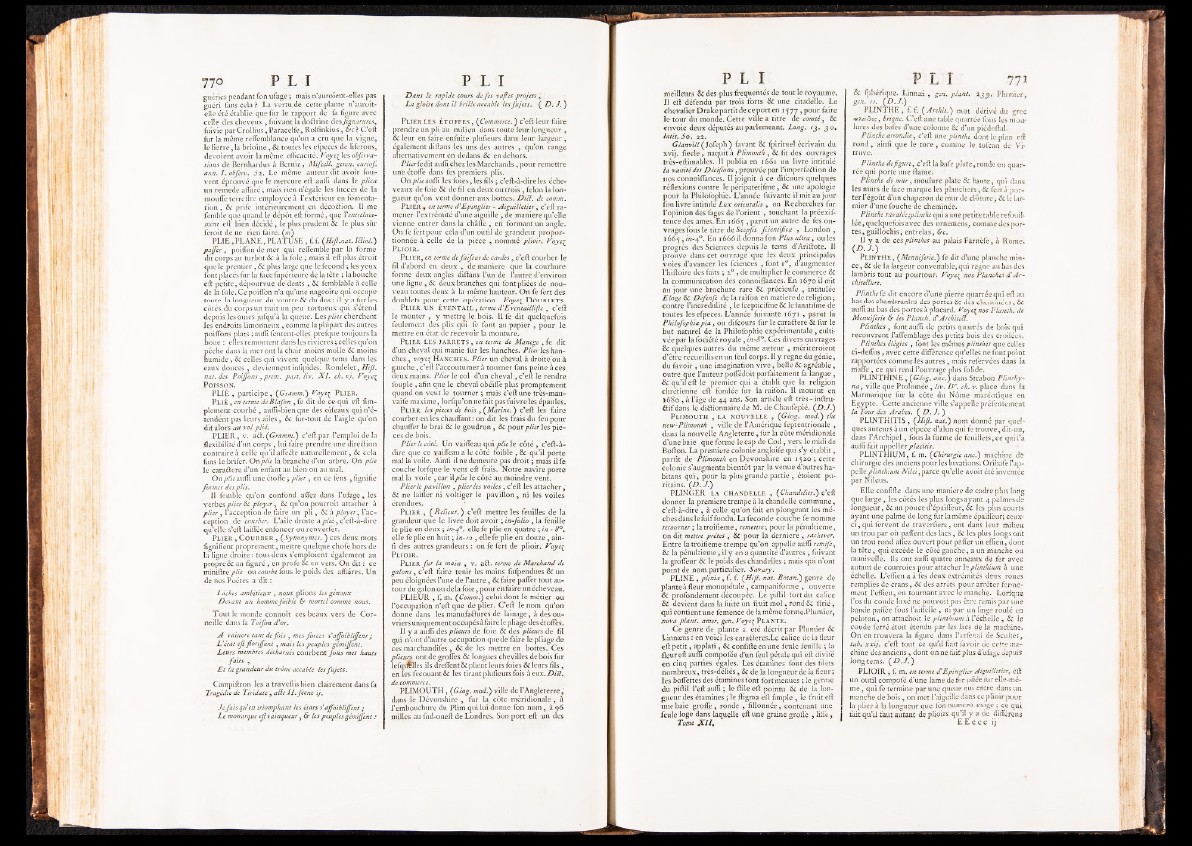
guéries pendant fon ufage ; mais n’auroient-elles pas
guéri fans cela ? La vertu de cette plante n’auroit-
elle été établie que fur le rapport de fa figure avec
celte des cheveux, fuivant la doûrine des fignat ares,
fuivie par Crollius, Paraceîfe, Rolfinkius, &c), C’eft
fur la môme reffemblance qu’on a cru que la vigne,
le lierre, la brioine, & toutes les efpeces de liferons,
dévoient avoir la même efficacité. V?ye{ les obferva-
tions de Bernhardus à Berniz, Mifcell. geren. curiof.
arm. I.obferv. J 2. Le même auteur dit avoir fou-
vent éprouvé que le mercure eft aufli dans le plie a
un remede affuré ; mais rien n’égale les fuççès de la
moufle terre lire employée à l’extérieur en fomentation
, & prife intérieurement en décoélion. Il me
femble que quand le dépôt, eft formé, que Mentrelacement
eft bien décidé, le;plus prudent & le plus sûr
feroit de ne rien faire. (?«)
PLIE, PLANE, PLATUSE, f. f. (Hiß.nat. Ictiol.)
paffer, poiflbn de mer qui reffemble par la forme
du corps au turbot & à la foie ; mais il eft plus étroit
que le premier, & plus large que le fécond ; les yeux
font placés fur la face fupéneure de la tête ; la bouche
eft petite, dépourvue de'dents , & femblable à celle
de la foie. Ce poiflbn n’a qu’une nageoire qui occupe
toute la longueur du ventre & du dos : il y a fur les
côtés du corps un trait un peu tortueux qui s’étend
depuis les ouies jufqu’à la queue. Les plies cherchent
les endroits limonneux , comme la plupart des autres
poiflons plats ; aufli fentent-elles prefque toujours la
boue : elles remontent dans les rivières ; celles qu’on
pêche dans la mer ont la chair moins molle & moins
humide , & celles qui vivent quelque tems dans les
eaux douces , deviennent infipides. Rondelet, Hiß.
nat. des Poiffons , prem. part. liv. X I . ch. vj. Voyeç
Poisson.
PLIÉ , participe, (Gramm.') Voyt%_ Plier.
P lié , en terme de Blafon , fe dit de ce qui eft Amplement
courbé , aufli-bien que des oifeaux qui n’é-
tendént pas leurs ailes, & fur-tout de l’aigle qu’on
dit alors au vol plié.
PLIER, v. aéi. (Gramm.) c’eft par l’emploi de la
flexibilité d’un corps , lui faire prendre une dire&ion
contraire à celle qu’il affeéle naturellement, & cela
fans le brifer. On plie la branche d’un arbre. On plie
.le caraftere d’un enfant au bien ou au mal.
On plie aufli une étoffe ; plier, en ce fens , lignifie
former des plis.
Il femble qu’on confond allez dans l’ufage, les
.verbes plier & ployer, Sç qu’on pourroit attacher à
plier, l’acception de, faire un p li, & à ployer, l’acception
de courber. L’aile droite a plie, c’ eft-à-dire
qu’elle s’eft laiffée enfoncer ou renverfer.
Plier , C ourber , ( Synonymes. ) ces deux mots
fxgnifient proprement, mettre quelque chofe hors de
la ligne droite : tous deux s’emploient également au
propre & au figuré , en profe ôé en vers. On dit : ce
miniftre plie ou courbe fous le poids des affaires. Un
de nos Poètes a dit :
Lâches ambitieux , nous plions les genoux
Devant un homme foible & mortel comme nous.
Tout le monde connoît ces beaux vers de Corneille
dans fa Toi fon d? or.
A vaincre tant de fois , mes forces s'affoibliffent ;
U état eß floriffant , mais les peuples gémiffent.
Leurs membres décharnés courbent fous mes hauts
faits ,
E t la grandeur du trône accable les fujets.
Campiftron les a traveftis bien clairement dans fa
Tragédie de Tiridate , acte Il.fcene ij.
Je fais qiicn triomphant les états s'affoibliffent ;
Le monarque eß vainqueur , 6* les peuples gémiffent :
Dans le rapide cours de fes vafles projets]
La gloire dont i l brille accable lés- fujets. ( D. J. )
PLIER les Étoffes , ( Commerce. ) c’eft leur faire
prendre un pli au milieu dans toute leurlongueur ,
& leur en faire enfuite plufieurs dans leur largeur ,
également diftans les, uns des autres-,,, qu’on range
alternativement en dedans & en dehors.
P lier ledit aufli chez les Marchands ,pour remettre
■ urife étoffe dans fes premiers plis.
On plie aufli les foies, les fils ; c’eft-à-dire les éche-
veaux de foie & de fil en deux ou trois , félon la longueur
qu’on veut donner aux bottes. Dict. de comm.
Plier 9 en terme d'Epinglier - Aiguilletier, c’eft ramener
l’extrémité d’une aiguille , de maniéré qu’elle
vienne entrer dans la châfle , en formant un angle.
On fe fertpour cela d’un outil de grandeur proportionnée
à celle de la piece , nommé plioir. Voyeç
Plio ir.
. Plier, en terme de faifeurde cardes, c’eft courber le
fil d’abord en deux , de maniéré que la courbure
forme deux angles diftans l’un de l’autre d’environ
une ligne , & deux branches qui font pliées de nouveau
toutes deux à la même hauteur. On fe fert des
doublets pour cette opération. Voye^ D oublets.
. Plier UN Éven ta il , terme d ’Eventaillifte , c’eft
le monter , y mettre le bois. Il fe dit quelquefois
feulement des plis qui fe font au papier , pour le
mettre en état de recevoir la monture.
Plier les jarrets , en terme de Manege , fe dit
d’un cheval qui manie fur les hanches. Plier les hanches
, voye^ Hanches. Plier un cheval à droite’ou à
gauche, c’eft l'accoutumer à tourner fans peine à ces
deux mains. Plier le col d’un cheval, c’en le rendre
fouple, afin que le cheval obéiffe plus promptement
quand on veut le tourner ; mais c’eft une très-mau-
vaife maxime, lorfqu’onnefaitpasfuivreles épaules.
Plier les pièces de bois , (Marine. ) c’eft les faire
courber en les chauffant : on dit les frais du feu pour
chauffer le brai & le goudron, & pour plier les pièces
de bois.
Plier le côté. Un vaifleau qui plie le côté , c’eft-à-
dire que ce yaiffeau a le côté foible , & qu’il porte
mal la voile. Ainfi il ne demeure pas droit ; mais ilfe
couche lorfque le vent eft frais. Notre navire porte
mal la voile , car il plie le côté au moindre vent.
P lier le pavillon , plier les voiles, c’eft les attacher,"
& ne laiffer ni voltiger le pavillon, ni les voiles
étendues.
Plier , ( Relieur. ) c’ eft mettre les feuilles de la
grandeur que le livre doit avoir ; in-folio , la feuille
fe plie en deux ; in-40. elle fe plie en quatre ; in - 8°.
elle fe plie en huit ; in-12, ellefe plie en douze, ainfi
des autres grandeurs : on fe fert de plioir. Voyei
Plioir.
Plier fur la main , v. aft. terme de Marchand de
galons, c ’eft faire tenir les mains fufpendues & un
peu éloignées l’une de l’autre, & faire paffer tout autour
du galon ou delà foie, pour en faire un écheveau.
PLIEUR , f, m. (’Comm.) celui dont le métier ou
l’occupation n’eft que de plier. C’eft le nom qu’on
donne dans les manufa&ures de lainage, à des ouvriers
uniquement occupés àfaire le pliage des étoffes.
Il y a aufli des plieurs de foie & des plieurs de fil
qui n’ont d’autre occupation que de faire le pliage de
ces marchandifes , & de les mettre en bottes. Ces
plieurs ont de groffes & longues chevilles de bois fur
lefqiMlles ils dreflent& plient leurs foies & leurs fils ,
en les fecouant& les tirant plufieurs fois à eux. Dict.
de commerce.
PLIMOUTH, (Géog. mod.) v ille de l’Angleterre,'
dans le Dévonshire , fur la côte méridionale, à
l’embouchure du Plim qui lui donne fon nom, à 96
milles au fud-oueft de Londres. Son port eft un des
meilleurs & des plus fréquentés de toutlë royaume.
Il eft défendu pâr trois forts & ime citadelle. Le
chevalier Drake partit de ce port en 15 7 7 , pour faire
le tour du monde. Cette ville a titre dt comté, 6c
envoie deux députés au parlemennt. Long. (g. g o.
bâtit. 5o. 22.
Glanvill (Jofeph) favant & fpiritueï écrivain du
xvij. fiecle, naquit à Plimoicth , & fit dés ouvrages j
très-eftimables. Il publia en 1661 un livre intitulé I
la vanité des Décifions, prouvée par l’imperfeélion de
nos connoiflances. Il joignit à ce difeours quelques
réflexions contre le péripatetifme, &c une apologie
pour la Philofophie. L’année fuivante il mit au jour
l’on livre intitule Lux orientalis , ou Recherches fur
l’opinion des fages de l’orient , touchant la préexif-
tenfce des âmes. En 166 5 , parut un autre de fes ouvrages
fous le titre deScepjis fcientifica , London ,
166 f , in-40. En 1666 il donna fon Plus ultra, ou les
progrès des Sciences depuis le tems d’Ariftote. Il
prouve dans cet ouvrage que les deux principales
voies d’avancer les fciences , font i ° , d’augmenter
ï’hiftoire des faits ; z ° , de multiplier le commerce
la communication des connoiflances. En 1670 il mit
au jour une brochure rare & précieufe , intitulée
Eloge & Défenfe de la raifon en matière de religion ;
contre l’incrédulité , le fceptieifme & lefanatifme de
toutes les efpeces. L’année fuivante 1671 , parut fa
Philofophia pia, ou difeours fur le cara&ere & fur le
but naturel de la Philofophie expérimentale, cultivée
par làfôciété royale, in-8°, Ces divers ouvrages
& quelques autres du même auteur , mériteroient
d’être recueillis en un feul corps. Il y régné du génie,
du faVoir j une imagination v iv e , belle & agréable,
outre que l’auteur poffédoit parfaitement fa langue ,
& qu’il eft le premier qui a établi que la religion
chrétienne eft fondée lur la raifon. Il mourut en
1680 , à l’âge de 44 ans. Son article eft très-inftru-
élif dans le di&ionnaire de M. de Chaufepié. (JD J .)
Plimouth ÿ LA NOUVELLE , (Géog. mod.) the
new-Plimouth , ville de l’Amérique feptentrionale ,
dans la nouvelle Angleterre, fur la côte méridionale
d’une baie que forme le cap de C o d , vers le midi de
Bofton. La première colonie angloife qui s’y établit,
partit de Plimouth en Devonshire en 15 10 ; cette
colonie s’augmenta bientôt par la venue d’autres ha-
bitans qui, pour la plus grande partie , étoient puritains.
(D. J.)
PLINGER LA CHANDELLE , (Chandelier.) c’ eft
donner la première trempe à la chandelle commune,
c’eft-à-dire , à celle qu’on fait en plongeant les mèches
dans lefuif fondu. La fécondé couche fe nomme
retourner ; latroifieme, remettre; pour la pénultième,
on dit mettre prêtes , & pour la derniere , rachever.
Entre la troifieme trempe qu’on appelle aufli remife,
& la pénultième j il y en a quantité d’autres , fuivant
la groffeur & le poids des chandelles ; mais qui n’ont
point de nom particulier. Savary.
PLINE , plinia , f. f. (Hijl. nat. Botan.) genre de
plante à fleur moriopétale , campaniforme , ouverte
& profondément découpée. Le piftil fort du calice
& devient dans la fuite un fruit ffiol, rond &C. ftrié,
qui contient une femence de la même fbrme.Plumier,
nova plant, amer. gen. f^oye^ PLANTE.
Ce genre de plante a été décrit par Plumier &
Linnæus : en voici les caraéleres.Le calice de la fleur
eft petit, applati ? & eonlifteenune feule feuille ; la
fleur eft aufli compofée d’un feul pétale qui eft divifé
en cinq parties égales. Les étamines font des filets
nombreux, très-déliés, & de la longueur de la fleur;
les boffettes des étamines font fort menues ; le germe
du piftil l’eft aufli ; le ftile eft pointu & de la longueur
des étamines ; le ftigma eft Ample, le fruit eft
line baie groffe , ronde , fillonnée, contenant une I
feule loge dans laquelle eft une graine grofl’e , lifi'e, j
Tome X I I . 1
& fphérique. Lirinæi , geri. plant, z i etc Plumier.
gen. //. (D ./ .)
PLINTHE, f. f . ( Archil. ) mot dérivé dit grec
■ wXiyd-oÇy brique. C’eft une table qiiarrée fous les moulures
des bafes d’une colonne & d’un piédeftal.
Plinthe arrondie, c’eft tint plinthe dont le; plan eft
rond, ainfi que le to re , comme le tofean de Vi-
truve.
Plinthe defigure, c’eft la bafe plate, ronde ou qttar-
réé qui porte uhe ftâtïiè’.
Plinthe de mur, moulure plate & haute, qui dans
les murs de face marque les planchers $ & fert à porter
l’égout d’un chaperon de mur de clôture * & le larmier
d’une fouche de cheminée.
Plinthe ravalée;plinthe qui a une petite table refouib
lee, quelquefois avec des ornemens, comme des portes
, guillochis, entrelas j &c.
Il y a de ces plinthes au palais Fàrnèfe, à Rome.
(D .J Ï ) .
Plinthe b ( MenUifcne.) fe dit d’une planche mince
, & de la largeur convenable, qui régné au bas des
lambris tout au pourtour. Foye{ nos Planches d'Ar*•
chiteclure.
Plinthe fe dit encore d’utte pierre quartée qui eft au
bas des chambranles des portes & des cheminées, Sc
aufli âu bas des portes à placard. Eoye{ nos Planché de
Menuiferie & les Planck. d'Architect.
Plinthes , font aufli de petits quartes de bois qui
recouvrent l’aflemblage des petits bois des croifées.
Plinthes élégies , font les mêmes plinthes que celles
ci-deflus, avec cette différence qu’elles.né font point
rapportées comme les autres, mais refervées dans la
ffiaflè , ce qui rend l’ouvragé plus folide.
PLINTH1N E , (Géog. ancj) dans Strabon Plinthy-
na, ville que Ptolomée , liv. IV. ch. v. placé dans la
Marmarique fur la côte du Nôme mâréotique en
Egypte. Cette ancienne ville s’appelle préfentement
la Tour des Arabes. [ D . J .)
PLINTHITIS , (Hift. nat.) nom donné par quelques
auteurs à un efpece d’alun qui fe trouve, dit-on,
dans l’Archipel, fous la forme de feuillets, ce qui l’a
aiifîï fait appellér placitis.
PLINTHIUM, f. m. (Chirurgie anc.) machine dé
chirurgie des anciens pour les luxations. Oribafe l’appelle
plinthium Nilei, parce qu’elle avoir été inventée
par Niletis.
Elle confifte dans une maniéré de cadre plus long
que large, les côtés les plus longs ayant 4 palmes de
longueur, & un pouce d’épaiffeur, & les plus courts
ayant une palme de long fur la même épameur; ceux-
ci , qui fervent de traverfiers, ont dans leur milieu
un trou par oii paflent des lacs , & les plus longs ont
un trou rond anez ouvert pour paffer un eflieu, dont
la tête, qui excède le côté gauche, a un manche ou
manivelle. Ils ont aufli quatre anneaux dé fer avec
autant de courroies pour attacher le plinthium à une
echelle. L’eflieu a à fes deux extrémités deux roues
remplies de crans, & des arrêts pour arrêter fermement
l’eflîeü, en tournant avec le manche. Lorfque
i’os du coude luxé ne pôuvoit pas être remis par une
bande paflee fous l’aifîelle , ni par un linge roulé en
peloton, on attachoit le plinthium à l’échelle , & le
coude ferré étoit étendu par les lacs de la machine.
On en trouvera la figure dans l’arfenal de Scultet,
tab, xxij. c’eft tout ce qu’il faut favoir de cette machine
des anciens, dont on ne fait plus d’ufage depuis
long-tems. (Z>./. )
PLIOIR , f. m. en ternie cCEpinglier Aiguilletier, eft
un outil compofé d’une lame de fer pliée fur elle-même
, qui fe termine par une queue qui entre dans un
manche de bois, on met l ’aiguille dans ce plioir pour
la plier à la longueur que fon numéro exige ; ce qui
fait qu’il faut autant de plioirs qu’il y a de différens