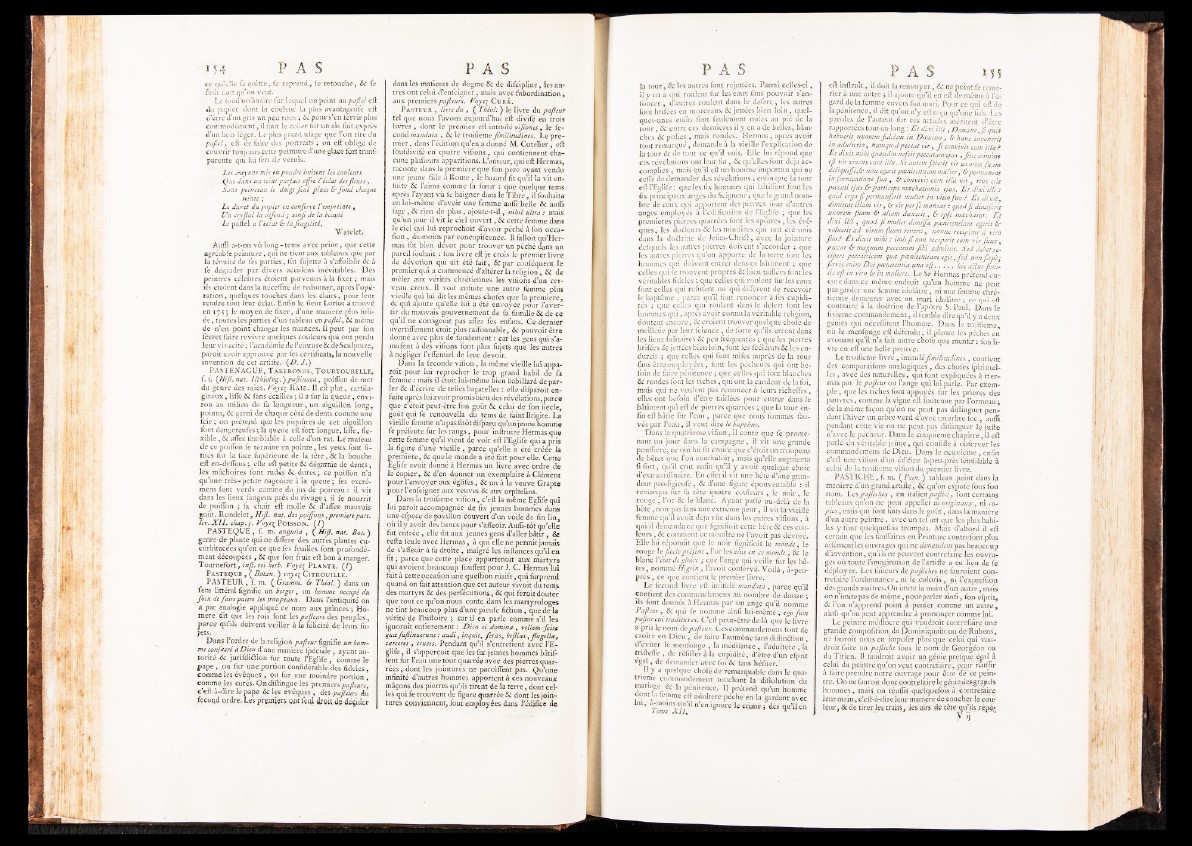
i < 4 P A S
ce qu’elle fe quitte, fe reprend * fe retouche, & le
finit tant qu’on veut.
Le f o n d ‘o rd in a ir e fur lequel on peint au paflel eft
du papier dont la couleur la plus avantàgeufe eft
d’être d’un gris un peu roux ; 6c pour s’en iervir plus
commodément, il faut le coller lur un ais fait exprès
d’iin bois léger. Le plus grand ulage que l’on tire du
paflel, eft de faire des portraits ; on eft obligé de
couvrir toujours cette peinture d’une glace fort tranf-
parente qui lui fert de vernis.
Les crayons mis en pondre imitent les couleurs
Que dans un teint parfait offre l'éclat des fleurs,
Sans peinceau le doigt fcul place & fond chaque
teinte ;
Le duvet du papier en conferve l'empreinte ,
Un cryflal la défend ; ainfl de la beauté
Le paftel a l'iciat & la fragilité,
Watelet.
A u d i a-t-on vû long - tems avec peine, que cette
agréable peinture, qui ne tient aux tableaux que par
la ténuité de fes parties, fut. fujette à s’affoiblir 6c à
fe dégrader par divers accidens inévitables. Des
peintres célébrés étoient parvenus à la fixer ; mais
ils étoient dans la néceflité de redonner, après l’opération
, quelques touches dans les clairs, pour leur
rendre tout leur éclat. Enfin le fleur Loriot a trouvé
en 1753 le moyen de fixer, d’une maniéré plus foli-
de, toutes les parties d’un tableau en pafiel, 6c même
de n’en point changer les nuances. Il peut par fon
fecret faire revivre quelques couleurs qui ont perdu
leur vivacité ; l’académie de P e in tu r e & deSculpture,
paroît avoir approuvé par fes certificats, la nouvelle
invention de cet artifte. (D . /.)
PASTENAGUE, T areronde, T ourtourelle,
f. f. (H iß . nat. lclhiolog. ) paflinaca, poiffon de mer
du genre des raies. Foye[ Raie. Il eft plat, cartilagineux
, lifte & fans écailles ; il a fur la queue, environ
au milieu de fa longueur, un aiguillon long, ■
pointu, 6c garni de chaque côté de dents comme une
feie ; on prétend que les piqufires de cet aiguillon
font dangereufes ; la queue elt fort longue, lifte, flexible
, 6c aflez femblable à celle d’un rat. Le rnufeau
de ce poiffon fe termine en pointe, les yeux font fi-
tués fur la face fupérieure de la tête, & la bouche
eft en-deffous ; elle eft petite 6c dégarnie de dents,
les mâchoires font rudes 6c dures; ce poiflbn n’a
qu’une très-petite nageoire à la queue; fes excré-
mens font verds comme du jus de poireau : il vit
dans les lieux fangeux près du rivage ; il fe nourrit
de poiffon ; fa chair eft molle 6c d’affez mauvais
goût. Rondelet, Hiß. nat. des poffons , première part.
liv .X I I . chap.j. Voye^ POISSON. (/)
PASTEQUE, f. m. anguria , ( Hifl. nat. Bot. )
genre de plante qui ne différé des- autres plantes cu-
curbitacées qu’en ce que fes feuilles font profondément
découpées , 6c que fon fruit eft bon à manger.
Tournefort, inß. rei herb. Foye{ Plante. (7)
Pastèque , ( Botan. ) voye[ C itrouille.
PASTEUR , f. m. ( Gramm. & Théol. ) dans un
fens littéral fignifie un berger, un homme occupé du
foin de faire paître les troupeaux. Dans l’antiquité on
a par analogie appliqué ce nom aux princes ; Homere
dit que les rois font les pafleurs des peuples,
parce qu’ils doivent veiller à la félicité de leurs fu-
jets.
Dans l’ordre de la religion pafleur fignifie un homme
confacré à Dieu d’une maniéré fpéciale , ayant autorité
6c jurifdiâion fur toute l’Eglife , comme le
pape, ou fur une portion confidérable des fideles
comme les évêques , ou fur une moindre portion
comme les cures. On diftin^ue les premiers pafleurs,
c’eft-à-dire le pape 6c les evêques , des pafleurs du
fecoijd ordre. Les premiers ont feul droit de décider
P A S
dans les matières de dogme & de difcipîine, les aü*
très ont celui d’enfeigner, mais avec fubordination *
aux premiers pafleurs. Foye{ C u ré.
Pasteur , livre du , ( Théol. ) le livre du pafleuf
tel que nous l’avons aujourd’hui eft divifé en trois
livres , dont le premier eft intitulé viflones, le fécond
mandata , 6c le troifieme fîmilitudines. Le premier
, dans l’édition qu’en a donné M. Cotelier, eft
foufdivifé en quatre vifions, qui contiennent chacune
plufieurs apparitions. L’auteur, qui eft Hermas,
raconte dans la première que fon pere ayant vendu
une jeune fille a Rome , le hazard fit qu’il la vit en-
fuite 6c l’aima comme fa foeur ; que quelque tems
«près l’ayant vû fe baigner dans le Tibre, il fouhaita
en lui-même d’avoir une femme aufli belle 6c aufti
fage , 6c rien de plus , ajoute-t-il, nihil ultra : mais
qu’un jour il vit le ciel ouvert, 6c cette femme dans
le ciel qui lui reprochoit d’avoir péché à fon occa-
fion, du-moins par concupifcenee. Il falloit qu’Her-
mas fut bien dévot pour trouver un péché dans un
pareil fouhait : fon livre eft je crois le premier livre
de dévotion qui ait été fait, & par conféquent le
premier qui a commencé d’altérer la religion, 6c de
meler aux vérités chrétiennes les vifions d’un cerveau
creux. Il voit enfuite une autre femme plus
I vieille qui lui dit les mêmes chofes que la première,
6c qui ajoute qu’elle lui a été envoyée pour l’avertir
du mauvais gouvernement de fa famille & de ce
qu’il ne corrigeoit pas aflez fes enfans. Ce dernier
avertiflement étoit plus raifonnable, 6c pouvoit être
donné avec plus de fondement : car les gens qui s’a-
mufent à des vifions font plus fujets que les autres
à négliger l’eflentiel de leur devoir.
Dans la fécondé vifion, la même vieille lui appa*
roît pour lui reprocher le trop grand babil de fa
femme : mais il étoit lui-même bien babillard de parler
6c d’écrire dé telles bagatelles : elle difparoît en-
fuite après lui avoir promisbien des révélations, parc«
que c’étoit peut-être fon goût 6c celui de fon fiècle,
goût qui fe renouvella du tems de faint Brigite. La
vieille femme n’apasfitotdifparu qu’un jeune homm«
fe préfente fur les rangs, pour inftruire Hermas que
cette femme qu’il vient de voir eft l’Eglife qui a pris
la figure d’une vieille, parce qu’elle a été créée la
première, 6c que le monde a été fait pour elle. Cette
Eglife avoit donné à Hermas un livre avec ordre de
le copier, 6c d’en donner un exemplaire à Clément
pour l’envoyer aux églifes, 6c un à la veuve Grapte
pour l’enfeigner aux veuves 6c aux orphelins.
Dans la ùroifieme vifion, c’eft la même Eglife qui
lui paroît accompagnée de fix jeunes hommes dans
une efpece de pavillon couvert d’un voile de fin lin,
où il y avoit des bancs pour s’afleoir. Auflî-tôt qu’elle
fut entrée , elle dit aux jeunes gens d’aller bâtir 6c
refta feule avec Hermas, à qui elle ne permit jamais
de s’afleoir à fa droite , malgré les inftances qu’il en
fit; parce que cette place appartenoit aux martyrs
qui ayoient beaucoup fouffert pour J. C. Hermas lui
fait à cette occafion une queftion niaife, qui furprend
quand on fait attention que cet auteur vivoit du tems
des martyrs 6c des perfécutions, 6c qui feroit douter
que tout ce qu’on nous conte dans les martyrologes
ne tînt beaucoup plus d’une pieufe fi&ion, que de la
vérité de l’hiftoire ; car il en parle comme s’il les
ignoroit entièrement : Dico éi domina , vellem feire
quoe fuflinuerunt : audi, inquit, feras, befiias, flagella,
carceres , cruces. Pendant qu’il s’entretient avec l’Eglife,
il s’apperçoit que les fix jeunes hommes bâtit
lent lur l’eau une tour quarrée avec des pierres quar-
rées, dont les jointures ne paroiflent pas. Qu’un,e
infinité d’autres hommes apportent à ces nouveaux
mâçons des pierres qu’ils tirent delà terre, dont celles
qui fe trouvent de figure quarrée & dont les jointures
conviennent, font employées dans l’édifice de
P A S
la tour, 6c\es autres font rejettées. Parmi- celles-ci,
il y en a qui roulent fur les eaux fans pouvoir s’enfoncer
, d’autres roulent dans le defert,, les autres
font brifées en morceaux 6c jettées bien lo in , quelques
unes enfin font feulement mifes au pié de la
tour 6c entre ces dernieres il y en a de belles, blam
ches 6c polies , mais rondes. Hermas , après avoir
tout remarqué, demande à la vieille l’explication de
la tour 6c de tout ce qu’il voit. Elle lui répond que
ces révélations ont leur fin, 6c qu’elles font déjà accomplies
, mais qu’il eft un homme importun qui ne
cefle de demander des révélations ; enfin que la tour
eft l’Eglife : que les fix hommes qui bâtiflent font les
fix principaux anges du Seigneur ; que le grand nombre
de ceux qui apportent des pierres font d’autres
anges employés à l’édification de l’Eglife ; que les
premières pierres quarrées font les apôtres, les évêques,
les dotteurs 6c les miniftres qui ont été unis
dans la doftrine de Jefiis-Chrift, avec la jointure
defquels les autres pierres doivent s’accorder ; que
les autres pierres qu’on apporte de la terre font les
hommes, qui doivent entrer dans ce bâtiment ; que
celles qui le trouvent propres 6c bien taillées font les
véritables fideles ; que celles qui roulent fur les eaux
font celles qui refulent ou qui different de recevoir
le baptême , parce qu’il faut renoncer à fes cupidités
; que celles qui roulent dans le defert font les
hommes qui, après avoir connu la véritable religion,
doutent encore, 6c croient trouver quelque chofe de
meilleùr par leur fcience , de forte qu’ils errent dans
les lieux folitaires 6c peu fréquentés ; que les pierres
brifées 6c jettées bien loin, font les fcélerats 6c les endurcis
; que celles qui font mifes auprès de la tour
fans être employées, font les pécheurs qui ont be-
foin de faire pénitence ; que celles qui font blançhes
6c rondes font les riches, qui ont la candeur de la foi,
mais qui ne veulent pas renoncer à leurs richeffes,
elles ont befoin d’être taillées pour entrer dans lè
bâtiment qui eft de pierres quarrées ; que la tour enfin
eft bâtie fur l’eau , parce, que nous Tommes fau-
vés par l’eau., il veut dire le baptême.
Dans la quatrième vifion, il conte que fç promenant
un jour dans la campagne, il vit une grande
pouflîere, ce qui lui fit croire que c’étoit un troupeau
de bêtes que Pon conduifoit, mais qu’elle augmenta
fi fort, qu’il crut enfin qu’il y avoit quelque choie
d’extraordinaire. En effet il vit une bête d’une grandeur
prodrgieufe, 6c d’une figure épouventable : il
remarqua fur fa tête quatre couleurs , le poir Iç
rouge, l’or & le blanc. Ayant pafle au-delà de la
bête, non pas fans une extrême peur, il vit la vieillë
femme qu’il avoit déjà vûe dans les autres vifions à
qui il demanda ce que fignifioit cette bête 6c ces couleurs
, 6c comment ce monftre ne l’avoit pas dévoré.
Elle lui répondit que le noir fignifioit le monde, le
rouge le flecle préf ént, l’or les élus, en ce monde , & le
blanc Vétat de gloire ; que l’ange qui veille fur les bêtes,
nommé Higrin, l’avoit confervé. V o ilà , à-rpeu-
près , ce que contient le premier livre.
Le fécond livre eft intitulé mandata, parce qu’il
contient des commandemens au nombre de douze *
ds font donnés à Hermas par up angç qu’il nomme
Pafleur, 6c qui fe nomme ainfl lui-même , ego furh ■
paflorcui tradituses. C’eft peut-être de-là que le flvre
a pris le nom de pafleur. Ces commandemens font de :
croire en Dieu , de faire l’aumône fans diftinélion, ;
d’éviter le menfonge , la médilance , l’adultere , là i
triftefle , de réfifter à la cupidité, d’être d’un efprlt 1
dgal, de demander avec foi & fans héfitër. '
Il y a quelque chofe de remarquable dans le qüar !
trieme commandement touchant la diflblution du !
mariage & la pénitence. Il prétend qu’un homme j
dont la femme eft adultéré pèche en la gardant avec I
lui, armoins_qu’ü n’ en ignore le crime ; dès qu’il en .
Tome X I I , ^ j
P A S ï
eft inftruit, il doit la renvoyer., & né point fe remar
rier à une autre ; il ajoute qu’il en eft de même à l’égard
de la femme envers fon mari. Pour ce qui eft de
la penitence, il dit qu’on n’y eft reçu qu’une fois. Les
paroles de l’auteur fur ces, articles, méritent d’être
rapportées tout-au-long : E t dix.i ill i , Domine,fi quis
. habuerit uxorem fidelem in Domino. , & hanc invenerit
in adulttrio, numquidpeccat vir, ficonvivit cum ilia ?
Et dixit mihi quandiu nefeit peccaiumejus , fine crimine
efi viryivens cum ilia. Si auiem feierit vir uxorem fuam
deliqidffefir non egerit patnitentiammulier , &permaneat
\ in fornicatione fua , & convivit ciun ilia vir , reus erit
peccati ejus & particeps mcechationis ejus. Et dixi illi :
j quid ergo f i permanferit millier in vitio fuo ? Et dixit.,
dimittat tllam vir, & vir perfe mantat : quodß dimiferit
uxorem fuam & aliam duxerit, & ipfe mceçhqtur. Et
dixi illi , quod f i millier dimiffa. poenitzntiam egerit (S*
volueritad virum fuum reverti, nonne recipitur à viro
fuo? E t dixit mihi : imb f i non receperit eam vir fû ts ,
peccat. & magnum peccatum fibi admittit. Sed débet re-
cipere peççatricem quee poenitentiam egit,fed nonfiepê;
fer vis enim Del poenitentia un a efi. . . . . hiç aclusfinit?
lis efi in viro & in midiere. Le Sr Hermas prétend encore
dans ce même endroit qu’un homme ne peut
pas garder une femme idolâtre, ni une femme chrétienne
demeurer avec un mari idolâtre ; ce qui eft
contraire à la do&rine de l’apôtre S.. Paul. E)ans le
flxieme commandement, il femble dire qu’il y a deux
génies qui néceffîtent l’homme. Dans le troifieme
oii le menfonge eft défendu, il,pleure fes péchés en
avouant qu’il n’a fait autre chofe que mentir : fon livre
en eft une belle preuve.
Le troifieme livre , intituléfimilitudines , contient
des comparaifons analogiques , des chofes Spirituelles
, avec des naturelles, qui font expliquées à Hermas
par le pafleur ou l’ange qui lui parle. Par exemple
, que les riches font appuyés- fur les prières des
pauvres, comme la vigne eft foutenue par l’ormeau ;
de la même façon qu’on ne peut pas diftinguer pen-
.dant l’hiver un arbre verd d’avec un arbre l'ec , aufli
.pendant ççtte- vie on ne peut pas diftinguer le jufte
d’avec le pécheur. Dans le,, cinquième chapitre, il eft
parlé du véritable jeûne, qui çonfifte à obferver les
commandemens de Dieu. Dans le neiivieme , enfin
c’eft une vifion d’un édifice à-peu-près femblable à
celui de la troifieme vifion du premier livre.
PASTICHE, f. m. (Pein. ), tableau peint dans la
maniéré d’un grand artifte, 6f. qu’on expofe fous fon
nom. Les paßic/ies , en italienpaflici, font certains
tableaux qu’on ne peut appeller m originaux, ni copies
, mais qui font faits dans le goût, dans la maniéré
d’un autre peintre, avec un tel art que les plus habiles
y font quelquefois trompés. Mais d’abord il eft
certain que les fauffaires en Peinture contrefont plus
aifément les ouvrages qui ne demandent pas beaucoup
d’invention, qu’ils ne peuvent contrefaire les ouvrages
où toute l’imaginatipn de l’artifte a eu lieu de fe
déployer. Les faifeurs de paflkh.es ne faurpient contrefaire
l’ordonnance , ni Ig çojp.ris , ni l’expreffiop
des grands maîtres. On imite la main d’un autre mais
on n’imite pas de même ,ppur parler ainfl, Ton éfprit,
& l’on n’apprend point à penfer comme un autre,
ainfl qu’on.peut apprendre à prpnonçer connue lui.
Le peintre médiocre qui v'pudroit contrefaire une
grande çomppfition du pominiquaih ,ou de Rubens,
ne fauiroit'nous'en impofer 'pftrs qqe celùi qui voudrait
faire un pafliche fous le nom de Georgéon ou
dyTitfen.. Il feudrQit avpjr pn ggnip prpfgue égal à
celui du peintre qii’Qq yeuj: cpntfefaire, bquf feiiflir
à faire prendre notre ouvrage pour être dé ce pein-*
îçê. Qn ne faurpit dpnê pontrpfeire le génie,àçs grajids
hommes, mais on répflk quelquefois à; èontpefeir^
leur main, c’eft-à-dire leur manière de cou,cher la coin
leur, & de tirenles traitf , .k s airs de tête qu’ils répé*