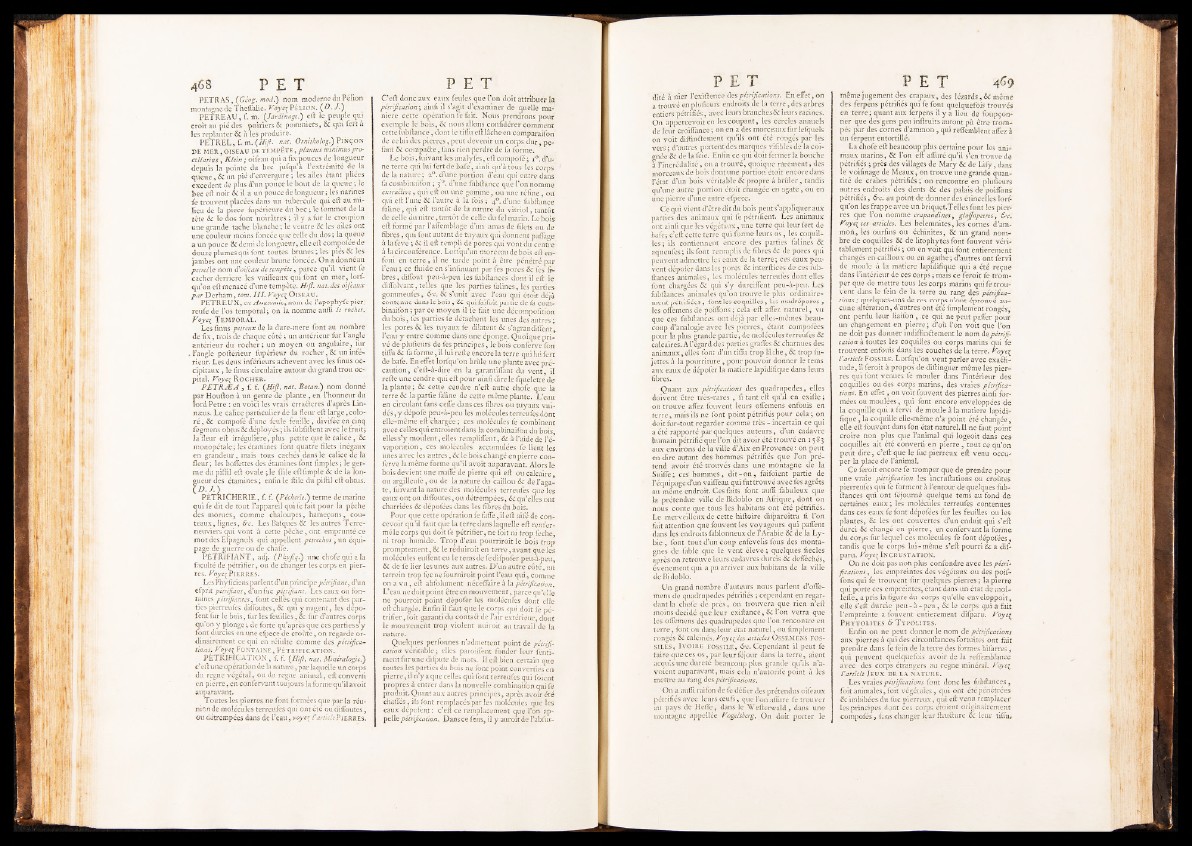
PETRAS, (Géog. moi.') nom moderne du Pélion
montagne de Theffalie. Voye? P é l i o n . ( O. /.)
PETREAU, f. m. {Jardinage.') eft le peuple qui
croît au pie des poiriers & pommiers, 6c qui feft à
les replanter 6c à les produire.
PETREL, f. m. (ffijt. nat. Ornitholog.) P in ç o n
DE MER, OISEAU DE TEMPÊTE, plautus minimus pro-
ccllarins, Klein ; oifeau qui a fix pouces de longueur
depuis la pointe du b e c . jufqu’à T extrémité de la
queue, & un pie d’envergure ; les ailes étant pliées
excédent de plus d’un pouce le bout de la queue ; le
bec eft noir & il a un pouce de longueur ; les narines
fe trouvent placées dans un tubercule qui eft au milieu
de la piece fupérieure du bec ; le lommet de la
tête 6c le dos font noirâtres ; il y a fur le croupion
une grande tache blanche ; le ventre 6c les aîles ont
une couleur moins foncée que celle du dos ; la queue
a un pouce & demi de longueur, elle eft conqjolee de
douze plumes qui font toutes brunes ; les pies & les
jambes ont une couleur brune foncée. On a donne au
petrelle nom à?oifeau de tempête, parce qu’il vient fe
cacher derrière les vaiffeaux qui font en mer, lorf-
qu’on eft menacé d’une tempête. Hft. nat.des oifeaux
par Derham, tûm. III. Voye\ O i s e a u .
PETREUX, en Anatomie, nom de Tapophyfe pier]
reufe de l’os temporal; on la nomme aufu le rocker.
Foye{ T e m p o r a l .
Les finus petreux de la dure-mere font au nombre
de lîx , trois de chaque côté ; un antérieur fur l ’angle
antérieur du rocher; un moyen ou angulaire, fur
. l’angle poftérieur fupérieur du rocher, 6c un inférieur.
Les deux inférieurs achèvent avec les linus occipitaux
, le finus circulaire autour du grand trou oc-
pital. Voye\ R o c h e r .
P E TRÆ A , f. f. (Hifi. nat. Botan.') nom donné
par Houfton à un genre de plante, en l’honneur du
lord Petre : en voici les vrais crraéleres d’après Lin-
næus. Le calice particulier de la fleur eft large, coloré
, 6c compofé d’une feule feuille, divifée en cinq
fegmens obtus 6c déployés ; ils fubfiftent avec le fruit;
la fleur eft irrégulière, plus petite que le calice, &
monopétale; les étamines font quatre filets inégaux
en grandeur, mais tous cachés dans le calice de la
fleur ; les boffettes des étamines font Amples ; le germe
du piftü eft ovale ; le ftile eftfimple 6c de la longueur
des étamines ; enfin le ftile du piftil eft obtus. <>•ƒ•) ■ ■ ■ ■ I ■ ■ ■ PÉTRI CHERIE, f. f. (Pêcherie?) terme de marine
qui fe dit de tout l’appareil qui fe fait pour la pêche
des morues, comme chaloupes, hameçons, couteaux,
lignes, &c. Les Bafques 6c les autres Terre-
neuviers qui vont à cette pêche, ont emprunté ce
mot des Elpagnols qui appellent petrechos , un équipage
de guerre ou de chaffe.
PÉTRIFIANT, ad j. (Pkyfiq.) u n e c h o f e q u i a l a
fa c u lté d e p é t r i f ie r , o u d e ch an g e r le s co rp s e n p ie r r
e s . Foye{ P i e r r e s .
Les Phyficiens parlent d’un principe pétrifiant, d’un
efprit pétrifiant, d’unfuc purifiant. Les eaux ou fontaines
pétrifiantes, font celles qui contenant des parties
pierreufes diffoutes, 6c qui y nagent, les depo-
fent fur le bois, fur les feuilles, 6c fur d’autres corps
qu’on y plonge ; de forte qu’après que ces parties s’y
font durcies en une efpece de croûte , on regarde ordinairement
ce qui en réfulte comme des pétrifications.
Foye[ F o n t a i n e , P é t r i f i c a t i o n .
PÉTRIFICATION , ƒ. f. (Hifl. nat. Minéralogie.)
c’ eft une opération de la nature, par laquelle un corps
du régné végétal, ou du régné animal, eft converti
en piérre, en confervant toujours la forme qu’il avoit
auparavant.
Toutes les pierres ne font formées que par la réunion
de molécules terreufes qui ont été ou diffoutes,
ou détrempées dans de l’eau, voyei l ’article Pierres.
C ’eft donc aux eaux feules que l’on doit attribuer la
pétrification ; ainfi il s’agit d’examiner de quelle manière
cette opération le fait. Nous prendrons pour
exemple le bois, 6c nous allons confidérer comment
cette lubftance, dont le tiffu eft lâche en comparaifon
de celui des pierres, peut devenir un corps dur, pe-
fant 6c conlpafte, fans rien perdre de fa forme.
Le bois, luivant les analyfes, eft compofé ; i d’u- '
ne terre qui lui fert de bafe, ainfi qu’à tous les corps
de la nature ; z°. d’une portion d’eau qui entre dans'
fa combinaifon ; 30. d’Une fubftance que l’on nomme
extractive, qui eft ou une gomme, ou une réfine, oii
qui eft l’une 6c l’autre à la fois ; 4° d’une fubftance
faline, qui eft tantôt de la nature du vitriol, tantôt
de celle du nitre, tantôt de celle du fel marin. Le bois
eft formé par l’affemblage d’un amas de filets ou de
fibres, qui font autant de tuyaux qui donnent paffage
à la feve ; & il eft rempli de pores qui vont du centre
à la circonférence. Lorfqu’un morceau de bois eft enfoui
en terre, il ne tarde point à être pénétré par
l’eau ; ce fluide en s’infinuant par fes pores 6c fes fr-
bres, diffout peu-à-peu les fubftances dont il eft le
diffolvant, telles que les parties falines, les parties
gommeufes, &c. 6c s’unit avec l’ eau qui étoit déjà
contenue dans le bois, 6c quifaifoit partie de fa combinaifon
; par ce moyen il fe fait une décompofition
du bois, fes parties fe détachent lés unes des autres ;
les pores 6c les tuyaux fe dilatent 6c s’agrandiffent
l’eau y entre comme dans une éponge. Quoique privé
de plufieurs de fes principes, le bois conferve fon
tiffu 6c fa forme, il lui refte encore la terre qui lui fert
de bafe. En effet lorfqu’on brûle une plante avec précaution,
c’eft-à-dire en la garantiffant du vent, il
refte une cendre qui eft pour ainfi dire le fquelette de
la plante ; 6c cette cendre n’eft autre chofe que la
terre & la partie faline de cette même plante. L’eau
en circulant fans ceffe dans ces fibres ou tuyaux vui-
d é s ,y dépofe peu-à-peu les molécules terreufes dont
elle-même eft chargée ; ces molécules fe combinent
avec celles qui entroient dans la combinaifon du bois
elles s’y moulent, elles remploient, & à l’aide de l’évaporation
, ces molécules accumulées fe lient les
unes avec les autres, 6c le bois changé en pierre conferve
la même forme qu’il avoit auparavant. Alors le
bois devient une maffe de pierre qui eft ou calcaire,
ou argilieufe, ou de la nature du caillou 6c de l’agate,
fuivant la nature des molécules terreufes que les
eaux ont ou diffoutes, ou détrempées, 6c qu’elles ont
charriées & dépofées dans les fibres du bois.
Pour que cette opération fe faffe, il eft aifé de concevoir
qu’il faut que la terre dans laquelle eft renfermé
le corps qui doit fe pétrifier, ne foit ni trop feche,
ni trop humide. Trop d’eau pourriroit le bois trop
promptement, 6c le reduiroit en terre, avant que les
molécules euffent eu le tems de fedifpofer peu-à-peu,
6c de fe lier les unes aux autres. D ’un autre côte, un
terrein trop feenefourniroit point l’eau qui, comme
on a v u , eft abfolument néceffaire à la pétrification.
L’eau ne doit point être en mouvement, parce qu’elle
ne pourroit point dépofer les molécules dont elle
eft chargée. Enfin il faut que le corps qui doit fe pétrifier
, lôit garanti du contact de l’air extérieur, dont
le mouvement trop violent nuiroit au travail de la
nature.
Quelques perfonnes n’admettent point de pétrification
véritable ; elles paroiffent fonder leur fenti-
ment fur une difpute de mots. Il eft bien certain que
toutes les parties du bois ne font point converties en
pierre, il n’y a que celles qui font terreufes qui foient
propres à entrer dans la nouvelle combinaifon qui fe
produit. Quant aux autres principes, après avoir été
chaffés, ils font remplacés par les molécules que les
eaux depofenf : c’eft ce remplacement que l’on appelle
pétrification. Dans ce fens, il y auroit de l’ablurdité
à nier l’èxiftence tes pétrifications. En effet, on
a trouvé en plufieurs endroits de la terre, des arbres
entiers pétrifiés, avec leurs branches & leurs racines.
On appercevoit en les coupant, les cercles annuels
de leur croiffancé ; on en a des morceaux fur lefquels
on voit diftin&ement qu’ils ont été rongés par les
vers ; d’autres portent des marques vifibles de la coignée
6c de la feie. Enfin ce qui doit fermer la bouche
a l’incrédulité, on a trouvé, quoique rarement, des
morceaux de bois dont une portion étoit encore dans
l’état d’un bois véritable 6c propre à b rûler, tandis
qu’une autre portion étoit changée en agate, ou en
une pierre d’une autre efpece.
Ce qui vient d’être dit du bôis peut s’appliquer aux
parties des animaux qui fe pétrifient. Les animaux
ont ainfi que les végétaux , une terre qui leur fert de
bafe; c’eft cette terre qui forme leurs ô s, les coquilles
; ils contiennent encore des parties falines 6c
aqueufes; ils font renmplis de fibres 6t de pores qui
peuvent admettre les eaux de la terre ; ces eaux peuvent
dépofer dans les pores 6c interftices de ces l’ub-
ftances animales, les molécules terreufes dont elles
font chargées 6c qui s’y durciffent peu-à-peu. Les
fubftances animales qu’on trouve le plus ordinairement
pétrifiées, font les coquilles, les madrépores ,
les offemens dé poiffons ; cela eft allez naturel, vu
que ces fubftances ont déjà par elles-mêmes beaucoup
d’analogie avec les pierres, étant compofées
pour la plus grande partie, de molécules’terreufes 6c
calcaires. A l’égard des parties graffes & charnues des
animaux, elles font d’un tiffu trop lâche, 6c trop fu-
jettes à la pourriture, pour pouvoir donner le tems
aux eaux de dépofer la matière lapidifique dans leurs
fibres.
Quant aux pétrifications des quadrupèdes, elles
doivent être très-rares , fi tant eft qu’il en exifte ;
on trouve affez fouvent leurs offemens enfouis en
terre, mais ils ne font point pétrifiés pour cela ; on
doit fur-tout regarder comme très - incertain ce qui
a été rapporté par quelques auteurs, d’un cadavre
humain pétrifie que l’on (lit avoir été trouvé en 1583
aux environs de la ville d’Aix en Provence : on peut
en dire autant des hommes pétrifiés que Ton prétend
avoir été trouvés dans une montagne de la
Suiffe ; ceS hommes, dit - o n , faifoient partie de
l ’équipage d’un vaiffeau qui fut trouvé avec fes agrêts
au même endroit. Ces faits font aufîi fabuleux que
la prétendue ville de Bidoblo en Afrique, dont on
nous conte que tous les habitans ont été pétrifiés.
Le merveilleux de cette hiftoire difparoîtra fi Ton
fait attention que fouvent les voyageurs qui paffent
dans les endroits fablonneux de l’Arabie 6c de la Ly-
b ie , font tout d’un coup enfevelis fous des montagnes
de fable que le vent éleve ; quelques fiecles
après on retrouve leurs cadavres durcis 6c defféchés,
événement qui a pu arriver aux habitans de la ville
de Bidoblo.
Un grand nombre d’auteurs nous parlent d’offe-
mens de quadrupèdes pétrifiés ; cependant en regardant
la chofe de près, on trouvera que rien n’eft
moins décidé que leur exiftance, 6c Ton verra que
les offemens des quadrupèdes que Ton rencontre en
terre, font ou dans leur état naturel, ou Amplement
rongés 6c calcinés. Foye^les articles OSSEMENS FOSSILES,
I v o i r e f o s s i l e , & c. Cependant il peut fe
faire que ces os, par leur féjour dans la terre, aient
acquis une durete beaucoup plus grande qu’ils n’a-
voient auparavant, mais cela n’autorife point à les
mettre au rang des pétrifications.
' On a aufîi raifon de fe défier des prétendus oifeaux
pétrifiés avec leurs oeufs, que Ton affure fe trouver
au pays de Heflè, dans le Wefterwaid, dans une
montagne appellée Fogelsberg. On doit porter le
m êm e ju g em e n t d e s e r a p a u x , des lé z a r d s , & m êm e
d e s fe rp en s p é t r ifié s q u i f e fo n t q u e lq u e fo is t r o u v é s
en t e r r e ; q u a n t a u x fe rp e n s il y a lie u d e fô u p ç ô n -
n e r q u e d e s g en s p e u in ft ru i ts a u ro n t p û ê t r e t r om p
é s p a r d es C o rn es d’ am m o n , q u i re ffem b len t a ffe z à
u n fe rp e n t e n to r t i llé i
La chofe eft beaucoup plus certaine pour les a ni-
maux marins, 6c Ton eft affuré qu’il s’en trouve de
pétrifiés ; près des villages de Mary & de L ify , dans
le voifinage de Meaux, on trouve une grande quantité
de crabes pétrifiés ; on rencontre en plufieurs
autres endroits des dents 6c des palais de poiffons
pétrifiés, &c. au point de donner des étincelles lorfi
qu’on les frappe avee un briquet.Telles font les pierres
que Ton nomme crapaudines, glojfiopetres, &ci
Fcye( ces articles. Les belemnites, les cornes d’am-
mofl, les ourfins ou échinites, 6c tin grand nombre
de coquilles 6c de litophytes font fouvent véritablement
pétrifiés ; on en voit qui font entièrement
changés en cailloux ou en agathe ; d’autres ont fervï
de moule à la matière lapidifique qui a été reçue
dans l’intérieur de ces corps ; mais ce feroit fe tromper
que de mettre tous les corps marins qui fë trouvant
dans le fein de la terre au rang des pétrifications
; quelques-uns de ces corps n’ont éprouvé aucune
altération, d’autres ont été Amplement rongés,
ont perdu leur liaifon , .ce qui ne peut paffer pour
un changement en pierre; d’oh Ton voit que Ton
ne doit pas donner indiftin&ement le nom de pétrifia
cation à toutes les coquilles ou corps ,marins qui fe
trouvent enfouis dans les couches de la terre. Voye^
l'article F o s s i l e . Lorfqu’on veut parler avec exactitude,
il feroit à propos de diftinguer même les pierres
qui font venues fe mouler dans l’intérieur des
coquilles ou des corps marins, des vraies pétrifica-
lions. En effet, on voit fouvent des pierres ainfi formées
ou moulées, qui font encore enveloppées de
la coquille qui a fervi de moule à la matière lapidifique
, la coquille elle-même n’a- point été changée ,
elle eft fouvent dans fon état naturel. Il ne faut point
croire non plus que l’animal qui logeoit dans ce»
coquilles ait été converti en pierre , tout ce qu’on
peut dire, c’eft que le fuc pierreux eft venu occuper
la place de l’animal.
C e fe ro it e n c o r e f e t rom p e r q u e d e p re n d r e p o u r
u n e v r a ie pétrification le s in c ru fta tio n s o u c ro û te s
p ie r re u fe s q u i f e fo rm e n t à l ’e n to u r d e q u e lq u e s fu b fta
n c e s q u i o n t fé jo u rn é q u e lq u e tem s a u fo n d d e
c e r ta in e s e a u x ; le s m o lé cu le s t e r r e u fe s co n te n u e s
dans c e s e a u x fe fo n t d é p o fé e s fu r le s fe u ille s o u lé s
p la n t e s , 6c le s o n t c o u v e r te s d’u n e n d u it q u i s’ e ft
d u r c i 6c c h a n g é e n p ie r r e , e n c o n fe r v a n t la fo rm e
d u c o rp s fu r le q u e l c e s m o lé c u le s f e fo n t d ép o fé e s ,
tan d is q u e le co rp s lu i -m êm e s’ e ft p o u r r i 6c a d i f -
p a ru . Foye^ In c r u s t a t i o n .
On ne doit pas non plus confondre avec les pétrU
fications, les empreintes des végétaux ou des poiffons
qui fe trouvent fur quelques pierres ; la pierre
qui porte ces empreintes, étant dans un état de mol-
leffe, apris la figure du corps qu’elie enveloppoit,
elle s’eft durcie p e u -à -p e u , & le corps qui a fait
l’empreinte a fouvent entièrement difpar^i. Foyez
P h y t o l i t e s 6 * T y p ô l i t e s .
Enfin on ne peut donner le nom de pétrifications
aux pierres à qui des circonftances fortuites ont fait
prendre dans le fein de la terre des formes bifarres,
qui peuvent quelquefois avoir de la reffemblance
avec des corps étrangers au régné minéral. Poyei
l ’article Je u x DE LA n a t u r e .
Les vraies pétrifications font donc les fubftances,
foit animales, foit végétales, qui ont été pénétrées
6c imbibées du fuc pierreux, qui eft venu remplacer
les principes dont ces corps étoient originairement
compofés , fans changer leur ftruélure 6c leur tiffu*