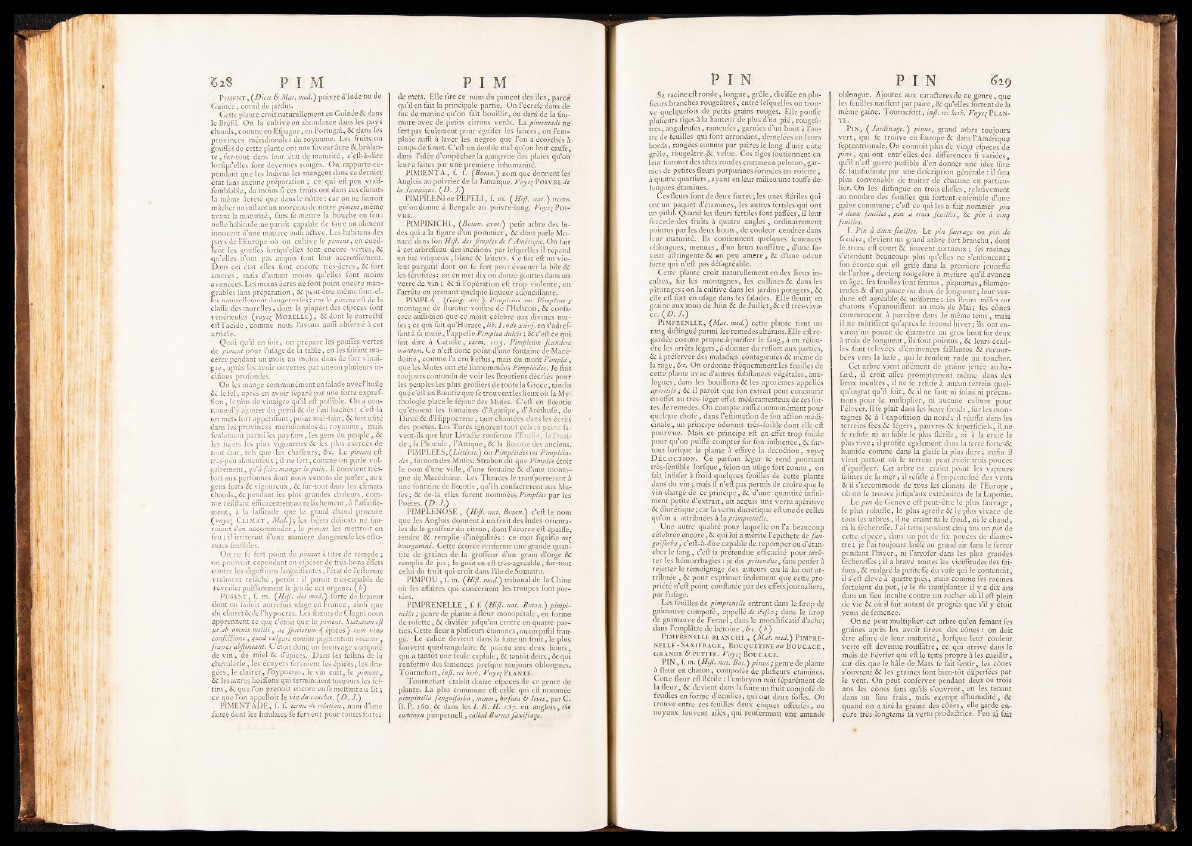
■5x8 P I M
P im e n t , (Diete & Mat. med.) poivre d’Inde ou de
Guinée, corail de jardin.
Cette plante croît naturellement en Guinée & dans
le Bréfil. On la cultive en abondance dans les pays
chauds, comme en Efpagne, en Portugal, dedans les
provinces méridionales du royaume. Les fruits ou
pouffes de cette plante ont une laveur âcre & brûlante
, fur-tout dans leur état de maturité, c’ eft- à-dire
lorfqu’elles font devenues rouges. On rapporte cependant
que les Indiens les mangent dans ce dernier
état fans aucune préparation ; ce qui eft peu vraif-
femblable, du moins fi ces fruits ont dans ces climats
la même âcreté que dans le notre : car on ne fauroit
mâcher un inftant un morceau de notre .piment, même
avant la maturité, fans fe mettre la bouche en feu.:
nulle habitude ne paroît capable de faire un aliment
innocent d’une matière aufli aôive. Les habitans dès
pays de l’Europe où on cultive le piment, en cueillent
les gouffes lorfqu’elles font encore vertes, &
qu’elles n’ont pas acquis tout leur accroiffement.
Dans cet état elles font encore très-âcres , & fort
ameres, mais d’autant mçins qu’elles font moins
avancées. Les moins âcres ne font point encore mangeables
fans préparation, & peut-être même font-elles
naturellement dangereufes; car le piment eft de la
claffe des morelles, dont la plupart des efpeces font
venéneufes {voye{ M o r e l le ) , &: dont le corre&if
eft l’acide, comme nous l’avons aufli obfervé à cet
article.
Quoi qu’il en foit, on prépare les gonfles vertes
de piment pour l’ufage de la table, en les fàifant macérer
pendant un mois au moins dans de fort vinai-
g.ie, après les avoir ouvertes par une ou plufieurs in-
cifxons profondes.
On les mange communément en falade avec l’huile
& le fe l, après en avoir féparé par une forte expref-
fion, le plus de vinaigre qu’il eft poflible. On a coutume
d’y ajouter du perfil & de l’ail hachés : c’eft-là
un mets fort appétiflant, point mal-fain, & fort uflté
dans les provinces méridionales du royaume, mais
feulement parmi les payfans, les gens du peuple, &
les -fujets les plus vigoureux & les plus exercés de
tout état, tels que les chafleurs, &c. Le piment eft
très-peu alimenteux ; il ne fert, comme on parle vulgairement
, qu à faire manger le pain. Il convient très-
lort aux perfonnes dont nous venons de parler, aux
gens forts & vigoureux, & fur-tout dans les climats
chauds, & pendant les plus grandes chaleurs, comme
réftftant efficacement au relâchement, à l’affaiffe-
ment, à la laflitude que le grand chaud procure
( voye{ C l im a t , Med.')-, les Sujets délicats ne fau-
roient s’en accommoder, le piment les mettroit en
feu ; il irriteroit d’une maniéré dangereufe les efto-
macs fenflbles.
On ne fe fert point du piment à titre de remede ;
bn poürroit cependant en efpérer de très-bons effets
contre les digeftions languifl'antes, l’état de l’eftomac
vraiment rélâché, perdu : il paroît très-capable de
réveiller puiffamment le jeu de cet organe. (b )
Pim e n t , f. m. (Hijl. des mod.) forte de liqueur
dont on faifoit autrefois ufage en France, aipfi que
du clairet &: de l’hypocras. Les ftatuts de Clugni nous
apprénnent ce que c’étoit que le piment. Statutum efl
ut ab omnis mellis , ac fpecicrum ■ *( épices ) cum vino
çonfectione , qitod vulgari nomine pigmentum vocatur,
fratres abflineant. C’etoit donc un breuvage compofé
de v in , de miel &; d’épices. Dans les feftins de la
chevalerie, les écuyers fervoient les épicées, les dragées,
le clairet, Phypocras, le vin cuit, le piment,
ite. les autres boiffons qui terminoient toujours les feftins,
& que l’on prenoit encore en fe mettant au lit;
ce que l’on appelloit le vin du coucher. {D. J.)
PIMENTADE, f. f. terme de relation, nom d’une
fauce dont les Infulaies fe fervent pour toutes fortes
P I M
de mets. Elle tire ce nom du piment des îles , parce
qu’il en fait la principale partie. On l’écrafe dans de
lue de manioc qu’on fait bouillir, ou dans de la fau-
mure avec de petits citrons verds. La pimentade ne
fert pas feulement pour éguifer les fatices, on l’emploie
aufli à laver les negres que l’on a écorchés à
coups de fouet. C’eft un double mal qu’on leur caiïfe,
dans l’idée d’empêcher-la gangrené des plaies qu’on
leur a faites par une première inhumanité.
PIMIENTA , 1. f. (Botan.) nom que donnent les
Anglois au poivrier de la Jamaïque. Foye^ Poivre
la Jamaïque. {D . J.)
PIMPILENI ou PEPELI, f. m. {Hiß. nat.) noms
qu’on donne à Bengale au poivre-long. Foye^ Poivre.
PIMPINICHI, {Botan. exot.) petit arbre des Indes
qui a la figure d’un pommier, & dont parle Mo-
nard dans fon Hiß. des fimples de l 'Amérique. On fait
à cet arbriffeau des incifions par iefquelles il répand
un fuc vifqueux, blanc & laiteux. Ce fuc eft un v iolent
purgatif dont on fe fert pour évacuer la bile &
les férofités : on en met dix ou douze gouttes dans un
verre de vin ; & fi l’opération eft trop violente, on.
l’arrête en prenant quelque liqueur adouciflante.
PIMPLA, {Géog. anc.) Pimpleius ou Pimpleus ;
montagne de Bceotie voifine de l’Hélicon, & confa-
crée aufli-bien que ce mont célébré aux divines mules
; ce qui fait qu’Horace, lib. 1. ode xxvj. en s’adreP
fantà fa mule ; l’appelle Pimplea dulcis ; & c’eft ce qui
fait dire à Catulle , carm.. i o j . Pimpleum feandere
montent. Ce n’eft donc point d’une fontaine de Macédoine
, comme l’a cru Feftus, mais du mont Pimpla,
que les Mufes ont été furnommées Pimpléides. Je fuis:
toujours confondu de voir les Boeotièns décriés pour
les peuples les plus grofliers de toute la Grece,tandis
que .c’ eft en Boeotie que fe trouvent les lieux oîi la Mythologie
place le féjour des Mufes. C’eft en Boeotie
qu’étoient les fontaines d’Aganipe, d’Aréthufe , de
Dircé & d’Hippocrene, tant chantées dans les écrits
des poètes. Les Turcs ignorent tout cela; à peine fa-
vent-ils que leur Livadie renferme l’Etolie, laDori-
de , la Phocide, l’Attique, & la Bceotie des anciens.
PIMPLÉES, {Littérat. ) ou Pimpléides ou Pimplèia-
des, fur nom des Mufes. Strabon dit qu ePimplée étoit
le nom d’une ville , d’une fontaine & d’une montagne
de Macédoine. Les Thraces le tranfporterent à
une fontaine de Boeotie, qu’ils confacrerent aux Mu-r
fes ; & de-là elles furent nommées Pimplées^r les
Poètes. (D . J.)
PIMPLENOSE , {Hiß. nat. Botan.) c’eft le nom
que les Anglois donnent à un fruit des Indes orientales
de la groffeur du citron , dont l’écorce eft épaiffe,
tendre & remplie d’inégalités : ce mot fignifle ne£
bourgeonné. Cette écorce renferme une grande quantité
de graines de la groffeur d’un grain d’orge &
remplis de jus ; le goût en eft très-agréable, fur-tout
celui du finit qui croît dans l’île de Sumatra.-
PIMPOU , f. m. {Hiß. mod.) tribunal de la Chine
où les affaires qui concernent les troupes font portées.
PIMPRENELLE, f. f. {Hiß. nat. Botan.) pimpi-
nella; genre de plante à fleur monopétale, en forme
de rofette, & divifée jufqu’au centre en quatre parties.
Cette fleur a plufieurs étamines, ou un piftil frangé.
Le calice devient dans la fuite un fru it,le plus
fouvent quadrangulaire & pointu aux deux bouts,
qui a tantôt une feule capfule, & tantôt deux, & qui
renferme des femences prefque toujours oblongues.
Tournefort, inß, rei herb. Foye^ Pl a n t e .
Tournefort établit douze efpeces de ce genre de
plante. La plus commune eft celle qui eft nommée
pimpinella fanguiforba, minor, hirfuta & levis, par C.
B . P. 160. & dans;,les I. R. H. t5y. en anglois , th*
common pimpernell., çalled Burtiet Jdxifrage.
P I N
Sa racine eft ronde, longue, grêle, divifée en plufieurs
branches rougeâtres, entre Iefquelles on trouve
quelquefois de petits grains rouges. Elle pouffe
plufieurs tiges à la hauteur de plus d’un pié, rougeâtres,
anguleufes, rameufes, garnies d’un bout à l’au^
tre de feuilles qui font arrondies, dentelées en leurs
bords, rangées comme par paires le long d’une côte
grêle, rougeâtre & velue. Ces tiges foutiennent en
leur fommet des têtes rondes comme en peloton, garnies
de petites fleurs purpurines formées en rofette,
à quatre quartiers, ayant en leur milieu une touffe de
longues etamines.
Ces fleurs font de deux fortes ; les unes ftériles qui
ont un paquet d’étamines, les autres fertiles qui ont
un piftil. Quand les fleurs fertiles font paffées, il leur
fuccede des fruits à quatre angles, ordinairement
pointus par les deux bouts, de couleur cendrée dans
leur maturité. Ils contiennent quelques femences
oblongues, menues, d’un brun rouffâtre, d’une faveur
aftringente & un peu amere , & d’une odeur
forte qui n’ eft pas défagréable. .
Cette plante croît naturellement en des lieux incultes,
fur les montagnes, les collines & dans les
pâturages ; on la cultive dans les jardins potagers, &
elle eft fort en ufage dans les falades. Elle fleurit en
graine aux mois de Juin & de Juillet, &; eft très-viva^
ce. {D . J .)
Pim p r e n l l e , {Mat. med.) cette plante tient un
rang diftingué parmi les remedes altérans. Elle eft regardée
comme propre à purifier le fang, à en réfoudre
les arrêts légers, à donner du reffort aux parties,
& à préferver des maladies contagieufes & même de
la rage, &c. On ordonne fréquemment les feuilles de
cette plante avec d’autres fubftances végétales, analogues
, dans les bouillons & les apozèmes appellés
apéritifs ; & il paroît que fon extrait: peut concourir
en effet au très-léger effet médicamenteux de ces fortes
de remedes. On compte aufli communément pour
quelque chofe, dans l’eftimation de fon aftion médicinale
, un principe odorant très-foible dont elle eft
pourvue. Mais ce principe eft en effet trop foible
pour qu’on puiffe compter fur fon influence, & fur-
tout lorfque la plante à effuyé la déco&ion, voye^
D é c o c t io n . Ce parfum léger fe rend pourtant
très-fenfible lorfque, félon un ufage fort connu, on
fait infufer à froid quelques feuilles de cette plante
dans du vin ; mais il n’eft pas permis de croire que le
vin chargé de ce principe, & d’une quantité infiniment
petite d’extrait, ait acquis une vertu apéritive
& diurétique ; car la vertu diurétique eft une de celles
qu’on a attribuées à la primprcnelle.
Une autre qualité pour laquelle on l’a beaucoup
celebrée encore, & qui lui a mérité l’épithete de fanguiforba
, c’eft-à-dire capable de repomper ou d’étancher
le fang, c’eft fa prétendue efficacité pour arrêter
les hémorrhagies : je dis prétendue, fans penfer à
rejetter le témoignage des auteurs qui la lui ont attribuée
, & pour exprimer feulement que cette propriété
n’eft point conftatée par des effets journaliers,
par l’ufage.
Les feuilles de pimprenelle entrent dans le firop de
guimauve compofé, ap pellé s ibifeo; dans le firop
de guimauve de Fernel; dans le mondificatif d’ache;
dans l’emplâtre de bétoine ,&c. {b )
Pim p r e n e l l e b l a n c h e ,. {Mat. med.) P im p r e n
e l l e -S à x i f r a g e , Bo u q u e t in e o « B o u c a c e ,
GRANDE & PETITE. F oye^ BOUCACE,
PIN, f. m. {Hijl. nat. Bot.) pinus ; genre de plante
à fleur en chaton, compofée de plufieurs étamines.
Cette fleur eft ftérile : l’embryon naît féparément de
la fleur, & devient dans la fuite un fruit compofé de
feuilles en forme d’écailles, qui ont deux foffes. On
trouve entre ces feuilles deux coques ofleufes , ou
noyaux fouvent aîlés, qui renferment une amande
P I N 629
oblongue. Ajoutez aux carafteres de ce genre, que
les feuilles naiffent par paire, & qu’elles fortent de la
même gaîne. Tournefort, injl. rei herb. Foye^Pl a n t
e .’ ,, ■ /
P in , ( Jardinage. ) pinus, grand arbre toujours
vert, qui fe trouve en Europe & dans l’Amérique
feptentrionale. On connoît plus de vingt efpeces de
pins, qui ont entr’elles des différences fi variées,
qu’il n’eft guere poflible d’en donner une idée fûre
&c fatisfaifante par une defeription générale : il fera
plus convenable de traiter de chacune en particulier.
On les diftingué en; trois claffes , relativement
au nombre des feuilles qui fortent enfemble d’une
gaîne commune; c’eft ce qui les a fait nommer pin
à deux feuilles, pin à trois feuilles, & pin à cinq
feuilles.
I. Pin a deux feuilles. Le pin fauvage ou pin de
Genève, devient un grand arbre fort branchu, dont
le tronc eft court & fouvent tortueux ; fes racines
s’étendent beaucoup plus qu’elles ne s’enfoncent;
fon écorce qui eft grife dans la première jeuneffe
de l’arbre., devieqt rougeâtre à mefure qu’il avance
en âge ; fes feuilles font fermes, piquantes, filamen-
teufes & d’un pouce ou deux de longueur ; leur verdure
eft agréable & uniforme; fes fleurs mâles ou
chatons s’épanouiflent au mois de Mai; fes cônes
commencent à paroître dans le même tems, mais
il ne mûriffent qu’après le fécond hiver ; ils ont environ
un pouce de diamètre au gros bout fur deux
à trois de longueur, ils font pointus, & leurs écailles
font relevées d’éminences Paillantes & recourbées
vers la bafe, qui le rendent rude au toucher.
Cet arbre vient aifément de graine jettée au ha-
fard, il croît affez promptement même dans des
lieux incultes , il ne fe refufe à aucun terrein quel-
qu’ingrat qu’il foit, & il ne faut ni foins ni précautions;
pour le multiplier, ni aucune culture pour
l’élever. Il fe plaît dans les lieux froids , fur les montagnes
& à l’expofition du nord; il réufîit dans les
terreins fecs & légers, pauvres & fuperficiels, il ne
fe refïife ni au fable le plus ftérile, ni à la craie la
plus vive ; il profite également dans, la terre forte &:
humide comme dans la glaife la plus dure ; enfin il
vient partout où le terrein peut avoir trois pouces
d’épaifleur. Cet arbre ne craint point les vapeurs
falines de la mer, il réfifte à l’iropétuofité des vents
& il s’accommode de tous les climats de l’Europe ,
où on le trouve jufqu’aux extrémités de la Laponie.
Le pin de Genève eft peut-être le plus fauvage,
le plus robufte, le plus agrefte & le plus vivace de
tous les arbres, il ne craint ni le froid, ni le chaud,
ni la féchereffe. J’ai tenu pendant cinq ans un pin de
cette efpece, dans un pot de fix pouces de diamètre
; je l’ai toujours laiffé au grand air fans le ferrer
pendant l’hiver, ni l’arrofer dans les plus grandes
léchereffes ; il a bravé toutes les viciflitudes des fai-
fons, & malgré la petiteffe du vafe qui le contenoit,
il s’eft élevé à quatre piés, mais comme fes racines
fortoient du pot, je le fis tranfplanter il y a dix ans
dans un lieu inculte contre un rojeher où il eft plein
de vie & où il fait autant de progrès que s’il y étoit
venu de femence.
On ne peut multiplier cef arbre qu’en femant fes
graines après les avoir tirées des cônes: on doit
etre affuré de leur .maturité, lorfque leur couleur
verte eft devenue rouffâtre, ce qui arrive dans le
mois de Février qui eft le tems propre à les cueillir,
car dès que le hâle de Mars ferait fentir, les cônes
s’ouvrent & les graines font bien-tôt difperfées par
le vent. On peut conferver pendant deux ou trois
ans les cônes fans qu’ils s’ouvrent,'en les tenant
dans un lieu frais, mais exempt d’humidité, ôe
quand on a tiré la graine des cônes, elle garde encore
très-longtems fa vertu produfrrice. J’en ai fait