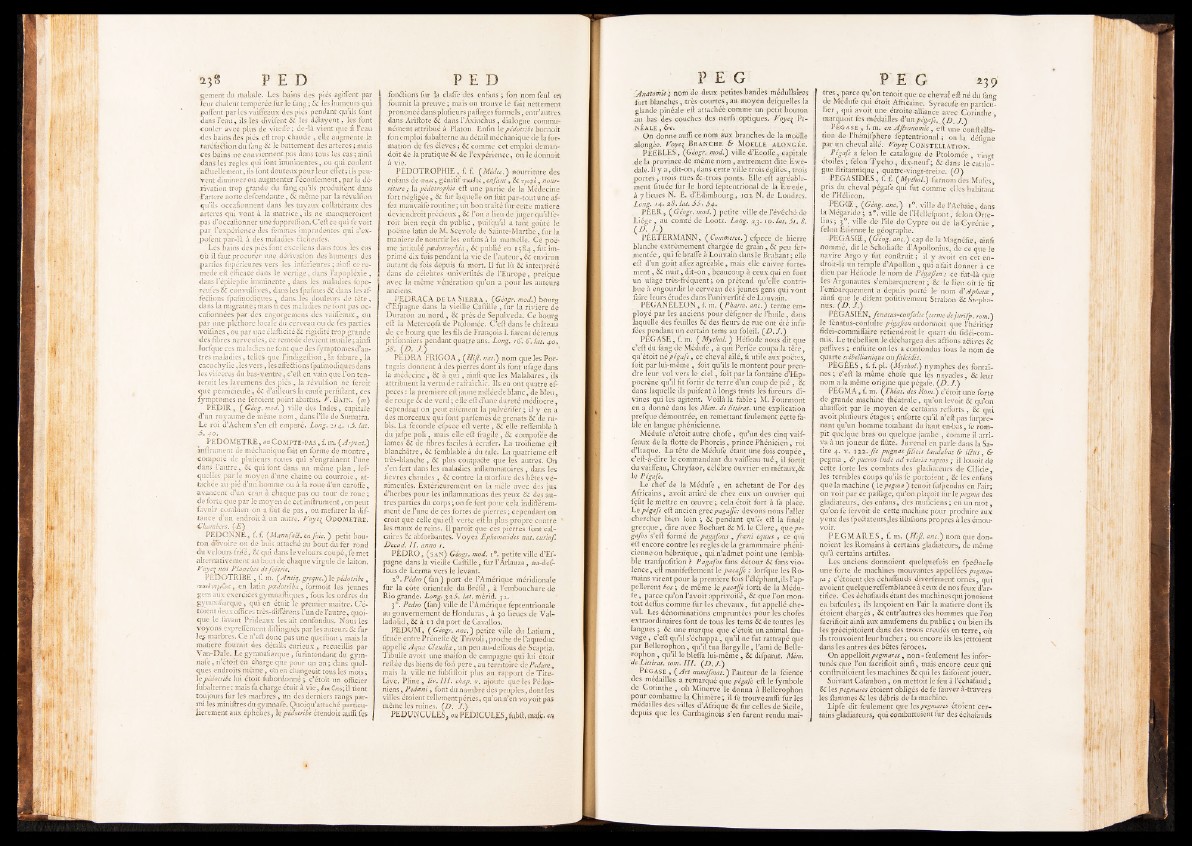
23S P E D
.jgemerit du rtiala’de. Les bains des pies agiflent par
leur chaleur tempérée fur le fang ; ôc les humeurs qui.
Raflent par les vaifîeaux des pies pendant qu’ils font
dans l’eau, ils les divifent & les délayent, les font
couler avec plus de vîteflë ; de-là vient que fi l’eaû
des bains des piés eft trop chaude , elle augmente la
raréfaction du fang & le battement des arteres ; mais
ces bains ne conviennent pas dans tous les cas ; ainfi
dans les réglés qui font imminentes, ou qui coulent
aftuellement, ils font douteux pour leur effet; ils peuvent
diminuer ou augmenter l’écoulement, par la dérivation
trop grande du fang qu’ils produisent dans
i ’artere aorte defcendante, ôc même par la révidfion
qu’ils occafionnent dans les tuyaux collatéraux des
arteres qui vont à la matrice , ils ne manqueroient
-pas d’occafionner -une fuppreffion. C’eft ce qui fe voit
par l’expérience des femmes imprudentes qui s’ex-
.pofent par-là à des maladies facheufes.
Les bains des piés font excellens dans tous les cas
eîi il faut.procurer une dérivation des humeurs des
.parties fupérieures vers les inférieures ; ainfi ce re-
mede eft efficace dans le vertige, dans l’apopléxie ,
dans l’épilepfie imminente , dans les maladies fopo-
reufes ôc convulfives, dans les fpafmes ôc dans les af-
feClions fpafmodiques , dans les douleurs de tête,
dans la migraine ; mais fi ces maladies ne font pas oc-
cafionnées par des engorgemens des vaifleaux, ou
par une pléthore locale du cèrveau ou de fes parties
voifines, ou par une élafiicité ôc rigidité trop grande
des fibres nerveufes, ce remede devient inutile ; ainfi
. lorfqueces maladies ne font que des fymptomes d’autres
maladies, telles que l’indigeftion , la fabure, la
cacochylie, les vers, les affrétions fpafmodiques dans
les vifceres du bas-ventre, c’efi; en vain que l’on ten-
teroit les lavemens des piés , la révulfion ne feroit
que pernicieufe, ôc d’ailleurs la caufe perfifiant, ces
fymptomes ne feroient point abattus. V. Bain* (m)
PEDIR, ( Géog. mod. ) ville des Indes, capitale
d’un royaume de même nom, dans l’île de Sumatra.
Le roi d’Achem s’en eft emparé. Long. 214. i5. lat. 5. 40.
PEDOMETRÊ, ou Com pte-pas , f. m. ( Arpent.)
infiniment de méchanique fait en forme de montre,
^ompofé de plufieurs roues qui s’engrainent l’une
dans l’autre , ôc qui font dans tm même plan , lef-
quelles par le moyen d’une chaine ou courroie-, attachée
au pié d’un homme ou à la roue d’un caroffe,
-avancent d’un cran à chaque pas ou tour de roue;
de forte que par le moyen de cet infiniment, on peut
favoir combien on a fait de pas, ou mefurer la distance
d’un endroit à un autre. Voyez Odometre.
Ghambers. (E )
PEDONNE, f. f. (Manufact. en foie.') petit bouton
düvoire ou de buis attaché au bout du fer rond
du velours frifé., ôc qui dans le velours coupé, fe met
alternativement au bout de chaque virgule de laiton.
Voye^nos Planches de foierie.
PÊDOTRIBE , f. m. (Antiq. grequef), le pêdotribe ,
en latin poedotriba, formoit les jeunes
gens aux exercices gymnaftiques, fous les ordres du
gymnafiarque, qui en étoit le premier maître. C’é-
toient deux offices très-différens l’un de l’autre, quoi- 1
que le favant Prideaux les ait confondus,. Nous les
voyons expreffément diftingués par les auteurs ôc fur 1^ marbres. Ce n’ eft donc pas une queftion ; mais la
matière fournit des détails cu rieuxrecu eillis par
Van-Dale. Le gymnafiarque, furintendant du gym-
nafe, n’étoit en charge que pour un an ; dans quelques
endroits même, o'n en changeoit tous les mois ;
1e pêdotribe lui étoit fubordonné ; c’étoit un officier
fubalterne : mais fa charge étoit à v ie, «T/« Qt014 il tient
toujours fur les marbres, un des derniers rangs parmi
les miniftres du gymnafe. Quoiqu’attaché particulièrement
aux épheoes, Ie_pêdotribe étendoit flïïffil fes
P E D
fondions fur la claffe des enfans ; fon nom feül en
[ fournit la preuve ; mais on trouve le fait nettement
prononcé dans plufieurs pafl'ages formels, entr’autres.
dans Ariftote ôc dans l’Axiuchus, dialogue communément
attribué à Platon. Enfin le pêdotribe bornoit
fon emploi fubalterne au détail méchanique de la formation
de fes éleves ; ôc comme cet emploi deman-
•doit de la pratique ôc de l’expérience , on le donnoit
à vie.
PÉDOTROPHIE , f. f. (Médec. ) nourriture des
enfans de Tacaç, génitif ■ zraiS'oç, enfant , ÔC rpoip>i, nourriture
; la pédotrophie eft une partie de la Médecine
fort négligée, ôc fur laquelle on fuit par-tout une af-
fez mauvaife routine ; un bon traité fur cette matière
deviendroit précieux, ôc l’on a lieu de juger qu’il fe^
roit bien reçu du public, puifqu’il a tant goûté le
poëme latin de M. Scevole de Sainte-Marthe, fur la
maniéré de nourrir les enfans à la mamelle. Cé poëme
intitulé ptzdotrophia, ÔC publié en 1584, fut imprimé
dix fois pendant la vie de l’auteur, ôc environ
autant de fois depuis fa mort. Il fut lu ôc interprété
dans de célébrés -uniVerfités de l’Europe, prefque
avec la même vénération qu’on a pour les auteurs
anciens.
PEDRACA de la Sierra , (Gêogr. mod.) bourg
d’Efpagne dans la vieille Caftille , fur la riviere de
Duraton au n ord, ôc près de Sepulveda. Ce bourg
eft la Metercofade Ptolomée. C’eft dans le château
de ce bourg que les fils de François I. furent détenus
prifonniers pendant quatre ans. Long. /(T. (f. lat. 40»
£8, (D . J.)
PEDRA FRIGOÀ, (Hifl. nat.) nom que les Portugais
donnent à des pierres dont ils font ufage dans
la médecine , & à q u i, ainfi que les Malabares, ils
attribuent la vertu de rafraîchir. Ils en ont quatre ef-
peces : la première eft jaune mélée de blanc, de bleu,
de rouge ôc de verd ; elle eft d’une dureté médiocre,
cependant on peut aifément la piüvérifer ; il y en a
des morceaux qui font parfemés de grenats ôc de rubis.
La fécondé efpece eft ve r te , ôc elle reflemble à
du jafpe p o li, mais elle eft fragile , ôc compofée de
lames ôc de fibres faciles à écralër. La troilieme eft
blanchâtre, ôc femblable à du talc. La quatrième eft
très-blanche, ôc plus compa&e que les autres. On
s’en fert dans les maladies inflammatoires , dans les
fievres chaudes , ôc contre la morfure des bêtes v ë-
nimeufes. Extérieurement on la mêle avec des jus
d’herbes pour les inflammations des yeux ôc des autres
parties du corps ; on fe fert pour cela indifféremment
de l’une de ces fortes de pierres ; cependant on
croit que celle qui eft verte eft la plus propre contre *
les maux de reins. Il paroît que ces pierres font calcaires
ôc abforbantes. Voyez Ephemerides nat. curiof
JDecad. II. anno 1.
PÉDRO, (s an) Gêogr. mod. i°. petite ville d’Efpagne
dans la vieille Caftille, fur l’Arlauza, au-def-
fous de Lerma vers le levant.
z°. Pédro ( fan ) port de l’Amérique méridionale
fur la côte orientale du Bréfil, à l’embouchure de
Rio grande. Long. 32 S. lat. mérid. 32.
30. Pedro (fan) ville de l’Amérique feptentrionale
au gouvernement de Honduras, à 30 lieues de Val-
ladolid, ôc à 11 du port de Cavallos.
PEDUM, ( Gêogr. anc. ) petite ville du Latium,
fituée entre Prénefte ôc T rivoli, proche de l’aqueduc
appelle Aqua Claudia, un peu au-defious de Scaptia.
Tibulle avoit une maifon de campagne qui lui etoit
reftée des biens de fon p ere, au territoire de Pedum,
mais la ville ne fubfiftoit plus au rapport de Tite-
Live. Pline , liv. III. chap. v. ajoute que les Pédoe-
niens, Pedani, font du nombre des peuples, dont les
villes étoient tellement péries, qu’on n’en voyoit pas
même les ruines. (D. J.)
PEDVNCULES, ou PEDICULES, fubft, roafc. en.
P E G
{Anatomie ; nom de deux petites bandés.médullaires
fort blanches, très courtes, au moyen defquelles la
glande pinéale eft attachée comme Un petit bouton
au bas des couches des nerfs optiques. Voye^ Pi-
.NÉALE , & c. . .
On donne auffi ce nom aux branches de la moelle
alongée. Voye[ Branche & Moelle alon g ée.
PÉEBLES, (Gêogr. niod.) ville d’Ecoffe, capitale
.de la province,de même npm, autrement dite Ewe-
dale. Il y a , dit-on, dans cette v ille trois églifes, trôijS
portes, trois tues & trois ponts. Elle eft agréablement
fituée' fur le bord feptentriônal de la Ewedé.,
.à 7 lieues N. E. d’Edimbourg, 102 N. de Londres.
Long. 14. 28. lat. 55. 64.
PÉER, ( Gêogr. mod. ) petite ville de l’évêché de
Liège , au Comté de Lootz. Long. 23. io.Iat, St. 8.
B S H D
PEETERMANN, (Commerce.) efpece de bierre
blanche extrêmement chargée de grain , ôc peu fermentée
, qui fe braffe à Louvain dans le Brabant ; elle
eft d’un goût affez agréable, mais elle enivre fortement,
ôc nuit, dit-on , beaucoup à ceux, qui en font
un ufage très-fréquent ; on prétend qu’elle contribue
à engourdir le cerveau des jeunes gens qui vont
faire leurs études dans l’tiniverfité de Louvain.
PÉGANÉLÉON, f. m. (Pharrn. anc.) terme employé
par les anciens pour défigner de l’huile, dans
laquelle des feuilles ôc des fleurs de rue ont été infii-
fées pendant un certain tems au foleil, (D . J .)
PÉGASE, f. m. ( Mythol. ) Héfiode nous dit que
c’eft du fang de Médufe , à qui Perfée coupa la tête,
qu’étoit né pêgafe, ce cheval aîlé, fi utile aux poëtes,
foit par lui-même , foit qu’ils le montent pour prendre
leur vol vers le c ie l, foit par la fontaine d’Hip-
pocrène qu’il fit fortir de terre d’un coup de pié , ôc
dans laquelle ils puifent à longs traits les fureurs divines
qui les agitent. Voilà la fable ; M. Fourmont
en. a donné dans les Mêm. de littêrat. une explication
prefque démontrée, en remettant feulement cette fable
en langue phénicienne.
Médufe n’étoit autre chofe , qu’un des cinq vaiffeaux
de la flotte de Phorcis, prince Phénicien, roi
d’itaque. La tête de Médufe étant une fois coupée ,
c’eft-a-dire le commandant du vaifleau tu é , il fortit
du vaifleau, Chryfaor, célébré ouvrier en métaux,&
le Pêgafe.
Le chef de la Médufe , en achetant de l’or des
Africains , avoit attiré de chez eux un ouvrier qui
fçût le mettre en oeuvre ; cela étoit fort à fa place.
Le pêgafe eft ancien grecpagaffe: devons nous l’aller
chercher bien loin ; ôc pendant qu’c? eft la finale
grecque, dire avec Bochart & M. le Clerc, que pe-
gafos s’ eft formé de pagafous , frani equus , ce qui
eft encore contre les réglés de la grammmaire phénicienne
ou hébraïque, qui n’admet point une femblable
tranfpofition ? Pagafos fans détour ôc fans vio- ■
_ lence, eft manifeftement le pacaffe : lorfque les Romains
virent pour la première fois l’éléphant,ils l’ap-
Çellerent bos ; de même le pacaffe forti de la Méduf
e , parce qu’on l’avoit apprivoilé, ôc que l’on mon-
toit defliis comme fur les chevaux, fi.it appellé cheval.
Les dénominations empruntées pour les chofes
extraordinaires font de tous les tems ôc de toutes les
langues ; ôc une marque que c’étoit un animal fau-
vage , c’eft qu’il s’échappa, qu’il ne fut rattrapé que
par Bellerophon, qu’il tua Bargylle, l’ami de Belle-
rophon , qu’il le blefla lui-même , ôc difparut. Mêm.
de JLittêrat. tom. I II. (D . J.)
Pégase , ( Art numifmat.) l’auteur de la fcience
■ des médaillés a remarqué que pêgafe eft le fymbole
de Corinthe , oh Minerve le donna à Bellerophon
pour combattre la Chimère ; il fe trouve auffi fur les
médaillés des villes d’Afrique Ôc fur celles de Sicile,
depuis que les Carthaginois s’en furent rendu maî-
P E G *39
très, parce qu’on tenoit que ce cheval eft né du fang
de Medufe qui etoit Africaine. Syracufe en particu-
her , qui avoit une étroite-alliance avec ' Corinthe ,
marcpioit fes médailles d’un pêgafe,^ (D. J.)
PEGASE , 1. m. en AJlronomie, eft une conftella-
tion de l’hémifphere feptentriônal ; on la défi »ne
par un cheval aîlé. C onstellation. °
Pègafe a félon le catalogue de Ptolomée , vingt
■ étoiles ; félon Tycho , dix-nèuf; ôc dans le catalogue
Britannique, quatre-vingt-treize. (O)
PÉGASIDES f. fi. ( Mythol.) furnom des Mufes,
pris du cheval pêgafe. qui fut comme elles habitant
de l’Hélicon.
PEGCE , (Géog. anc.) i° . ville de l’Achaïe, dans
la Mégaride ; 20. ville de l’Hellefpont, félon Orte-
lius; 3°. ville de l’île de Cypre ou de lâ Cyrénie ,
félon Etienne le géographe.
PEGASGE, (Gêog. anc.) cap de la Magnéfie, ainfi
nommé, dit le Scholiafte d’Apollonius, de ce que le
navire Argo y fut conftruit ; il y avoit en eèt endroit
là un temple d’Apollon, qui a fait donner à ce
dieu par Héfiode lënom de Pègajîen : cê fut-là que
les Argonautes s’embarquèrent ; ôc le lieu oh fe fit
l’embarquement a depuis porté le nom ÜAphetoe ,
ainfi que le- difent pofitivement Strabon &Stepha-
-nus. (D . J .) *
PÉGASIEN, fenatus-confulte (terme de jurifp. rom.)
le fénatus-confulte ptgafien ordonnoit que l’héritier
fidei-commiflaire retiendroit le quart du fidéi-com-
mis. Le trébellien le déchargea des actions aétives ôc
paffives ; enfuite on les a confondus fous le nom de
quarte trébellianique ou falcidie.
PÉGÉES , f. f. pl. (Mythol.) nymphes des fontaines
; c’eft la même chofe que les nayades, ôc leur
nom a la même origine que pêgafe. (D. J.)
PÉGMA, f. m. (Tkéat. des Rom.) c’étoit une forte
de grande machine théâtrale, qu’on levoit & qu’on
abaifloit par le moyen de certains refforts , ôc qui
avoit plufieurs étages ; enforte qu’il n’eft pas furpre-
nant qu’un homme tombant du haut en-bas, fe rompit
quelque bras ou quelque jambe , domme il arriva
à un joueur de flûte. Juvénal en parle dans la Satire
4. v. 122. fie pugnas fîlicis laudabat & ictus, &
pegma , & pueros inde ad velaria raptos ; il louoit de
cette forte les combats des gladiateurs de Cilicié,
les terribles coups qu’ils fe portoient, ôc les enfans
que la machine ( le pegma ) tenoit fufpendus en Pair;
on voit par ce paflage, qu’on plaçoit fiir le pegma des
gladiateurs, des enfans, des muficiens; en un mot,
qu’on fe fervoit de cette machine pour produire aux
yeux des fpeûateurs,les illufions propres à les émouvoir.
''
P EGM A R E S , fi m. (Hift. anc.) nom que don-
noient les Romains à certains gladiateurs, de même
qu’à certains artiftes.
Les anciens donnoient quelquefois en fpeéiacle
une forte de machines mouvantes appellées pegma-
ta ; c’étoient des échaftauds diverfement ornés , qui
avoient quelque reflemblance à ceux de nos feux d’artifice.
Ces échafauds étant des machines qui jouoient
en bafcules ; ils lançoient en l’air la matière dont ils
étoient chargés, ôc entr’autres des hommes que l’on
facrifioit ainfi aux amufemens du public ; ou bien ils
les précipitoient dans des trous creufés en terre, oil
ils trouvoient leur bûcher ; ou encore ils les jettoient
dans les antres des bêtes féroces.
On appelloit pegmares, non - feulement les infortunés
que l’on facrifioit ainfi, mais encore ceux qui
conftruifoient les machines ôc qui les faifoient jouer.
Suivant Cafaubon, on mettoit le feu à l’échafaud ;
ôc les pegmares étoient obligés de fe fauver à-travers
les flammes ôc les débris de la machine.
Lipfe dit feulement que les pegmares étoient certains
gladiateurs, qui combattoient fur des échafauds