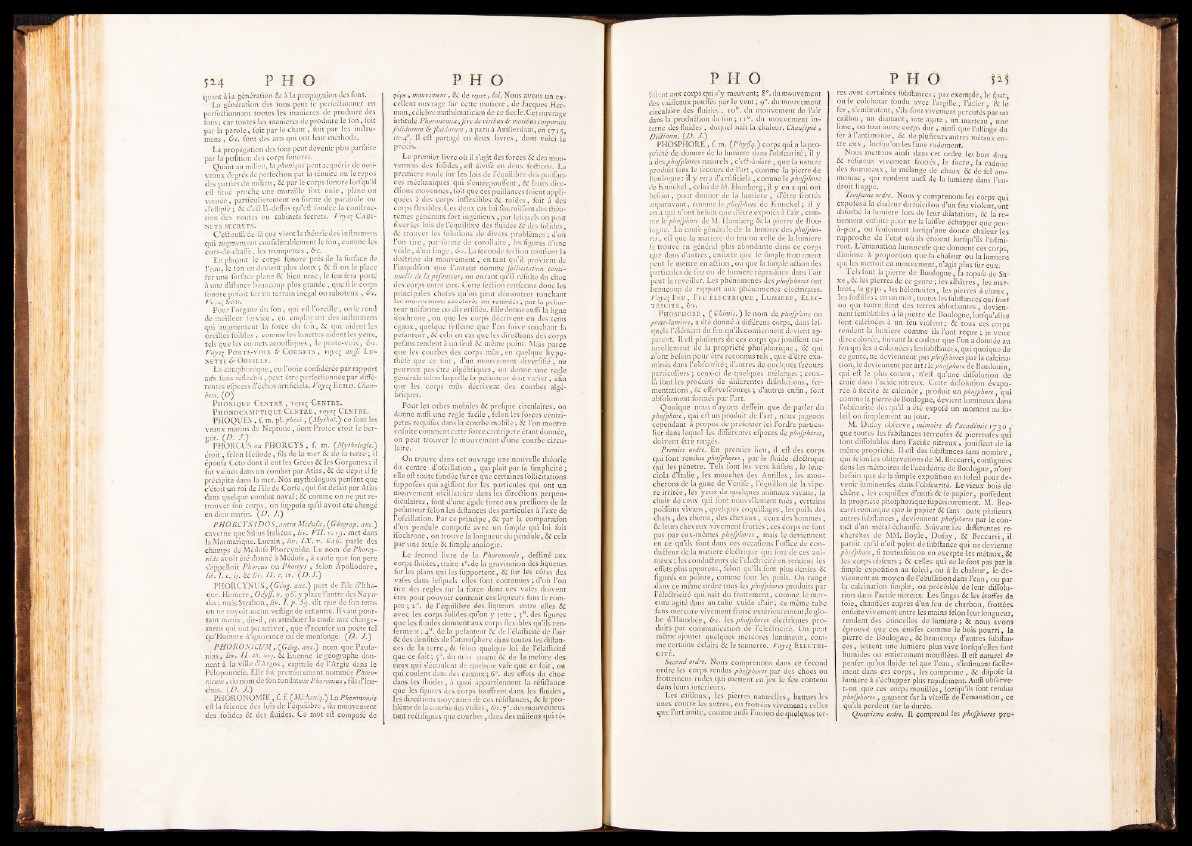
m p h o
quant à la génération & à la propagation dés fonS.
La génération des fons peut le perfe&ionner en
perfeéîionnant toutes les maniérés de produire des
fons ; car toutes les maniérés de produire le fon, foit
par la parole, foit par le chant, foit par les inftru-
mens , &c. font des arts qui ont leur méthode.
La propagation des fons peut devenir plus parfaite
par la poution des corps fonores.
Quant au milieu, la phonique peut acquérir de nouveaux
degrés de perfe&ion par la ténuité ou le repos
des parties du milieu, 6c par le corps fonore lorfqu’il
eft fitué proche une muraille fort unie, plane ou
voûtée, particulièrement en forme de parabole ou
d’ellipfe ; 6c c’eft là-deffus qu’eft fondée la conftruc-
tion des voûtes ou cabinets fecrets. Vyye^ C a b i n
e t s s e c r e t s .
• C ’eft auffi de-là que vient la théorie des inftrumens
qui augmentent conlidérablement le fon, comme les
cors-de-chafl'e, les trompettes, &c.
En plaçant le corps fonore près de la furface de
Veau, le fon en devient plus doux ; & fi on le place
fur une furface plane 6c bien unie, le fon fera porté
à une diftance beaucoup plus grande, que fi le corps
fonore pofoit fur un terrain inégal ou raboteux, &c.
Voye{ S o n .
Pour l’organe du fon , qui eft l’oreille , on le rend
de meilleur fervice, en employant des inftrumens
qui augmentent la force du fon, 6c qui aident les
oreilles foibles , comme les lunettes aident les yeux,
tels que les cornets acouftiques , le porte-voix, &c.
Voye^ P o r t e -v o i x & C o r n e t s , voye^ aujji L u n
e t t e 6 O r e i l l e .
La c a ta p h o n iq u e , o u l’o u ie co n fid é r é e p a r r a p p o r t
aifa fo n s r é f lé c h is , p eu t ê t r e p e r fe f t io n n e u p a r d iffé r
en te s e fp e c e s d ’ é ch o s a r t ific ie ls . Viye{E c h o . Charniers.
(O)
P h o n i q u e C e n t r e , voye^ C e n t r e .
P h o n o c à m p t i q u e C e n t r e , voyei C e n t r e .
PHOQUES , f. m. pl.pkoci, (Mythol.) ce font les
veaux marins de Neptune, dont Protée étoit le berger.
(Z>. J.)
PHORCUS ou PHORCYS , f. m. (Mythologie.)
étoit, félon Héfiode, fils de la mer 6c de la terre ; il
époufa Céto dont il eut les Grées 6c les Gorgones ; il
fiit vaincu dans un combat par Atlas, & de dépit il fe
précipita dans la mer. Nos mythologues penfent que
c’étoit un roi de Pile de Corfe, qui fut défait par Atlas
élans quelque combat naval ; 6c comme on ne put retrouver
fon corps, on fuppofa qu’il avoit été changé
en dieu marin. ( D. /.)
PHORCYNIDOS, antra Medufce, (Géograp. anc.')
caverne qùè Silius Italicus , liv. VIL v. 19. met dans
la Marmarique. Lucain, liv. IX . v. 6%G. parle des
champs de Médufe Phorcynide. Le nom de Phorcynide
avoit été donné à Médufe, à caufe que fon pere
s’appclloit Phorcus ou Phorcys , félon Apollodore,
lib. I. c. i f 6c liv. IL c. iv. (D .J .)
PHORCYNUS, ( Géog. anc.") port de l’île d’Ithaque.
Homere, Odyjf. v .gG .y place l’antre des Naya-
des ; mais Strabon, liv. I. p. 5$. dit que de fon tems
on ne voyoit aucun veftige de cet antre. Il vaut pourtant
mieux, dit-il, en attribuer la caufe aux change-
mens qui ont pu arriver, que d’accufer un poëte tel
qu’Homere d’ignorance ou de menfonge. (D . J.)
PHORON1CUM, {Géog. anc.') nom que Paufa-
nias, liv. IL ch. xvj. 6c Etienne le géographe donnent
à la ville d’Argoscapitale de l’Argie dans le
Péloponnèfe. Elle fut premièrement nommée Phoro•
nicurn, du nom de fon fondateur Phoronius, fils d’Ina-
chus.. (D . J.)
PHORONOMIE , f. f. (Mcchaniq.) La Phoronomie
eft la fcience des lois de l’équilibre, du mouvement
.des .folides 6c des fluides. Ce mot eft çompofé de
P H O
çopa y mouvement, &c de vopoç, loi. Nous avons un excellent
ouvrage fur cette matière, de Jacques Herman*
célébré mathématicien de ce liecle. Cet ouvrage
intitulé Phoro nomia ,five de viribus & motibus corporurn
folidorum & jhtidorum, a paru à Amfterdam,en 1715
in-40. Il eft partagé en deux livres, dont voici le
précis.
Le premier livre oit il s’agit des forces 6c des mou-
vemens des'folides, eft divifé en deux feélions. La
première roule fur les lois de l’équilibre des pu i flan-
ces méchaniques qui s’entrepouffent, & leurs dire-
éfions moyennes, foit que ces puiflances foient appliquées
à des corps inflexibles &: roides, foit à des
corps flexibles. Ces deux cas lui fourniffent des théorèmes
généraux fort ingénieux, par lefquels on peut
fixer les lois de l’équilibre des fluides 6c des folides ,
6c trouver les folutions de divers problèmes ; d’où
l’on tire, par forme de corollaire, les figures d’une
vo ile, d’un linge, &c. La fécondé feclion contient la
do 61 ri ne du mouvement, en tant qu’il provient de
l’impulfion que l’auteur nomme JblUcitation continuelle
de lapefauteur, ou entant qu’il réfulte du choc
des corps entre eux. Cette feéfion renferme donc les
principales chofes qu’on peut démontrer touchant
les mouvemens accélérés ou retardés, par la pefan-
teur uniforme ou diverfifiée. Elle donne auili la ligne
ifochrone , ou que les corps décrivent en des tems
égaux, quelque fyftème que l’on fuive touchant la
pefanteur, 6c cela en cas que les direéfions des corps
pefans tendent à un feul 6c même point. Mais parce
que les courbes des corps mus, en quelque hypo-
thèfe que ce foit, d’un mouvement diverfifié ne
peuvent pas être algébriques, on donne une réglé
générale ièlon laquelle la pefanteur doit v arier, afin
que les corps mus décrivent des courbes algébriques.
Pour les orbes mobiles & prefque circulaires, on
donne auffi une réglé facile , félon les forces centripètes
requifes dans la courbe mobile; 6c l’on montre
enfuite comment cette force centripète étant donnée,
on peut trouver le mouvement d’une courbe circulaire.
On trouve dans cet ouvrage une nouvelle théorie
du centre d’ofcillation , qui plaît par fa fimplicité ;
elle eft toute fondée fur ce que certaines follicitations
fuppofées qui agiffent fur les particules qui ont un
mouvement ofcillatoire dans les dire&ions perpendiculaires
, font d’une égale force aux preflions de la
pefanteur félon les diftances des particules à l’axe de
l’ofcillation. Par ce principe, 6c par la comparaifon
d’un pendule compofé avec un fimple qui lui foit
ifochrone, on trouve la longueur du pendule, 6c cela
par une feule 6c fimple analogie.
Le fécond livre de la Phoronomie, deftiné aux
corps fluides, traite i°. de la gravitation des liqueurs
fur les plans qui les fupportent, 6c fur les côtes des
vafes dans lefquels elles font contenues ; d’où l’on
tire des réglés fur la force dont ces vafes doivent
être pour pouvoir contenir ces liqueurs fans fe rompre
; 20. de l’équilibre des liqueurs entre elles 6c
avec les corps folides qu’on y jette ; 30. des figures
que les fluides donnent aux corps flexibles qu’ils renferment;
40. de la pefanteur 6c de l’élafticité de l’air
& des denfités de l’atmofphere dans toutes les diftances
de la terre, & félon quelque loi de l’élafticité
que ce foit; 50. du mou ement 6c de la mefure des
eaux qui s’écoulent de quelque vafe que ce foit, ou
qui coulent dans des canaux ; 6°. des effets du choc
dans les fluides, à quoi appartiennent la réfiftance
que les figures des corps iouffrent dans les fluides,
les direélions moyennes de ces réfiftances, & le problème
de la courbe des voiles j &c. 70. des mouvemens
tant reétilignes que courbes, dans des milieux qui ré-
P H O
fiftent aux corps qui s’y meiiVent; 8°. du mouvement
dés vaiffeaux poufles parle vent; 90. du mouvement
circulaire des fluides ; io°. du mouvement de l’air
dans la produéiion du fon ; 1 1v. du mouvement interne
des fluides , duquel naît la chaleur. Chaufepié ,
Diclionn. (D . J.)
PHOSPHORE, f. m. (Phyjîq.) corps qui a la propriété
de donner de la lumière dans l’obfcurité ; il y
a des phofphores naturels , c’eft-à-dire, que la nature
produit fans le fecours de l’art, comme la pierre de
Boulogne : il y en a d’artificiels, comme le phofphore
de Kunckel, çelui de M. Homberg; il y en a qui ont
befoin, pour donner de la lumière , d’être frottés
auparavant, comme le phofphore de Kunckel; il y
en a qui n’ont befoin que d’être expofés à l’air, comme
le phofphore de M. Homberg 6c la pierre de Boulogne.
La caufe générale de la lumière des phofphores,
eft que la matière du feu ou celle de la lumière
fe trouve en général plus abondante dans ce corps
que dans d’autres, enforte que le fimple frottement
peut le mettre en aélion, ou que la fimple attion des
particules de feu ou de lumière répandues dans l’air
peut la reveiller. Les phénomènes des phofphores ont
beaucoup de rapport aux phénomènes électriques.
Voye{ F e u , F e u é l e c t r i q u e , L u m i è r e , É l e c t
r i c i t é , &c.
P h o s p HORÉ , ( Chimie. ) le nom de phofphore ou
porte-ltimiere, a été donné à différens corps, dans lefquels
l’élément du feu qu’ils contiennent devient apparent.
Il eft plufieurs de ces corps qui jouiffent naturellement
de la propriété phofphorique, 6c qui
n’ont befoin pour être reconnus tels, que d’être examinés
dans l’obfcurité ; d’autres de quelques fecours
particuliers ; ceux-ci de quelques mélanges ; ceux-
là font les produits de différentes diffolutions, fermentations
, 6c effervefcences ; d’autres enfin, font
abfolument formés par l’art.
Quoique nous n’ayons deffein que de parler du \
phofphore, qui eft un produit de l’a r t , nous jugeons
cependant a propos de préfenter ici l’ordre particulier
dans lequel les différentes efpeces de phofphores,
doivent être rangés.
Premier ordre. En premier lieu, il eft des corps
qui font rendus phofphores, par le fluide éleétrique
qui les pénétré. Tels font les vers luifans, le leuc-
ciola d’Italie, les mouches des Antilles, les moucherons
de la gune de Venife, l’éguillon de la vipère
irritée, les yeux de quelques animaux vivans, la
chair de ceux qui font nouvellement tués , certains
poiffons vivans, quelques coquillages, les poils des
chats, des chiens, des chevaux, ceux des hommes,
6c leurs cheveux vivement frottés ; ces corps ne font
pas par eux-mêmes phofphores , mais le deviennent
en ce qu’ils font dans ces occafions l’office de con-
duéieur de, la matière éleririque qui fort de ces animaux
; les condufteurs de l’eleclricité en rendent les
effets plus apparens, félon qu’ils font plus denfes 6c
figurés en pointe, comme font les poils. On range
dans ce même ordre tous les phofphores produits par
l’éleélricité qui naît du frottement, comme-le mercure
agité dans un tube vuide d’air ; ce même tube
fans mercure vivement frotté extérieurement;le globe
d’Hauxbée, &c. les phofphores éleélriques produits
par communication de l’éleélricité. On peut
meme ajouter quelques météores lumineux, comme
certains éclairs 6c le tonnerre. Voye^ E l e c t r i c
i t é .
Second ordre. Nous comprenons dans ce fécond
ordre les corps rendus phofphores par des chocs ou
frottemens rudes qui mettent en jeu le feu contenu
dans leurs intérieurs.
Les cailloux, les pierres naturelles, battues les
imes contre les autres, ou frottées vivement ; celles
que 1 art imite, comme auffi l’union de quelques terp
h o m
res avec certaines fubftaiices.; par exempiè, lé fpat>'
ouïe eolchotar fondu aVéc l’argille, l’acier; & lô
fer, s embraient, s ils font vivement percutés par un
caillou, un diamant, une agate, un marteau , une
lime, ou tout autre corps dur * ainfi que l’alliage du
fer à l’antimoine, 6c de plufieurs autres métaux entre
eu x , lorfqu’on les lime rudement.
Nous mettons ainfi dans cet ordre les bois durs
6c réfineux vivement frottés; lé fucré, la cadmie
des fourneaux, le mélange de chaux 6c de fel ammoniac
, qui rendent auffi de la lumière dans l’endroit
frappé.
Troifieme ordre. Nous y comprenons les corps qui
expofés à la cnaleur du foleil ou d’un feu violent, ont
abforbe la lumière lors de leur dilatation, & la retiennent
enfuite pour ne la laiffer échapper que peu-
à-peu, ou feulement lorfqu’une douce chaleur les
rapproche de l’etat où ils étoient lorfqu’iis l’admirent.
L émanation lumineufe que donnent ces corps,
diminue , à proportion que la chaleur ou la lumière
qui les mettoit en mouvement, n’agit plus fur eux:
Tels font la pierre de Boulogne, la topafe de Saxe
, 6c les pierres de ce genre ; les albâtres, les marbres,
le gyps , les belemnites, les pierres à chaux,
les foffilles ; en un mot, toutes les fubftances qui font
ou qui fourniffent des terres abforbantes, deviennent
femblables à la pierre de Boulogne, lorfqu’elles
font calcinées à un feu violent ; 6c tous ces corps
rendent la lumière comme ils l’ont reçue ; je veux
dire colorée, fuivant la couleur que l’on a donnée au
feu qui les a calcinées ; les fubftances, qui quoique de
ce genre, ne deviennent pas phofphores par la calcination,
le deviennent par art : le phofphore de Baudouin,
qui eft le plus connu, n’eft qu’une diffolution de
craie dans l’acide nitreux. Cette diffolution évaporée
à ficcité & calcinée, produit un phofphore, qui
comme la pierre de Boulogne, devient lumineux dans
l’obfcurité dès qu’il a été expofé un moment au foleil
ou fimplement au jour*
M. Dufay obferve, mémoire de C académie ty^o
que toutes les fubftances terreufes 6c pierreufes qui
font diffolubles dans l’acide nitreux, jouiffent de la
même propriété. Il eft des fubftances fans nombre,
qui félon les obfervations de M. Beccarri, confignées
dans les mémoires de l’académie de Boulogne, n’ont
befoin que de la fimple expofition au foleil pour devenir
lumineufes dans Pobfcurité. Le vieux bois de
chêne , les coquilles d’oeufs & le papier, poffedent
la propriété phofphorique fupérieurement. M. Beccarri
remarque que le papier 6c fans oute plufieurs
autres fubftances, deviennent phofphores par le con-
ta& d’un métal échauffé. Suivant les différentes recherches
de MM. Boyle, D u fay , 6c Beccarri, il
• paroît qu’il n’eft point de fubftance qui ne devienne
phofphore, fi toutesfois on en excepte les métaux, &
les corps obfcurs ; 6c celles qui ne le font pas par la
fimple expofition au foleil, ou à la chaleur, le deviennent
au moyen de l’ébullition dans l’eau, ou par
la calcination fimple, ou précédée de leur diffolution
dans l’acide nitreux. Les linges 6c les étoffes de
foie, chauffées auprès d’un feu de charbon, frottées
enfuite vivement entre les mains félon leur longueur,
rendent des étincelles de lumière ; & nous avons
éprouvé que ces étoffes comme le bois pourri, la
pierre de Boulogne, 6c beaucoup d’autres fubftances
, jettent une lumière plus vive lorfqu’elles font
humides ou entièrement mouillées. Il eft naturel de
p enfer, qu’un fluide tel que l’eau, s’infinuant facilement
dans ces corps, les comprime , & difpofe la
lumière à s’échapper plus rapidement. Auffi obferve-
t-on que ces corps mouilles, lorfqù’ils font rendus
phofphores, gagnent fur la vîteffe de l’émanation, ce
qu’ils perdent fur la durée.
Quatrième ordre. Il comprend les phofphores prer-*