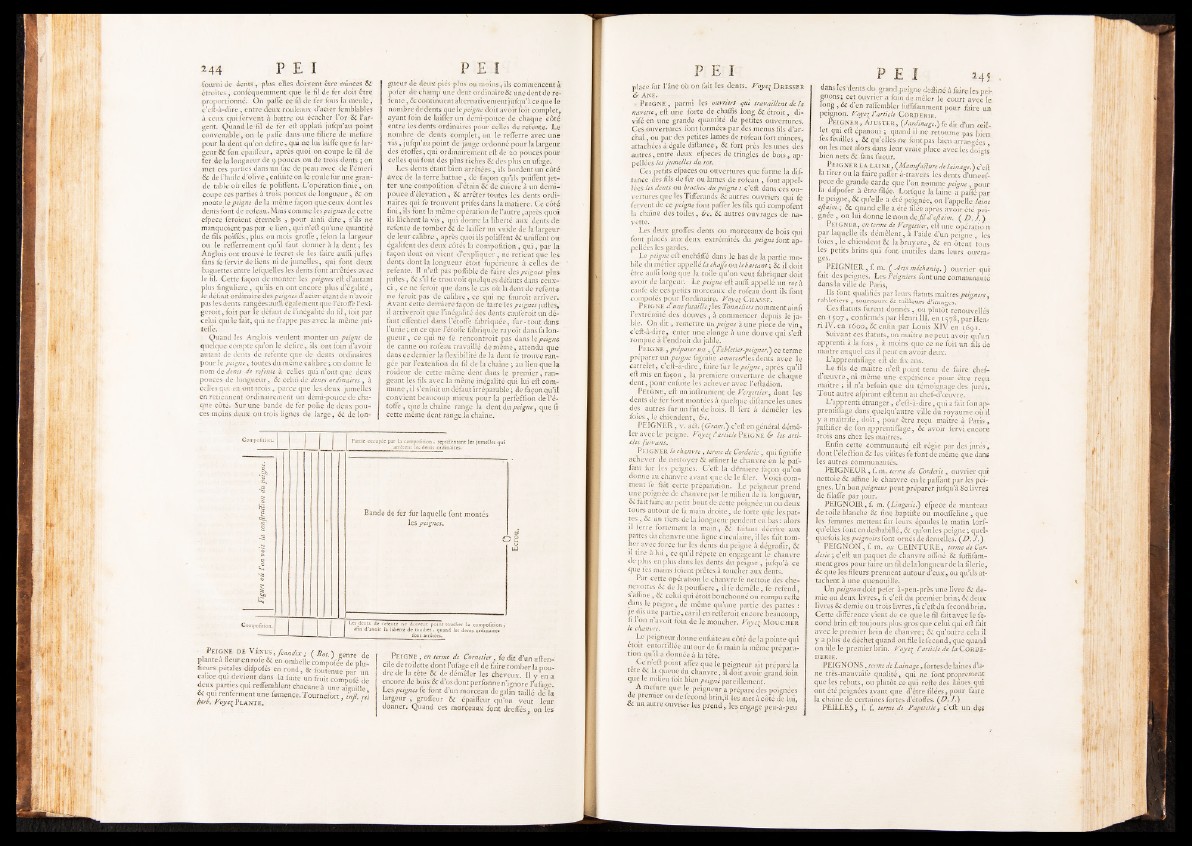
fourni de dents, plus elles doivent être minces 6c
étroites, conféquemment que le fil de fer doit être
proportionné. On paffe ce fil de fer fous la meule,
c’eft-à-dire , entre deux rouleaux d’acier femblables
à ceux qui fervent à .battre ou écacher l’or & l’argent.
Quand le fil de fer eft applati jufqu’au point
convenable, on le paffe dans une filiere de mefure
pour la dent qu’on defire, qui ne lui laiffe que fa lar-’
geur 6c fon ëpaiffeur, après quoi on coupe le fil de
fer de la longueur de 9 pouces ou de trois dents ; on
met ces parties dans un fac de peau avec de l’émeri
& de l’huile d’o live, enfuite on le roule fur une grande
table où elles fe poliffent. L’opération finie, on
coupe ces parties à trois pouces de longueur, 6c on
monte le peigne de la même façon que ceux dont les
dents font de rofeau. Mais comme les peignes de cette
efpece feroient éternels pour ainfi dire, s’ils ne
manquoient pas par e lien, qui n’ eft qu’une quantité
de fils poiffés, plus ou mois groffe, félon la largeur
ou le reflërrement qu’il faut donner à la dent ; les
Anglois ont trouvé le fecret de les faire auffi juftes
fans fe fervir de liens ni de jumelles, qui font deux
baguettes entre lefquelles les dents font arrêtées avec
le fil. Cette façon de monter les peignes eft d’autant
plus finguliere, qu’ils en ont encore plus d’égalité,
le défaut ordinaire des peignes d’acier étant de n’avoir
pas les dents rangées aufli également que l’étoffe l’exi-
geroit, foit par le défaut de l’inégalité du fil, foit par
celui qui le fait, qui ne frappe pas avec la même juf-
teffe.
Quand les Anglois veulent monter un peigne de
quelque:compte qu’on le defire, ils ont foin d’avoir
autant de dents de refente que de dents ordinaires
pour le peigne, toutes du même calibre ; on donne le
nom de dents de refente à celles qui n’ont que deux
pouces de longueur, 6c celui dé dents ordinaires, à
celles qui en ont trois , parce que les deux jumelles
en retiennent ordinairement un demi-pouce de chaque
côté. Sur une bande de fer polie de deux pouces
moins .deux ou trois lignes de large, & de Iongüeur
de deux piés plus o» moins, ils commencent à
poler de champ une dent ordinaire & une dent de refente
, 6c continuent alternativement jufqu’à ce que le
nombre de dents que le peigne doit avoir loit complet,
ayant foin de laiffer un demi-pouce de chaque côté
entre les dents ordinaires pour celles de refente. Le
nombre de dents complet, on le refferre avec une
v is , jufqu’au point de jauge ordonné pour la largeur
des étoffes, qui ordinairement eft de zo pouces pour
celles qui font des plus riches 6c des plus en ufage.
Les dents étant bien arrêtées, ils bordent un côté
avec de la terre.battue, de façon qu’ils puiffent jet-
ter une compofition d’étain &c de cuivre à un demi-
pouce d’élévation , 6c arrêter toutes les dents ordinaires
qui fe trouvent prifes dans la matière. Ce côté
fini, ils font la même opération de l’autre, après quoi
ils lâchent la vis , qui donne la liberté aux dents de
refente de tomber 6c de laiffer un vuide de la largeur
de leur calibre, après quoi ils poliffent 6c unifient ou
égalifent des deux côtés la compofition , q u i, par la
façon 'dont 011 vient d’expliquer , ne retient que les
dents dont la longueur étoit fupérieure à celles de
refente. Il n’eft pas pofîible de faire des peignes plus
juftes, 6c s’il fe trouvoit quelques défauts dans ceux-
ci , ce ne feroit que dans le cas où la dent de refente
ne feroit pas de calibre, ce qui 11e fauroit arriver.
Avant cette derniere façon de faire les peignes juftes,
il arriveroit que l’inégalité des dents cauferoit un défaut
effentiel dans l’étoffe fabriquée, fur - tout dans
l’unie ; en ce que l’étoffe fabriquée rayoit dans fa longueur
, ce qui ne fe rencontroit pas dans le peigne
de canne ou rofeau travaillé de meme, attendu que
dans ce dernier la flexibilité de la dent fe trouve rangée
par l’extenlion du fil de la chaîne ; au lieu que la
roideur de cette même dent dans le premier, rangeant
les fils avec la même inégalité qui lui eft commune
, il s’enfuit un défaut irréparable ; de façonqu’il
convient beaucoup mieux pour la perfeûion deTé-
toffe , que la chaîne range la dent du peigne, que fi
cette même dent rangera chaîne.
c “ poli,ic,n- 1 1 1 1 P artie occupée par la compolîcion, repréfencanc le* jum elles qui
Sa
h a
%
0
« ^0
. â j
Bande de fer fur laquelle font montés
les peignes.
c °",,or“io-
Les dents de reiénee n e doivent p o int toucher la com polîcion,'
afin d ’avoir la liberté de to m b er, quand les dents ordinaires
fo n t arrêtées.
feigne de V enus, feandix; ( Bot.) genre
plante à fleur en rofe 6c en ombelle compofée de t
-lieurs petales'xhfpofés en rond, & foutenue par
calice.qui devient dans la fuite un fruit compofé
deux parties qui reffemblent chacune à une ai«ui
& qui renferment une femence. Tournefort ïnft.
fitri. Voyi^ l'LANTE. J '
Peigne , en terme de Cornaier, fe dit d’un uften-
cile de toilette dont.l’ufage eft de faire tomber la poudre
de la tête & de démêler les cheveux. Il y en a
encore de buis & d’os dont perforine n’ignore l’ufaee.
Les peignes fe font d’un morceau degalin taillé de là
bifgeur ^gtoffeur & épaiffeur qu’on veuf leur
donner. Quand ces morceaux font dreffés, on les
place fur l ’âne où on fait les dents. Voye^ D resser
& Ane,
• Peigne , parmi les ouvriers qui travaillent de la
navette, eft une forte de chaffis long & étroit, di-,
vifé en une grande quantité de petites ouvertures.
Ces ouvertures font formées par des menus fils d’ar-
chal, ou par des petites lames de rofeau fort minces,
attachées à égale diftance, & fort près les unes des
autres, entre deux efpeces de tringles de bois, ap-
pellées les jumelles du rot.
Ces petits efpaces ou ouvertures que forme la diftance
des fils de fer ou lames de rofeau , font appell
e s les dents ou broches du peigne : c’eft dans ces ouvertures
que les Tifferands 6c autres ouvriers qui fe
fervent de ce peigne font paffer les fils qui compofent
la chaîne des toiles, &c. 6c autres ouvrages de navette.
Les deux groffes dents ou morceaux de bois qui
font'placés aux deux extrémités du peigne font app
elles les gardes.
Le peigne eft enchâffé dans le bas de la partie mobile
du métier appellé la chajfe ou le battant ; & il doit
être auffi long que la toile qu’on veut fabriquer doit
avoir de largeur. Le peigne eft auffi appelle^ un rot à
caufe de ces petits morceaux de rofeau dont ils font
compofés pour l’ordinaire. Voye^ C hasse.
Peigne d'une futaille jles TonneLiers nomment ainfi
l’extrémité des douves , à commencer depuis le ja-
ble. On d it , remettre un peigne à une piece de vin,
c’eft-à-dire, enter une alonge à une douve qui s’eft
rompue à l’endroit du jable.
Peigne , préparer un , ( Tabletier-peigner.) ce terme
préparer un peigne lignifie amorcer*les dents avec le
carrelet, c’eft-à-dire, faire fur le peigne, après qu’il
eft mis en façon , la première ouverture de chaque
dent, pour enfuite les achever avec l’eftadiou.
Peigne, eft un inftrument de Vergettier, dont les
dents de fer font montées â quelque diftancejles unes
des autres fur un fut de bois. Il fert à démêler les
foies , le chiendent, &c.
PEIGNER, v. a£h (Gram.) c’eft en général démêler
avec le peigne. Voye^ l'article Peigne & les articles
fuivans.
Peigner le chajivre, terme de Çorderie , qui lignifie
achever de nettoyer & affiner le chanvre en le paf-
fant fur les peignes, C’eft la derniere façon qu’on
donne au chanvre avant que de le filer. Voici comment
fe fait cette préparation. Le peigneur prend
une poignée de chanvre par le milieu de fa longueur,
& fait faire au petit bout de cette poignée,un ou deux
tours autour de fa main droite, de forte que les pattes
, 6c un tiers de la longueur pendent en bas : alors
il ferre fortement la main, 6c failant décrire aux
pattes du chanvre une ligne circulaire, il les fait tomber
avec force fur les dents du peigne à dégroffir, &
il tire à lu i, ce qu’il répété en engageant le chanvre
de plus en plus dans les dents du peigne , jufqu’à ce
que fes mains foient prêtes à toucher aux dents.
Par cette opération le chanvre fe nettoie des che-
nevottes 6c de là pouffiere, il fe démêle, fe refend,
s affine, 6c celui qui étoit bouchonné ou rompu refte
dans le peigne, de même qu’une partie des pattes :
je dis une partie , car il en refteroit encore beaucoup,
fi 1 on n’avoit foin de le moucher. Voyez Moucher
le chanvre.
, peigneur donne enfuite au côté de la pointe qui
etoit entortillée autour de fa main la même préparation
qu’il a donnée à la tête.
: g P°‘nt affez que le peigneur ait préparé la
tete & la queue du chanvre, il doit avoir grand foin
que le milieu foit bien peigné pareillement.
A mefure que le peigneur a préparé des poignées
de premier ou de fécond brin,il les met à côté de lui,
& un autre ouvrier les prend, les engage peu-à-peu
«faaslesSfentsdu grand,peigne.defonê A {aire les pei-,
gnons; cet ouvrier a foin de mêler le court avec le
long , & d’en raffembler fuffifamment pour faire un
peignon. Voye^ l'article Çorderie.
, Peign er, A juster, fe d;t d>un oe;j.
Jet qui eft épanoui ; quand il ne retourne pas bien
fes feuilles , & qu’elles ne font pas bien arrangées
on les met alors dans leur vraie place avec les doigts
bien nets & fans, fueur.
PEIGNER LA laine , (^Manufacture de lainage.) c’eft
la tirer ou la faire paffer à-travers les dents d’uneef-
pece de grande carde que l’on nomme peigne , pour
la difpoler à être filée. Lorfque la laine a paffe par
le peigne, & qu’eue a été peignée, on l’appelle laine
eftaimr, 6c quand elle a été filée après avoir été pei-
gnee , on lui donne le nom de f i l d'eflaim. ( D. J. )
Peigner, en terme de Vîrgetrier, eft une opératio n
par laquelle ils démêlent, à l’aide d’un peigne , les
foies , le chiendent 6c la bruyere, 6c en ôtent tous
les petits brins qui font inutiles dans leurs ouvrages.
PEIGNIER, f. m. ( Arts méchaniq, ) ouvrier qui
fait des peignes. Les Peigniers font une communauté
dans la ville de Paris,
Ils font qualifiés par leurs ftatuts maîtres ptigners,
tabletiers , tourneurs 6c tailleurs d’images.
Ces ftatuts furent donnés , ou plutôt renouvelles
en 1507, confirmés par Henri III. en 1578, par Hen?
ri IV. en 1600, 6c enfin par Louis XIV en 1691.
Suivant ces ftatuts, un maître ne peut avoir qu’un
apprenti à la fois , à moins que ce ne foit un fils de
maître auquel cas il peut en avoir deux.
L’apprentiffage eft de. fix ans..
Le fils de maître n’eft point tenu de faire chef-
d’oeuvre, ni. même une expérience pour être reçu
maître ; il n’a befoin que du témoignage des jurés.
Tout autre afpirant eft tenu au chef-d’oeuvre.
L’apprenti étranger, c’eft-à-dire, qui a fait fon ap-
prentiffage dans quelqu’autre ville du royaume où il
y amaîtrife, do it, pour être reçu maître , à Paris ,
juftifier de fon apprentiffage, 6c avoir fervi encore
trois ans chez les maîtres.
Enfin cette communauté eft régie par des jurés
dont l’éle&ion 6c les vifites fe font de même que dans
les autres communautés.
PEIGNEUR, f. m. terme de Çorderie, ouvrier qui
nettoie 6c affine le chanvre en le paffant par les peignes.
Un bon peigneur peut préparer jufqu’à 80 livres
de filaffe par jour.
PEIGNOIR, f. m. (Lingerie.) efpece de mânteau
de toile blanche 6c fine baptifte ou mouffeline , que
les femmes mettent fur leurs épaules le matin lorf-
qu’elles font en deshabillé, 6c qu’onles peigne; quelquefois
les peignoirs font ornés de dentelles. (Z>. ƒ.),
PEIGNON , f. m. ou CEINTURE, terme de Cor-
derie ; c’eft un paquet de chanvre affiné 6c fuffifamment
gros pour faire un fil de la longueur de la filerie,
6c que les fileurs prennent autour d’eux, ou qu’ils attachent
à une quenouille.
Un peignon doit pefer à-peu-près une livre 6c demie
ou deux livres, fi c’eft du premier brin; 6c deux
livres & demie ou trois livres, fi c’eft du fécond brin.
Cette différence vient de ce que le fil fait avec le fécond
brin eft toujours plus gros que celui qui eft fait
avec le premier brin de chanvre ; 6c qu’outre cela il
y a plus de déchet quand on file le fécond, que quand
on file le premier brin. Voye^ l'article de la Corde-
DERIE.
PEIGNONS, terme de Lainage, fortes de laines d’une
très-mauvaife qualité, qui ne font proprement
que les rebuts, ou plutôt ce qui refte des laines qui
ont été peignées avant que d’être filées, pour faire
la chaîne de certaines fortes d’étoffes. (Z?. /.)
PEILLES, f, f, terme de Papeterie 7 c’eft un dçs