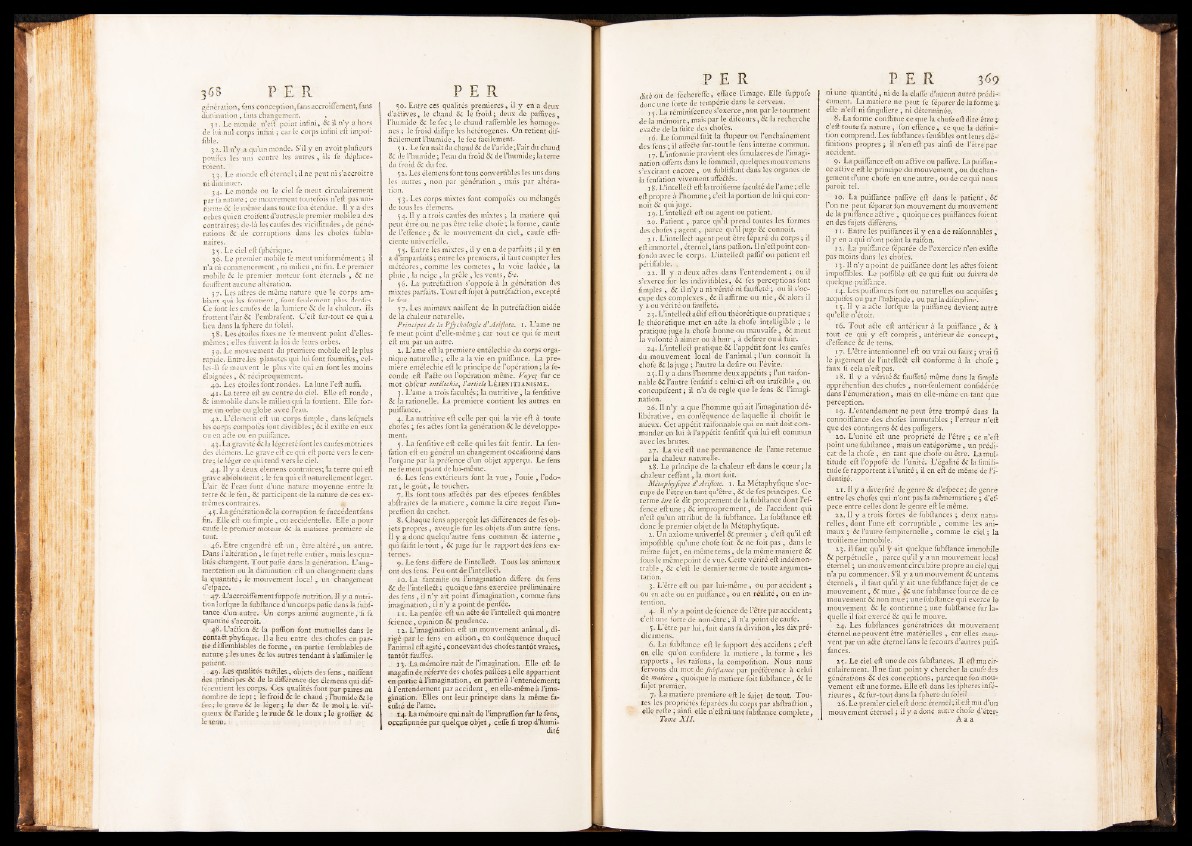
génération, fans conception,fans accroiffement,fans
diminution, fans changement.
3 1. Le monde n’ eft point infini, & il n’y a hors
de lui nul corps infini ; car le corps infini eft impof-
lible.
3 z. Il n’y a qu’un monde. S’il y en avoit plufieurs
pouffés les uns contre les au tre s , ils fe deplace-
roient.
3 3. Le monde eft éternel ; il ne peut ni s’accroître
n i d iminuer.,
3 4. Le monde ou le c ie l fe meut circulairement
par fa nature ; ce mouvement toutefois n’eft pas uniforme
& le même dans toute fon étendue. Il y a des
orbes quien cvoilèntd’autres;le premier mobile a des
contraires ; d e-là les caules des v icilîitudes, de générations
& de corruptions dans les chofes fublu-
naires.
3 y L e ciel eft fphérique.
36. L e premier mobile fe meut uniformément ; il
n’a ni commencement, ni m ilieu , ni fin. Le premier
mobile & le premier moteur font éternels , & ne
fouiïrent aucune altération.
37. Les aftres de même nature que le corps ambiant
qui les fou tien t, font feulement plus denfes.
C e font les caiifes de la lumière & de la chaleur. Ils
frottent l’air & l’embrafent. C ’eft fur-tout ce qui a
lieu dans la fphere du foleil.
38. Les étoiles fixes ne fe meuvent point d’elles-
mêmes ; e lles fuivent la loi de leurs orbes.
3 9. L e mouvement du première mobile eft le plus
rapide. Entreies planètes qui lui font loumifes, celles
là fe meuvent le plus vîte qui.en font les moins
éloignées, & réciproquement.
40. Le s étoiles font rondes. La lune l’ eft auffi.
4 1 . La terre eft au centre du ciel. Elle eft ron d e ,
& immobile dans le milieu qui la foutient. Elle fo rme
un o rb e o u globe av ec l’eau.
4 1 . L’élément eft un corps fimple, dans lefquels
les corps compofés font divilibles ; & il exifte en eux
ou en a â e ou en puiflance.
43. La g ravité & la légèreté font les caufes motrices
des élémens. L e grave eft ce qui eft porté vers leoen-
t r e ; le léger ce qui tend vers le ciel.
44. Il y a deux élemens contraires; la terre qui eft
grave ablolument ; le feu qui eft naturellement léger.
L ’air & l’eau font d’une nature mo yenne entre la
terre & le feu , & participent de la nature de ces e x trêmes
contraires.
45. L a génération & la '.corruption fe fuccédentfans
fin. Elle eft ou fimple, ou accidentelle. Elle a pour
caufe le premier moteur & la matière première de
tout.
4 6 . Etre engendré eft u n , être a lté r é , un antre.
Dans l’altération, le fujet refte entie r, mais les qualités
changent. T o u t pafiè dans la génération. L’augmentation
ou la diminution eft un changement dans
la quantité le mouvement lo c a l , un changement
d’elpace.
47. L ’accroiftementfuppofe nutrition. Il y a nutrition
lorfque la fiibftance d’un corps paffe dans la iiibf-
tance d’un-autre. Un corps anime augmente,'fi fa
quantité s’accroît.
48. L’aÔion & la paftion font mutuelles dans le
c o n ta â phyfique. Il a lieu entre des ohofes en partie
dMembiables de fo rm e , en partie femblables de
nature ; ;les unes & les .autres tendant à s’afiimiler le
patient. ' |
49. Les qualités taâ iles., objets des fe n s , naifient
des principes & de la différence des élemens qui diffé
r e n t ent les corps. C e s qualités font p a r paires an
nombre de fept ; le froid & le chaud ; l’humide & le
fe c ; de g ra v e & le lé g e r ; le -dur & de mo l:; le. vif-
queux & l’aride ; le rude & le doux ; le greffier &C
le tenu.
50. Entre ces qualités premières, il y en a deux
d’aétrves, le chaud & le froid ; deux de paffives,
l’humide & le fec ; le chaud raffemble les homogènes
; le froid diffipe les hétérogènes. On retient difficilement
l’humide, le fec facilement.
51. Le feu naît du chaud & de l’aride ; l’air du chaud
{te de l’humide ; l’eau du froid & de l’humide; la terre
du froid & du fec.
52. Les élemens font tous convertibles les 11ns dans
les autres , non par génération , mais par altération.
53. Les corps mixtes font compofés ou mélangés
de tous les élemens.
54. Il y a trois caufes des mixtes ; la matière qui
.peut être ou ne pas être telle chofe ; la forme, caufe
de l’eflence ; & le mouvement du ciel, caufe efficiente
univerfelle.
5 5. Entre les mixtes, il y en a de parfaits ; il y en
a d’imparfaits ; entre les premiers , il faut compter les
météores, comme les cometes , la voie la â é e , la
pluie, la neige , la grêle , les vents, &c.
56. La putréfaâion s’oppofe à la génération des
mixtes parfaits. Tout eft fujet à putréfaâion, excepté
le feu.
57. Les animaux naiffent de la putréfaâion aidée
de la chaleur naturelle.
Principes de la Pfychologie d'Arijlote. 1. L’ame ne
fe meut point d’elle-même ; car tout ce qui fe meut
eft mu par un autre.
2. L’ame eft la première entélechie du corps organique
naturelle ; elle a la vie en puiflance. La première
entélechie eft le principe de l’opération ; la fécondé
eft l’aâe ou l'opération même. Voye^ fur ce
mot obfcur entélechie, Varticle LÉIBNITIANISME.
3. L’ame a trois facultés ; la nutritive, la fenfitive
& la rationelle. La première contient les autres en
puiflance.
4. La nutritive eft celle par qui la vie eft à toute
chofes ; fes aâes font la génération & le développement.
5. La fenfitive eft celle qui les fait fentir. La fen-
fation eft en général un changement occafionné dans
l’organe par la préfence d’un objet apperçu. Le fens
ne fe meut peint de lui-même.
6. Les fens extérieurs font la vu e , l’ouie , l’odo-»
rat, le goût, le toucher.
7. Ils font tous affeâés par des efpeces fenfibles
abftraites de la matière, comme la cire reçoit l’im-
preffion du cachet.
8. Chaque fens apperçoit les différences de fes objets
propres , aveugle fur les objets d’un autre fens.
Il y a donc quelqu’autre fens commun & interne,
qui faifit le tou t, & juge fur le rapport des fens externes.
9. Le fens différé de l’intelleâ. Tous les animaux
ont des fens. Peu ont de l’intelleâ.
10. La fantaifie ou l’imagination différé du fens
& de l’intelleâ ; quoique fans exercice préliminaire
des fens , il n’y ait point d’imagination, comme fans
imagination, il n’y a point de penfée.
11. La penfée eft un a â e de l’intelleâ qui montre
fcience, opinion & prudence.
12. L’imagination eft un mouvement animal, dirigé
par le fens en a â io n , en conféquence duquel
l’animal eft agité, concevant des chofes tantôt vraies,
tantôt fauffes.
. 13. La mémoire naît de l’imagination. Elle eft le
magafin de réferve des chofes paffées ; elle appartient
en partie à l’imagination, en partie à l’entendement;
à l’entendement par accident, en elle-même à l’imagination.
Elles ont leur principe dans la même faculté
de l’ame.
14. La mémoire qui naît de l’impreffion fur le fens,
occafionnée par quelque objet, ceffe û trop d’humidité
P E R
Aitè ou de ' féchereffe, efface finage. Elle jfuppofe
donc une forte de teinpérieidans le cerveau. : !
15. La réminifcence s’exerce, non par le tourment
de la mémoire, mais par le difeours, & la recherche
exaâe de la fuite des^ chofes.
16. Le fommeilfuit la ftupeur ou l’enchaînement
des fens • il affeâe fur-tout le fens interne commun.
17. L’infomnie provient des fimulacres de l’imagination
offerts dans lé fommeil, quelques mouvemens
s’excitant encore , ou fubfiftant dans les organes de
la fenfation vivement affeâés.
.18. L’intelleâ eft la troifieine faculté de l’ame ; elle
eft propre à l’homme ; c’eft la portion de lui qui con-
noît & qui juge.
19. L’intelleâ eft ou agent ou patient.
20. Patient , parce qu’il prend toutes les formes
des chofes ; agentpa rce; qu’il juge {te connoît.
21. L’intelleâ agent peut être féparé du corps ; il
eft immortel, éternel, fans paffion. Il n’eftpoint confondu
avec le corps. L’intelleâ paffif ou patient eft
périffable. *
22. Il y a deux aâes dans l’entendement ;. ou il
s’exerce fur les indivifibles, & fes perceptions font
Amples , & il n’y a ni vérité ni fauflêté ; ou il s’occupe
des complexes, & il affirme ou n ie , & alors il
y a ou vérité ou fauffeté. • . : >
23. L’intelleâ a â if eftonthéorétique ou pratique ;
le théorétique met en aâe la chofe intelligible ; le
pratique juge la chofe bonne ou mauvaife, & meut
la volonté à aimer ou à haïr , à defirer ou à fiiir.
24. L’intelleâ pratique &: l ’appétit font les caufes
du mouvement local de l’animal ; l’un connoît la
chofe & la juge ; l’autre la defire ou l’évite.-
2 5. Il y a dans l’homme deux appétits ; l’un raifon-
nable & l ’autre fenfitif : celui-ci eft ou irafcible, cm
concupifcent ; il n’a de réglé que le fens & l’imagination.
26. Il n’y a que l’homme qui ait l’imagination délibérative
, en conféquence de laquelle il choifit le
mieux. Cet appétit raifonnable qui en naît doit commander
en lui à l’appétit fenfitir qui lui eft commun
avec les brutes.
27. La vie eft une permanence de l’ame retenue
par la chaleur naturelle.
28. Le principe de la chaleur eft dans le coeur ; la
chaleur ceffant, la mort fuit.
Métaphyjîque d'Ariftote. 1. La Métaphyfique s’occupe
de l’être en tant qu’être, & de fes principes. Ce
terme être fe dit proprement de la fubftance dont l’effence
eft une; & improprement, de l’accident qui
n’eft qu’un attribut de la fubftance. La fuhftance eft
. donc le premier objet de la Métaphyfique.
2. Un axiome univerfel & premier ; c’eft qu’il eft
impoffible qu’une chofe foit & ne foit pas , dans le
même fujet, en même tems, de la même maniéré &
. fous le même point de vue. Cette vérité eft indémontrable
, & c’eft le dernier terme de toute argumentation.
3. L’être eft ou par lui-même , ou par accident ;
ou en aâe ou en puiflance, ou en réalité, ou en intention.
4. Il n’y a point de fcience de l’être par accident ;
c’eft une forte de non-être ; il n’a point de caufe.
5. L’être par lui, fuit dans fa divifion, les dix pré-
dicamens.
6. La. fubftance eft. le fupport des accidens ; c’eft
en elle qu’on confidere la matière , la forme , les
rapports , les raifons, la compofition. Nous nous
fervons du mot de fubftance par préférence à celui
de matière , quoique la matière foit fubftance , & le
fujet premier.
7. La matière première eft le fujet de tout. Tou-
• tes les propriétés féparées du corps par abftraâion ,
elle, refte ; ainfi elle n’eft ni une fubftance complété,
Tom e X I I .
P E R 369
ni une quantité, ni de la clafle d*aiicun autre prédi-:
cament. La matière ne peut fe féparer de la forme *<:
elle n’eft ni flnguliere , ni déterminée.
8. La forme conftitue ce que la chofe eft dite être ;>
c’eft toute fa nature , Ton effence, ce que la définition
comprend. Les fubftances fenfibles ont leurs dé-;
finitions propres ; il n’en eft pas ainli de l’être par
accident.
- 9. La puiflance eft ou aâive ou paffive. La puiffan-
ce aâive eft le principe du mouvement, ou du changement
d’une cnofé en une autre, ou de ce qui nous
paroît tel. .
10. La puiflance paffive eft dans le patient, Sc
l’on ne peut féparer fon mouvement du mouvement
de la puiflance a âive , quoique ces puiffances foient
en des fujets différens.
11. Entre les puiffances il y en a de raifonnables ,’
il y en a qui n’ont point la raifon.
12. La puiflance féparée de l’exercice n’en exifte
pas moins dans les chofes.
13. Il n’y a point de puiflance dont les aâes foient
impoflibles. Le poflîble eft ce qui fuit ou fuivra de
quelque puiflance.
14. Les puiffances font ou naturelles ou acquifes ;
acquifes ou par l’habitude, ou par la difcipline.
15. Il y a aâe lorfque la puiflance devient autre
qu’elle n’étoit.
16. Tout aâe eft antérieur à la puiflance , & à
tout ce qui y eft compris, antérieur de concept,
d’effence & de tems.
17. L’être intentionnel eft ou vrai ou faux ; vrai fi
le jugement de l’intelleâ eft conforme à la chofe ;
faux fi cela n’eft pas.
18. Il y a vérité & fauflêté même dans la fimple
appréhenfion des chofes , non-feulement confidérée
dans l’énumération, mais en elle-même en tant que
perception.
19. L’entendement ne peut être trompé dans la
connoiflance des chofes immutables ; l’erreur n’eft
que des contingens & des paffagers.
20. L’unité eft une propriété de l’être ; ce n’eft
point une fubftance , mais un catégorème, un prédicat
de la chofe , en tant que choie ou être. La multitude
eft l’oppofé dé l’unité. L’égalité & la fimili-
tude fe rapportent à l’unité ; il en eft de même de l’identité.
21. Il y a diverfité de genre & d’elpece ; de genre
entre les chofes qui n’ont pas la même matière ; d’elpece
entre celles dont le genre eft le même.
22. II y a trois fortes de fubftances ; deux naturelles
, dont l’une eft corruptible , comme les animaux
; & l’autre fempiternelle, comme le ciel ; la
troifieme immobile.
23. Il faut qu’il y ait quelque fuhftance immobile
& perpétuelle , parce qu’il y a un mouvement local
éternel ; un mouvement circulaire propre au ciel qui
n’a pu commencer. S’il y a un mouvement & un tems
éternels, il faut qu’il y ait une fubftance fujet de ce
mouvement, & mue , & une fubftance fource de ce
mouvement & non mue ; une fubftance qui exerce le
mouvement & le contienne ; une fubftance fur laquelle
il foit exercé & qui le mouve.
24. Les fubftances génératrices du mouvement
éternel ne peuvent être matérielles , .car elles meuvent
par un aâ e éternel fans le feçours d’autres puiffances.
25. Le ciel eft une de ces fubftances. Il eftmucir-
culairement. Ilne faut point y chercher la-caufe des
générations & des conceptions, parce que fon mouvement
eft une forme. Elle eft dans les fpheres inférieures
, & fur-tout dans la fpherè duToleil.
26. Le premier ciel eft donc éternel ; il eft mu d’un
mouvement éternel ; il y a donc autre chofe d’éter-
1 A a a