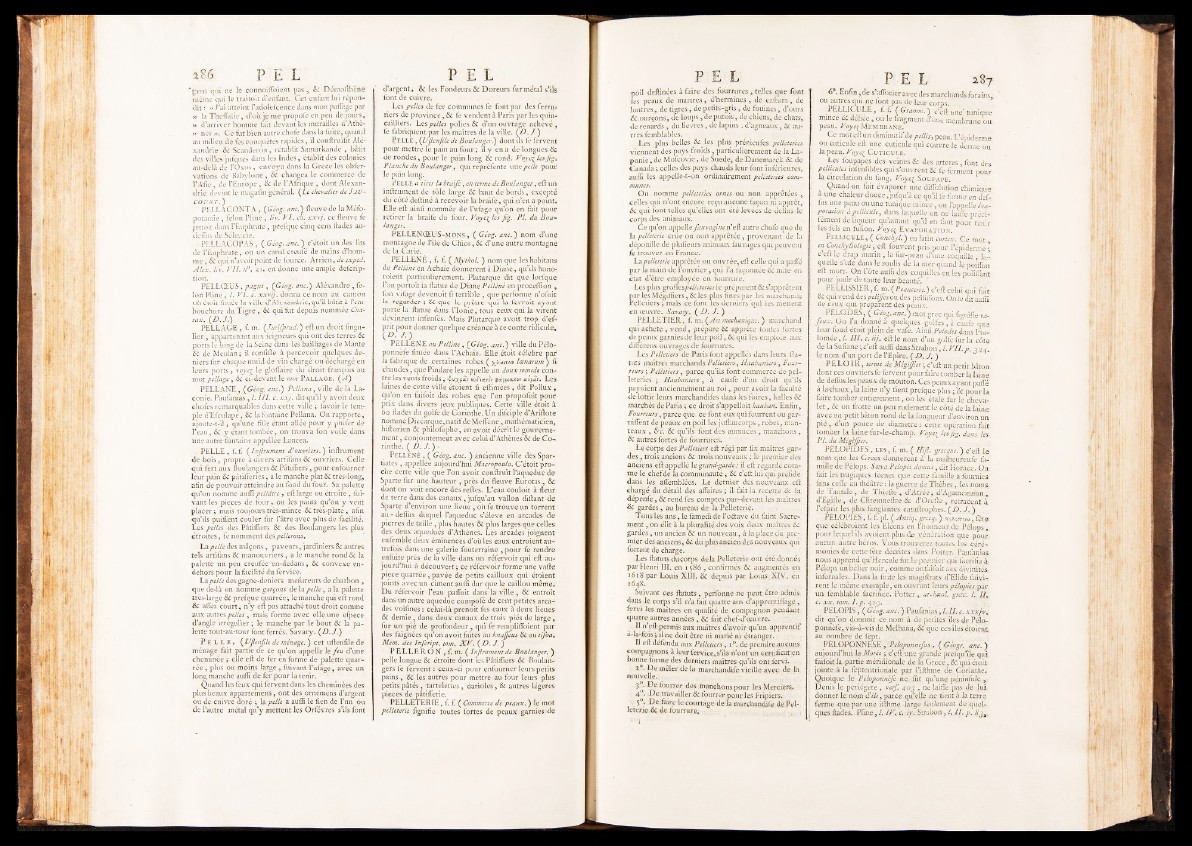
'gens qui ne le connoiftoient pas , 6c Démofthène
même qui le traitoit d’enfant. Cet enfant lui répondit
: » J’ai atteint l’adolefcence dans mon paflage par
» la Theffalie, d’oh je me propofe en peu de jours,
»> d’arriver homme fait devant les murailles d’Àthe-
» nés ». Ce fi.it bien autre chofe dans la fuite, quand
au milieu de fes conquêtes rapides, il conftruifit Alexandrie
6c Scanderon , rétablit Samarkande , bâtit
des villes jufques dans les Indes, établit des colonies
au-delà de l’Oxus, envoya dans la Grece les obfer-
vations de Babylone, & changea le commerce de
l’Afie de l’Europe , & de l’Afrique , dont Alexandrie
devint le magafin général. (Le chevalier de Ja u -
c o u r t . )
PELLACONTA, (Géog. anc.) fleuve de la Méfo-
potamie , félon Pline , liv. VI. ch. xxvj. ce fleuve fe
jettoit dans l’Euphrate, pfefque cinq cens ftades au-
defliis de Séleucie.
PELLACOPAS , ( Géog. anc. ) c’étoit un des lits
de l’Euphrate, ou un canal creufé de mains d’homme
, & qui n’avoit point de fource. Arrien, de exped.
Alex. liv. VII. n°. 21. en donne une ample defcrip-
tion.
PELLCEUS, pagus , (Géog. anc.') Aléxandre , félon
Pline , /. VI. c. xxvij. donna ce nom au canton
oh étoit fituée la ville d’Alexandrie,qu’il bâtit à l’embouchure
du Tigre , 6c qui fut depuis nommée Cha-
rax. (D .J .)
PELLAGE, f. m. (Jurifprud.) eft un droitfingu-
lier , appartenant aux feigneurs qui ont des terres &
ports le long de la Seine dans les bailliages de Mante
6c de Meulanj il confifte à percevoir quelques de-,
niers fur chaque muid de vin chargé ou déchargé en
leurs ports, voye^ le gloflaire du droit françois au
mot pellage , 6c ci-devant le mot Pa llag e. (A )
PELLANE, (Géog. anc.) Pellana, ville de la Laconie.
Paufanias, /. I II. c. x x j. dit qu’il y avoit deux
c.hôfes remarquables dans cette ville ; favoir le temple
d’Efculape, & la fontaine Pellana. On rapporte,
ajoute-t-il, qu’une fille étant allée pour y puifer de
l’eau, & y étant tombée, on trouva fon voile dans
une autre fontaine appellée Lancea.
PELLE , f. f. ( Infiniment d'ouvriers. ) infiniment
de bois, propre à divers artifans 6c ouvriers. Celle
qui fert aux Boulangers 6c Pâtifliers, pour enfourner
leur pain 6c pâtifferies, a le manche plat 6c très-long,
afin de pouvoir atteindre au fond du four. Sa palette
qu’on nomme aufîi pellâtre, eft large ou étroite, fui-
vant les pièces de four, ou les pains qu’on y veut
placer ; mais toujours très-mince 6c très-plate, afin
qu’ils puiffent couler fur l’âtre avec plus de facilité.
Les pelles des Pâtifliers 6c des Boulangers les plus
étroites, fe nomment des pellerons.
La pelle des mâçons, paveurs, jardiniers 6c autres
tels artifans 6c manouvriers, a le manche rond 6c la
palette un peu creufée en-dedans, 6c convexe en-
dehors pour la facilité du fervice.
La pelle des gagne-deniers mefureurs de charbon ,
que de-là on nomme garçons de la pelle, a la palette
très-large 6c prefque quarrée; le manche qui eft rond
& affez court, n’y eft pas attaché tout droit comme
aux autres pelles , mais forme avec elle une efpece
d’angle irrégulier ; le manche par le bout 6c la palette
tout-au-tour font ferrés. Savary. (D . J.)
P e l l e , {Ufiinfd. de ménage. ) cet uftenfile de
ménage fait partie de ce qu’on appelle le feu d’une
cheminée ; elle eft de fer en forme de palette quar-
f é e , plus ou moins large , fuivant l’ufage, avec un
long manche aufli de fer pour la tenir. V
Quand les feux qui fervent dans les cheminées des
plus beaux appartemens, ont des ornemens d’argent
ou de cuivre doré ; la pelle a aufli le fien de l’un ou
de l’autre métal qu’y mettent les Orfèvres s’ils font
d’argent, 6c les Fondeurs & Doreurs fur métal s’ils
font de cuivre.
Les pelles de fer communes fe font par des ferni»
riers de province, & fe vendent à Paris par les quin*
cailliers. Les pelles polies & d’un ouvrage achevé,
fe fabriquent par les maîtres de la ville. (D . J .)
P elle , (Uflenfile de Boulanger.) dont ils fe fervent
pour mettre le pain au four ; il y en a de longues &
de rondes, pour le pain long 6c rond. Voye^ les figk
Planche du Boulanger, qui repréfente unt pelle pour
le pain long.
Pelle à tirer la braife, en terme de Boulanger, eft uri
infiniment de tôle large 6c haut de bords, excepté
du côte deftiné à recevoir la braife, qui n’en a point*
Elle eft ainfi nommée de l’ufage qu’on en fait pour
retirer la braife du four. Voye^ les fig. PI. du Boulanger.
PELLEN(EUS-m o ns , ( Géog. anc.) nom d’une
montagne de l’île de Chios, 6c d’une autre montagne
de la Carie;
PELLENÉ , f. f. ( Mythol. ) nom que les habitans
de Pelléne en Achaïe donnèrent à Diane, qu’ils hono-*
roient particulièrement. Plutarque dit que lorfque
l’on portoit la ftatue de Diane Pelléné en proceflion ,
fon vifage devenoit fx terrible , que perfonne n’ofoit
la regarder ; 6c que le prêtre qui la fervoit ayant
porté la ftatue dans l’Ionie, tous ceux qui la virent
devinrent infenfés. Mais Plutarque avoit trop d’ef*
prit pour donner quelque créance à ce conté ridicule.
( O . y . ) ,ï- . -
PELLENE ou Pellitu , (Géog. anc.) ville du Pélô->
ponnèfe fituée dans l’Achaie. Elle étoit célébré par
la fabrique de certaines robes ( x^ctlvm écenarum ) fi
chaudes, que Pindare les appelle un doux remede contre
les vents froids, ~^vxpHv tuS'utvci> <pa.pp.uKor aopctv. Les
laines de cette ville étoient fi eftimées , dit Pollux ,
qu’on en faifoit des robes que l’on propofoit pour
prix dans divers jeux publiques. Cette ville étoit à
60 ftades du golfe de Corinthe. Un difciple d’Ariftote
nommé Dicéarque, natif de Meflene, mathématicien,
hiftorien 6c philofophe, en avoit décrit le gouvernement
, conjointement avec celui d’Athènes 6c de Corinthe.
( D . J. ) «
Pelléné , ( Géog. anc. ) ancienne ville dés Spartiates
, appelléé aujourd’hui Macropoulo. C’étoit proche
cette ville que l’on avoit conftruit l’aqueduc de
Sparte fur une hauteur , près du fleuve Eurotas, 6c
dont on voit encore des rèftes. L’eau couloit à fleur
de terre dans des canaux, jufqu’au vallon diftant de
Sparte d’environ une lieue , oîi fe trouve un torrent
au - deflus duquel l’aqueduc s’élève en arcades de
pierres de taille , plus hautes & plus larges que celles
des deux aqueducs d’Athènes. Les arcades joignent
enfemble deux éminences d’oiiles eaux entroient autrefois
dans une galerie fouterraine , pour fe rendre
enfuite près de la ville dans un réfervoir qui eft aujourd’hui
à découvert ; ce réfervoir forme une vafte
pièce quarrée, pavée de petits cailloux qui étoient
joints avec un ciment aufli dur que le caillou même.
Du réfervoir l’eau pafloit dans là ville , 6c entroit
dans un autre aqueduc compofé de cent petites arcades
voifines : celui-là prenoit fes eaux à deux lieues
6c demie, dans deux canaux de trois piés de large,
fur un pié de profondeur , qui fë rempliffoient par
des faignées qu’on avoit faites au knajfeus 6c au tifoa»
Mem. des Infcript. tom. X V . (D . J. )
P E L L E R O N , f. m. ( Infiniment de Boulanger. )
pelle longue & étroite dont les Pâtifliers & Boulangers
fe fervent : ceux-ci pour enfourner leurs petits
pains, 6c les autres pour mettre au four leurs plus
petits pâtés, tartelettes , darioles, 6c autres légères
pièces de pâtifferie.
PELLETERIE, f. f. ( Commerce de peaux. ) le mot
pelleterie lignifie toutes fgrtes de peaux garnies de
poil deftinées à faire des fourrures , telles que font
les peaux de martres, d’hermines , de caftors, de
loutres, de tigres, de petits-gris, de fouines, d’ours
& ourçons, de loups, de putois, de chiens, de chats,
de renards , du lievres, de lapins . d’agneaux, & autres
femblables. • .
Les plus belles 6c les plus préeieufes pelleteries
viennent des pays froids, particulièrement de la Laponie
, de Mofcovie, de Suède, de Danemarck & de
Canada ; celles des pays chauds leur font inférieures,
aufli les appelle-t-on ordinairement pelleteries communes.
On nomme pelleteries ornes ou non apprêtées ,
celles qui n’ont encore reçu aucune façon ni apprêt,
Ôc qui font telles qu’elles ont été levées de deflus le
corps des animaux.
Ce qu’on appelle fauvagine n’eft autre chofe que de
la pellet erie crue ou non apprêtée, provenant de la
dépouille de plufieurs animaux fauvages qui peuvent
fe trouver en France. '
La pelleterie apprêtée ou ouvrée, eft celle qui a paffé
par la main de l’ouvrier, qui l’a façonnée 6c mile en
état d’être employée en fourrure.
Les pliis groflëspelleteries le préparent & s’apprêtent
par les.Mégifliers, & le s plus fines par les marchands
Pelletiers ; mais ce font les derniers oui les mettent
en oeuvre. Savary. ( D . J . )
PELLETIER, f. m. (Art mechanique. ) marchand
qui acheté , vend, prépare 6c apprête toutes fortes,
de peaux garnies de leur poil, 6c qui les emploie aux
différens ouvrages de fourrures.
Les Pelletiers de Paris font appelles dans leurs fta-
îuts maîtres marchands Pelletiers, Haubaniers, Fourreurs
; Pelletiers, parce qu’ils font commerce de pelleteries
; Haubaniers , ' à caufe d’un droit qu’ils
payoient anciennement au r o i, pour avoir la faculté
de lottir leurs marchandifes dans les foires, halles 6c
marchés de Paris ; ce droit s’appelloit hauban. Enfin,
Fourreurs, parce que ce font eux qui fourrent ou gar-
■ niflent de peaux en poil les juftaucorps , robes, manteaux
, &c. 6c qu’ils font des aumucés , manchons,
& autres fortes de fourrures.
Le corps des Palletiers eft régi par fix maîtres gardes
, trois anciens & trois nouveaux ; le premier des
anciens eft appellé le grand-garde : il eft regardé comme
le chef de îa communauté, 6c c’eft lui qui préfide
dans les aflèmblées. Le dernier des nouveaux eft
chargé du détail des affaires ; il fait la recette 6c la
depenfe, 6c rend fes comptes par-devant les maîtres
6c gardes, au bureau de la Pelleterie.
Tous les ans, le famedi de l’o&ave du faint Sacrement
, on élit à la pluralité des voix deux maîtres
gardes, un ancien & un nouveau, à la place, du premier
des anciens, 6c du plus ancien des nouveaux qui
lortent de charge.
Les ftatuts du corps delà Pelleterie ont été .donnés
par Henri III. en 1586 , confirmés 6c augmentés en
té 18 par Louis XIII. 6c depuis par Louis XIV. en
1648.
Suivant ces ftatuts, perfonne ne peut être admis
dans , le corps s’il n’a fait quatre ans d’apprentiflàge ,
fervi l'es maîtres en qualité de compagnon pendant
quatre autres années , 6c fait chef-d’oeuvre.
- M u’eft permis aux maîtres d’avoir qu’un apprentif
à-la-fois ; il ne doit être ni marié ni étranger.
Il eft défendu aux Pelletiers, i °. de prendre .aucuns
compagnons, à leur fervice, s’ils n’ont un certificat-en
bonne forme des derniers maîtres qu’ils ont,l'ervi>i *-,r[
De mêler de la marchandife vieille avec de la
nouvelle.' ;
30. De fourrer des manchons, pour les Merciers..
40. D,e,travailler & fourrer pour les Fripiers/
. 5 ; Dé faire le courtage, de la marçhaodifg de Pelleterie
6c de fourrure.
6°. Enfin, de s’aflocier avec des marchands forains,
ou autres qui ne font pas de leur corps.
.^kLU CU LE, f. f. ( Gramm. ) c’eft une* tunique
mince 6c deiiee, ou le fragment d’une membrane ou
peau. Voye[ M embrane.
Ce mot eft un diminutif de pellis, peau. L’épiderme
ou cuticule eft une cuticule qui couvre le derme ou
la peau. Voye^ C u ticule.
Les foupapes des veines & des arteres, font des
pellicules infenfibles qui s’ouvrent 6c fe ferment pour
la circulation du fang. Voye^ Soupape.
^ Quand on fait evaporer une diffolution chimique
à une chaleur douée, jufq.u’à ce qu’il fe forme en def-
fus une peau ou une tunique mince, on l’appelle évaporation
à pellicule, dans laquelle on ne laiffe préci-
fément de liqueur qu’autant qu’il en faut pour tenir
les fels en fiifion. Voye^ Ev aporat ion.
Pellicu le, ( Conchyl. ) en latin cortex. Ce mot
en Conchyliologie, eft fouvent pris pour l’épiderme ;
c’eft le drap marin , la fur-peau d’une coquille , laquelle
s’ufe dans le roulis de la mer quandle poiflbn
eft mort. On l’ôte aufli des coquilles en les polifî’ànt
pour jouir de toute leur beauté. ‘
PELLISSIER,f. m. (Peaucerie.) c’eft celui qui fait
6c qui v end dtspdijfesou des peliilfons. Onle dit aufli,
de ceux qui préparent des peaux.
PELODES, ( Géog.anc. ) mot grec qui fi<mifîe va-
feux. On l’a donné à quelques golfes , à caufe que
leur fond étoit plein de vafe. Ainfi Pelodes dans Pto-
lomée, L. III. c. iij. eft le nom d’un golfe fur la côte-
de la Sufiane ; .c’eft aufli dans Strabon, l. VII. p. 324.
le nom d’un port de l’Epire. ( D . J . )
P E L 0 1R , terme de Mégifiier ; c’eft un petit bâton
dont ces ouvriers fe fervent pour faire tomber la laine
de deflus les peaux de mouton. Ces peaux ayant paffé
à la chaux, la laine n’y tient prefque plus ; & pour la
faire tomber entièrement, on les étale, fur le chevalet
, 6c on frotte un peu rudement le çôt.é. de la laine
avec un: petit bâton rond de là longueur d’environ un
pié , d’un pouce de diamètre : cette opération fait
tomber la laine fur-le-champ. Voyez les fi», dans les
PL du Mégiffier.
PÊLÔPÏDF.S, LES, f. m. ( Hifi. grecque. ) ç’eft le
nom que les Grecs donnèrent à la malheureufe famille
de Pélops. Soeva Pelopis domus, dit Horace. On
fait les tragiques fceaes. que cette famille a fournies
fans celle au theatre : la guerre de Thèbes, les noms,
de Tantale, de Thiefte , d’Atrée, d’Agamemrion ,
d’Egifte, de Clitemneftre 6c d’O refte, retracent à
l’ eiprit les plus fanglantes eataftrophes. (D . J .) .
PÉLOPIES, f. f. pl. Ç Aniiq.grecq. ) ^A6™ « , fête
que célébroient les Eléens en l’honneur de Pélops,
pour lequel ils ayoient plus de vénération; que pour
aucun autre héros. Vous trouverez toutes les cérémonies
de cette fête décrites dans Potter. Paufanias,
nous apprend qu’Hercule fiitie premier qui facrifia à.
Pelops un bélier noir, comme on fàifoit aux divinités,
infernales... Dans la fuite les. magiftrats d’Elide luivi-
rent le même exemple, en ouvrant leurs pélQpies.pax,
un femblable facrifice. Potter , archoeol. graç. L. //,
e. x x . tom. /. p. 4.2.0; 'LV
PELOPIS, (Géog. anc. ) Paufanias, l. II. ç. x xxjvl
dit q.u?on donnoit ce, nom à de. petit es îles de Pélp-j
ponnèfe, vis-à-vis de Melhana, & que ces îles étoient,
au nombre de fept.
- PELOPONNESE , Pelaponnefus , ( Géogr. anc. )
aujourd’hui la Morée ; c’eft aine grande p.refqu’île qui
faifoit la partie méridionale .de la Grece, 6c qui étoit
jointe 'à la féptentrionale par Fifthme de. Corinthe.
Quoique ;lè PMoponnefc neiiut qu’une péninfule ,
Denis le periégete , verf. go3 , ne laiffe .pas de lui
donner le nom d’//e, parce qu’ elle ne tient à la tenre
ferme quepar une ifthme large feulement de quelques
ftades.. Pline, /, IV*. ç, <iy.$irabon, L II. p.