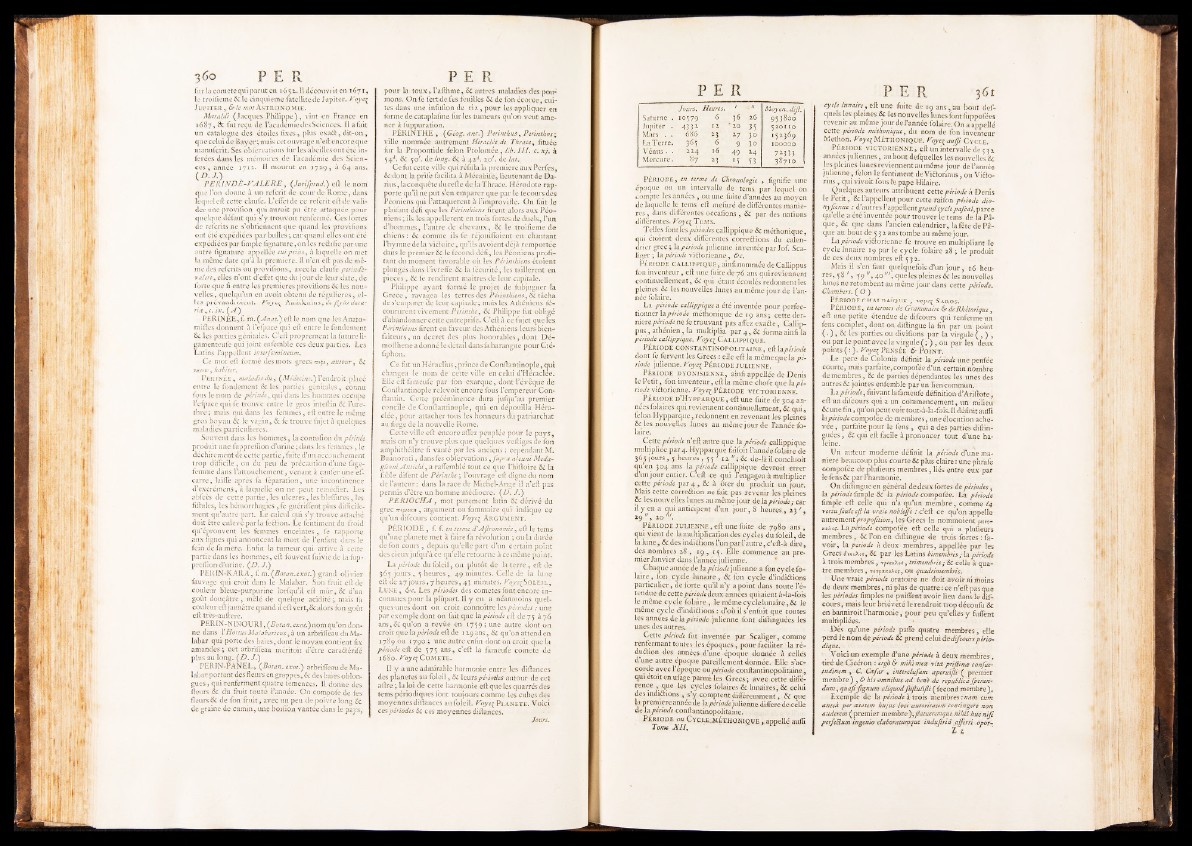
fur la coinete qui parut en 16 5 2. Il découvrit en 1671,
le troifieme 6c le cinquième fatellite de Jupiter. V o yt\
Jupiter, G le mot Astr on om ie.
Maraldi (Jacques Philippe), vint en France en
1687, & fut reçu de l’academie des Sciences. Il a fait
un catalogue des étoiles fixes, plus exadl, dit-on,
qde celui de Bayer; mais cet ouvrage n’efl encore que
manufcrit. Ses obfervations fur les abeilles ont été inférées
dans les mémoires de l’académie des Scienc
e s , année 1712. Il mourut en 17 x 9 , à 64 ans.
(Z > .7,> I
P E R IN D È -V A L E R E , (Jurifprud.') efl le nom
que l’on donne à un relcrit de cour de Rome, dans
lequel efl cette claufe. L’effet de ce refcrit efl de valider
une provifion qui auroit pu être attaquée pour
quelque défaut qui s’y trouvoit renfermé. Ces fortes
de relents ne s’obtiennent que quand les provifions
ont été expédiées par bulles ; car quand elles ont été
expédiées par fimple fignature, on les reéhfie par une
autre fignature appellee cui priiis, à laquelle on met
la même date qu’à la première. Il n’en efl pas de même
des refcrits ou provifions, avec la claufe perindï-
vulcrc, elles n’ont d’effet que du jour de leur date, de
forte que fi entre les premières provifions 6c les nouvelles
, quelqu’un en avoit obtenu de régulières, elles
prévaudroient. Voyc\ Amidenius, de flylo datants
, c. ix. (y7 )
PERINÉE, f. m. (Anat.yefl le nom que les Anato-
mifles donnent à l’efpace qui efl entre le fondement
6c les parties génitales. C’efl proprement la future li-
gamenteufe qui joint enfemble ces deux parties. Les
Latins l’appellent interfoemineum.
Ce mot efl formé des mots grecs wtp/, autour, 6c
rcauv, habiter.
PERINEE, maladie d u , (Médecine.) l’endroit placé
entre le fondement 6c les parties génitales, connu
fous le nom de perinee, qui dans les hommes occupe
l’efpace qui fe trouve entre le gros inteflin 6c l’ure-
thre; mais qui dans les femmes, efl entre le même
gros boyau 6c le vagin, & fe trouve fujet à quelques
maladies particulières.
Souvent dans les hommes, la contufion du périnée
produit une fupprefîlon d’urine ; dans les femmes , le
déchirement de cette partie, fuite d’un accouchement
trop difficile , ou du peu de précaution d’une fage-
femme dans l’attouchement, venant à caufer une ef-
carre, laiffe après fa féparation, une incontinence
d’excrémens, à laquelle on ne peut remédier. Les
abfcès de cette partie, les ulcérés, les bleffures, les
fiflules, les hémorrhagies , fe guériflènt plus difficilement
qu’autre part. Le calcul qui s’y trouve attaché
doit être enlevé parla fe&ion. Le fentiment du froid
qu’éprouvent les femmes enceintes, fe rapporte
aux lignes qui annoncent la mort de l’enfant dans le
fein de fa mere. Enfin la tumeur qui arrive à cette
partie dans les hommes, efl fouvent fuivie de la fup-
preffion d’urine. (D. /.)
PERIN-KARÀ, f. m. (Botan.exot.) grand olivier
fauvage qui croît dans le Malabar. Son fruit efl de
couleur bleue-purpurine lorfqu’il efl mur, & d’un
goût douçâtre, mêlé de quelque acidité ; mais fa
couleur efl jaunâtre quand il efl vert, & alors fon goût
efl très-auflere.
PERIN-NINOURI, (Botan. exot.') nom qu’on don- I
ne dans YHortusMa/abaricus, à un arbriffeau du Malabar
qui porte des baies, dont le noyau contient fix
amandes ; cet arbriffeau méritoit d’être caraétérifé
plus au long. (D . /.)
PERIN-PANEL, (Botan. exot.) arbriffeau de Malabar
portant des fleurs en grappes ,& des baies oblon-
gues, qui renferment quatre femences. Il donne des
fleurs 6c du fruit toute l’année. On compofe de les
fleurs 6c de fon fruit, avec un peu de poivre long 6c
de graine de cumin, une boifion vantée dans le pays,
pour là toux, l’aflhme, 6c autres maladies des poumons.
On fe fert.de fes feuilles 6c de fon écorce, cui-
! tes dans une infufion de riz , pour les appliquer en
forme de cataplafme furies tumeurs qu’on veut amener
à fuppuration.
PÉR1NTHE , (jGéog. anc.') Perinthus, Perinthos;
ville nommée autrement Héraclée de T/trace, fituée
fur la Propontide félon Ptolomée, lib. JII. c. xj. à
54d. 6c 507. de long. 6ç à 4Zd. zoL de lat.
Ce fut cette ville qui réfifla la première aux Perfes,
& dont la prife facilita à Mécabife, lieutenant de Darius,
la conquête du refie de laThrace. Hérodote rapporte
qu’il ne put s’en emparer que par le fèeours des
Péoniens qui l’attaquerent à l’improvifte. On fait le
plaifant défi que les Périnthiens firent alors aux Péoniens
; ils les appelèrent en trois fortes de duels, l’un
d’hommes, l’autre de chevaux, 6c le troifieme de
chiens : 6c comme ils fe réjouiffoient en chantant
l’hymne de la victoire, qu’ils avoient déjà remportée
dans le premier 6c le fécond défi, les Péoniens profitant
du moment favorable oii les Périnthiens étoient
plongés dans l’ivreffe 6c la lécurité, les taillèrent en
pièces, 6c fe rendirent maîtres de leur capitale.
Philippe ayant formé le projet de fubjuguer la
Grece , ravagea les terres des Périnthiens, 6c tâcha
de s’emparer de leur capitale ; mais les Athéniens fé-
coururent vivement Pèrinthe, 6c Philippe fut obligé
d’abandonner cette entreprife. C’efl à ce fujet que les
Périnthiens firent en faveur des Athéniens leurs bienfaiteurs
, un decret des plus honorables, dont Dé-
moflhene a donné le détail dans faharangue pour Cté-
fiphon.
Ce fi.it un Héraclius, prince de Conflantinople, qui
changea le nom de cette ville en celui d’Héraclee.
Elle eil fameufe par fon exarque, dont l’évêque de
Conflantinople relevoit encore fous l’empereur Con-
flantin. Cette prééminence dura jufqu’aii premier
concile de Conflantinople, qui en dépouilla Héraclée
, pour attacher tous les honneurs du patriarchat
au fiege de la nouvelle Rome.
Cette ville efl encore affez peuplée pour le pays,
mais on n’y trouve plus que quelques vefliges de fon
amphithéâtre fi vanté par les anciens ; cependant M.
Buanoroti, dans fes obfervations ,fupra aLcuni Meda-
glioni Antichi, a raffemblé tout ce que l’hifloire 6c la
fable difent de Pèrinthe ; l’ouvrage efl digne du nom
de l’auteur : dans la race de Michel-Ange il n’efl pas
permis d’être un homme médiocre." (7?. /.)
PER IOCHA , mot purement latin 6c dérivé du
grec 7Jipionn , argument ou fommaire qui indique ce
qu’un difeours contient. Poyt^ A rgument.
PERIODE , f. f. en terme d'Agronomie, efl le tems
qu’une planete met à faire fa révolution ; ou la durée
de fon cours , depuis qu’elle part d’un certain point
des ci eux jufqu’à ce qu’elle retourne à ce même point.
La période du foleil, ou plutôt de la terre , efl de
365 jours, 5 heures, 49. minutes. Celle de la lune
efl de 27 jours,7 heures, 43 minutes. ^bye^SoLEiL,
L une , &c. Les périodes des cometes font encore inconnues
pour la plûpart. Il y en a néanmoins quelques
unes dont on croit çonnoître les périodes : une
par exemple dont on fait que la période efl de 75 à 76
ans, & qu’on a revûe en 1759; une autre dont on
croit que la période efl de 129 ans, 6c qu’on attend en
1789 ou 179.0 ; une autre enfin dont on croit que la
période efl de 575 ans, c’efl la fameufe çomete de
1680. Voye{ Comete.
Il y aune admirable harmonie entre les diflances
des planet.es au foleil, 6c leurs périodes autour de cet
aflre ; la loi de cette harmonie efl que les quarrés des
tems périodiques font toujours comme les cubes des
moyennes diflances au foleil. Voye^ PLANETE. Voici
ces périodes 6c ces moyennes diflances.
Jours.
P E R
Jours, Heures. a Moyen, dijl.
Saturne . 10579 6 36 26 953800
Jupiter . 43 31 12 *20 35 520110
Mars . . 1 é86 23 27 30 152.369
La Terre. 365 6 9 30 100000
V énus. . 224 16 49 24 7 23 3 3 Mercure. 87 23 m 53 38710
PÉRIODE, en terme de Chronologie , .fignifie une
époque ou un^ intervalle de tems. par lequel on
compte les années , ou une fuite d’années au moyen
de laquelle le tems efl mefuré de différentes maniérés
, clans differentes occafions , 6c par des nations
différentes. Voye{ T ems.
Telles font les périodes callippique 6c méthonique,
qui étoient deux différentes correélions du calendrier
grec ; la période julienne inventée par Jof. Sca-
liger ; la période viélorienne, &c.
Période callippique, ainfinommée de Callippus
fon inventeur, efl une fuite de 76 ans quireviennent
continuellement, 6c qui étant écoulés redonnent les
pleines 6c les nouvelles lunes au même jour de l’année
folaire.
La période callippique a été inventée pour perfecr
donner la période méthonique de 19 ans; cette derr
nierepériode ne fe trouvant pas affez exaéte, Callippus,
athénien, la multiplia par 4 , & forma ainfi la
période callippique. Voye^ Callippique.
PÉRIODE CONSTANTINOPOLITAINE, efl la période
dont fe fervent les Grecs : elle efl la même qu e la période
julienne. Voye{ Période julienne.
Période dyonisienne, ainfi appellée de Denis
le Petit, fon inventeur, efl la même chofe que la période
viêtorienne. Voye^ PÉRIODE victorienne.
Période d’Hypparque , efl une fuite de 304 années
fblaires qui reviennent continuellement, 6c qui,
félon Hypparque, redonnent en revenant les pleines
6c les nouvelles lunes au même jour de l’année folaire.
Cette période n’efl autre que la période callippique
multipliée par 4. Hypparque faifoit l’année folaire de
36^5-jours, 5 heures , 55 ' 12 6c de-làil conciuoit
qu’en 304 ans la période callippique devroit errer
d’un jour entier. C’efl ce qui l’engagea à multiplier
cette période par 4 , 6c à ôter du produit un jour.
Mais cette correûion ne fait pas revenir les pleines
6c les nouvelles lunes au même jour de la période ; car
il y en a qui anticipent d’un jou r, 8 heures., 23 ‘ ,
29 " , 20 .
P ériode julienne , efl une fuite de 7980 ans ,
qui vient de la multiplication des cycles du foleil, de
la lune, 6c des indiélions l’un par l’autre, c’efl-à dire,
des nombres 28 , 1 9 , 15. Elle commence au premier
Janvier dansl’année julienne.
_ Chaque année de la période julienne a fon cycle folaire
, fon cycle lunaire , 6c fon cycle d’indiélions
particulier, de forte qu’il n’y a point dans toute l’étendue
de cette période deux années qui aient à-la-fois
le même cycle folaire , le même cycle lunaire, & le
meme cycle d’indiélions : d’oii il s’enfuit que toutes
les années de la période julienne font diflinguées les
unes des autres. .
Cette période frit inventée par ScaUger, comme
renfermant toutes l,es époques , pour faciliter la réduction
des années d’une époque donnée à celles
d’une autre epoque .pareillement donnée. Elle s’accorde
avec l’epoque ou période conflantinopplitaine,
qui étoit en ufage parmi-les Grecs ; avgecette diffé-
rence , que les cycles folaires 6c lunaires, 6c celui
des mdi&ions , s ’y comptent différemment, 6c que
la première annee de la période julienne différé de celle
de la période conflantinopolitaine.
Période ou Ç ycle«methoni<2ue j.appelle auffi
Tome X I I .
P E R 361
cycle lunaire, efl une fuite de 19 ans, au bout def-
quels les pleines 6c les nouvelles lunes font fuppofées
revenir au même jour de l’année folaire. On a appellé
cette période méthonique, du nom de fon inventeur
Methon. Voye{ M é t h o n i q u e . rcrye^ auffi C y c l e .
P é r i o d e v i c t o r i e n n e , efl un intervalle de 5 3 2
années juliennes, au bout defquelles les nouvelles 6c
les pleines lunes reviennent au même jour de l’année
julienne , félon le fentiment de Viélorinus, ou Viéio-
rius , qui vivoit fous le pape Hilaire.
Quelques auteurs attribuent cette période à Denis
le Petit, & l’appellent pour cette raifon période dio-
nyjjcnne :d autres l’appellent grand cycle pafcal, parce
qu’elle a été inventée pour trouver le tems de la Pâque,
6c que dans l’ancien calendrier, la fête de Pâque
au bout dey 3 2 ans tombe au même jour.
La période victorienne fe trouve en multipliant le
cycle lunaire 19 par le cycle folaire 28 ; le produit
de ces deux nombres efl 532.
Mais il s’en faut quelquefois d’un jou r , 16 heu-
res » 5 8 1 , 59 (l, 4° 1 qtie les pleines & les nouvélles
lunes ne retombent au même jour dans cette période,
Chambers. ( O )
P é r io d e c h a l d a î q u e , voye^ S a r o s .
PÉRIODE, en termes de Grammaire & de Rhétorique ,
èft une petite étendue de difeours qui renferme un
fens complet, dont on diflingue la fin par un point
1(1. ) , 6c les parties ou divifions par la virgule ( , ) ,
ou par le point avec la virgule ( ; ) , ou par les deux
-points ( : ). Voye^ P e n s é e & P o i n t .
Le pere de Colonia définit la période une penfée
courte, mais parfaite, compofée d’un certain nombre
de membres , 6c de parties dépendantes les unes des
autres & jointes enfemble par un lien commun.
La période, fuivant la fameufe définition d’Ariflote,
efl un difeours qui a un commencement, un milieu
&une fin, qu’on peut voir tout-à-la-fois. Il définit auffi
hpériode compofée de membres, une élocution achevée
, parfaite pour le fens -, qui a des parties diflinguées
, 6c qui efl facile à prononcer tout d’une haleine.
Uii auteur moderne définit la période d’une maniéré
beaucoup plus courte 6c plus claire : une p’nrafe
compofée de plufieurs membres, liés entre eux par
le fens & par l’harmonie.
On diflingue en général de deux fortes de périodes,
la période fimple 6c la période compofée. La période
fimple efl celle qui n’a qu’un membre, comme Ici
venu feule ejl la vraie nobleffie : c’efl ce qu’on appelle
autrement propofition, les Grecs la nommoient poro-
koXcc. La période compofée efl celle qui a plufieurs
membres, 6c l’on en diflingue de trois fortes : fa-
voir, la période à deux membres, appellée par les
Grecs S'mtXoç, 6c par les Latins bimembns ; la période
à trois membres, tptxoXoç, trimembris • 6c celle à quatre
membres, reTpcatoXoç,ou quadrimembris.
Une vraie période oratoire ne doit avoir ni rfioins
de deux membres, ni plus de quatre : ce n’efl pas que
les périodes fimples ne puiffent avoir lieu dans le difeours
, mais leur brièveté le rendroit trop découfii &
en banniroit l’harmonie, pour peu qu’elles y fuffent
multipliées.
Dès qu’une période paffe quatre membres, elle
perd le nom de période 6c prend celui de difeours périodique.
Voici un exemple d’une période à deux membres
tiré de Cjcéron : ergb & mThi mea vitre prijiinæ confue-
tudincm , - C. Ccefar ,- in terclufam aperuijii( premier
membre ) ,& his omnibus ad benè de republicâ fperan-
dum, quafijignum aliquodfufiulifli ( fécond membre).
Exemple de la période à trois membres : nam cum.
anteà per oetatem hujus loci autdritatern confingere non
auderem (premier membre '),ftatueremque, nihil hücniji
perfection ingenio elaboratunique indufiriâ affèrri ■. opor-
Z z