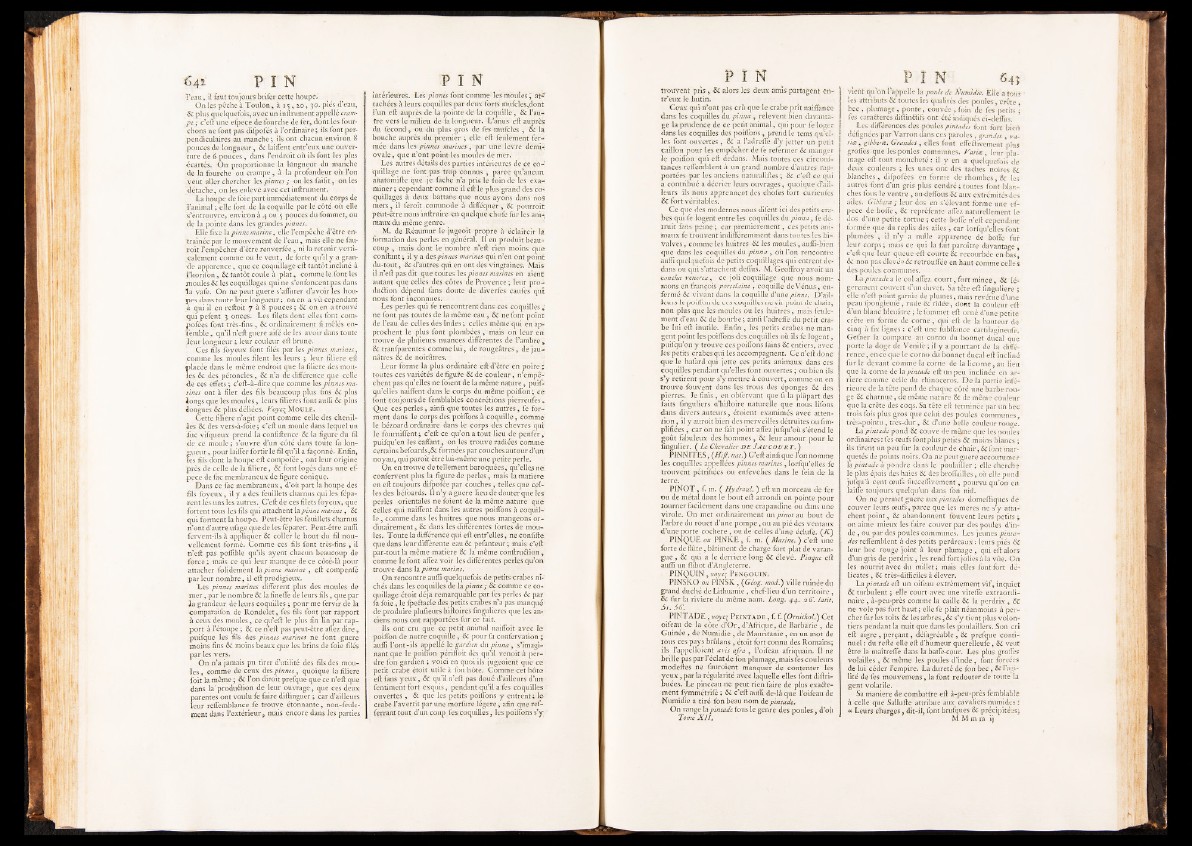
l’eau, il faut toujours brifer cette houpe.'
On les pêche à Toulon, à 15 ,2 0 , 30. pies d’eau,
ÔC plus quelquefois, avec un infiniment appelle crampe
; c’eft une efpece de fourche de fer, dont les fourchons
ne font pas difpofés à l’ordinaire; ils font perpendiculaires
au manche ; ils ont chacun environ 8
pouces de longueur, & laiffent entr’eux une ouverture
de 6 pouces, dans l’endroit oh ils font les plus
écartés. On proportionne la longueur du manche
.de la fourche ou crampe , à la profondeur oh l’on
.veut aller chercher les pinnes on les faifit, on les
détache, on les enleve avec cet infiniment.
La houpe de foie part immédiatement du corps de
l ’animal ; elle fort de la coquille par le côté oh elle
.s’entrouvre., environ à 4 ou 5 pouces du fominet, .ou
de la pointe dans les grandes pinnes.
Elle fixe la pinne marine, elle l’empêche d’être entraînée
par le mouvement de l’eau, mais elle ne fait-
'roit l’empêcher d’être renverfée, ni la retenir verticalement
comme ou le veut, de forte qu’il y a grande
apparence, que ce coquillage cil tantôt incliné à
l’horifon , & tantôt coule à plat, comme le font les
moules ôc les coquillages qui ne s’enfoncent pas dans
la vafe. On ne peut guere s’affurer d’avoir les houppes
dans toute leur longueur ; on en a vu cependant
à qui il en reftoit 7 à 8 pouces ; ô c on en a trouvé
qui pefent 3 onces. Les filets dont elles font com-
pofées font très-fins , ôc ordinairement fi mêlés ensemble
, qu’il n’eft guere aifé de les avoir dans toute
leur longueur ; leur couleur efl brune.
* Ces fils foyeux font filés par les pinnes mannes,
comme les moules filent les leurs ; leur filiere eft
placée dans le même endroit que la filiere des moules
ôc des pétoncles, & n’a de différence que celle
de ces effets ; c’eft-à-dire que comme les pinnes marines
ont à filer des fils beaucoup plus fins Ôc plus
longs que les moules, leurs filières font aufli ôc plus
longues & plus déliées. V oye^ Moule.
Cette filiere n’agit point comme celle des chenilles
ôc des vers-à-foie ; c’eft im moule dans lequel un
fuc vifqueux prend la confiftence ôc la figure du fil
de ce moule ; s’ouvre d’un côté dans toute fà longueur,
pour laiffer fortir le fil qu’il a façonné. Enfin,
les fils dont la houpe eft compofée, ont leur origine
près de celle de la filiere, ôc font logés dans une efpece
de fac membraneux de figure conique.
Dans ce fac membraneux, d’oh part la houpe des
fils foyeux, il y a des feuillets charnus qui les fépa-
rent les unsles autres. C’eft de ces filets foyeux, que
fortent tous les fils qui attachent la pinne marine, ÔC
qui forment la houpe. Peut-être les feuillets charnus
n’ont d’autre ufage que de les féparer. Peut-être aufli
fervent-ils à appliquer ôc coller le bout du fil nouvellement
formé. Comme ces fils font très-fins , il
n’eft pas poflible qu’ils ayent chacun beaucoup de
force ; mais ce qui leur manque de ce côté-là pour
attacher folidement fa. pinne marine , eft compenfé
par leur nombre., il eft prodigieux.
'Les pinnes mannes different plus des moules de
mer.,.par le nombre ôc la fineffe de leurs fils, que par
la grandeur de leurs coquilles ; pour me fervir de la
•comparaifon de Rondelet, fes fils font par rapport
à ceux des moules, ce qu’eft le plus fin lin par rapport
à l’étoupe ; ôc ce n’eft pas peut-être affez dire,
.puifque les fils des pinnes marines ne font guere
moins fins ôc moins beaux que les brins de foie filés
par les vers.
On n’a jamais pu tirer d’utilité des fils des moule
s , comme de ceux des pinnes, quoique la filiere
foit la même ; & l’on diroit prefque que ce n’eft que
dans la’ production de leur ouvrage, que ces deux
parentes ont voulu fe faire diftinguer ; car d’ailleurs
leur reffemblance fe trouve étonnante, non-feulement
dans l’extérieur., mais encore dans les parties
intérieures. Lespinnès font comme les moules ÿ at^
tachées à leurs coquilles par deux forts mufcles,dont
l’un eft auprès de la pointe de la coquille, ôc l’autre
vers le milieu de fa longueur. L’anus eft auprès
du fécond, ou du plus gros de fes mufcles , & la
bouche auprès du premier ; elle eft feulement fermée
dans les pinnes marines ,"par une .:lèvre demi-]
ovale, que n’ont point les moules de mer.
Les autres détails des parties intérieures de ce co-(
quillage ne font'pas trop connus , parce qu’aucun
aftatomifte qué je fâche n’a pris le foin de les exa-;
miner ; cependant comme il eft le plus grand des c<>,
quillages à deux battans que nous ayons dans nos
mèrs, il feroit commode à difféquèr, ôc pourroit
peut-être nous inftruire en quelquechofe fur les animaux
du même genre.
M. de Réaumur le jugeoit propre à éclaircir la
formation des perles en général. Il en produit beaucoup
, mais dont le nombre n’ eft rien moins que
confiant ; il y adespinnes marines qui n’en ont point
du-tout, & d’autres qui en ont des vingtaines. Mais
il n’eft pas dit que toutes les pinnes marines en aient
autant que celles des côtes de Provence; leur production
dépend fans doute de diverfes caiifes qui
noiis font inconnues/
Les perles qui fe rencontrent dans ces coquilles
ne font pas toutes de la même eau, & ne font point
de l’eau de celles des Indes ; celles même qui en approchent
le plus font plombées, mais on leur en
trouve deplufieiirs nuances différentes de l’ambre,
& tranfparentes comme lui, de rougeâtres, de jaunâtres
Ôc de noirâtres.
Leur forme la plus ordinaire eft d’être en poire ;
toutes ces variétés de figure ôc de couleur, n’empêchent
pas qu’elles ne foient de la même nature, puif-
qu’elles naiffent dans le .corps du même poiffon; ce
font toujours de femblables concrétions pierreufes.
Que ces perles, ainfi que toutes les autres , fe forment
dans le corps des poiffons à coquille, comme
le bézoard ordinaire dans le corps des chevres qui
le fôurniffent; c’eft ce qu’on a tout lieu de penfer,'
puifqu’en les Caftant, on les trouve radiées comme
certains befoards,& formées par couches autour d’un
noyau, qui paroît être lui-même une petite perle.
On en trouve de tellement baroquées, qu’elles ne
confervent plus la figure de perles, mais fa matière
en eft toujours difpolee par couches, telles que celles
des béfoards. Il n’y a guere lieu de douter que les
perles orientales ne foient de la même nature que
celles qui naiffent dans les autres poiffons à coquille
, comme dans les huitres que nous mangeons ordinairement
, ôc dans les différentes fortes de moules.
Toute la différence qui eft entr’elles, ne confifte.
que dans leur différente eau ôc pefanteur ; mais c’eft
par-tout la même matière & la même conftruéHon ,
comme le font affez voir les différentes perles qu’on
trouve dans la pinne marine.
On rencontre aufli quelquefois de petits crabes nichés
dans les coquilles de la pinne ; & comme ce coquillage
étoit déjà remarquable par fes perles ôc par
fa foie , le fpe&açle des petits crabes n’a pas manqué
de produire plufieurs hiftoires fingulieres que les anciens
nous ont rapportées fur ce fait.
Ils ont cru que ce petit animal naiffoit avec le
poiffon de notre coquille, ôc pour fa confervation ;
aufli l’ont-ils appellé le gardien clu pinna, s’imaginant
que le poiffon périffoit dès qu’il venoit à perdre
fon gardien ; voici en quoi ils jugeoient que ce
petit crabe étoit utile à fon hôte. Comme cet hôte
eft fans y e u x , ôc qu’il n’eft pas doué d’ailleurs d’un
fentiment fort exquis, pendant qu’il a fes coquilles
ouvertes , & que les petits poiffons y entrent ; le
crabe l’avertit par une morfure légère, afin que ref-
ferrant tout d’un coup fes coquilles, les poiffons s’y
trouvent pris > ôc alors les deux amis partagent en-
fr’eux le butin.
Ceux qui n’ont pas cru que le crabe prît naiffance
dans les coquilles du pinna , relevent bien davantage
la prudence de ce petit animal, qui pour fe loger
dans les coquilles des poiffons, prend le tems .qu’elles
font ouvertes , ôc a l’adreffe d’y jetter un petit
caillou pour les empêcher de fe refermer ôc manger
le poiffon qui eft dedans. Mais toutes ces circonf-
tances reffemblent à un grand nombre d’autres rapportées
par les anciens naturaliftes ; ôc c’eft ce qui
a contribué a décrier leurs ouvrages, quoique d’ailleurs
ils nous apprennent des chofes fort curieufes
& fort véritables.
Ce que des modernes nous difent ici des petits cra-.
bes qui fe logent entre les coquilles du pinna, fe détruit
fans peine ; car premièrement, ces petits animaux
fe trouvent indifféremment dans toutes les bivalves
, comme les huitres ôc les moules, aufli-bien
que dans les coquilles du pinna , oh l’on rencontre
aufli quelquefois de petits coquillages qui entrent de-
dans ou qui s’attachent deffus. M. Geoffroy avoit un
toncha venerea, ce joli coquillage que nous nommons
en françois porcelaine , coquille de Vénus, enfermé
& vivant dans la coquille d’une pinne. D ’ailleurs
le poiffon de ces coquilles ne vit point de chair,
non plus que les moules ou les huitres, mais feulement
d’eau ôc de bourbe ; ainfi l’adrefle du petit crabe
lui eft inutile. Enfin , les petits crabes ne mangent
point les poiffons des coquilles oh ils fe logent,
puifqu’on y trouve ces poiffons fains ôc entiers, avec
les petits crabes qui les accompagnent. Ce n’eft donc
que le hafard qui jette ces petits animaux dans ces
coquilles pendant qu’elles font ouvertes ; ou bien ils
s’y retirent pour s’y mettre à couvert, comme on en
trouve fouvent dans les trous des éponges & des
pierres. Je finis , en obfervant que fi la plupart des
faits finguliers d’hiftoire naturelle que nous lifons
dans divers auteurs, étoient examimés avec attention
, il y auroit bien des merveilles détruites ou Amplifiées
, Car on ne fait point affez jufqu’oh s’étend le
goût fabuleux des hommes, ôc leur amour pour le
fingulier. ( Le Chevalier DE J a u c o u r t .)
PINNITES, (Hifl. nat.) C’eft ainfi que l’on nomme
les coquilles appellées pinnes marines, lorfqu’elles fe
trouvent pétrifiées ou enfevelies dans le fein de la
terre.
PIN OT, f. m. ( Hydraul. ) eft un morceau de fer
ou de métal dont le bout eft arrondi en pointe pour
tourner facilement dans une crapaudine ou dans une
virole. On met ordinairement un pinot au bout de
l’arbre du rouet d’une pompe, ou au pié des ventaux
d’une porte cochere ; ou de celles d’une éclufe. (IC)
PINQUE ou PINKE, f. m. ( Marine. ) c’eft une
forte de flûte, bâtiment de charge fort plat de varangue
, &c qui a le derrière long Ôc élevé. Pinque eft
aufli un flibot d’Angleterre.
PINQUIN, voyei P e n g o u i n .
PINSKO ou PINSK, (Géog. mod.) ville ruinée du
grand duché de Lithuanie , chef-lieu d’un territoire,
oc fur la riviere du même nom. Long. 44. zG. latit.
â i. SG
PINTADE, voye{ P e in t a d e , f. f. (OrnilhoL) Cet
oifeau de la côte d’O r, d’Afrique, de Barbarie , de
Guinée , de Numidie , de Mauritanie, en un mot de
tous ces pays brûlans, étoit fort connu des Romains;
ils l’appelloient avis afra , l’oifeau afriquain. Il ne
brille pas par l’éclat de fon plumage, mais les couleurs
modeftes ne fauroient manquer de contenter les
eu x, par la régularité avec laquelle elles font diftriuées.
Le pinceau ne peut rien faire de plus exactement
fymmétrifé ; & c’eft aufli de-là que l’oifeau de
Numidie a tiré fon beau nom de pintade.
On range la pintade fous le genre des poules, d’oh
Tome XII\
Vient qu’ôtt l'appelle la poule de tiumidie. Elle à tous
les attributs & toutes les Qualités des poules ; 'crête )
bec , plufnage , ponte, couvée , foin de fes petits ;
fes caraêteres diftinétifs ont été indiqués cî-deffus.
Les différences des poules pintades font fort bien
défignées par Varron dans ces paroles , grandes varia
, gibbera. Grandes, elles font effectivement plus
groffes que les poules communes. Varia > leur plumage
eft tout moucheté : il y en a quelquefois de
deux couleurs ; les unes ont des taches noires Sc
blanches , difpofées èn forme de rhombes, & les
autres font d’un gris plus cendré ; toutes font blanches
fous le ventre , airdeffous &c aux extrémités des
aîles. Gibbera ; leur dos en s’élevant forme une efpece
de boffe * ôc repréfente affez naturellement le
dos d’une petite tortue ; cette boffe n’eft cependant
formée que du replis des aîles j car lorfqu’elles font
plumées ; il n’y a nulle apparence de boffe fur
leur corps ; mais ce qui la fait paroître davantage,
c’eft que leur queue eft courte êc recourbée en bas,
& non pas élevée & retrouflée en haut comme celles
des poules communes.
La pintade a le col affez, court, fort minçë, & légèrement
couvert d’un duvet. Sa tête eft finguliere ;
elle n’eft point garnie de plumes, mais revêtue d’une
peau fpongieufe, rude & ridée, dont la couleur eft
d’un blanc bleuâtre ; le fommet eft orné d’une petite
crête en forme de corne, qui eft de la hauteur de
cinq à fix lignes : c’eft Une fiibftance cartilagineiife»
Gefner la compare au corno du bonnet ducal que
porte la doge de Venife ; il y a pourtant de la différence
, ènce que le corno du bonnet ducal eft incliné
fur le devant comme la corne de la licorne, au lieu
que la corne de la pintade eft un peu inclinée en arriéré
comme celle du rhinocéros. De la partie inférieure
de la tête pend de chaque côté une barbe rouge
& charnue, de même nature & de même couleur
que la crête des coqs. Sa tête eft terminée par un bec
trois fois plus gros que celui des poules communes,
très-pointu, très-dur, & d’une belle couleur rouge.
La pintade pond & couve de mê*ne que les poules
ordinaires : fes oeufs font plus petits & moins blancs ;
ils tirent un peu fur la couleur de chair, & font marquetés
de points noirs. On ne peut guere accoutumér
la pintade à pondre dans le poulailler ; elle cherche
le plus épais des haies & des broffailles , 011 elle pond
jufqu’â cent oeufs fucceflivement, pourvu qu’on en
laiffe toujours quelqu’un dans fon nid.
On ne permet guere aux pintades domeftiqites de
couver leurs oeufs, parce que les meres ne s’y attachent
point, & abandonnent fouvent leurs petits ;
on aime mieux les faire couver par des poules d’in-
d e , ou par des poules communes. Les jeunes pinta-
des reffemblent à des petits perdreaux: leurs piés &
leur bec rouge joint à leur plumage , qui eft alors
d’un gris de perdrix, les rend fort jolies à la vûe. On
les nourrit avec du millet ; mais elles font fort délicates
, & très-difficiles à élever.
La pintade eft un oifeau extrêmement v if, inquiet
& turbulent ; elle court avec une vîteffe extraordinaire
, à-peu-près comme là caille & la perdrix , Ôc
ne vole pas fort haut ; elle fe plaît néanmoins à percher
fur les toîts & les arbres, & s’y tient plus volontiers
pendant la nuit que dans les poulaillers. Son cri
eft aigre , perçant, défagréable , ôc prefque continuel
: du refte elle eft d’humeur querelleufe, ôc veut
être la maîtreffe dans la baffe-cour. Les plus groffes
Volailles , ÔC même les poules d’inde , font forcées
de lui céder l’empire. La dureté de fon bec, & l’agilité
de fes mpuvemens, la font redouter de toute la
gent volatile.
Sa maniéré dé combattre eft à-peu-près fémbiablë
à celle que Sallufte attribue aux cavaliers numides i
« Leurs charges, dit-il, font brufques ôc précipitées;
M M m m ij