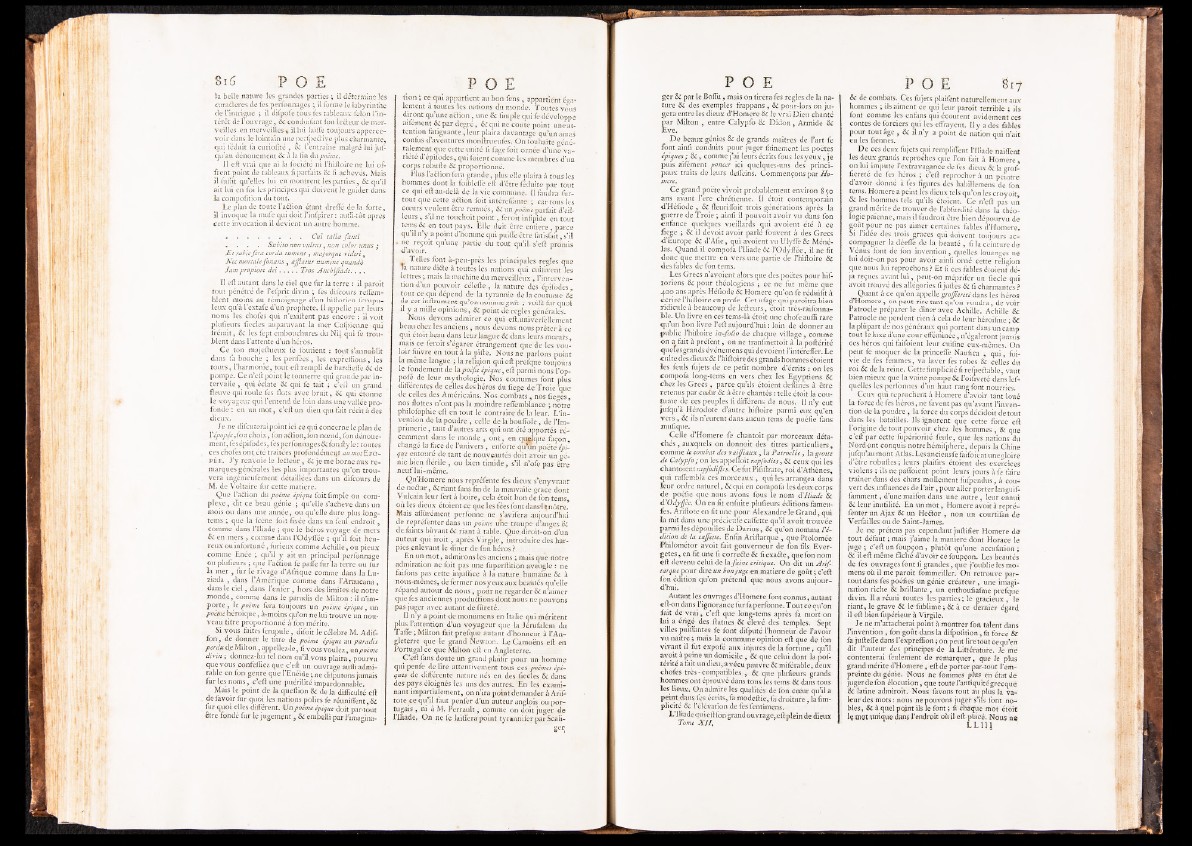
la belle nature les grandes parties ; il détermine les
caraûeres de fes perfonnages ; il forme le labyrinthe
de l’intrigue ; il dilpofe tous fes tableaux félon l’in-
tcrêt de l’ouvrage, 6c conduifant fon lecteur de merveilles
en merveilles f il lui laiffe toujours apperce-
voir dans le lointain une perfpeélive plus charmante,
qui féduit fa curiolité , 6c l’entraîne malgré lui juf-
qu’au dénouement & à la fin du poème.
Il eft vrai que ni la fociété ni l’hiftoire ne lui offrent
point de tableaux fi parfaits 6c fi achevés. Mais
il fufîit qu’elles lui en montrent les parties, 6c qu’il
ait lui en foi les principes qui doivent le guider dans
la compofition du tout.
Le plan de toute l’aûion étant dreffé de la forte,
il invoque la mufe qui doit l’infpirer : aulfi-tôt après
cette invocation il devient un autre homme.
.........................................Cui talia fanti
. . . . Subito non valais, non color utius ;
Et rabie fera corda tumeut , ma]orque videri,
Nec mortale fonans , affatur numine quandà
Jam propiore dei..........Tros Anchijiadt. . . .
Il eft autant dans le ciel que fur la terre : il paroît
tout pénétré de l’efprit divin ; fes dil'cours reffem-
blent moins au témoignage d’un hiftorien ferupu-
leux qu’à l’extafe d’un prophète. Il appelle par leurs
noms les chofes qui n’exiftent pas encore : il voit
plufieurs fiecles auparavant la mer Cafpienne • qui
frémit, 6c les fept embouchures du Nil qui fe troublent
dans l’attente d’un héros.
Ce ton majeftueux fe foutient : tout s’annoblit
dans fa bouche ; les penfées, les expreffions, les
tours , l’harmonie, tout eft rempli de hardieffe 6c de
pompe. Ce n’eft point le tonnerre qui gronde par intervalle
, qui éclate & qui fe tait ; c’eft un grand
fleuve qui roule fes flots avec bruit, & qui étonne
le-voyageur qui l’entend de loin dans une vallée profonde
: en un mot, c’eft un dieu qui fait récit à des
dieux.
Je ne difcuteraipointici ce qui concerne le plan de
Y épopée,{on choix, fon aétion, fon noeud, fon dénouement,
fes épifodes, fes perfonnages 6c fon ftyle : toutes
ces chofes ont été traitées profondément aumotEpo-
p é e . J’y renvoie le leéteur , 6c je me borne aux remarques
générales les plus importantes qu’on trouvera
ingénieufement détaillées dans un difeours de
M. de Voltaire fur cette matière.
Que l’a&ion du poème épique foit fimple ou complexe
, dit ce beau génie ; qu’elle s’acheve dans un
mois ou dans une année, ou qu’elle dure plus long-
tems ; que la fcène foit fixée dans un feul endroit,
comme dans l’ Iliade ; que le héros voyage de mers
& en mers , comme dans l’Odyffée ; qu’il foit heureux
ou infortuné, furieux comme Achille, ou pieux
comme Enee j qu’il y ait un principal perfonnage
ou plufieurs ; que l’aétion fe palfe fur la terre ou lur
la mer , fur le rivage d’Afrique comme dans la Lu-
ziada , dans l’Amérique comme dans l’Araucana
dans le ciel, dans l’enfer, hors des limites de notre
monde, comme dans le paradis de Milton : il n’im-
porte, le poème fera toujours un poème épique, un
poème héroïque, à-moins qu’on ne lui trouve un nouveau
titre proportionné à fon mérite.
Si vous faites fcrupule, difoit le célébré M. Adif-
fon, de donner le titre de poème épique au paradis
perdu de Milton, appellez-le, fi vous voulez, un poème
divin ; donnez-lui tel nom qu’il .vous plaira, pourvu
que vous confeffiez que c’eft un ouvrage auffi admirable
en fon genre que 1 Eneide ; ne dilputons jamais
fur les noms, c’eft une puérilité impardonnable.
Mais le point de la queftion 6c de la difficulté eft
de favoir fur quoi les nations polies fe réunifient &
fur quoi elles différent. Un poème épique doit par-tout
être fonde fur le jugement, 6c embelli par l’imagination
‘ cê qui appartient au bon fens , appartient é°as
lement à toutes les nations du monde. Toutes vous
diront qu’une aftion, une 6c fimplè qui fe développe
aifement 6c par degré, 6c qui ne coûte point une attention
fatiguante j leur plaira davantage qu’un affias
confus d’aventures monftrueufes. On louhaite géné-
ralement que cette unité fi fage foit ornée d’une variété
d’epifodes, qui foient comme les membres d’un
corps robufte 6c proportionné.
Plus l’ariion fera grande, plus elle plaira à tous les
hommes dont la foibleffe eft d’être féduite par tout
ce qui eft au-delà de la vie commune. Il faudra fur-
tout que cette aélion foit interefîante j car tous les
coeurs veulent être remués, 6c un poème parfait d’e.il-
leurs , s’il ne touchoit point, feroit infipide en tout
• tems 6c en tout pays. Elle doit être entière, parce
qu’il n’y a point d’hemme qui puiffe être fatisfait s’il
• ne reçoit qu’unç partie du tout qu’il, s’eft promis
d’avoir.
Telles font à-peu-près les principales réglés que
la nature difte à toutes les nations qui cultivent les
lettres ; mais la machine du merveilleux, l’interven-
txon d’un pouvoir célefte , la nature des épifodes,
tout ce qui dépend de la tyrannie de la coutume 6c
de cet infiniment qu’on nomme goût ; voilà fur quoi
il y a mille opinions, 6c point de réglés générales.
Nous devons admirer ce qui eft.univerfellement
beau ohez les anciens, nous devons nous prêter à ce
qui étoit beau dans leur langue & dans leurs moeurs,
mais ce feroit s’égarer étrangement que de les vouloir
luivre en tout à la pifte. Nous ne parlons point
la meme langue ; la religion qui eft prefque toujours
le fondement de la poéfie épique, eft parmi nous l’op-
pofe de leur mythologie. Nos coutumes font plus
différentes de celles des héros du fiege de Troie que
de celles des Américains. Nos combats, nos fieges,
nos flottes n’ont pas la moindre reffemblance ; notre
philofophie eft en tout le contraire de la leur. L’invention
de la poudre , celle de la bouffole, de l’Imprimerie
, tant d’autres arts qui ont été apportés récemment
dans le monde , ont, en q^dque façon,
changé la face de l’univers , enforte qirun poète épique
entouré de tant de nouveautés doit avoir lin génie
bien ftérile , ou bien timide, s’il n’ofe pas être
neuf lui-même.
Qu’Homere nous repréfente fes dieux s’enyvrant
de neélar, & riant fans fin de la mauvaife grâce dont
Vulcain leur fert à boire, cela étoit bon de fon tems,
où les dieux étoient ce que les fées font dans-l^ nôtre.
Mais aflurément perfonne ne s’avifera aujourd’hui
de reprefenter dans un poème une troupe d’anges 6c
de faints buvant & riant à table. Que diroit-on d’un
auteur qui iro it , après Virgile, introduire des harpies
enlevant le dîner de fon héros ?
En un m ot, admirons les anciens ; mais que notre
admiration ne foit pas une fuperftition aveugle : ne
faifons pas cette injuftice à la nature humaine &c à
nous-mêmes, de fermer nos yeux aux beatités qu’elle
répand autour de nous, pour ne regarder 6c n’aimer
que fes anciennes productions dont nous ne pouvons
pas juger avec autant de fureté.
Il n’y a point de monumens en Italie qui méritent
plus l’attention d’un voyageur que la Jerufalem du
Taffe ; Milton fait prefque autant d’honneur à l’Angleterre
que le grand Newton. Le Camoëns eft en
Portugal ce que Milton eft en Angleterre.
C’eft fans doute un grand plaifir pour un homme
qui penfe de lire attentivement tous ces poèmes épiques
de différente nature nés en des fiecles 6c dans
des pays éloignés les uns des autres. En les examinant
impartialement, on n’ira point demander à Arif-'
tote ce qu’il faut penfer d’un auteur anglois ou portugais
, ni à M. Perrault, comme on doit juger de
l’Iliade, On ne fe laiffera point tyrannifer par Scaliger
6c par le Boffu, mais on tirera fes réglés de la nature
6c des exemples frappans , 6c pour-lors on jugera
entre les dieux d’Homere 6c le vrai Dieu chanté
par Milton , entre Calypfo 6c Didon, Armide 6c
Eve.
De beaux génies & de grands maîtres de l’art fe
font ainfi conduits pour juger fainement les poètes
épiques; 6c, comme j’ai leurs écrits fous les y eu x , je
puis aifément poncer ici quelques-uns des principaux
traits de leurs deffeins. Commençons par Homère.
Ce grand poète vivoit probablement environ 850
ans avant l’ere chrétienne. Il étoit contemporain
d’Héfiode , 6c fleuriffoit trois générations après la
guerre de Troie ; ainfi il pou voit avoir vu dans fon
enfance quelques vieillards qui avoient été à ce
iiege j & il devoit avoir parlé fouvent à des Grecs
-d’Europe 6c d’Afie, qui avoient vu Ulyffe 6c Méné-
3as. Quand il compofa l’Iliade 6c l’Odyffée, il ne fit
donc que mettre en vers une partie de l’hiftoire 6c
des fables de fon tems.
. Les Grecs n’avoient alors que des poètes pour historiens
6c pour théologiens ; ce ne fut même que
400 ans après Héfiode 6c Homere qu’on fe réduifit à
écrire l’hiftoire en profe. Cet ufage qui paroîtra bien
ridicule à beaucoup de leéleurs, étoit très-raifonna-
ble. Un livre en ces tems-là étoit une chofe auffi rare
qu’un bon livre l’eft aujourd’hui : loin de donner au
public l’hiftoire in-folio de chaque village, comme
on a fait à préfent, on ne tranfmettoit à la poftérité
quelesgrands événemens qui dévoient l’intéreffer. Le
culte des dieux 6c l’hiftoire des grands hommes étoient
les feuls fujets de ce petit nombre d’écrits : on les
compofa long-tems en vers chez les Egyptiens 6c
chez les Grecs , parce qu’ils étoient deftinés à être
retenus par coeïir 6c à être chantés : telle étoit la coutume
de ces peuples fi différens de nous. Il n’y eut
iufqu’à Hérodote d’autre hiftoire parmi eux qu’en
vers , & ils n’eurent dans aucun tems de poéfie fans
anufique.
Celle d’Homere fe chantoit par morceaux détachés
, auxquels on donnoit des titres particuliers,
comme le combat des vaiffeaux, la Patroclée , la grotte
de Calypfo; on les appeïloit rapfodies, 6c ceux qui les
chantoient rapfodijlts. Ce fut Piliftrate, roi d’Athènes,
qui raflèmbla ces morceaux , qui les arrangea dans
leur ordre naturel, &qui en compofa les deux corps
de poéfie que nous avons fous le nom d'Iliade &
A'Odyffée. On en fit enfuite plufieurs éditions fameu-
fes. Ariftote en fit une pour Alexandre le Grand, qui
la mit dans une précieufe caffette qu’il avoit trouvée
parmi les dépouilles de Darius, 6c qu’on nomma l'édition
de la caffette. Enfin Ariftarque , que Ptolomée
Philométor avoit fait gouverneur de ton fils Ever-
getes, en fit une fi correcte 6c fi exaèle, que fon nom
eft devenu celui de la faine critique. On dit un Ariftarque
pour dire un bon juge, .en matière de goût ; c’eft
fon édition qu’on prétend que nous avons aujourd’hui.
Autant les ouvrages d’Homere font connus, autant
eft-on dans l’ignorance fur faperfonne. Tout ce qu’on
fait de v ra i, c’eft que long-tems après fa mort on
lui a érigé des ftatues 6c élevé des temples. Sept
villes puifiàntes fe font difputé l’honneUr. de l’avoir
vu naître ; mais la commune opinion eft que de fon
vivant il fut éxpofé aux injures de la fortune, qu’il
avoit à peine un domicile , 6c que celui dont la postérité
â fait un dieu, a vécu pauvre 6c miférable^ deux
chofes très-compatibles,, & que plufieurs grands
hommes'ont éprouvé dans tous les tems 6c dans tous
les lieux. On admire les qualités'de fon; coeur qu’il a
peint dans fçs écrits, fa modeftie, fà droiture , la fim-
plicité 6c l’élévation de fes fentimens.
L’Iliade qui eftfon grand ouvrage, eft plein de dieux
Tome X I I .
& de combats. Ces fujets plaifent naturellement aux
hommes ; ils aiment ce qui leur paroît terrible ; ils
font comme les enfans qui ecoutent avidement ces
contes de forciers qui les effrayent. Il y a des fables
pour tout âge , 6c il n’y a point de nation qui n’ait
eu les fiennes.
De ces deux fujets qui rempliffent l’Iliade naiffent
les deux grands reproches que l’on fait à Homere
on lui impute l’extravagance de fes dieux 6c la grof-
fierete de fes héros c eft reprocher à un peintre
d’avoir donné à fes figures des habillemens de fon
tems. Homere a peint les dieux tels qu’on les croyoit,
6c les hommes tels qu’ils étoient. Ce n’eft pas un
grand mérite de trouver de l’abfurdité dans la théologie
païenne, mais il faudroit être bien dépourvu de
goût pour ne pas aimer certaines fables d’Homere.
Si l’idée dés trois grâces qui doivent toujours accompagner
la déeffe de la beauté , fi la ceinture de
Vénus font de fon invention, quelles louanges né
lui doit-on pas pour avoir ainfi orné cette religion
que nous lui reprochons ? Et fi ces fables étoient déjà
reçues avant lui, peut-on méprifer un fiecle qui
avoit trouvé des allégories fi juftes & fi charmantes ?
Quant à ce qu’on appelle groffiereté dans les héros
d’Homere, on peut rire tant qii’on voudra, de voir
Patrocle préparer le dîner avec Achille. Achille 6c
Patrocle ne perdent rien à cela de leiir héroïfme ; 6c
la plûpart de nos généraux qui portent dans un camp
tout le luxe d’une cour efféminée, n’égaleront jamais
ces héros qui faifoient leur cuifine eux-mêmes. On
peut fe moquer de la princeffe Naufica , qui, fui-
vie de fes femmes, va laver fes robes 6c celles du
roi 6c de la reine. Cette fimplicité fi refpe&able, vaut
bien mieux que la Vaine pompe 6c l’oihveté dans lef-
quëlles les perfoiines d’un haut rang font nourries.
Ceux qui reprochent à Homere d’avoir tant loué
la force de fes héros, ne favent pas qu’avant l’invention
de la poudre , la force du corps décidoit de tout
dans les batailles. Ils ignorent que cette force eft
l'origine de tout pouvoir chez les hommes , & que
c ’eft par cette fupériorité feule, que les nations du
Nord ont conquis notre hémifphere, depuis la Chine
jufqu’aUmont Atlas. Les anciens fe faifoient une cdoire
d’être robuftes ; leurs plaifirs étoient des exercices
violens ; ils ne paffoient point leurs jours à fe faire
traîner dans des chars mollement fufpendus, à cou-î
vert des.influences de l ’air , pour aller porter lan^uif-
famment, d’une maifon dans une autre, leur ennui
6c leur inutilité. En un mot, Homere avoit à repré-
fénter un Ajax & un Heélor , non un courtifan dé
Verfâilles.ou de Saint-James.
Je ne prétens pas cependant juftifier Homere dè
tout défaut ; mais j’aime la maniéré dont Horace lé
juge ; c’eft un foupçon , plutôt qu’une accufation ;
6c il eft même fâché d’avoir ce foupçon. Les beautés
de fes ouvrages font fi grandes, que j’oublie les mo-
mens où il me paroît fommeiller. On retrouve partout
dans fes poéfies un génie créateur, une imagination
riche 6c brillante , un enthoufiafme prefque
divin. Il a réuni toutes les parties ; lé gracieux , le
rjant, le grave 6c le fublime ; 6c à ce dernier égard
il eft bien fupérieur à Virgile.
Je ne m’attacherai point à montrer fon talent dans
l’invention , fon goût dans la difpofition, fa force 6c
fa jufteffe dans l’expreffion ; on peut lire tout ce qu’en
dit l’auteur des principes de la Littérature. Je me
contenterai feulement de remarquer, que le plus
grand mérite d’Homere , eft de porter par-tout l’empreinte
du génie. Nous ne fommes plus eh état de
juger de fon élocution, que toute l’antiquité grecquè
6c latine admiroit. Nous favorts tout àu plus la valeur'
des mots : nous ne pouvons juger s’ils font no-
blés, & à quel point ils lé font ; fi chaque mot étôit
lç mot Unique dans l’endroit où il eft-placé. Nous ne
L L 11J