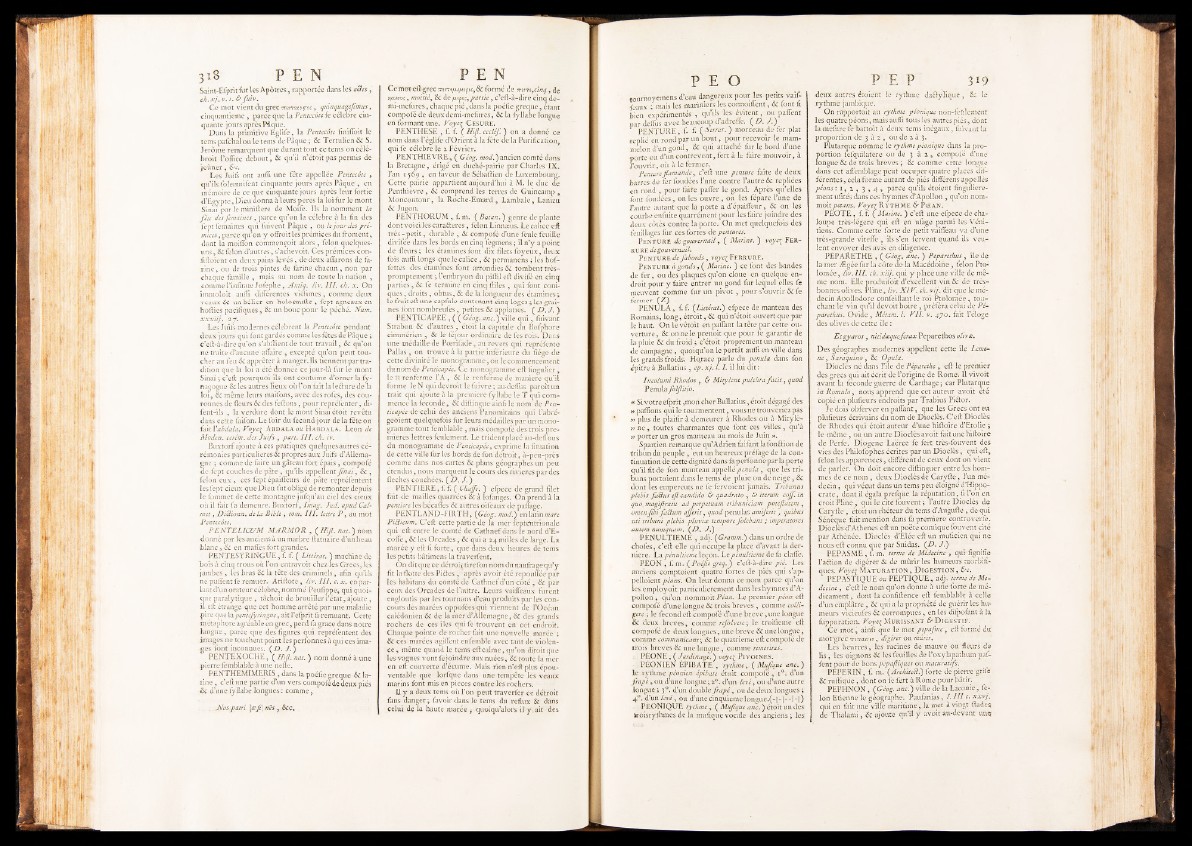
Saint-Efprit furies Apôtres, rapportée dans les actes,
ch. x j. v-I.& fuiv.
Ce mot vient du grec , quinquagefimus,
cinquantième , parce que la Pentecôte fe célébré cinquante
jours après PÂque.
Dans la primitive Eglife, la Pentecôte finifToit le
tems pafchalou le teins de Pâque ; 6c Tertulien 6c S.
Jerome remarquent que durant tout ce tems on cele-
broit l’office debout, & qu’il n’étoit pas permis de
jeûner, &c.
Les Juifs ont auffi une fête appellée Pentecôte ,
qifils folemnifent cinquante jours après Pâque , en
mémoire de ce que cinquante jours après leur fortie
d’Egypte, Dieu donna à leurs peres la loi fur le mont
Sinaï par le miniftere de Moïfe. Ils la nomment la
fête des femaines, parce qu’on la célébré à la fin des
fept femaines qui fuivent Pâque , ou le jour des prémices
, parce qu’on y offroit les prémices du froment,
dont la moifïbn commençoit alors , félon quelques-
uns, & félon d’autres-, s’achevoit. Ces prémices con-
fiftoient en deux pains levés, de deux affarons de fa-
rine, ou de trois pintes de farine chacun, non par
chaque famille , mais au nom de toute la nation ,
comme l’infmue Jofephe, Anùq. liv. III. ch. x. On
immoloit auffi différentes viclimes, comme deux
veaux 6c un bélier en holoçaufte , fept agneaux en
hofties pacifiques, 6c un bouc pour le péché. N um.
x xxiij. 2. y.
Les Juifs modernes célèbrent la Pentecôte pendant
deux j ours qui font gardés comme les fêtes de Pâque ;
c ’eft-à-dire qu’on s’abffient de tout travail, 6c qu’on
ne traite d’aucune affaire , excepté qu’on peut toucher
au feu & apprêter à manger. Ils tiennent par tradition
que la loi a été donnée ce jour-là fur le mont
Sinaï ; c’eft pourquoi ils ont coutume d’orner la fy-
nagogue 6c les autres lieux oîi l’on fait la leéhire de la
lo i, 6c même leurs maifons, avec des rofes, des couronnes
de fleurs 6c des feftons, pour repréfenter, di-
fent-ils , la verdure dont le mont Sinaï étoit revêtu
dans cette faifon. Le foir du fécond jour de la fête on
fait Yabdala. Voye{ A bdala. ou R abdala. Leon de
Moden, cerém. des Juifs , part. I I I . ch. iv.
Buxtorf ajoute à .ces pratiques quelques autres cérémonies
particulières & propres aux Juifs d’Allemagne
; comme de faire un gâteau fort épais , compofé
de fept couches de pâte , qu’ils appellent final, 6c ,
félon eux , ces fept épaiffeurs de pâte repréfentent
les fept deux que Dieu fut obligé de remonter depuis
le fommet de cette montagne jufqu’au ciel des deux
oîi il fait fa demeure. Buxtorf, Imag. Jud. apud Cal-
inet , Dictionn. delà Bible , tom. I II. lettre P . au mot
Pentecôte.
PENTELICUM MARMOR , {Hiß. neu. ) nom
donné par les anciens à un marbre ftatuaire d’un beau
blanc, 6c en maffes fort grandes.
PENTESYRINGUE, f. f. ( Littéral. ) machine de
bois à cinq trous où l’on entravoit chez les Grecs, les
jambes., les bras 6c la tête des criminels, afin qu’ils
ne puffent fe remuer. Ariftote, liv. III. c. x. en parlant
d’un orateur célébré, nommé Peufippe, qui quoique
paralytique , tâchoit de brouiller l’état, ajoute,
il ,eft étrange que cet homme arrêté par une maladie
pire que lapentefyringue, a itl’efprit fi remuant. Cette
métaphore agréable en grec , perd fa grâce dans notre
langue., parce que des figures qui repréfentent des
images ne touchent point les personnes à qui ces images
font inconnues. (D . J.)
PENTEXOCHE, ( Hiß. nat. ) nom donné à une
-pierre fémblable à ime nefie.
PENTHEMIMERIS , dans la poéfie greque 6c latine
, c’eft une partie d’un vers compofé de deux piés
d’une fyüabe longues : comme,
Mospatri \<zfi\nés, 6cc.
Ce mot eft grec formé de mrnycinq, de
jifjLiavç, moitié, 6c de //spoç, partie, c’eft-à-dire cinq de-
mi-mefures, chaque pié, dans la poéfie greque, étant
compofé de deuxdemi-mefures, 6c la fyüabe longue
en formant une. Voye^ C esure.
PENTHESE , f. f. ( Hiß. ecclèf. ) on a donné ce
nom dans l’églife d’Orient à la fête de la Purification,
quife célébré le z Février.
PENTHIEVRE, ( Géog. mod. ) ancien comté dans
la Bretagne, érigé en duché-pairie par Charles IX.
l’an 1 569 , en faveur de Sébaftien de Luxembourg.
Cette pairie appartient aujourd’hui à M. le duc de
Penthievre, 6c comprend les terres de Guincamp ,
Moncontour, la Roche-Emard , Lambale, Lanizu
6c Jugon.
PENTHORUM, f. m. ( B q tan. ) genre de plante
dont voici les caraôeres, félon Linnæus. Le calice eft
très-petit, durable , & compofé d’une feule feuille
divifée dans les bords en cinq fegmens ; il n’y a point
de fleurs ; les étamines font dix filets foyeux, deux
fois auffi longs que le calice, 6c permanens ; les bof-
fettes des étamines font arrondies 6c tombent très-
promptement ; l’embryon du piftil eft divifé en cinq
parties, 6c fe termine en cinq ftiles , qui font coniques
, droits , obtus, & de la longueur des étamines ;
le fruit eft une capfule contenant cinq loges ; les graines
font nombreufes, petites 6c applaties. ( D . J. J
PENTICAPÉE, ( ( Géog. anc. ) ville q u i, fuivant
Strabon 6c d’autres , étoit la capitale du Bofphore
cimmérien , & le féjour ordinaire de fes rois. Dans
une médaille de Poerifade, au revers qui repréfente
Pallas , on trouve à la partie inférieure du fiége de
cette divinité le monogramme, ou le commencement
du nom de Penticapèe. Ce monogramme eft finguïier,
le n renferme l’A , 6c le renferme de maniéré qu’il
forme le N quidevroit lefuivre; au-deffus paroîtun
trait qui ajoute à la première fyüabe le T qui commence
la fécondé, 6c diftingue ainfi le nom de Pen-
ticapée de celui des anciens Panomitains qui l’abré-
geoient quelquefois fur leurs médailles par un monogramme
tout femblable , mais compofé des trois premières
lettres feulement. Le trident placé au-defl'ous
du monogramme de Penticapèe, exprime la fituation
de cette ville fur les bords de fon détroit, à-peu-près
comme dans nos cartes 6c plans géographes un peu
étendus, nous marquent le cours des rivières par des
fléchés couchées. {D . / .)
PENTIERE, f. f. ( Chaffe. ) efpece de grand filet
fait de mailles quarrées 6c à lofanges. On prend à la
pentiere les bécaffes 6c autres oifeaux de paffage.
PENTLAND-FIRTH, (Géog. mod?) enlatinmare
Picticum. C’eft cette partie de la mer feptentrionale
qui eft entre le comté de Cathnef dans le nord d’E-
coffe, 6c les Orcades, 6c qui a 24 milles de large. La
marée y eft ii forte, que dans deux heures de tems
les petits bâtimens la traverfent.
On dit que ce détroit tire fon nom du naufrage qu’y
fit la flotte des Piftes , ' après avoir été repounee par
les habitans du comté de Cathnef d’un côté , 6c par
ceux des Orcades de l’autre. Leurs vaiffeaux frirent
engloutis par les tournans d’eau produits par les concours
des marées oppoféesqui viennent de l’Océan
calédonien 6c de la mer d’Allemagne, 6c des grands
rochers de ces îles qui fe trouvent en cet endroit.
Chaque pointe de rocher fait une nouvelle marée ;
6c ces marées agiffent enfemble avec tant de violenc
e , même quand le tems eft calme, qu’on diroitque
les vagues vont fe joindre aux nuées, 6c toute la mer
en eft couverte d’écume. Mais rien n’eft plus épou-
ventable que lorfque dans une tempête les veaux
marins font mis en pièces contre les rochers.
11 y a deux tems où l’on peut traverfer ce détroit
fans danger ; favoir dans le tems du reflux & dans
celui dé la haute matée * quoiqu’alors il y ait des
tourhoyetnens cf’eau dangereux poat les petits vaiffeaux
; mawfts mariniers les toâneiffent, & font fi
bien • expérimentés., iqtfîls les évitent paffent
par deffus avec b e a iàW d’adreffe ( ■ » / )
r PENTURE f. f. ( Sernir. ) morceau de fer plat
replié en rond par un bout, pour recevoir le mam-
melon d’un gond, 6c qui attaché fur le bord d’une
porte ou d’un contrevent, fert à le faire mouvoir, à
l’ouvrir, où à le fermer.
Penture flamande, c’eft Une penture faite de deux
barres de fer foudées l’une contre l’autre 6c repliées
en rond , pour faite paffer le gond. Après qu’elles
-font foudées, on les ouvre, on les fépare l’une de
l’autre autant que la porte a d’épaiffeur, 6c on les
combe enfuite quarrément pour les faire joindre des
deux côtés contre la porte. On met quelquefois des
feuillages fur ces fortes de pentures.
Penture de gouvernail, ( Marine. ) voye{ Ferrure
de gouvernail.
Penture de Jabords, voyeç Ferrure.
Penture à gonds, ( Marine, j ce font des bandes
de fer, ou des plaques qu’on cloue en quelque endroit
pour y faire entrer un gond fur lequel elles fe
meuvent comme fur un p ivo t, pour s’ouvrir.& fe
fermer. (Z )
PENULA, f. f. (Littéral?) efpece de manteau des
Romains, long , étroit, 6c qui n’étoit ouvert que par
le haut. On le vêtoit en paffant la tête par cette ouverture
, 6c on ne le prenoit que pour le garantir de
la pluie 6c du froid ; c’ étoit proprement un manteau
de campagne, quoiqu’on le portât auffi en ville dans
les grands froids. Ho/ace parle du penula dans fon
«pître à Bullatius , ep. x ) . 1. 1. il lui dit :
Incolumi Rhodos , & Mitylene pulchra facit, quod
Penula foljlitio.
« Si votre efprit ,mon cher Bullatius, étoit dégagé des
» paffions qui le tourmentent, vous ne trouveriez pas
;» plus de plaifrr à demeurer à Rhodes ou à Mityiè-
» ne , toutes charmantes que font ces villes , qu’à
» porter un gros manteau au mois de Juin ».
Spartien remarque qu’Adrien faifaiit lafonôion de
tribun du peuple , eut un heureux préfage de la continuation
de cette dignité dans faperfonnepar la perte
qu’il fit de fon manteau appelléy>e/z«/<z, que les tribuns
portoient dans le tems de pluie ou de neige, 6c
dont les empereuts ne fe fervoient jamais. Tribunus
p le bis factus eft candido & quadrato , & iterum coff. in
quo. magifratu ad perpétuant tribuniciam poteftatem ,
omenfibi factum afferit, quod penulas amiferit, quibus
uti tribuni plebis pluvial tempore Jolebant ; imperatores
autan numquam. (H. J.)
. PÉNULTIÈME , adj. (Grarnm.) dans un ordre de
chofes, c’eft elle qui occupe la place d’avant la dernière.
La pénultième leçon. Le pénultième de fa claffe.
PÉON , f.m. (Poéfie greq.) c’eft-à-dire pié. Les
anciens comptoient quatre fortes de piés qui s’ap-
pelloient péons. On leur donna ce nom parce qu’on
les employoit particulièrement dans les hymnes d’Apollon
j qu’on nommoit Péan. Le premier pèon eft
compofé d’une longue & trois brèves , comme colli-
gere ; le fécond eft compofé d’une breve ,une longue
6c deux brèves, comme refolvaeyie troifieme eft
compofé de deux longues, une breve 6c une longue,
comme communicant ; 6c le quatrième eft compolc de
trois brèves 6c une longue,, comme temeritàs.
:. PÉONE, ( Jardinage. ) voye£ PivOINES.
PÉON1EN ÉPIBATE , rythme, ( Mufique anc. )
le rythme péonien épibate étoit compofé, i° . d’un
frapè, ou d’une longue ; 20. d’un levé, ou d’une autre
longue ; 30. d’un double f r ^ e , ou de deux longues ;
4°. d’un levé, ou d’une cinquième longiie.(-|-|--|-|)
PÉONIQUE rythme , ( Mufique anc. ) étoit un des
fcrôisryîhmes de la mufique vocale des anciens ; les.
deux autres étoient le rythme dactylique, 6c le
rythme jambique.
On rapportoit au rythme péonique non-feulement
les quatre péons, mais auffi tous les autres piés, dônt
la mefiire fe battoit à deux tems inégaux, fuivant la
proportion dé 3 à 2 , ou de 2 à 3.
Plutarque nomme le rythme péonique dans la proportion
lefquilatere ou de 3 à 2 , compofé d’une
longue & de trois brèves ; 6c comme cette longue
dans cet affemblage peut occuper quatre places différentes
, cela forme autant de piés différens appellés
péons : 1 , 2 , 3 , 4 , parce qu’ils étoient finguliere-
ment ufités dans ces hymnes a’Apollon , qu’on nommoit
poeans. V'oye^ R y thm e & Poeàn.
PÉO TE, f. f. ( Marine. ) c’eft une efpece de chaloupe
très-légere qui eft en ufage parmi les Vénitiens.
Comme cette forte de petit vaiffeau va d’une
très-grande vîteffe , ils s’en fervent quand ils veulent
envoyer des avis en diligence.
PÉPARETHE , ( Géog. anc. ) Peparethus, île de
la mer Ægée fur la côte de la Macédoine, félon Pto*
lomée, liv. III. ch. xiij. qui y place une ville de même
nom. Elle produifoit d’excellent vin 6c de très-
bonnes olives. Pline, liv. X IV . ch. vij. dit que le médecin
Apollodore confeillant le roi Ptolomée , touchant
le vin qu’il devoit boire , préféra celui de Pè-
parethus. Ovide, Métam. I. PII. v. 470. fait l’éloge
des olives de cette île :
Etgyaros, nitidoequeferax Peparethos 0 liv te.
Des géographes modernes appellent cette île Leme~
ne, Saraqui.no , 6c O pilla.
Dioclès né dans l’île de Pèparethe , eft le premier
des grecs qui ait écrit de l’origine de Rome. 11 vivoit
avant la fécondé guerre de Carthage ; car Plutarque
in Romulo, nous apprend que cet auteur avoit été
copié en plufieurs endroits par Trabius Piûor.
\ Je dois obferver en paffant, que les Grecs ont eu
plufieurs écrivains du nom de Dioclès. C ’eft Dioclès
. de Rhodes qui étoit auteur d’une hiftoire d’Etolie ;
le même , ou un autre Dioclès avoit fait une hiftoire
de Perfe. Diogene Laërçe fe fert très-fouvent des
vies des Philofophes écrites par un D ioclès, qui eft,
félon les apparences, différent de ceux dont on vient
de parler. On doit encore diftinguer entre les hommes
de ce nom , deux Dioclès de Caryfte , l’un médecin
, qui vécut dans un tems peu éloigné d’Hippocrate
, dont, il égala prefqiie la réputation, fi l’on en
Croit Pline , qui le cité fouvent ; l’autre Dioclès de
Caryfte , étoit un rhéteur du tems d’Augufte , de qui
Séneque fait mention dans fa première controverlè.
Dioclès d’Athènes eft un poète comique fouvent cité
par Athénée. Dioclès d’Elée eft un muficien qui ne
nous eft connu que par Suidas. (D. J.)
PEPASME , 1. m. terme de Médecine , qui fignifie
l’aétion de digérer 6l de mûrir les humeurs morbifiques.
Voye^Ma tu r a t io n , D ig e st io n , &c,
PEPASTIQUE ou PEPTIQUE, adj. terme de Médecine
, c’eft le nom qu’on donne à une forte de médicament
, dont la confiftence eft femblable à celle
d’un emplâtre , 6c qui a la propriété de guérir les humeurs
vicieufes & corrompues, en les diipofant à la
frippuration. Voye[ Mûrissant 6* Digestif.
■ Ce mot ‘ ainfi que le mot pepafme, eft formé dû
niôt'grec Tnrra.iviv, digérer ou mûrir.
Les beurres, les racines de mauve ou fleurs de
lis , les oignons & les feuilles de l’ox.yfapathum paffent
pour de bons pepafliqucs ou maturatifs.
PEPERIN, f. m. (Architect.) forte de pierre grife
6c ruftiqüe , dont on fe fert à Rome pour bâtir.
PEPHNON, (Géog. anc.) v ille de la Laconie, félon
Etienne le géographe. Paufanias, /. I I I c. xxvj.
qui en fait une ville maritime,.la met à vingt ftades
de Thalami, 6c ajoute qu’il y avoir au-devant une