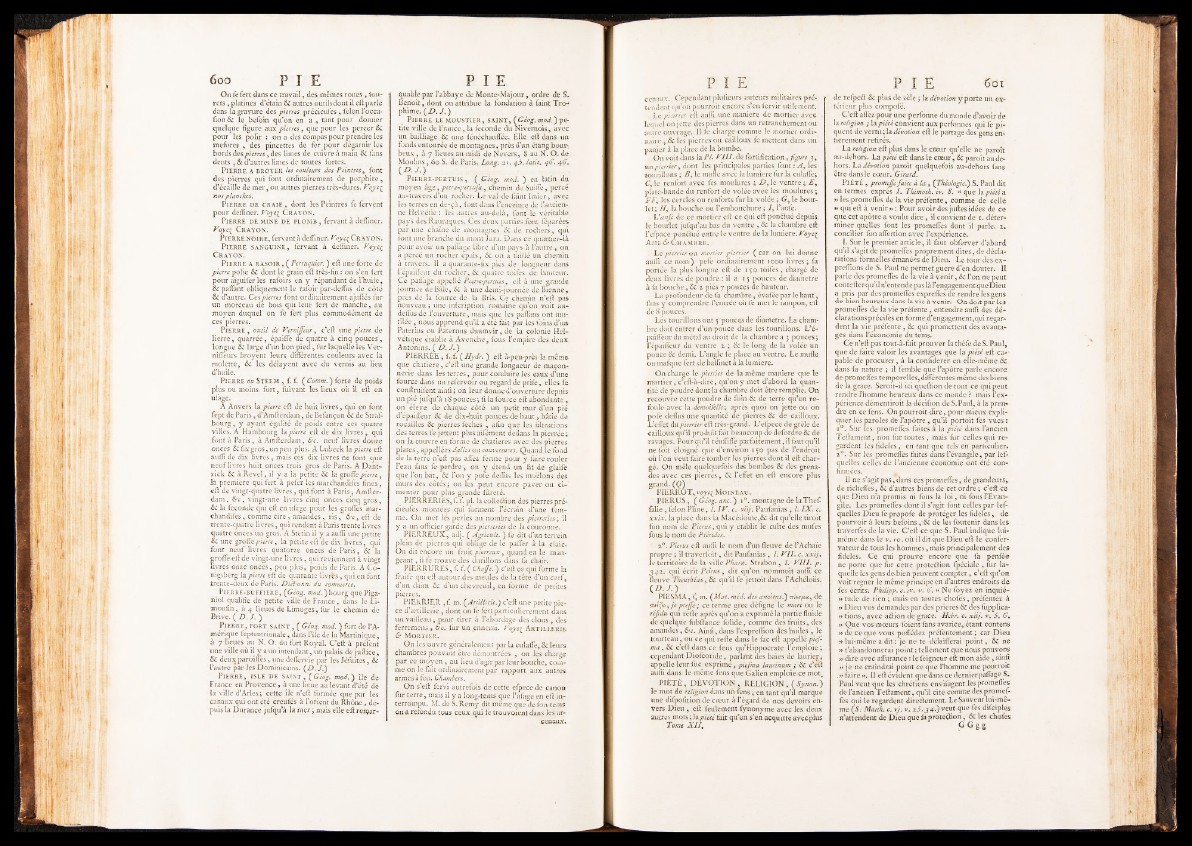
On fe fert dans ce travail, des mêmes roues , tou-
rets , platines d’étain & autres outils dont il eft parlé
dans la gravure des pierres précieufes , félon l’occa-
fion & le befoin qu’on en a , tant pour donner
quelque figure aux pierres, que pour les percer &
pour les polir : on a dés compas pour prendre les
mefures , des pincettes de fer pour dégarnir les
bords des pierres, des limes de cuivre à main 6c fans
dents , & d’autres limes de toutes fortes.
P i e r r e a BROYER les couleurs des Peintres, fo n t
d e s p ie r re s q u i fo n t o rd in a ir em en t de p o r p h i r e ,
d ’ é c a i lle d e m e r , o u au t res p ie r re s trè s -d u re s . Voyc{
nos planches.
P i e r r e d e c r a i e , dont les Peintres fe fervent
pour defliner. Voye^ C r a y o n .
P ie r r e d e m in e d e p l o m b , fe rv a n t à d e fline r .
Voye^ C r a y o n .
P i e r r e n o i r e , f e rv a n t à d e flin e r . Voyc{ C r a y o n .
P i e r r e s a n g u i n e , fe rv a n t à d e flin e r . Voyeç
C r a y o n .
P i e r r e A r a s o i r , ( Perruquier. ) eft une forte de
pierre polie & dont le grain eft très-fin : on s’en fert
pour aiguifer les rafôirs en y répandant de l’huile,
6c paffant obliquement le rafoir par-defliis de côté
6c d’autre. Ces pierres font ordinairement ajuftés fur
un morceau de bois qui leur fert de manche, au
moyen duquel on fe fert plus commodément de
ces pierres.
P lE R R È , outil de Vernijfeur, c’eft une pierre de
lierre, quarrée, épaiffe de quatre à cinq pouces,
longue 6c large d’un bon pied, fur laquelle les Ver-
niflèurs broyent leurs différentes couleurs avec la
molette, 6c les délayent avec du vernis au lieu
d’huile.
P ie r r e ou S t e e m , f. f. ( Comm. ) forte de poids
plus ou moins fort, fuivant les lieux oii il eft en
ufage.
A Anvers la pierre eft de huit livres, qui en font
fept de Paris, d’Amftèrdam, de Befançon 6c de Straf-
bourg, y ayant égalité de poids entre ces quatre
villes. A Hambourg la pierre eft de dix livres, qui
font à Paris, à Amfterdam, &c. neuf livres douze
onces 6c fixgros, un peu plus. A Lubeck la pierre eft
aufli de dix livres, mais ces dix livres ne font que
neuf livres huit onces trois gros de Paris. A Dant-
zick 6c à Revel, il y a la petite 6c la grofle pierre,
la première qui fert à pefer les marchandifes fines,
eft de vingt-quatre livres, qui font à Paris, Amfterdam
, & c , vingt-une livres cinq onces cinq gros,
6c la fécondé qui eft en ufage pour les groffes marchandifes
, comme cire, amandes , ris, & c , eft de
trente-quatre livres, qui rendent à Paris trente livres
quatre onces un gros. A Stetin il y a aufli une petite
& une grotte pierre, la petite eft de dix livres, qui
font neuf livres quatorze onces de Paris, & la
grofle eft de vingt-iine livres, qui reviennent à vingt
livres onze onces, peu plus, poids de Paris. A Co-
nigsberg la pierre eft de quarante livrés, qui en font
trente-deux de Paris. Diclionri. du commerce.
P ie r r e -b u f f i e r e , ( Géog. mod. ) bourg que Piga-
niol qualifie de petite ville de France, dans le Li-
moufin, à 4 lieues de Limoges, fur le chemin de
Brive. ( D . J . )
P i e r r e ^ f o r t s a in t , ( Géog. mod. ) fort de l’Amérique
feptentrionale, dans 111e de la Martinique ,
à 7 lieues au N. O. du fort Royal. C ’eft à préfent
une ville oîi il y a un intendant, un palais de juftice,
& deux paroifles, une deflèrvie par les Jéfuites, &
l’autre par les Dominicains. (D . ƒ.)
P i e r r e , i s l e d e s a i n t , (.Géog. mod. ) île de
France en Provence, à une lieue au levant d’été de
la ville d’Arles; cette île n’eft formée que par les
canaux qui ont été creufés à l’orient du Rhône, depuis
la Durance jufqu’à la mer ; mais elle eft remarquable
par l’abbaye de Monte-Majour, ordre dé S.
Benoît , dont on attribue la fondation à faint Tro-*
phime. ( D . J. )
P i e r r e l e m o u s t i e r , s a i n t , (Géog. mod.') p e t
it e v i l l e de F r a n c e , la fé c o n d é d u N iv e rn o i s , a v e c
u n b a illia g e 6c u n e fé n é eh a u ffé e . E l le e ft dans u n
fo n d s e n to u r é e d e m o n ta g n e s , p rè s d’ u n é tan g bour-,
b e u x , à 7 lie u e s a u m id i d e N e v e r s , 8 a u N . O . de
M o u lin s , 6 0 S . de P a r is . Long. 21. latit. 46". 46
{D . J .)
P i e r r e -p e r T u i s , ( Géog. mod. ) en la tin du
m o y e n â g e , pum-pertufa, c h em in d e S u i f f e , p e r c é
a u - t r a v e r s d’u n ro c h e r . L e v a l de fa in t I tn ie r , av e c,
le s te r r e s en d e - ç à , fo n t d ans l’ e n c e in te d e l’an c ien n
e H e lv é t ie : le s au t re s a u - d e là , fo n t le v é r itab le ,
p a y s d es R a u r a q u e s . C e s d e u x p a r t ie s fo n t fé p a r é e s
p a r u n e ch a în e de mon ta gn e s , 6c d e r o c h e r s , q u i
lb n t u n e b r a n c h e du m o n t Jura. D a n s c e q u a r t ie r - là
p o u r a v o i r u n p a fia g e l ib r e d’u n p a y s à l ’a u t r e , o n
a p e r c é u n r o c h e r épais, 6c o n a t a i llé u n c h em in
à t r a v e r s . Il a q u a r a n te - fix p ié s d e lo n g u e u r d ans
l ’ ép a iffeu r du r o c h e r , 6c q u a t re to ife s d e h a u teu r .
C e pafl'age a p p e llé Pierre-pertuis, e ft à u n e grande,
jo u rn é e de B â le , 6c à u n e d em i-jo u rn é e de B ie n n e ,
p rè s de la fo u r c e d e la B r is . C e ch em in n ’e ft p a s
n o u v e a u ; u n e in fc r ip t io n rom a in e q u ’o n v o i t a u -
d eflu s d e T o u v e r tu r e , ma is q u e le s pa ffans o n t mut
ilé e , n o u s a p p ren d q u ’il a é té fa it p a r le s fo in s d ’u n
P a te r iu s o u P a te rn u s d u u m v i r , d e la c o lo n ie H e lv
é t iq u e é ta b lie à A v e n c h e , fo u s l ’em p ire d es d e u x
A n to n in s . ( D. J.')
P I E R R É E , f. .f . ( Hydr. ) e ft à-peu-près la.mêm©
q u e c h a t ie r e , c ’ e ft u n e g ran d e lo n g u e u r d e m a ço n n
e r ie dans le s t e r r e s , p o u r c o n d u ir e le s e a u x d ’u n e
fo u r c e dans u n r é f e r v o i r o u r e g a rd d e p r i f e , e lle s f e
c o n ft ru ife n t ainfi ; o n le u r d o n n e d ’o u v e r tu r e d ep u is
u n p ié ju fq u ’à 18 p o u c e s ; fi la fo u r c ’e e ft ab o n d an te ,
o n é le v e d e c h a q u e c ô t é u n p e t it m u r d’u n p i é
d’ epaifl'eur 6c d e d ix -h u i t p o u c e s de h a u t , b â t ie d e
r o c a ille s & p ie r r e s fe c h e s , a fin q u e le s f ilt r a t io n s
d e s te r r e s fe je t te n t p lu s a ifém en t d ed ans la p i e r r é e ;
o n la c o u v r e en fo rm e de c h a t ie re s a v e c d e s p ie r r e s
p l a t e s , a p p e llé e s dalles o u couvertures. Q u a n d le fo n d
d e la te r r e n ’e ft pa s a f fe z fe rm e p o u r y fa ir e r o u le r
l ’e au fans fe p e r d r e , o n y é te n d u n l i t d e g la if e
q u e l ’o n b a t , & l ’ o n y p ô le d effus le s m o ë lo n s d e s
mu r s d es c ô té s ; o n le s p e u t e n c o r e p a v e r o u c im
e n te r p o u r p lu s g r an d e fû r e té .
P IE R R E R IE S , 1. f. p l. la c o lle c t io n d e s p ie r r e s p r é c
ie u fe s m o n té e s q u i fo rm en t l’ é c r a in d ’ u n e fem m
e . O n m e t le s p e r le s a u n om b r e d es pierreries ; il
y a u n o ffic ie r g a rd e d es pierreries d e la c o u r o n n e .
P I E R R E U X , ad j. ( Agricult. ) fe d it d ’un te r r e in
p le in d e p ie r r e s q u i o b lig e d e le p a ffe r à la c la ie .
O n d it e n c o r e u n fru it pierreux, q u an d en le m a n g
e a n t , ii fe t r o u v e d es d u r illo n s dans fa ch a ir .
P IE R R U R E S , f. f. ( Ckajfe. ) c ’ e ft c e q u i fo rm e la
fr a i fe q u i e ft a u to u r d e s m e u le s d e la tê te d ’ un c e r f ,
d’u n d a im 6c d’un c h e v r e u i l , en fo rm e d e p e t ite s
p ie r r e s .
P IE R R IE R , f . m. (Artillerie.) c ’ e ft u n e p e t ite p iè c
e d’ a r t i lle r ie , d o n t o n fe fe r t p a r t ic u liè r em en t d ans
u n v a i f f e a u , p o u r t ir e r à l ’ a b o rd a g e d e s c lo u s , d es
f e r r em e n s , &c. fu r u n ten n em i. Voye^ A r t i l l e r i e
& M o r t i e r .
O n le s o u v r e g én é r a lem en t p a r la c u la f le , & leu r e
ch am b re s p o u v a n t ê t re d ém o n tré e s , o n le s ch a rg e
p a r c e m o y e n , au lie u d ’a g ir p a r le u r b o u c h e , com m
e o n le fa it o rd in a irem en t p a r r a p p o r t a u x au tre s
arm e s à fe u . Chambers.
O n s’e ft f e r v i au t r e fo is d e c e t t e e fp e c e de c an o n
fu r t e r r e , ma is il y a lo n g - tem s q u e l’ u fa g e e n e ft in te
r rom p u . M . de S . R em y d it m eme q u e d e fo n te ms
o n a r e fo n d u to u s c e u x q u i f e t r o u v o ie n t d ans le s ar-
c e n a u x .
ceïiaux. Cependant pltifieurs auteurs militaires prétendent
qu’on pourroit encore s’en fervir utilement.
Le pierrier eft aufli une maniéré de mortier avec
lequel on jette des pierres dans un retranchement ou
antre ouvrage. Il fe charge comme le mortier ordinaire
, 6c les pierres ou cailloux fe mettent dans un
panjer à la place de la bombe.
On voit dans la Pl. FU I. de fortification, figure 3,
un pierrier, dont les principales parties font : A , les
tourillons ; Z , le mufle avec la lumière fur la culafle;
<7, le renfort avec fes moulures ; D , le ventre ; E ,
plate-bande du renfort de volée avec les moulures ;
F F , les cercles ou renforts fur la volée ; G, le bour-
let; JT, la bouche ou l’embouchure ; ƒ, l’anfe.
Vanfe de ce mortier eft ce qui eft pondtué depuis
le bourlet jufqu’au bas du ventre, 6c 1a chambre eft
l’efpace ponélué entre le ventre de la lumière. Viye%_
A m e & C h a m b r e .
Le pierrier ou mortier pierrier ( car on lui donne
aufli ce nom) pefe ordinairement 1000 livres; fa
portée la plus longue eft de 150 toifes ,■ chargé de
deux livres de poudre : il a 15 pouces de diamètre
à fa bouche, 6c 2 piés 7 pouces de hauteur.
La profondeur de fa chambre, évafée par le haut,
fans v comprendre l’entrée oii fe met le tampon, eft
de 8 pouces.
Les tourillons ont 5 pouces de diamètre. La chambre
doit entrer d’un pouce dans les tourillons. L’é-
paiffeur du métal au droit de la chambre a 3 pouces ;
l’épaiffeur du ventre 2 ; 6c le long de la volée un
pouce 6c demi. L’angle fe place au ventre. Le mufle
ou mafque fert de baflinet à la lumière.
• On charge le pierrier de la même maniéré que le
mortier, c’eft-à-dire, qu’on y met d’abord la quantité
de poudre dont la chambré doit être remplie. On
recouvre cette poudre de foin 6c de terre qu’on refoule
avec la demoiftlle ; après quoi on jette ou on
pofe deffus une quantité de pierres 6c de'Cailloux.
L’effet du pierrier eft très-grand. L’efpece de grêle de
cailloux qu’il produit fait beaucoup de defordre 6c de
ravages. Pour qu’il réufliffe parfaitement, il faut qu’il
ne foit éloigné que d’environ 150 pas de l’endroit
oîi l’on veut faire tomber les pierres dont il eft chargé.
On mêle quelquefois des bombes 6c des grenades
avec ces pierres, 6c l’effet en eft encore plus
grand. (Q)
PIERROT, voyei M o in e a u .
. PIERUS, ( Géog. dnc.),.i°. montagne de laThefi
falie, félon Pline, /. IV. c. viij. Paufanias , /. IX . c.
xxix. la place dans la Macédoine,& dit qu’elle tiroit
fon nom de Fieras, qui y établit le culte des mufes
fous le nom de Piérides.
20. Pierus eft aufli le nom d’un fleuve de l’Achaïe
propre ; il traverfoit, dit Paufanias , l. VII. c. x x ij.
le territoire de la ville Pkarce. Strabon, /. VIII. p.
342. qui écrit Peirus, dit qu’on nommoit aufli ce
fleuve Theuthéas, 6c qu’il fe jettoitdans l’Achéloiis.
( D - J •}
PIESMA, f, m. (Mat. med. des anciens.) mta-pet, de
•ntlfa, jeprejfc-; ce.terme grec défigne le marc ou le
réjidu qui refte après qu’on a exprimé la partie fluide
de quelque fubftance folide, comme des fruits, des
amandes, &c. Ainfi, dans l’expreflion des huiles , le
tourteau, ou ce qui refte dans le fac eft appellépief-
ma, & .c’eft dans ce fens qu’Hippocrate l’emploie ;
cependant Diofcoride, parlant des baies de laurier,
appelle leur fuc exprime, piefma laurinum ; 6c c’eft
aufli dans le même, fens que Galien emploie ce mot#
PIÉTÉ, D É VOT IO N , RELIGION, (Synon.)
le mot de religion dans un fens ; en tant qu’il marque
une difpofition de coeur à l’ égard de nos devoirs envers
Dieu , eft feulement fynonyme avec les deux
autres mots ; la piété fait qu’on s’en acquitte avec plus
Tom e X I I .
de refpeét 6t plus de zèle ; la dévotion y porte un extérieur
plus compofé.
C’eft affez pour une perfonne du monde d’avoir dé
la religion ; la piété convient aux perfonnes qui fe plaquent
de vertu-; la dévotion eft le partage des gens entièrement
retirés.
La. religion eft plus dans le coeur qu’elle lie paroît
au-dehors. La piété eft dans le coeur, 6c paroît au de*
hors. La dévotion paroît quelquefois au-dehors fans
être dans le coeur. Girard.
Pieté , promejfe faite à la > ( Théologie.) S. Paul dit
en termes exprès /. Thimoth. iv. 8. « que la piété a
» les promeffes de la vie préfente, comme de celle
» qui eft à venir » : Pour avoir des juftes idées de ce
que cet apôtre a voulu dire , il convient de 1. déterminer
quelles font les promeffes dont il parle. 2.
concilier fon affertion avec l’expérience.
I. Sur le premier article, il faut obfervef d’abord
qu’il s’agit de promeffes proprement dites, de décia*
rations ‘formelles émanées de Dieu. Le tour des ex-
preflîons de S. Paul ne permet guere d’en, douter. Il
parle des promeffes de la v ie à venir, 6c l’on ne peut
contefter qu’il n’entende pas là l’engagement qiteDieu
a pris par des promeffes expreffes de rendre les gens
de bien heureux dans la vie à venir. On doit par lès
promeffes de la vie préfente, entendre aufli des déclarations
précifes en forme d’engagement,qui regardent
la vie préfente , 6c qui promettent des avantages
dans l’économie du tems.
Ce n’eft pas tout-à-fait prouver lathèfe de S. Paul,
que de faire valoir les avantages que la piété eft ca-*'
pable de procurer, à la confiderer en elle-même 6c
dans fa nature ; il femble que l’apôtre parle encore
de promeflés temporelles, différentes même des biens
de la grâce. Seroit-il ici queftion de tout ce qui peut
rendre l’homme heureux dans ce monde ? mais l’ ex*
périence démentiroit la décifion de S. Paul, à la prendre
en ce fens. On pourroit d ire, pour mieux expli*
quer les paroles de l’apôtre , qu’il portoit fes vues :
i° . Sur les promeffes faites à la piété dans l’ancien
Teftament, nOn fur toutes , mais fur celles qui regardent
les fideles, en tant que tels en particulier»
20. Sur les promeffes faites dans l’évangile, par lesquelles
^celles de l ’ancienne économie ont été confirmées.
,
Il ne s’agit pas, dans ces promeffes, de grandeurs,
de richeffes, 6c d’autres biens de cet ordre ; c’eft ce
que Dieu n’a promis ni fous la lo i, ni fous l’Evangile.
Les promeffes dont il s’agit font celles par lesquelles
Dieu fe propofe de protéger les fideles, de
pourvoir à leurs befoins ,‘6c de les foutenir dans les
traverfes de la vie. C ’eft ce que S. Paul indique lui-
même dans le v. 10. oii il dit que Dieu eft-le confer-
vateur de tous les hommes, mais principalement des
fideles. Ce qui prouve encore que fa penfée
ne porte que fur cette proteftion fpéciale , fur laquelle
les gens de.bien peuvent compter, c’ eft qu’on
voit regner le même principe en d’autres endroits de
fes écrits. Philipp. c. iv. v. G. « Ne foyez en inquié-
» tude de rien ; mais en toutes chofes, préfentez à
» D ieu vos demandes par des' prières 6c des fupplica-
» tions, avec aftion de grâce. Hebr. c. xiij. v. 5. G.
» Que vos moeurs foient fans avarice, étant contens
» de ce que vous poffédez préfentement ; car Dieu
» lui-même a dit : je ne te délaifferai point, 6c ne
» t’abandonnerai point : tellement que nous pouvons
» dire avec affurance :-lè feigneur eft mon a ide, ainfi
» je ne craindrai point ce que l’homme me pourroit
.» faire ». Il eft évident que dans ce dernier paffage S.
Paul veut que les chrétiens envifagent les promeflés
de l’ancien Teftament, qu’il cite comme des promefi
fes qui le regardent direriement. Le Sauveur lui-même
(S. Matth. c. vj. v. 2.5.3 4.)'veut que fès difciples
n’attendent de Dieu que fa protection, 6c les chofes G G g g