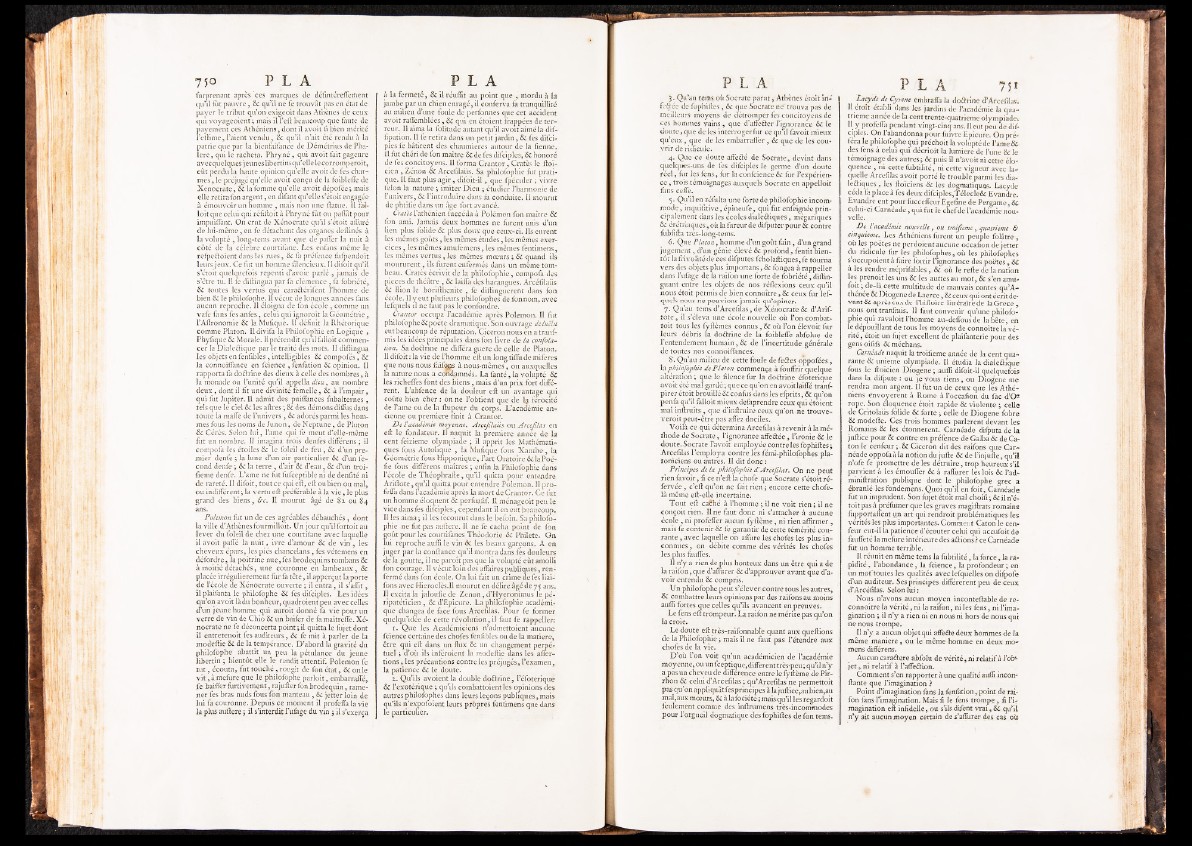
furprenant après ces marques de défintéreffement
qu’il fut pauvre, & qu’il ne fe trouvât pas en état de
payer le tribut qu’on exigeoit dans Athènes de ceux
qui voyageoient ; mais il l’eft beaucoup que faute de
payement ces Athéniens, dont il avoit fi bien mérité
l’eftime, l’aient vendu, & qu’il n’ait été rendu à la
patrie que par la bienfaifance de Dcmétrius de Pha-
lere, qui le racheta. Phryné, qui avoit fait gageure
avecquelques jeunes libertinsqu’elle le corromperoit,
eût perdu la haute opinion qu’elle avoit de fes charmes
, le préjugé qu’elle avoit conçu de la foiblefî'e de
Xenocrate, & la fomme qu’elle avoit dépofée ; mais
elle retirafon argent, en difant qu’elle s’étoit engagée
à émouvoir un homme , mais non une ftatue. Il fal-
loit que celui qui réfiftoit à Phryné fut ou pafîat pour
impuiffant. On crut de Xénocrate qu’il s’étoit afïiiré
de lui-même, en fe détachant des organes deftinés à
la volupté , long-tems avant que de paffer la nuit à
côté de la célébré eourtifane. Les enfans même le
refpeéloient dans les mes, & fa préfence fufpendoit
leurs jeux. Ce fut un homme filencieux. Il difoit qu’il
s’étoit quelquefois repenti d’avoir parlé , jamais de
s’être tu. Il le diftingua par fa clémence , fa fobriété,
(te toutes les vertus qui caraélérifent l’homme de
bien & le philofophe. Il vécut de longues années fans
aucun reproche. 11 éloigna de fon école , comme un
vafe fans fes anfes, celui qui ignoroit la Géométrie,
l’Aftronomie & la Mufique. Il définit la Rhétorique
comme Platon. Il divifa la Philofophie en Logique ,
Phyfique & Morale. Il prétendit qu’il falioit commencer
la Dialectique par le traité des mots. Il diftingua
les objets en fenfibles , intelligibles & compofés , (te
la connoiffance en fcience , fenfation & opinion. Il
rapporta fa doélrine des dieux à celle des nombres, à
la monade ou l’unité qu’il appella dieu, au nombre
deux , dont il fit une divinité femelle, & à l’impair,
qui fut Jupiter. Il admit des puiffances fubalternes ,
tels que le ciel & les aftres ; & des démons difilis dans
toute la maffe de l’univers , & adorés parmi les hommes
fous les noms de Junon, de Neptune, de Pluton
& Cérès. Selon lui, l’ame qui fe meut d’elle-même
fut un nombre. Il imagina trois denfes différens ; il
compofa les étoiles & le foleil de feu , & d’un premier
denfe ; la lune d’un air particulier & d’un fécond
denfe ; & la terre , d’air & d’eau, & d’un troi-
lîeme denfe. L’ame ne fut fufceptible ni de denfité ni
de rareté. Il difoit, tout ce qui eft, eft ou bien ou mal,
ou indifférent ; la vertu eft préférable à la v ie , le plus
grand des biens, &c. Il mourut âgé de 8z ou 84
ans.
Polemon fut un de ces agréables débauchés, dont
la ville d’Athènes fourmilloit. Un jour qu’il fortoit au
lever du foleil de chez une eourtifane avec laquelle
il avoit pafl'é la nuit, ivre d’amour & de v in , les
cheveux épars, les piés chancelans, fes vétemens en
défordre, la poitrine nue,fes brodequins tombans &
à moitié détachés, une couronne en lambeaux, &
placée irrégulièrement fur fa tête, il apperçut la porte
de l’école de Xénocrate ouverte ; il entra, il s’affit,
il plaifanta le philofophe & fes difciples. Les idées
qu’on avoit là du bonheur, quadroient peu avec celles
d’un jeune homme qui auroit donné fa vie pour un
verre de vin de Chio & un baifer de fa maîtreffe. Xé-.
nocrate ne fe déconcerta point ; il quitta le fujet dont
il entretenoit fes auditeurs, & fe mit à parler de la
modeftie & de la tempérance. D ’abord la gravité du
philofophe abattit un peu la pétulance du jeune
libertin ; bientôt elle le rendit attentif. Polemon fe
tu t, écouta, fut touché, rougit de fon état, & on le
v i t , à mefure que le philofophe parloit, embarraffé,
fe baiffer furtivement, rajufter fon brodequin, ramener
fes bras niids fous fon manteau, & jetter loin de
lui fa couronne. Depuis ce moment il profeffa la vie
la plus auftere ; il s’interdit l’ufage du v in ; il s’exerça
à la fermeté, & il réuflit au point que , mordu à la
jambe par un chien enragé, il conferva fa tranquillité
au milieu d’une foule de perfonnes que cet accident
avoit raffemblées, & qui en étoient frappées de terreur.
Il aima la folitude autant qu’il avoit aimé la dif-
fipation. Il fe retira dans un petit jardin, & fes difciples
fe bâtirent des chaumières autour de la fienne.
Il fut chéri de fon maître & de fes difciples, & honoré
de fes concitoyens. Il forma Crantor , Cratèsle ftoï-
cien , Zénon & Arcefilaiis. Sa philofophie fut pratique.
Il faut plus agir, difoit-il, que fpéculer ; vivre
félon la nature ; imiter Dieu ; étudier l’harmonie de
l’univers, & l’introduire dans là conduite. Il mourut
de phtifie dans un âge fort avancé.
Gratis l’athénien fuccéda à Polémon fon maître &
fon ami. Jamais deux hommes ne furent unis d’un
lien plus folide & plus doux que ceux-ci. Ils eurent
les mêmes goûts, les mêmes études, les mêmes exercices
, les mêmes amufemens, les mêmes fentimens,
les mêmes v ertus, les mêmes moeurs ; & quand ils
moururent, ils furent enfermés dans un meme tombeau.
Cratès écrivit de la philofophie, compofa des
pièces de théâtre , & laifla des harangues. Arcefilaiis
& Bion le borifthenite , fe diftinguerent dans fon
école. Il y eut plufieurs philofophes de fonnom, avec
lefquels il ne faut pas le confondre.
Crantor occupa l’académie après Polemon. Il fiit
philofophe & poète dramatique. Son ouvrage delucla
eut beaucoup de réputation. Cicéron nous en a tranf-
mis les idées principales dans fon livre de La confola-
don. Sa doftrine ne différa guère de celle de Platon.
Il difoit : la vie de l’homme eft un long tiffu de miferes
que nous nous faifogs à nous-mêmes, ou auxquelles
la nature nous a ccmdgmnés. La fanté, la volupté &
les richeffes font des biens, mais d’un prix fort différent.
L’abfence de la douleur eft un avantage qui
coûte bien cher : on ne l’obtient que de l j férocité
de l’ame ou de la ftupeur du corps. L’académie ancienne
ou première finit à Crantor.
De l'académie moyenne. Arcefilaiis ou Arcefilas en
eft le fondateur. Il naquit la première annee de la
cent feizieme olympiade ; il apprit les Mathématiques
fous Autolique , la Mufique fous Xanthe, la
Géométrie fous Hipponique, l’art Oratoire & la Poé-
fie fous différens maîtres ; enfin la Philofophie dans
l’école de Théophrafte, qu’il quitta pour entendre
Ariftote, qu’il quitta pour entendre Polemon. Il pro-
feffa dans l’académie après la mort de Crantor. C e fut
un homme éloquent & perfuafif. Il ménageoit peu le
vice dans fes difciples, cependant il en eut beaucoup.
Il les aima ; il les fecourut dans le befoin. Sa philofo^
phie ne fut pas auftere. Il ne fe cacha point de fon
goût pour les courtifanes Théodorie & Philete. On
lui reproche aufli le vin & les beaux garçons. A en
juger par la confiance qu’il montra dans fés douleurs
de la goutte, il ne paroît pas que la volupté eût amolli
fon courage. Il vécut loin des affaires publiques, renfermé
dans fon école. On lui fait un crime de fes liai-
fons avec Hieroclès.Il mourut en délire âgé de 75 ans.
Il excita la jaloufie de Zenon, d’Hyeronimus le pé-
ripatéticien , & d’Epicure. La philofophie académique
changea de face fous Arcefilas. Pour fe former
quelqu’idée de cette révolution, il faut fe rappeller:
1. Que les Académiciens n’admettoient aucune
fcience certaine des chofes fenfibles ou de la matière,
être qui eft dans un flux & un changement perpétuel
; d’où ils inféroient la modeftie dans les afTer-
tions, les précautions contre les préjugés, l’examen,
la patience & le doute.
z. Qu’ils avoient la double doélrine, l’éfoteriqué
& l’exotérique ; qu’ils combatt,oient les opinions des
autres philofophes dans leurs leçons publiques, mais
qu’ils n’expofoient leurs prôpres fentimens que dans
le particulier.
3 • Qu’au teins où Socrate pafut, Athènes étoit îri-
fe&ée de fophiftes, & que Socrate ne' trouva pas de
meilleurs moyens de détromper fes concitoyens de
ces hommes vains , que d’affeéter l’ignorance & le
doute, que de les interroger fur ce qu’il favoit mieux
qu’eux, que de les embarraflèr, & que de les cou*
.vrir de ridicule.
4. Que ce doute affecté de Socrate, devint dans
quelques-uns de fes difciples le germe d’un doute
réel, fur les fèns, fur la confcience & fur l’expérience
, trois témoignages auxquels Socrate en appelloit
fans celle.
5. Qu’il en réfulta une forte de philofophie incommode
, inquifitive, épineufe, qui fut enfeignée principalement
dans les écoles dialeériques, mégariqués
& eretriaques, où la fureur de difputer pour & contre
fubfifta tres-long-tems.
6. Que Platon, homme d’un goût fain, d’un grand
jugement, d’un génie élevé & profond, fentit bientôt
la frivolité de ces difputes fcholaftiques,fe tourna
vers des objets plus importans, & fongea à rappellef
dans l’ufage de la raifon une forte de fobriété, diftin-
guant entre les objets de nos réflexions ceux qu’il
nous étoit permis de bien connoître, & ceux fur lefquels
nous ne pouvions jamais qu’opiner.
7. Qu’au tems d’Arcefilas, de Xénocrate & d’Ariftote
, il s’éleva une école nouvelle où l’on combat-
toit tous les fyftèmes connus, & où l’on élevoit fur
leurs débris la doétrine de la foibleffe abfolue de
l’entendement humain, & de l’incertitude générale
de toutes nos connoiffances.
8. Qu’au milieu de cette foule de feétes oppofées,
la philofophie de Platon commença à fouffrir quelque
altération ; que le filence fur la doétrine éfoterique
avoit été mal gardé; que ce qu’on en avoitlaiffé tranf-
pirer étoit brouillé & confus dans les efprits, & qu’on
penfa qu’il falioit mieux defaprendre ceux qui étoient
mai inftruits , que d’inftruire ceux qu’on ne trouve-
veroit peut-être pas affez dociles.
Voilà ce qui détermina Arcefilas à revenir à la méthode
de Socrate, l’ignorance affeétée, l’ironie & le
doute. Socrate l’avoit employée contre les fophiftes ;
Arcefilas l ’employa contre les fémi-philofophes platoniciens
ou autres. Il dit donc :
Principes de la philofophie d'Arcefilas. On ne peut
rien favoir, fi ce n’eft la chofe que Socrate s’étoit ré-
fervée , c’eft qu’on ne fait rien ; encore cette chofe-
là même eft-elle incertaine.
Tout eft caChé à l’homme ; il ne voit rien ; il ne
conçoit rien. Il ne faut donc ni s’attacher à aucune
école, ni profeffer aucun fyftème, ni rien affirmer,
mais fe contenir & fe garantir de. cette témérité courante
, avec laquelle on affure les chofes les plus inconnues
, on débite comme des vérités les chofes
les plus fauffes.
Il n’y a rien de plus honteux dans un être qui a de
la raifon, que d’afliirer & d’approuver avant que d’avoir
entendu & compris.
Un philofophe peut s’élever contre tous les autres,
& combattre leurs opinions par des raifons au moins
aufli fortes que celles qu’ils avancent en preuves.
Le fens eft trompeur. La raifon ne mérite pas qu’on
la croie.
Le doute eft très-raifonnablé quant aux queftions
de la Philofophie ; mais il ne faut pas l’étendre aux
chofes de la vie.
D’où l’on voit qu’un académicien de l’académie
moyenne, ou un feeptique,different très-peu; qu’il n’y
a pas un cheveu de différence entre le fyftème de Pir-
rhon & celui d’Arcefilas ; qu’Arcefilas ne permettoit
pas qu’on appliquât fes principes à la juftice,aubien,au
mal,aux moeurs, & à lafociété ; mais qu’il les regardoit
feulement comme des inftrumens très-incommodes
pour l’orgueil dogmatique des fophiftes de fon tems.
Lacyde de Cyrene ehibraffa la doétrîne d’Arcefilas *
Il etoit établi dans les jardins de l’académië la qua-*
trieme année de la cent trente-quatrieme olympiade*
Il y profeffa pendant vingt-cinq ans. Il eut peu de dif*
ciplés, On l’abandonna pour fuivre Epicure. On pré*
féra le philofophe qui préchoit la volupté de l’ame &
des fens à celui qui décrioit la lumière de l’une & le
témoignage des autres ; & puis il n’avoit ni cette élo*
qiiehce , ni cette fubtilité, ni cette vigueur avec la*
quelle Arcefilas avoit porté le trouble parmi les dia*
leéliques, les ftoïciens (te les dogmatiques. Lacyde
céda fa place à fes deux difciples,Télecle& Evandre*
Evandre eut pour fucceffeurEgefîne de Pergame, (te
celui-ci Carneade, qui fut le chefde l’académie nouvelle*
De l'académie nouvelle , ou troifieme, quatrième &
cinquième. Les Athéniens furent un peuple folâtre ,
où les poètes ne perdoient aucune occafion de jetter
du ridicule fur les philofophes, où les philofophes
s’occupoient à faire fortir l’ignorance des poètes, (te
à les rendre méprifables, & où le refte de la nation
les prenoit les uns & les auttes au mot, & s’en amü-
g s j > de-là cette multitude de mauvais contes qu’A-*
thenee & Diogene de Laerce, & ceux qui ont écrit de*
van t& après eux de l’hiftoire littéraire de laGrece ,
nous ont tranfmis. Il faut convenir qu’une philofophie
qui ravaloit l’homme au-deffousde la bête, en
le dépouillant de tous les moyens de connoître la vérité,
étoit un fujet excellent de plaifanterie pour des
gensoififs &méchans.
Carnéade naquit la troifieme année de la Cent qua*
rante & unième olympiade. Il étudia la dialeéHque
fous le ftoïcien Diogene ; aufli difoit-il quelquefois
dans la difpüte : ou je vous tiens, ou Diogene me
rendra mon argent. Il fut un de ceux que les Athéniens
envoyèrent à Rome à l’occafion du fac d’O
rope. Son éloquence étoit rapide & violente ; celle
de Critolaüs folide & forte ; celle de Diogene fobre
& modefte. Ces trois hommes parlèrent devant les
Romains (te les étonnèrent. Carnéade difputa de la
juftice pour & contre en préfence de Galba & de Caton
le cenfeur Cicéron dit des raifons que Carnéade
oppofaà la notion du jufte & de Pinjufte, qu’il
n’ofe fe promettre de les détruire, trop heureux s’il
parvient à les émouffer & à raffurer les lois & l’ad-
miniftration publique dont le philofophe grec a
ébranlé les fondemens. Quoi qu'il en foit, Carnéade
fut un imprudent. Son fujet étoit mal choifi ; & il n’é-
toit pas à préfumer que les graves magiftrats romains
fuppqrtaffent un art qui rendroit problématiques les
vérités les plus importantes. Comment Caton le cenfeur
eut-il la patience d’écouter celui qui accufoit de
fauffeté la mefure intérieure des aérions ? ce Carnéade
fut un homme terrible.
Il réunit en même tems la fubtilité, la force, la rapidité
, l’abondance, la fcience, la profondeur ; en
un mot'toutes les qualités avec lefquelles on difpofe
d’un auditeur. Ses principes différèrent peu de ceux
d’Arcéfilas. Selon lui:
Nous n’avons aucun moyen inconteftable de re-
connoître la vérité, ni la raifon, ni les fens, ni l’imagination
; il n’y a rien ni en nous ni hors de nous qui
ne nous trompe.
Il n’y a aucun objet qui affeûe deux hommes de la
même maniéré, ou le même homme en deux mo-
mens différens.
Aucun caraélere âbfolu de vérité, ni relatif à l’objet
, ni relatif à l’affeélion.
Comment s’en rapporter à une qualité auflî incon-
ftante que l’imagination ?
Point d’imagination fans la fenfation, point de rai-
fon fans l’imagination. Mais fi le fens trompe, fi l’imagination
eft infidelle, ou s’ils difent v rai, & qu’il
n’y ait aucun moyen certain de s’affurer des cas oit