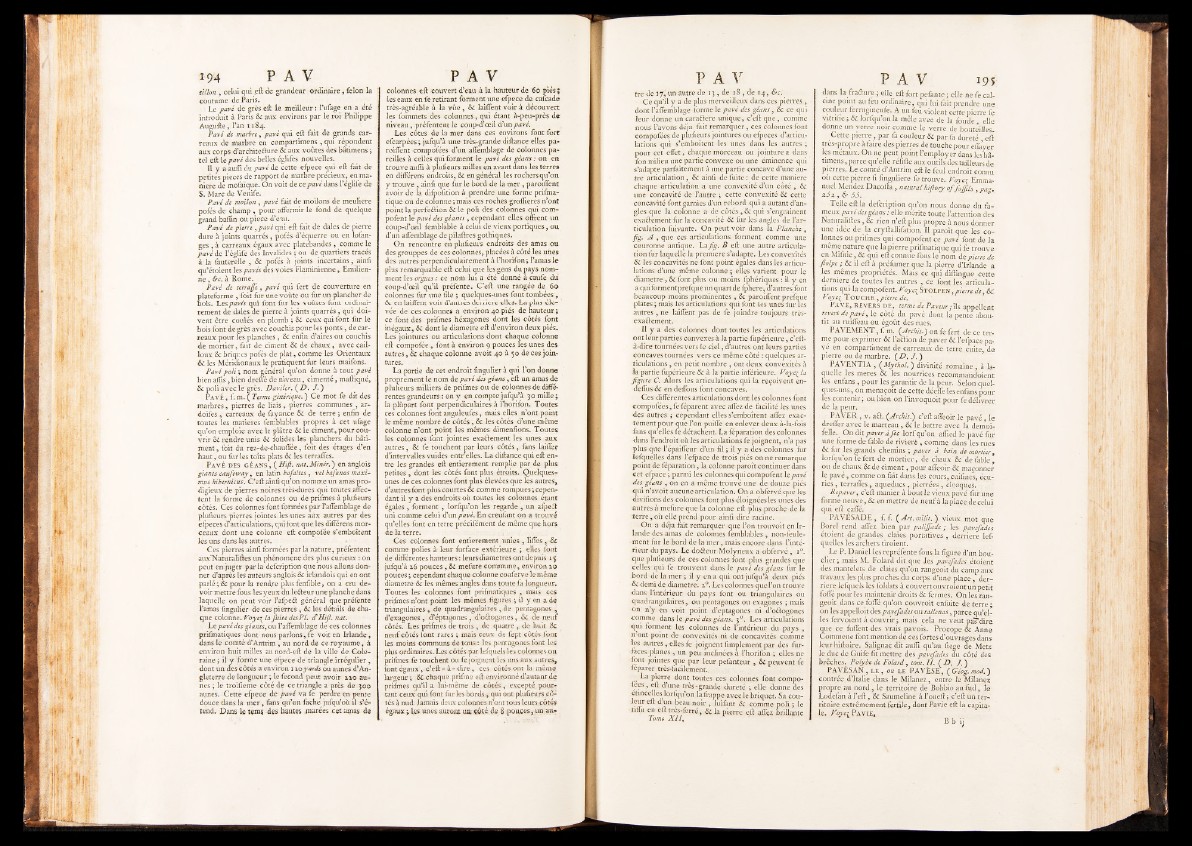
ttllon , celui qui eft de grandeur ordinaire, félon la
coutume de Paris.
Le pavé de grès eft le meilleur : l’ufage en a été
introduit à Paris 8c aux environs par le roi Philippe
Augufte, l’an 1184.
Pavé de marbre, pavé qui eft fait de grands carreaux
de marbre en compartimens , qui répondent
aux corps d’architeôure 8c aux .voûtes des bâtimens ;
tel eft le pavé des belles églifes nouvelles.
Il y a auiïï du pavé de cette efpece qui eft fait de
petites pièces de rapport de marbre précieux, en maniéré
de mofaïque. On voit de ce pavé dans l’égfife ds
S. Marc de Venife.
Pavé de moilon, pavé fait de moilons de meuliere
pofés de champ , pour affermir le fond de quelque
grand balfin ou piece d’eau.
Pavé de pierre , pavé qui eft fait de dales de pierre
dure à joints quarrés , pofés d’équerre ou en lofan-
ges , à carreaux égaux avec platebandes, comme le
pavé de l’églife des Invalides ; ou de quartiers tracés
à la fauterelle , & pofés à joints incertains, ainfi
qu’étoient les pavés des voies Flaminienne, Emilien-
n e , &c. à Rome.
Pavé de terraße, pavé qui fert de couverture en
plateforme , ‘foit fur une voûte ou fur un plancher de
bois. Les pavés qui font fur les voûtes font ordinairement
de dales de pierre à joints quarrés, qui doivent
être coulés en plomb ; 8c ceux qui font fur le
bois font de grès avec couchis pour les ponts, de carreaux
pour les planches, 8c enfin d’aires ou couchis
de mortier, fait de. ciment. 8c de chaux, avec cail-
loux 8c briques pofés de plat, comme les Orientaux
6c les Méridionaux le pratiquent fur leurs maifons.
Pavé poli ; nom général qu’on donne à tout pavé
bien aflïs, bien drefl'é de niveau, cimenté, maftiqué,
& poli avec lè grès. Daviler. ( D . J. )
Pa vé , f: m. ( Terme générique. ) Ce mot fe dit des
marbres, pierres de liais, pierres communes , ar-
doifes , carreaux de fayance 8c de terre ; enfin de
toutes les matières femblables propres à cet ufage
qu’on emploie avec le plâtre 8c le ciment, pour couvrir
8c rendre unis 8c lolides les planchers du bâtiment
, foit du rez-de-chauffée, foit des étages d’en
haut, ou fur les toits plats 8c les terraffes.
Pa v é des géans , ( Hiß. nat.Minér.') en anglois
giants caufeway, en latin bafaltes, vel bafanos maxi-
mus hlbernicus. C’eft ainfi qu’on nomme un amas prodigieux
de pierres noires très-dures qui toutes affectent
la forme de colonnes ou de prifmes à plufieurs
côtés. Ces colonnes.font formées par l’aftemblage de
plufieurs pierres jointes les :unes aux autres par des
efpeces d’articulations, qui font que. les différens morceaux
dont une colonne eft compofée s’emboîtent
les uns dans les autres.
Ces pierres ainfi formées parla nature, préfentent
aux'Naturaliftes un phénomène des plus curieux : on
peut en juger par la defeription que nous allons donner
d’après les auteurs anglois 8c irlandois qui en ont
parlé ; 8c pour la rendre plus fenfible, on a cru devoir
mettre fous lesyeux du lefteur une planche dans
laquelle on peut voir l’afp eft général que préfente
l’amas finguliér de ces pierres , 8c les détails de chaque
colonne. Voye£ la fuite desPl. £ Hiß. nat.
Le pavé des géants, ou l’affemblage de ces colonnes
prifinatiques dont nous parlons, fe voit en Irlande,
dans le comté d’Antrim , au nord de ce royaume, à
environ huit milles au nord-eft de la ville de Cole-
raine ; il y forme une efpece de triangle irrégulier ,
dont un des côtés a environ 110yards ou aunes d’Angleterre
de longueur ; le fécond peut avoir 210 aunes
; le troifieme côté de ce triangle a près de 300
aunes. Cette efpece de pavé va fe perdre en pente
douce dans la mer, fans qu’on fache jufqu’oii il s’é-
tendr Dans le tem$ des hautes -marées cet amas de
colonnes , eft couvert d’eau à la hauteur de 60 pies ;
les eaux en fe retirant forment une efpece de cafcade
très-agréable à la vite , 8c laiffent voir à découvert
les fommets des colonnes, qui étant à-peu-près d«
niveau, préfentent le coup-d’oeil d’un pavé.
Les côtes de la mer dans ces environs font fort
efearpées ; jufqu’à une très-grande diftance elles pa-
roiffent compofées d’un affemblage de colonnes pareilles
à celles qui forment le pavé des géans : on en
trouve auffi à plufieurs milles en avant dans les terres
en différens endroits, 8c en général les rochers qu’on
y trouve , ainfi que fur le bord de la mer , paroiffent
avoir de la difpofition à prendre une forme prifma-
tique ou de colonne;mais ces roches groflieres n’ont
point la perfeftion 8c le poli des colonnes qui com-
pofent le pavé des géants , cependant elles offrent un
coup-d’oeil femblable à celui de vieux portiques, ou,
d’un affemblage de pilaftres gothiques.
On rencontre en plufieurs endroits des amas ou
des grouppes de ces colonnes, placées à côté les unes
des autres perpendiculairement à l’horifon; l’amas le
plus remarquable eft celui que les gens du pays nomment
les orgues : ce nom lui a été donné à caufe dû
côup-d’oeil qu’il préfente. C ’eft une rangée de 60
colonnes fin une file ; quelques-unes font tombées ,
8c en laiffent voir d’autres derrière elles. La plus éle- '
vée de ces colonnes a environ 40 piés de hauteur ;
ce font des prifmes héxagones dont les côtés font
inégaux, 8c dont le diamètre eft d’environ deux piés.
Les jointures ou articulations dont chaque colonne
eft compofée, font à environ 9 pouces les unes des
autres, 8c chaque colonne avoit 40 à 50 de ces jointures.
La partie de cet endroit finguliér à qui l’on donne
proprement le nom de pavé des géans, eft un amas de
plufieurs milliers de prifmes ou de colonnes de différentes
grandeurs : on y en compte jufqu’à 30 m ille;
la plupart font perpendiculaires à l’horifon. Toutes
ces colonnes font anguleufes, mais elles n’ont point
le même nombre de côtés, 8c les côtés d’une même
colonne n’ont point les mêmes dimenfions. Toutes
les colonnes font jointes exaftement les unes aux
autres, 8c fe touchent par leurs côtés, fans laiffer
d’intervalles vuides entr’elles. La diftance qui eft entre
les grandes eft entièrement remplie par de plus
petites , dont les côtés font plus étroits. Quelques-
unes de ces colonnes font plus élevées que les autres,
d’autres font plus courtes 8c comme rompues; cependant
il y a des endroits oii toutes les colonnes étant
égales , forment, lorfqu’on les regarde , un afpeft
uni comme celui d’un pavé. En creufant on a trouvé
qu’elles font en terre précifément de même que hors
de la terre.
Ces colonnes font entièrement unies, liffes, 8c
comme polies à leur furface extérieure ; elles font
de différentes hauteurs : leurs diamètres ont depuis 15
jufqu’à 26 pouces, 8c mefure commune, environ 20
pouces ; cependant chaque colonne conferve le même
diamètre 8c les mêmes angles dans toute fa longueur.
Toutes les colonnes font prifmatiques , mais ces
prifmes n’ont point les mêmes figures ; il y en a de
triangulaires, de quadrangulaires, de pentagones ,
d’exagones , d’éptagones , d’oftogones, 8c de neuf
côtés. Les prifmes de trois , de quatre ,. de huit 8c
neuf côtés font rares ; mais ceux de fept côtés- font
les moins communs de tous : les pentagones font les
plus ordinaires. Les côtés par lefquels les colonnes ou
prifmes fe touchent ou fe joignent les uns aux autres,
font égaux,. c’eft - à - dire , ces côtés ont la même
largeur ; 8tchaque prifine eft environné d’autant de
prifmes qu’il a mi-même de côtés, excepté pourtant
ceux qui font fur les bor.ds, qui ont plufieurs côtés
à nud. Jamais deux colonnes n’ont tous leurs côté$
égaux ; les unes auront ua. çôté, de 8 pouces, un au*
P A V
tire de i% un autre de 13 , de 18 , de 14, &ci
Ce qu’il y a de plus merveilleux dans ces pierres.,
dont l’affemblage forme le pavé des géans, & ce qui
leur donne un caraftere unique, c’eft que, comme
nous l’avons déjà fait remarquer, ces colonnes font
compofées de plufieurs jointures ou efpeces d’articulations
qui s’emboîtent les unes dans les autres ;
pour cet effet, chaque morceau ou jointure a dans
fon milieu une partie convexe ou une éminence qui
s’adapte parfaitement à une partie concave d’une autre
articulation, 8c ainfi de fuite : de cette maniéré
chaque articulation a une convexité d’un côté , 8c
une concavité de l’autre ; cette convexité 8c cette
concavité font garnies d’un rebord qui a autant d’angles
que la colonne a de côtés , 8c qui s’engrainent
exaftement fur la concavité 8c fur les angles de l’articulation
fuivante. On peut voir dans la Planche ,
fig. A , que ces articulations forment comme une
couronne antique. La fig. B eft une autre articulation
fur laquelle la première s’adapte. Les convexités
8c les concavités ne font point égales dans les articulations
d’une même colonne ; elles varient pour le
diamètre, 8c font plus ou moins fphériques : il y en
a qui forment prefque un quart de fphere, d’autres, font
beaucoup moins prominentes , 8c paroiffent prefque
plates ; mais les articulations qui font les unes fur les
autres , ne laiffent pas de fe joindre toujours très-
exaftement.
Il y a des colonnes dont toutes les articulations
ont leur parties convexes à la partie fiipérieure, c’ eft-
à-dire tournées vers le ciel, d’autres ont leurs parties
concaves tournées vers ce même côté : quelques articulations
, en petit nombre , ont deux convexités à
la partie fiipérieure 8c à la partie inférieure. Voye{ La
figure C. Alors les articulations qui la reçoivent en-
deffus 8c en deffous font concaves.
Ces différentes articulations dont les colonnes font
compofées, fe féparent avec affez de facilité les unes
des autres ; cependant elles s’emboîtent affez exactement
pour que l’on puiffe en enlever deux à-la-fois
fans qu’elles fe détachent. La féparation des colonnes
dans l’endroit oii les articulations fe joignent, n’a pas
plus que l’épaiffeur d’un fil ; il y a des colonnes fur
lefquelles dans l’efpace de trois piés on ne remarque
point de féparation, la colonne paroît continuer dans
cet efpàce ; parmi les colonnes qui compofent le pavé
■ des géans , on en a même trouvé une de douze piés
qui n’avoit aucune articulation. On a obfervé que les
divifions des colonnes font plus éloignées les unes des
autres à mefüre que la colonne eft plus proche de la
terre , ou elle prend pour ainfi dire racine.
O n a déjà fait remarquer que l’on trouvoit en Irlande
des amas de colonnes femblables , non-feulement
fur le bord de la iner, mais encore dans l’intérieur
du pays. Le dofteur Molyneux a obfervé, i°.
que plufieurs de ces colonnes lont plus grandes que
celles qui fe trouvent dans le pavé des géans fur le
bord de la mer ; il y en a qui ont jufqu’à deux piés
& demi de diamètre. 20. Les colonnes que l’on trouve
dans l’intérieur du pays font ou triangulaires ou
quadrangulaires, ou pentagones ou exagones ; mais
on n’y en voit point d’eptagones ni d’oftogones
comme dans le pavé des géans. 30. Les articulations
qui forment les colonnes de l’intérieur du pays ,
n ont point de convexités ni de concavités comme
les autres, elles fe joignent Amplement par des fur-
fàces. planes , un peu inclinées à l’horifon ; elles ne
font jointes que par leur pefanteur , 8c peuvent fe
feparer très-facilement..
La pierre dont toutes ces colonnes font compofées
, eft d’une très-grande dureté ; elle donne des
etmcelles lorfqu’on la frappe avec le briquet. Sa couleur
eft d’un -beau noir , luifant & comme poli ; le
tiflu en eft très-ferré, 8c la pierre eft affez brillante
Tpme X I I ,
p a y 195
dans la frafture ; elle eft fort pefante ; elle ne fe calcine
point au feu ordinaire, qui lui fait prendre une
couleur ferrugineufe. A un feu violent cette pierre fe
vitrifie; 8c lorfqu’on la mêle avec de la foude elle
donne un verre noir comme le verre de bouteilles.
Cette pierre, par fa couleur 8c par fa dureté eft
très-propre à faire des pierres de touche pour effayer
lçs métaux. On ne peut point l’employer dans les bâ-
timens, parce qu’elle réfifte aux outils des tailleurs de
pierres. Le comté d’Antrim eft le feul endroit connu
oii cette pierre fi finguliere fe trouve. Foyei Emmanuel
Mendez Dacofta, natural hiflory o f fofjîls, pa<*. 2.32 , & 55. o ■
Telle eft la defeription qu’on nous donne du fameux
pavé des géans : elle mérite toute l’attention des
Naturaliftes , 8c rien n’eft plus propre à nous donner
une idee de la cryftallifation. Il paroît, que les colonnes
ou prifmes qui compofent ce pavé font de la
même nature que la pierre prifmatique qui fe trouve
en Mifnie, 8c qui eft connue fous le nom de pierre de
fiolpe ; 8c il eft à préfumer que la pierre d’Irlande a
.les mêmes propriétés. Mais ce qui diftingue cette
derniere de toutes les autres , ce font les articulations
qui la compofent. Voye{ Stolpen , pierre de, 8c
Voye[ T ouche , pierre de.
Pa v é , revers de? terme de Paveur; ils appellent
revers dépavé, le côté du pavé dont la pente aboutit
au ruiffeau ou égoût des rues.
PAVEMENT, f. m. (Arelût.) on fe fert de ce terme
pour exprimer 8c l’aftion de paver 8c l’efpace pavé
en compartiment de carreaux de terre cuite, de
pierre ou de marbre. (Z>. J. )
PAVENTIA , ( Mythol. ) divinité romaine , à laquelle
les meres 8c les nourrices recommandoient
les enfans , pour les garantir de la peur. Selon quelques
uns, on menaçoit de cette déeffe lesenfàns pour
les contenir; ou bien on l’invoquoit pour fe délivrer
de la peur.
PA V ER , v. aft. ([Arckit.) c’eft affeoir le pavé, le
dreffer avec le marteau, 8c le battre avec la demoi-
felle. On dit paver à fec lorf qu’on affied le pavé fur
une forme de fable de rivierè , comme dans les rues
8c fur les grands chemins ; paver à bain de mortier,
lorfqu’on le fert de mortier, de chaux 8c de fable,
ou de chaux 8c de ciment, pour affeoir 8c maçonner
le p avé, comme on fait dans les cours, cuifines, écuries
, terraffes, aqueducs, pierrées, cloaqiies. •
Repaver, c’eft manier à bout le vieux pavé fur une
forme neuve, 8c en mettre de neuf à la place de celui
qui eft caffé.
P A VÉSADE , f. f. ( Art. mille. ). vieux mot que
Borel rend affez bien par palifiade ; les pavefades
étoient de grandes claies portatives , derrière lefquelles
les archers tiroient.
Le P. Daniel les repréfente fous la figure d’un bouclier
; mais M. Folard dit que des pavefades étoient
des mantelets de claies qu’on rangeoit du camp aux
travaux les plus proches au corps d’une place, derrière
lefquels les foldats à couvert ouvroient un petit
foffé pour les maintenir droits 8c fermes. On les rangeoit
dans ce foffé qu’on couvroit enfuite de terre ;
on les appelloit des pavefades ou tallenas, parce qu’elles
fervoient à couvrir ; mais cela ne veut paTdire
que ce fuffent des vrais pavois. Proçope 8c Anne
Commene font mention de ces fortes d’ouvrages dans
leur hiftoire. Salignaç dit aufli qu’au fiege de Metz
le duc de Guife fit mettre des pavefades du côté des
brèches. Polybe de Folard, tom. II. ( D . J .)
PAVÉSAN, le , ou le PAVÈSE, { Géog. mod.)
contrée d’Italie dans le Milanez, entre le Milanez
propre au nord, le territoire de Bobbio au iu d , lê
Lodefàn à l’eft, 8c Saumeline à l’pueft ; c’eft un territoire
extrêmement fertile, dont Pavie eft la capitale.
Voyez Pà VLE,
B b ij