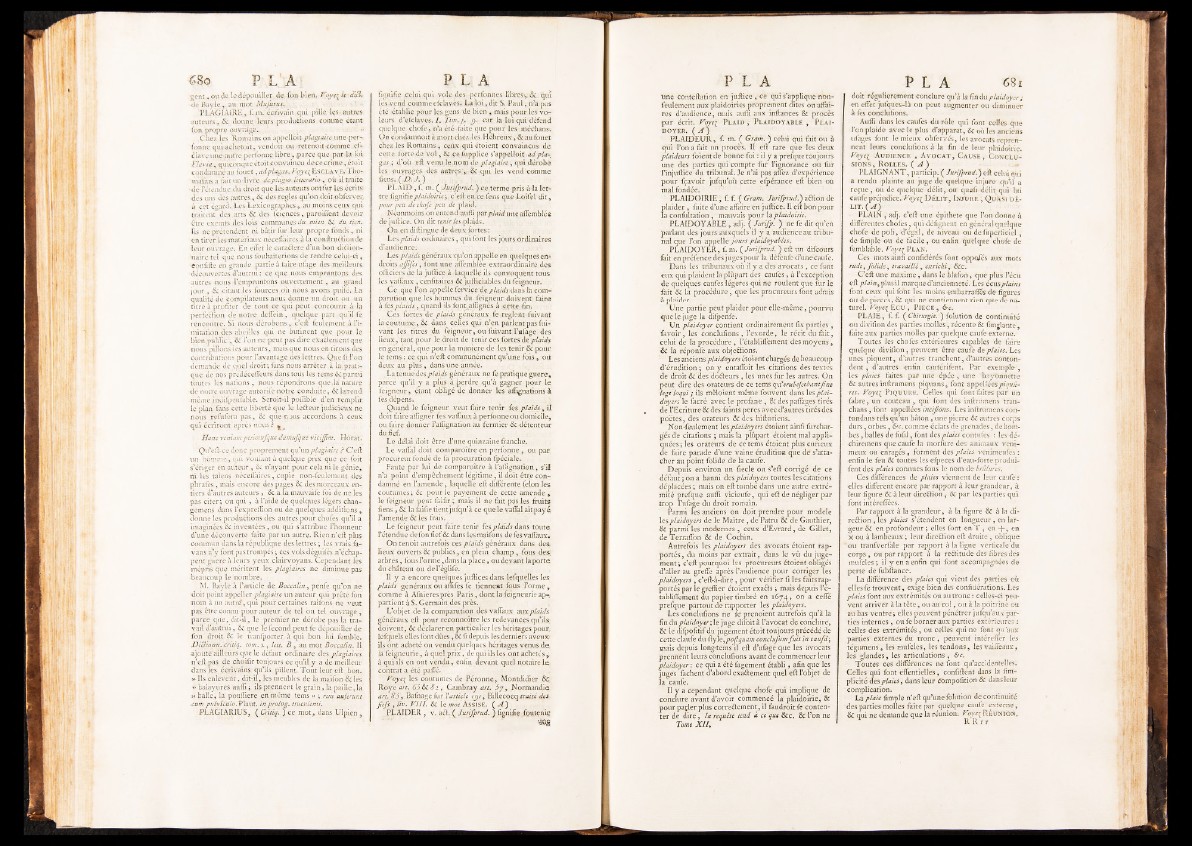
gent., Qu de le dépouiller ,de-fon bien. Voyelle-diftv
de Ba yle, au mot Mufurusf x \
PLAGIAIRE, f.jn. écrivain.qui pille, lçs\autres
auteurs., & donne leurs productions comme, étant
{on propre ouvrage.
. .Chez les Romains on appellôït,plagiaire une per-
fonne qui achetoit, vendoit o,u •retenoitcomme ef-
éiave une.aut're perfonnç libre ., .parce que^par la loi
Flavia, quiconque étoit convaincu de ce crime , étoit
condamné au fouet, ad plaças. Vpye{ Esclave. ! ho-
malius a 6iit undivfe dcplàgip liuerariooù-il traite
•de l’étendue du droit que lès auteurs ont fur les écrits
des uns des autres., 6c des réglés qu’on doit obferver,
à cet égard.. Les Lexicographes, au moins ceux qui
traitent des .arts & 'des fciencës, parodient devoir
être exemts des lois communes du mien 6c dp tien.
fis ne prétendent ni bâtir fur leur propre fonds, ni
en tirer les matériaux ncceffaires à la conftruétion de
leur ouvrage. En effet le caraftere d’un bon dictionnaire
tel que nous fouhaiterions de rendre ‘celui-ci,
eoniifte en grande partie à taire nfage des'meilleurs
découvertes d’autrui : ce que nous empruntons des.
autres nous Rempruntons ouvertement, au grand
jour , 6c citantles fources Où nous avons puilé. La
qualité de compilateurs nous donne un droit pu un
titré à profiter de tout ce qui peut concourir à la
perfection de notre deffein, quelque part qu'il fe
rencontre. Si nous dérobons , c’ett feulement à Limitation
des abeilles qui ne butinent que pour le
bien public *, & l’on ne peut pas dire exactement que
nous pillons les auteurs, mais que nous en tirons des
contributions pour.l’avantage des lettres. Que l! l’on
demande de quel droit ; lans nous arrêter (à la. pratique
de nos prédéceffeurs dans tous les tems & parmi
toutes les nations , nous répondrons que ,1a1 nature
de notre ouvrage autorife notre conduite, Stlarend
même indifpeniable. Seroit-il poffible d’en remplir
le plan fans cette liberté que le leCteur judicieux ne
nous r effilera pas, Sc que njus accordons à ceux
qui écriront après nous ? «
liane veniam penmufque âctmufque viciffim. Horat.
Qu’eft-ce donc proprement qu’un plagiaire ? C ’eft
un homme,, qui voulant à quelque prix que ce foit
s’ériger en auteur , Sc n’ayant pour cela ni le génie,
ni les talens nëceffaires, copie non-feulement des
phrafes, mais encore des pages Sc des morceaux entiers
d’autres auteurs, 6c.a la mauvaife foi de ne les
pas citer ; ou q u i, à l’aide de quelques légers chan-
gemens dans l’expreflion ou de quelques additions ,
donne les productions des autres pour chofes qu’il a
imaginées 6c inventées , ou qui s’attribue l’honneur
d’une découverte faite par un autre. Rien n’ eft plus
commun dans la république des lettres ; les vrais fa-
vans n’y font pas trompés ; ces vols déguifés n’échappent
guère à leurs yeux clairvoyans. Cependant les
mépris que méritent les plagiaires ne diminue pas
•beaucoup le nombre.
M. Bayle à l’article de Boccalin, penfe qu’on ne
doit point appeller plagiaire un auteur qui prête fon
nom à un autre*, qui pour certaines railons ne veut
pas être connu pour auteur de tel ou tel ouvrage ,
parce que, dit-il, le premier ne dérobe pas la travail
d’autrui, Sc que le fécond peut fe dépouiller de
fon droit Sc le tranfporter à qui bon lui femble.
Diciionn. critiq. tom.z, leu. B , au mot Boccalin. Il
•âjoutë ailleürs que le défaut ordinaire des.plagiaires
n’eft .pas de choifir toujours ce qu’il y a de meilleur
dansles écrivains qu’ils , pillent. Tout leur eft bon;
» Ils enlevent, dit-il, les meubles de la maifon Sc les
>> balayures auffi ; ils prennent le grain, la paille, la
« balle, là poufliere en même tems » ; rem auferunt
•cum pulvicülo. Plant, in prolog. truculend.
PLAGIARIUS, ( Critiq. ) ce mot, dans Ulpien,
fignifie .celui qui vole des -pcrfonnes libresv & qui
les.vend comme efclavjes,. La lo i , dit S. Paul, n’a pas
cté établie pour les gens de bien, mais pour les voleurs
d’elclayes./. Fim-.f ç).v_ car la loi qui défend
quelque chofe, n’a été daitè, que pour lea.méchansv
On condamnoit à mort chez fles Hébreux, & au fouet
chez les Romains -, ceux t qui étoient convaincus; de
cette lorte de v o l, Sc çefupplice s’appelloitWpla~
gus ; d’oii eft venu, le,nom dp plagiaire , qui dérobé
les ; ouvrages des autres ,^n & . qui les vend 'comme
fiens,\(jjQ./..)
PLAID, 1', m. { Jurifprud,. ) ce,termepris'âda lettre
lignifie plaidoirie^ c’eft en, ce fens que Loifel dit,
pour peu de chofe peu de plaid.
Néanmoins on entend aufti par plaid uneàffemblée
de juftice. On dit tenir les plaids.
On en diftingue de deux fortes :
Les plaids ordinaires, qui font les jours Ordinaires
d’audience;
Les plaids généraux qu’on appelle en quelques endroits
ajjifes, l'ont une affemblée extraordinaire des
officiers de la juftice à laquelle ils convoquent tous
les. yaffaux , cenfitaires Sc jufticiables du feigneur.
• Ce qUe l’on appelle ferviçede plaids dans là comparution
que les hommes du feigneur doivent faire
à les plaids, quand ils font alîîgnés à .cette fin.
Ces fortes de plaids • généraux fe reglerit ffuivant
laçoutume., & dans celles qui n’en parlent pas fui-
vant les titres du feigneur, ou fuivant l’ufage des
lieux,'tant pour le droit dé tenir ces fortes de plaids
en générai, que pouf la maniéré de les tenir & pour
le tems ; ce qui n’eft communément qu’une fois , ou
deux.au plus , dans Une année.
La tenuédesplaids généraux ne fe pratique guère,
parce qu’il y a plus à perdre qu’à gagner pour le
feigneur v, étant obligé de donner les aliénations à
fes dépens.
Quand le feigneur veut faire tenir fes plaids, il
doit fairé àffigner les valfaux à perfonne ou domicile,
ou faire.donner l’alîignation au fermier Sc détenteur
du.ftef.-
Le délai doit être d’une quinzaine franche.
Le vaffal doit comparoître en perfonne, ou par.
procureur fondé de fa procuration fpéciale.
Faute par lui de comparoître à l’aflignation, s’il
n’a point d’empêchement légitime, il doit être condamné
en l’amende, laquelle eft différente {elon les
coutumes ; Sc pour le payement de cette amende ,
le feigneur peut faifir ; mais il ne fait pas les fruits
fiens, Sc la faifie tient jufqu’à ce que le vaffal ait payé
l’amende Sc les frais.
Le feigneur peut faire tenir fes plaids dans toute
l’étendue de fon fief & dans les maifons de fes vaffaux.
On tenoit autrefois ces plaids généraux dans deslieux
ouverts Sc publics, en plein champ , fous des.
arbres, fous l’orme, dans la place, ou devant la porte
du château ou del’églife.
Il y a encore quelques juftices dans lefquelles les
plaids généraux ou aflifes fe tiennent fous l’orme ,
comme à Afnieres près Paris, dont la feigneurie appartient
à S. Germain des près.
L’objet de la comparution des vaffaux aux plaids
généraux eft pour reconnoître les redevances qu’ils,
doivent, Sc déclarer en particiilier les héritages pour,
lefquels elles font dues, Sc fi depuis les derniers aveux
ils ont acheté ou vendu quelques héritages venus de;
la feigneurie, à quel prix, de qui ils les ont achètes ,
à qui ils en ont vendu, enfin devant quel notaire le
contrat a été paffé.
Voye^ les coutumes de Péronne, Montdidier Sc
Rôye art. 65 Sc 8 z , Cambray art. 5y , Normandie
art. 85, Bafnage fur l’article ig i, Billecocq traité des
fiefs , liv. VIII. Sc le mot ASSISE. ( A )
PLAIDER, v. aél. ( Jurifprud. ) lignifie fouteniç
p f
line conteftation en juftice, ce qui s’applique non-
feulement aux plaidoiries proprement dites ou affaires
d’audience, mais aufti aux inftances & procès
par écrit. Voyei Plaid i Plaïdoyable , Pla id
oyer. ( A )
PLAIDEUR, f. m. ( Gram. ) celui qui fait Ou à
qui l’on a fait un procès. Il eft rare due lés deux
plaideurs foient de bonne foi : il y a prefque toujours
une des parties qui compte fur l’ignorance on fur
l’injuftice du tribunal. Je n’ai pas affez d’expérience
pour fçavoif jufqtr.où cette efpérance eft bien où
mal fondée.
PLAIDOIRIE , f. f. ( Gram. Jurifprud.') aôion de
plaider , fuite d’une .affaire en juftice. Il en bon pour
la confultation , mauvais pour la plaidoirie.
PLAIDOYABLE, adj. ( Jurifp. ) ne fe dit qtt’ert
parlant des jours auxquels il y a audience au tribunal
que l’on appelle jours plaidoyabüs.
PLAIDOYER, f. m. ( Jurifprud. ) eft un difeours
fait en préfence dés juges pour la défenfe d’une catife.
Dans les tribunaux où il y a des avocats , ce font
eux qui plaident la plupart des càufes, à l’exceptibh
de quelques caùfes légères qui rie roulent que fur le
fait & la procédure, que les procureurs font acîfnis
à plaider.
Une partie peut plaider pour elle-même, pourvu
que le juge la difpenfe.
Un plaidoyer contient ordinairement fix parties ,
favoir, les cOnclufioris , l’éxorde, le récit dü fàit,
celui de la procédure , l’établiflement des moyens,
Sc la réponfe aux .objections.
Les anciens plaidoyers étoient chargés de beaucoup
d’érudition j on y entaffoit les citatioùs des textes
de droit & des doéteurs , les nnès fur lés autres. On
peut dire des orateurs de ce terris tylerubefctbantfine
lege toqui ; ils mêloient même foùvent dans les plaidoyers
le facré àvêc le profane, Sc des paffages tirés
de l’Ecriture Sc des faints peres avec d’autres tirés des
poètes, des orateurs & des hiftôtieriS.
Non-feulement les plaidoyers étoient àinfi furchar-
gés de citations ; mais là plupart étoient mal appliquées
; les orateurs de ce tems étoient plus curieux
de faire parade d’une vaine érudition que dé s’attacher
au point folidé de la caufe.
Depuis environ un fiecle on s’ eft corrigé de ce
défaut ; ori a banni des plaidoyers toutes les citations
déplacées ; mais on eft tombe dans urte autre extrémité
prefque aufti vicieufe, qui eft de négliger par
trop l’ufage du droit romain.
Parmi les anciens on doit preftdre pour modèle
les plaidoyers de le Maître, de Patru St de Gauthier,
Sc parmi les modernes , ceùx d’Evrard, de Gillet,
de Terraffori Sc de Cochin.
Autrefois les plaidoyers dê'$ aVOcàts étoient rapportés
, du moins par extrait, dans le vu du jugement
; c’eft pourquoi les procureurs étoient obligés
d’aller au greffe après l’audience pour corriger les
plaidoyers , c’eft-à-dif e , pour vérifier fi les faits rapportés
par le greffier étoient exafts ; mais depuis l’e-
tabliffemefit du papier timbré en 1674, on a ceffe
prefque partout de rapporter les plaidoyers.
Les coriclufions ne‘ le prenoient autrefois qu’à la
fin du plaidoyer ; le juge diloit à l’avocat de conclure,
Sc le difpofitif du jugement étoit toujours précédé dé
cette claufe du fty’lë,pof quant coiiclufüm fuit in caufâ’t
mais depuis long-tems il eft d’ufage que les avocats
prennent leurs conclufions avant de commencer leur
plaidoyer : ce qui a été fagement établi, afin que les
juges fâchent d’abord exactement quel eft l’objet de
la caufe.
Il y a cependant quelque chofe qui implique de
conclure avant d’avoir commencé la plaidoirie, &
pour paçler plus correctement, il faudroitfe contenter
de dire, la requête tend, à ce que Scc. St l’on ne
Tome XIU
doit régulièrement conclure qu’à la fin du plaidoyer ;
en effet jufques-là on peut augmenter ou diminuer
à fes conclufions.
Auffi dans les caufes du rôle qui font celles que
l’on plaide avec le plus d’apparat, Sc oii les anciens
ufages font le mieux obfervés, les avocats reprennent
leurs conclufions à la fin de leur plaidoirie.
yoyei A u d ie n c e , A v o c a t , C a u s e , C o n c l u s
io n s , R o l l e s . ( A )
PLAIGNANT, particip. ( Jurifprud. ) eft celui qui
a rendu -plainte au juge de quelque injure quJil a
reçue, Ou de quelque délit, où quafi délit qui lui
caufe préjudice. Voyt{ D é l i t , In ju r e , QuASi d é -
L IT .(^ )
PLAIN , adj. c’eft une épithete que l’on donne à
différentes ch o fe s , qui défignent en général quelque
chofe de p o li, d’é g a l, de niveau ou de fu p e r fic ie l,
de fimple ou de fa c i le , ou enfin quelque chofe de
femblable. Voyé^ Pl a n .
Ces mots ainfi confidéfés font oppqfés aux mots
rude, folide, travaillé, enrichi, Sic.
C ’eft une maxime, dans le blafon, que plus l’écu
eft plain, plus il marque d’ancienneté. Les écu s plains
font ceux qui font les moins embarrafles de figures
ou de pièces, Sc qui ne contiennent rien que de naturel.
Vcyei E c u , PIECE, &c.
PLAIE, f. f. ( Chirurgie. ) folution de continuité
ou divifion des parties molles, récente Sc fanglante,
faite aux parties molles par quelque caufe externe.
Toutes les chofes extérieures capables de faire
quelque divifion, peuvent être caufe de plaies. Les
unes piquent, d’autres tranchent, d’autres confondent,
d’autres enfin cautérifent. Par exemple ,
les plaies faites par une épé e, une bayOnnette
Sc autres inftrumens piquans, font appelieeèpiquâtes.
Voyé^ Piq u u r e . Celles qui font faites par uh
fabre, un couteau , qui ' font des irifimme-ns tran-
chans, font appellées incijiôns. Les inftrumens con-
tondansrels qu’un bâton, une'pierre Sc autres corps
durs, orbes, &c. comme éclats de grenades, de bombes
, balles de fufil, font des plaies contufes : les dé-
chiremens que caufe la morfure des animaux venimeux
ou enragés , forment des plaies venimeufes :
enfin le feu Sc toutes les êfpeces d’eau-forte produi-
fent des plaies connues fous le nom de brûlures.
Ces différences de ploies viennent de leur caufe :
elles different encore par rapport à leur grandeur, à
leur figure Sc à leur direftion, Sc par les parties qui
font intéreflees.
Par rapport à la grandeur, à là figure Sc à la di-
re&ion , les plaies s’étendent en longueur , en largeur
& en profondeur ; elles font en T , en ~p, en
X ou à lambeaux ; leur direction eft droite, oblique
"ou tranfverfale par rapport à la ligne verticale du
corps, ou par rapport à la re&itude des fibres des
mufcles ; il y en a enfin qui font accompagnées de
perte de fubftance.
La difféfence des plaies qui vient des parties oii
elles fe trouvent , exige bien des confédérations. Les
plaies font aux extrémités Ou au tronc : celles-ci peuvent
arriver à la tête, ou au col , 011 à lapôitrine du
au bas ventre ; elles peuvent pénétrer jufqu’aux parties
internes , ou fe borner aux parties extérieures :
celles dés extrémités , ou celles qui ne font qu’aux
parties externes du tronc, peuvent intéreffer les
tégumens, lés mufcles, lés tendons, les vaifféa'ux,
les glandes, les articulations, &c.
Toutes ces différences ne font qu’accidentelles:
Celles qui font effentiellès, confiftent dans la fim-
plieité des plaies, dans leur (fompofitiori Sc dans leur
complication.
La plaie fimple n’eft qu’une folution de continuité
des parties m olles faite par quelque caufe e x te rn e ,
Sc qui ne demande que la réunion. V>yc{ R.é u n iô n ,
^ R R r r