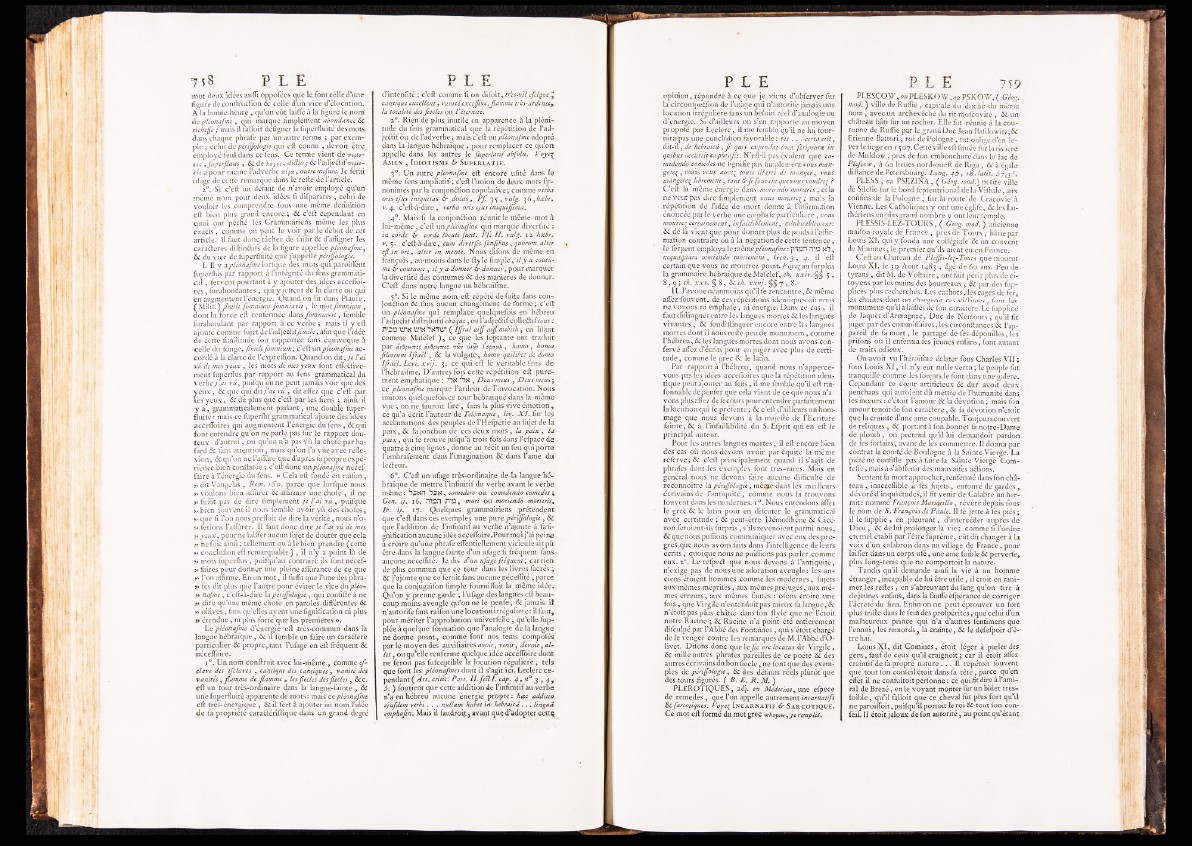
mot deux idées auffi oppofées que le font celle d’ime
figure deconftruétion 6c celle d’un vice d’élocution.
A la bonne heure , qu’on eût laifle à la figure le nom
de pléonafme, qui marque Amplement abondance 6c
richefj'e; mais il ialloit defigner lafuperfluité des mots
dans chaque phrafe par un autre terme ; par exemple
, celui de périjfologie qui eft connu , devoit être
employé feul dans ce fens. Ce terme vient de mptr-
s k tfuperjluus, & de hlyoc, diclio ; & l ’adje£tifîri/w<j-.
(fit a pour racine l’adverbe rtlpety outre mefure. Je ferai
ufage de cette remarque dans le refte de l’article.
2°. Si c’eft un défaut de n’avoir employé qu’un
même nom pour deux idees fi difparates, celui de
vouloir les comprendre fous une même définition
eft bien plus grand encore ; 6c c’eft cependant en
quoi ont péché les Grammairiens même les plus
exacts , comme on peut le voir par le début de cet
article. Il faut donc tâcher de failir 6c d’afligner les
cara&eres diftinétifs de la figure appellée pléonafme y
6c du vice de fuperfluité que j’appelle périjfologie.
I. Il y apléonafme lorfque des mots qui paroiffent
fuperflus par rapport à l’intégrité du fens grammatical
, fervent pourtant à y ajouter des idées acceffoi-
re s , furabondantes , qui y jettent de la clarté ou qui
en augmentent l’énergie. Quand on lit dans Plaute,
(Milit.) (initie fomnium fomniavit, le mot fomnium ,
dont la force eft renfermée dans fomniavit, femble
furabondant par rapport à ce verbe ; mais il y eft
ajouté comme fujet de l’adjeQixîfimile, afin que l’idée
de cette limilitude foit rapportée fans équivoque à
celle du fonge, fimile fomnium; c’eft un pléonafme accordé
à la clarté de l’exprefîion. Quand on dit, y s l'ai
vu de mes yeux , les mots de mes yeux font effectivement
fuperflus par rapport au fens grammatical du
verbe f a i vu y puifqu’onne peut jamais voir que des
y e u x , 6c que qui dit j'ai vu , dit aflez que c’eft par
les y e u x , 6c de plus que c’eft par les fiens ; ainfi il
y a , grammaticalement parlant, une double fuperfluité
: mais ce fuperflu grammatical ajoute des idées
acceffoires qui augmentent l’énergie du fens , 6c qui
font entendre qu’on ne parle pas fur le rapport douteux
d’autrui, ou qu’on n’a pas vû la chofe par ha-
fard 6c fans attention, mais qu’on l’a vue avec réflexion
, & qu’on ne l’affûre que d’après fa propre expérience
bien conftatée ; c’ eft donc un pléonafme nécef-
faire à l’énergie du fens. « Cela eft fondé en raifon,
» dit Vaugelas , Rem. iGo. parce que lorfque nous
» voulons bien aflurer 6c affirmer une choie , il ne
» fuffit pas de dire Amplement je l'ai vu , puifque
» bien fouvent il nous femble avoir vû des chofes,
» que A l’on nous preffoit de dire la vérité, nous n’o-
» ferions l’affûrer. Il faut donc dire je l'ai vu de mes
» yeux, pourne laiffer aucun fujet de douter que cela
» ne foit ainfi ; tellement qu’à le bien prendre (cette
» concluAon eft remarquable ) , il n’y a point là de
» mots fuperflus , puifqu’au contraire ils font nécef-
» faites pour donner Une pleine aflurance de ce que
» l’on affirme'. En un m ot, il fuffit que l’une des phra-
» fes dit plus que l’autre pour éviter le vice dupléo-
» nafme, c’eft-à-dire la périjfologie, qui confifte à ne
» dire qu’une même chofe en paroles différentes 6c
» oiftves, fans qu’elles ayent une ftgnificatio.n ni plus
» étendue, ni plus forte que les premières ».
Le pléonafme d’énergie eft très-commun dans la
langue hébraïque , 6c il femble en faire un caraûere
particulier 6c propre, tant l’ufage en eft fréquent 6c
néceffaire.
i° . Un nom conftruit avec lui-même , comme ef~
clave des efclaves , cantique des cantiques , vanité des
vanités, flamme de flamme , les ficelés des fiecles, &c.
eft un tour très-ordinaire dans la langue-fainte , 6c
une fuperfluité apparente de mots : mais ce pléonafme
eft très-énergique, 6c il fert à ajouter au nom l’idée
de fa propriété cara&ériftique dans un grand degré
d’intenfité ; c’eft comme A on difoit, trïs-vil cfcluvty
cantique excellent, vanité excejfive, flamme très-ardentep
la totalité des fiecles ou l'éternité.
2°. Rien de plus inutile en apparence à la plénitude
du fens grammatical que la répétition de l’ad-
jeétif ou de l’adverbe ; mais c’eft un pléonafme adopté
dans la langue hébraïque, pour remplacer ce qu’on
appelle dans les autres le fuperlatif abfolu. Voye£
A m en , Id io t i sm e 6* Su p e r l a t if .
3°. Un autre pléonafme eft encore ufité dans le
même fens ampliatif ; c’eft l’union de deux mots fy-
nonimes parla conjonctioncopulative; comme verba
oris ejus iniquitas & dolus, Pf. 35 , vulg. 36 , hoebr.
v. 4. •c’eft-à-dire, verba oris ejus iniquiffima.
40. Mais A la conjonction réunit le même mot à
lui-même, c’eft un pléonafme qui marque diverfité :
in corde & corde locuti Junt. Pf. II. vulg. 12 hoebr.
v. 5. c’eft-à-dire, cum dtverfis fenfibus, quorum alter
efi in ore, alter in mente. Nous difons de même en
françois, au-moins dans le ftyle Ample, il y a coutume
6* coutume , il y a donner & donner, pour marquer
la diverAté des coutumes 6c des maniérés de donner»
C ’ eft dans notre langue un hébraïfme.
50. Si le même nom eft répété de fuite fans conjonction
6c fans aucun changement de forme ; c’efl:
un pléonafme qui remplace quelquefois en hébreu
l’adj eCtif diftributif chaque, ou l’adjeCtif collectif tout :
JY.DD ty’N Sfrnïi?’ ( Iffral a iff aiff mebith-, en lifant
comme Mafclef ) , ce que les feptante ont traduit
par dv6p<o7roç a.v&pu7roç twV Jiiïr 1 trpxnX , h,omo , homo
filiorum Ifraël, 6c la vùlgate, homo quilibet de domo
lfraél. Levi. xvij. 3 . ce qui eft le véritable fens de
l’hébraïfme. D ’autres fois cette répétition eft purement
emphatique : ’Sx , Deus meus , Deus meus ;
ce pléonafme marque l’ardeur de l’invocation. Nous
imitons quelquefois ce tour hébraïque dans la même
vue ; on ne fauroit lire , fans la plus vive émotion ,
ce qu’a écrit l’auteur de Télémaque, liv.<XI. fur les
acclamations des peuples de l’Hefpérie au fujet de la
paix, 6c la jonCtion de ces deux mots , la paix, la.
paix, qui fe trouve jufqu’à trois fois dans l’efpace de
quatre à cinq lignes, donne au récit un feu qui porte
l’embrafement dans l’imagination 6c dans l’ame du
leCteur.
6°. C’eft un ufage très-ordinaire de la langue hébraïque
de mettre l’infinitif du verbe avant le verbe
même : S o x , comedere ou comedendo comedes ;
Gen. ij. 16. mon mû , mori ou moriendo morieris.
Ib. ij. 17. Quelques grammairiens prétendent
que c’eft dans ces exemples une pure périjfologie, &
que l’addition de l’infinitif au verbe n’ajoute à fafi-
gnification aucune idée acceffoire.Pour moi j’ai peine
a croire qu’une phrafe effentiellement vicieufe ait pu
être dans la langue fainte d’un ufage fi fréquent fans
aucune néceffite. Je dis d.' un ufage fréquent, car rien
de plus commun que ce tour dans les livres facrés ;
& j’ajoûte que ce feroitfans aucune néceffité , parce
que la conjugaifon Ample fourniffoit la même idée.
Qu’on y prenne garde ; l’ufage des langues eft beaucoup
moins aveugle qu’on ne le penfe, 6c jamais il
n’autorife fans raifon une locution irrégulière : il faut,
pour mériter l’approbation univerfelle , qu’elle fup-
plée à quelque formation que l’analogie de la langue
ne donne point, comme font nos tems compofés.
par le moyen des auxiliaires avoir, venir, devoir y aller
, ou qu’elle renferme quelque idée acceffoire dont
ne feroït pas fufceptible la locution régulière, tels
que font les pléonafmes dont il s’agit ici. Leclerc cependant
( Art. critic. Part. Il.fectI. cap. 4 ,n ° j , 4 ,
5. ) foutient que cette addition de l’infinitif au verbe
n’ a en hébreu aucune énergie propre: hac additio
ejufdem verbi . . . nullam habet in hebraïcâ. . . linguâ
emphafin. Mais il faudroit, avant quç d’adopter cette
opinion, répondre à ce que je viens d’obferver fur
la circonfpeétion de i’ufage qui n’autorife jamais une
locution irrégulière fans un befoin réel d’analogie ou
d ’énergie. Si d’ailleurs on s’en rapporte au moyen
propole par Leclerc, il me femble qu’il ne lui fournira
pas une concluAon favorable : res . . . certa erit,
dit-il 4 de hebraicâ , f i quis expendat loca fcripturce in
quibus o,ccùrrit eaphrafis. N’eft-il pas évident que comedendo
comedes ne Agnifie pas Amplement vous man-
geref, mais vous aurc{ toute liberté de manger y vous
mangere^ librement y tant & f i fouvent que vous voudre^ ?
C’eft la même énergie dans moriendo morieris ; cela
ne veut pas dire Amplement vous mourreç ; mais la
répétition de l’idée de mort donne à l’affirmation
énoncée parle verbe uneemphafeparticulière , vous
mourre£ certainement, infailliblement y indubitablement’.
6c de là vient que pour donner plus de poids à l’affirmation
contraire ou à la négation de cette fentence,
.le ferpent employa le mêmepléonafme : |T723n !T1D xS ,
nequaquam moriendo moriemini , Gen. 3 ÿ 4. il eft
certain que vous ne mourrez point. Aoyeçaufurpius
la grammaire hébraïque de Mafclef j ch. xxiv. §§ 5 ,
8 ,9 ; ch. xxv. § 8, 6c ch. xxvj. §§ 7 ,8 ;
II. J’avoue néanmoins qu’il fe rencontre, 6c même
aflez fouvent, de ces répétitions identiques où nous
ne voyons ni emphafe , ni énergie. Dans ce cas , il
faut diftinguer entre les langues mortes 6c les langues
vivantes, 6c foudiftinguer encore entre les langues
mortes dont il nous refte peu de monumens, comme
l’hébreu, & les langues mortes dont nous avons con-
fervé aflez d'écrits pour en juger avec plus de certitude
, comme le grec 6c le latin.
Par rapport à l’hébreu, quand nous n’apperce-
vons pas les idées acceffoires que la répétition identique
peut ajouter au fens ., il me femble qu’il eft rai-
fonnable depenfer que cela vient de ce que nous n’a •
vons plus aflez defecours pour entendre parfaitement
la locution qui fe préfente ; 6c c ’eft d’ailleurs un hommage
que nous devons à la majefté de l’Ecriture
fainte, 6c à l’infaillibilité du S. Efprit qui en eft le
principal auteur.
Pour les autres langues mortes, il eft encore bien
des cas où nous-devons avoir par équité la même
réferve ; 6c c’eft principalement quand il s’agit de
phrafes dont les exemples font très-rares. Mais en
général nous ne devons faire aucune difficulté de
reconnoître la périfj'olpgie, mêqje dans les meilleurs
.écrivains de l’antiquité, comme nous la trouvons
fouvent dans les modernes. i ° . Nous entendons affez
le grec 6c le latin pour en difeuter le grammatical
avec certitude ; 6c peut-être Démofthène 6c Cicé-
ron feroient-ils furpris, s’ilsrevenoientparmi nous,
& que nous puffions communiquer avec eux des progrès
que nous avons faits dans l’intelligence de leurs
écrits, quoique nous ne puiffions pas parler comme
eux. 20. Le refpeâ que nous devons à l’antiquité,
n’exige pas de nous une adoration aveugle : les anciens
étoient hommes comme les modernes, fujets
aux mêmes méprifes, aux mêmes préjugés, aux mêmes
erreurs, aux mêmes fautes : ofons croire une
fois , que Virgile n’entendoitpas mieux fa langue, 6c
n’etoit pas plus châtié dans fon ftyle que ne l’étoit
notre Racine ; 6c Racine n’a point été entièrement
difculpé par l’Abbé des Fontaines, qui s’étoit chargé
de le venger contre les remarques de M. l’Abbé d’O-
livet. Difons donc que le fie ore locutus de Virgile,
6c mille autres phrafes pareilles de ce poète 6c des
autres écrivains du bon fiecle, ne font que des exemples
de périjfologie, & des défauts réels plûtôt que
des tours figurés. ( B. E. R. M. )
PLÉROTIQUES, adj. en Médecine y une efpece
de remedes , que l’on appelle autrement incarnatifs
Sefarcotiques. Voye{ INCARNATIF & SARCOTIQUE.
Ce mot eft formé du mot grec <ax»pou y je remplis.
PLESCOW, ou PLESKOW, ou P SK O V , ( Géog.
mod. ) ville de Ruffie, capiiale du duché du même
nom, avec un archevêché du rit mofeovite , 6c un
château bâti fur un rocher. Elle Ait réunie à la couronne
de Ruffie par le grandDuc Jean BaAlovitz,&
Etienne Battori, roi de Pologne, fut obligé d’en lever
lefiege en 1507. Cette ville eft fituée fur la riviere
de Muldow, près de fon embouchure dans le lac de
Plefcowy à 60 lieues nord-oueft de Riga, 6c à égale
diftance de Petersbourg. Long. 4 3 , iSUatit. i y , j 5;
PLESS , ou PSEZINA j ( Géog. mod J petite ville
de Siléfie Air le bord feptentrional delà V iftule, aux
confins de la Pologne , fur la route de Cracovie à
Vienne. Les Catholiques y ont une églife, 6c les Luthériens
en plus grand nombre y ont leur temple.
PLESSIS-LEZ-TOURS, ( Géog. mod, ) ancienne
maifon royale de France , près de Tours , bâtie par
Louis X I. qui y fonda une collégiale 6c un couvent
de Minimes, le premier qu’ils aient eu en France.
C’eft au Chateau de PlefJîs-le^-Tours que mourut
Louis XI. le 30 Août 1483 , âgé de 60 ans. Peu de
tyrans , dit M. de Voltaire, ont fait périr plus de citoyens
par les mains des bourreaux, 6c par des fup-
plices plus recherchés. Les cachots, les cages de fer,
les chaînes dont on chargeoit ces vi&imes, font les
monumens qu’ilalaiffés de fon caraftere.Le fupplice
de Jaquet d’Armagnac, Duc de Nemours , qu’il fit
juger par des commiffaires, les circonftances 6c l’appareil
de fa m ort, le partage de fes dépouilles, les
prifons où il enferma fes jeunes enfans, font autant
de traits odieux.
On avoit vu l’héroïfme éclater fous Charles VII ;
fous Louis X I , il n’y eut nulle vertu ; le peuple fut
tranquille comme les forçats le font dans une galere.
Cependant ce coeur artificieux 6c dur avoit deux
penchans qui auroient dû mettre de l’humanité dans
les moeurs : c’étoit l’amour 6c la dévotion ; mais fon
amour tenoit de fon caraftere, & fa dévotion n’étoit
que la crainte d’une ame coupable. Toujours couvert
de reliques, 6c portant à fon bonnet fa notre-Dame
de plomb, on prétend qu’il lui demandoit pardon
de fes forfaits, avant de les commettre. Il donna par
contrat la comté de Boulogne à la Sainte Vierge. La
piété ne confifte pas à faire la Sainte Vierge Com-
teffe, mais à s’abftenir des mauvaifes aérions.
Sentant fa mort approcher, renfermé dans fon château
, inacceffible à fes fujets , entouré de gardes ,
dévoré d’inquiétudes, il fit venir de Calabre un her-
mite nomme François Martqrillo, révéré depuis fous
le nom de S. François de Paule. Il lé jette à fes piés ;
il le fupplie, en pleurant, d’intercéder auprès de
D ieu , 6c de lui prolonger la vie; comme fi l’ordre
éternel établi par l’être fuprème, eût dû changer à la
voix d’un calabrois dans un village de France, pour
laiffer dans un corps ufé, une ame foible 6c perverfe,
plus Iong-tems que ne comportoit la nature.
Tandis qu’il demande ainfi la vie à un homme
étranger, incapable de lui être u tile, il croit en ranimer
les reftes , en s’abreuvant du fang qu’on tire à
de jeunes enfans, dans la fauffe efpérance de corriger
l’âcreté du fien. Enfin on ne peut éprouver un fort
'■ plus trifte dans le fein des profpérités, que celui d’un
malheur'eux prince qui n’a d’autres fentimens que
l’ennui, les remords. la crainte, 6c le défefpoir d’être
haï.
Louis X I , dit Comines, étoit léger à parler des
gens, fauf de ceux qu’il craignoit ; car il étoit affez
craintif de fa propre nature . . . Il répétoit fouvent
que tout fon confeil étoit dans fa tê te , parce qu’en
effet il ne confultoit perl’onne : ce qui fit dire à l’amiral
de Brezé, en le voyant monter fur un bidet très-
foible, qu’il fâlloit que ce cheval fût plus fort qu’il
ne paroiffoit, puifqu’il portoit le roi & tout fon confeil.
Il étoit jaloux de fon autorité, au point qu’étant