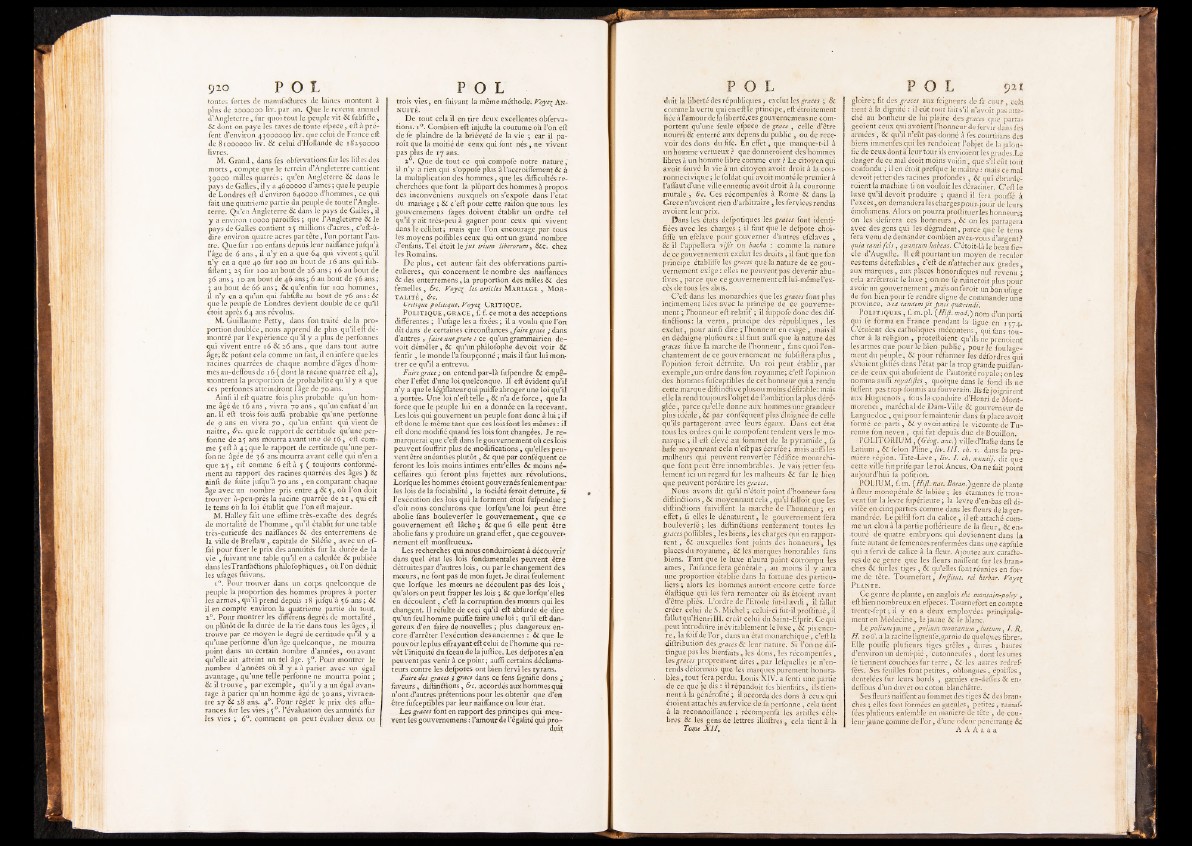
toutes fortes de manufactures de laines montent à
plus de 2000000 liv. par an. Que le revenu annuel
d’Angleterre, fur quoi tout le peuple vit & fublifle,
& dont on paye les taxes de toute efpece, elt à pré-
fent d’environ 43000000 liv. que celui de France elt
de 81000000 liv. & celui d’Hollande de 18250000
livres.
M. Grand, dans fes obfervations fur les liftes des
morts , compte que le terrein d’Angleterre contient
39000 milles quarrés ; qu’en Angleterre & dans le
pays de Galles, il y a 4600000 d’ames ; que le peuple
de Londres eft d’environ 640000 d’hommes, ce qui
fait une quatrième partie du peuple de toute l’Angleterre.
Qu’en Angleterre & dans le pays de Galles, il
y a environ 10000 paroiffes ; que l’Angleterre & le
pays de Galles contient 25 millions d’acres, c’eft-à-
dire environ quatre acres par tête, l’un portant l’autre.
Que fur 100 enfans depuis leur naiffance jufqu’à
l’âge de 6 ans , il n’y en a que 64 qui vivent ; qu’il
n’y en a que 40 fur 100 au bout de 16 ans qui lub-
lîlrent ; 25 fur 100 au bout de 26 ans ; 16 au bout de
36 ans ; 10 au bout de 46 ans ; 6 au bout de 56 ans ;
3 au bout de 66 ans ; & qu’enfin fur 100 hommes,
il n’y en a qu’un qui fubnfte au bout de 76 ans : &
que le peuple de Londres devient double de ce qu’il
etoit après 64 ans révolus.
M. Guillaume Petty, dans fon traité de la proportion
doublée, nous apprend de plus qu’il eft démontré
par l’expérience qu’il y a plus de perfonnes
qui vivent entre 16 & 26 ans, que dans tout autre
âge;& pofant cela comme un fait, il en inféré que les
ràcines quarrées de chaque nombre d’âges d’hommes
au-deffous de 16 ( dont la racine quarrée eft 4),
montrent la proportion de probabilité qu’il y a que
ces perfonnes atteindront l’âge de 70 ans.
Ainfi il eft quatre fois plus probable qu’un homme
âgé de 16 ans , vivra 70 ans , qu’un enfant d ’un
an. 11 eft trois fois aufïi probable qu’une perfonne
de 9 ans en vivra 7 0 , qu’un enfant qui vient de
naître, &c. que le rapport de certitude qu’une perfonne
de 2 5 ans mourra avant une de 16 , eft comme
5 eft à 4 ; que le rapport de certitude qu’une per-
fon ne âgée de 3 6 ans mourra avant celle qui n’en a
que 2 5 , eft comme 6 eft à 5 ( toujours conformément
au rapport des racines quarrees des âges ) &
ainfi de fiiite jufqu’à 70 ans , en comparant chaque
âge avec un nombre pris entre 4 & 5, où l’on doit
trouver à-peu-près la racine quarrée de 2 1 , qui eft
le tems où la loi établit que l’on eft majeur.
M. Halley fait une eftime très-exatte des degrés
de mortalité de l’homme, qu’il établit fur une table
très-curieufe des naiffances & des enterremens de
la ville de Breflaw, capitale de Siléfie, avec un ef-
fai pour fixer le prix des annuités fur la durée de la
vie , fuivant une table qu’il en a calculée & publiée
dans lesTranfaétions philofophiques, où l’on déduit
les ufages fuivans.
i° . Pour trouver dans un corps qnelconque de
peuple la proportion des hommes propres à porter
les armes, qu’il prend depuis 18 jufqu’à 56 ans ; &
il en compte environ la quatrième partie du tout.
i ° . Pour montrer les differens degrés de mortalité,
ou plutôt de la durée de la vie dans tous les âges, il
iroxive par ce moyen le degré de certitude qu"il y a
qu’une perfonne d’un âge quelconque, ne mourra
point dans un certain nombre d’années, ou avant
qu’elle ait atteint un tel âge. 30. Pour montrer le
nombre d’années où il y a à parier avec un égal
avantage, qu’une telle perfonne ne mourra point ;
& il trouve , par exemple, qu’il y a im égal avantage
à parier qu’un homme âgé de 30 ans, vivra entre
27 & 28 ans. 40. Pour régler le prix des affu-
rances fur les vies ; 50. l’évaluation des annuités fur
les vies ; 6°. comment on peut évaluer deux ou
trois vies , en fuivant la même méthode. Voyez Ann
u i t é .
De tout cela il en tire deux excellentes obferVa-
tions.i®. Combien eft injufte la coutume où l ’on eft
de fe plaindre de la brièveté de la v ie ; car il pa-
roît que la moitié de ceux qui font nés, ne vivent
pas plus de 17 ans.
20. Que de tout ce qui compofe notre nature
il n’y a rien qui s’oppole plus à l ’accroiffement & à
la multiplication des hommes, que les difficultés recherchées
quë font la plupart des hommes à propos
des inconveniens auxquels on s’expofe dans l’etat
du mariage ; & c ’eft pour cette raifon que tous les
gouvernemens fages doivent établir un ordte teï
qu’il y ait très-peu à gagner pour ceux qui vivent
dans le célibat; mais que l’on encourage par tous
les moyens poflibles ceux qui ont un grand nombre
d’enfans.Tel étoit le ju s trium liberorum, &c. chez
les Romains.
De plus, cet auteur fait des obfervations particulières,
qui concernent le nombre des naifiances
& des enterremens, la proportion des mâles & des
femelles, &c. Voyez les articles M a r i a g e , M o r t
a l i t é , &c.
Critique politique. Voyez C R IT IQ U E .
P o l i t i q u e , g r â c e , f. f. ce mot a des acceptions
différentes ; l ’ufage les a fixées ; il a voulu que l’on
dît dans de certaines circonftances, faire grâce ; dans
d’autres, faire une grâce : ce qu’un grammairien de-
voit démêler , & qu’un philofophe devoit voir &
fentir, le monde l’afoupçonné ; mais il faut lui mon*
trer ce qu’il a entrevu.
Faire grâce ; on entend par-là fufpendre & empêcher
l’effet d’une loi quelconque. Il eft évident qu’il
n’y a que le légiflateur qui puiffe abroger une loi qu’il
a portée. Une loi n’eft telle , & n’a de force, que la
force que le peuple lui en a donnée en la recevant.
Les lois qui gouvernent un peuple font donc à lui ; il
eft donc le même tant que ces lois.font les mêmes : il
eft donc modifié quand fes lois font changées. Je remarquerai
que c’eft dans le gouvernement où ces lois
peuvent fouffrir plus de modifications, qu’elles peuvent
être anéanties plutôt, & que par conféquent ce
feront les lois moins intimes entr’elles & moins né-
ceffaires qui feront plus fujettes aux révolutions.
Lorfque les hommes étoient gouvernés feulement par
les lois de la fociabilité , la fociété feroit détruite, fi
l’exécution des lois qui la forment étoit fufpendue ;
d’où nous conclurons que lorfqu’une loi peut être
abolie fans bouleverfer le gouvernement, que ce
gouvernement eft lâche ; & que fi elle peut être
abolie fans y produire un grand effet, que ce gouvernement
eft monftrueux.
Les recherches qui nous conduiroient à découvrir'
dans quel état les lois fondamentales peuvent être
détruites par d’autres lois, ou par le changement des
moeurs, ne font pas de mon fujet. Je dirai feulement
que lorfque les moeurs ne découlent pas des lois,
qu’alors on peut frapper les lois ; & que lorfqu’elles
en découlent, c’eft la corruption des moeurs qui les
changent. Il réfulte de ceci qu’il eft abfurde de dire
qu’un feul homme puiffe faire une loi ; qu’il eft dangereux
d’en faire de nouvelles ; plus dangereux encore
d’arrêter l’exécution des anciennes : & que le
pouvoir le plus effrayant eft celui de l’homme qui revêt
l’iniquité du fceau de la juftice. Les defpotes n’en
peuvent pas venir à ce point; auffi certains déclama*
teurs contre les defpotes ont bien fervi les tyrans.
Faire des grâces } grâce dans ce fens fignifie dons
faveurs , diftin&ions, &c. accordés aux nommes qui
n’ont d’autres prétentions pour les obtenir que d’ en
être fufceptibles par leur naiffance ou leur état.
Les grâces font en rapport des principes qui meuvent
les gouvernemens ; l’amour de l’égalité qui produis
duit la liberté des républiques, exclut les grâces ; Sc
comme la vertu qui en eft le principe, eft étroitement
liée à l’amour de la liberté,ces gouvernemens ne comportent
qu’une feule efpece de grâce , celle d’être
nourri & enterré aux dépens du public , ou de recevoir
des dons du fifc. En effet, que manque-t-il à
un homme vertueux ? que donneroient des hommes
libres à un homme libre comme eux ? Le citoyen qui
avoit fauvé la vie à un citoyen avoit droit à la cou1
ronne civique J le foldat qui avoit monté le premier à
l’aflaut d’une ville ennemie avoit droit à la couronne
murale, &c. Ces récompenfès à Rome & dans la
Grece n’avoient rien d’arbitraire, les fer vices rendus
avoient leur prix.
Dans les états defpotiques les grâces font identifiées
avec les charges ; il faut que le defpote choi-
fiffe un efclave pour gouverner d’autres efclaves ,
& il l’appellera vifir ou hacha : comme la nature
de ce gouvernement exclut les droits , il faut que fon
principe établiffe les grâces que la nature dé Ce gouvernement
exige : elles ne peuvent pas devenir abu?-
five s, parce que ce gouvernement eft lui-même l’excès
de tous les abus.
C ’eft dans les monarchies que les grâces Cont plus
intimement liées avec le principe de ce gouvernement
; l’honneur eft relatif ; il fuppofe donc des dif-
tinâions: la vertu, principe des républiques, les
exclut, pour ainfi dire ; l’honneur en exige , mais il
en dédaigne plufieurs il faut aufli que la nature des
grâces fuive la marche de l ’honneur, fans quoi l’enchantement
de ce gouvernement ne fubfiftera plus ,
l’opinion feroit détruite. Un roi peut établir, par
exemple ,un ordre dans fon royaume; fc’eft l’opinion
des hommes fufceptibles de cet honneur qui a rendu
cette marque diftin&ive plus ou moins défirable: mais
elle la rend toujours l’objet de l’ambition la plus déréglée
, parce qu’elle donne aux hommes une grandeur
plus idéale, & par conféquent plus éloignée de celle
qu’ils partageront avec leurs égaux. Dans cet état
tous les ordres qui le compofent tendent vers le monarque
; il eft élevé au fommet de la pyramide, fa
bafe moyennant cela n’eft pas écrafée ; niais auffi les
malheurs qui peuvent renverfer l’édifice monarchique
font peut être innombrables. Je vais jetter feulement
ici un regard fur les malheurs & fur le bien
que peuvent porduire les grâces.
Nous avons dit qu’il n’étoit point d’honneur fans
diftinftions, & moyennant cela, qu’il falloit que les
diftinftions fuiviffent la marche de l’honneur ; en
effet, fi ellèsle dénaturent, le gouvernement fera
bouleverfé ; les diftinûions renferment toutes lès
grâces poffibles , les biens, les charges qui en rapportent
, & auxquelles font, joints .des honneurs , les
places du royaume, & les marques honorables fans
biens. Tant que le luxe n’aura point corrompu les
âmes, l’aifaneefera générale , au moins il y aura
une proportion établie dans la fortune des particuliers
; alors les, hommes auront encore cette force
élaftique qui les fera remonter où ils étoient avant
d’être pliés. L’ordre de l’Etoile fut-il a v ili, il fallut
créer celui de S. Michel ; celui-ci fut-il proftitué , il
fallut qu’Henri III. créât celui du Saint-Elprit. C e qui
peut introduire inévitablement le luxe, & pis eiiço-
re, la foifde l’o r, dansun état monarchique, C’eft la
diftribution des grâces & leur nature. Si l’on ne distingue
pas les bienfaits, les dons, les récompênfes ,
les grâces proprement dites, par léfqu elles je n’entends
déformais que les marques purement honorables
, tout fera perdu. Louis XIV. a fenti Une partie
de ce que je dis : il répandoit fes bienfaits, ils tiennent
à la générofité ; il accorda des dons à ceux qui
étoient attachés aufervice de fa perfonne , cela tient
à la reconnoiffànce ; récompenfa les artiftes célébrés
& les gens de lettres illuftres cela tient à la
Tot/ic X I I ,
gloire ; fit des grâces aux feigneiirs de fa cour , cela
tient à la dignité : il eût tout fait s’il n’avoit pas attaché
au bonheur de lui plaire des grâces que parta-
geoient ceux qui avoient l’honneur de fervir dans fes
armées, & qu’il n’eût pas donné à fes courtifans des
biens immenles qui les rendôient l’objet de la jalou-
fie de ceux dont à leur tour ils envioient lésgrades.Le
danger de ce mal étoit moins voifin, | | s’il eût tout
confondu ; il en étoit prefque le maître : mais Ce mal
devoit jetter des racines profondes , & qui ébranle-
roient la machine fi on vouloit les déraciner. C’eft le
luxe qu’il devoit produire ; quand il fera pouffé à
l’excès, on demandera les charges pour-jouir de leurs
émolumens. Alors on pourra proftituerles honneurs;
on les defirera ces honneurs , & on les partagera
avec des gens qui les dégradent, parce que le tems
fera venu de demander combien avez-vous d’argent?
quia tanti fcis, quantum habeas. C’étoit-là le beau fie-
cle d’Augufte. Il eft pourtant un moyen de reculer
ces tems déteftables, c’eft de n’attacher aux grades,
aux marques , aux places honorifiques nul revenu ;
cela arrêteroit le luxe ; on ne fe ruineroit plus pour
avoir un gouvernement, mais on feroit un bon ufage
de fon bien pour fe rendre digne de commander une
province. Sed tandem fit finis qucerendi.
Po l it iq u e s , f. m. pl. (\Hifi. mod.) nom d’un parti
qui fe forma en France pendant la ligue en 1574.
C’étoient des catholiques mécontens, qui fans toucher
à la religion , proteftoient qu’ils ne prenoicnt
les armes que pour le bien public , pour le foulage-
ment du peuple, & pour reformer les défordres qui
s’étoient gliffés dans l’état par la trop grande puiffan-
ce de ceux qui abufoient de l’autorite royale ; on les
nomma auffi royalifies , quoique dans le fond ils ne
fiiffent pas trop fournis au fouverain. Ils fe joignirent
aux Huguenots , fous la conduite d’Henri de Mont-
morenci, maréchal de Dam-Ville & gouverneur de
Languedoc, qui pour fe maintenir dans fapjace avoit
formé ce parti, & y avoit attiré le vicomte de Tu-
renne fon neveu , qui fut depuis duc de Bouillon.
POLITORIUM, (Géog. anc.) ville d’Italie dans le
Latium , & félon Pline, liv. I II. ch. v. dans la première
région. Tite-L ive, liv. I. ch. xxxiij. dit que
cette ville fut prife par le roi Ancus. On ne fait point
aujourd’hui fa pofition.
POLIUM, f m. (Hifi. nat. Rotang genre de plante
à fleur monopétale & labiée ; les etamines fe trouvent
fur la levre fupérieure ; la levre d’en-bas eft di-
vifée en cinq parties comme dans les fleurs de la ger-
mandrée. Le piftil fort du calice, il eft attaché comme
un clou à la partie poftérieure de la fleur, & en-
•touré de quatre embryons qui deviennent dans la
fuite autant de femences renfermées dans une capfule
qui a fervi de calice à la fleur. Ajoutez aux caractères
de ce genre que les fleurs naiffent fur les branches
& furies tiges , & qu’elles font réunies en forme
de tête. Tournefort, Inflitut. rei herbar. Voyez
P l a n t e .
Ce genre de plante, en anglois the montain-poley ,
eft bien nombreux en elpeces. Tournefort en compte
trente-fept ; il y ën a deux employées principalement
en Médecine -, le jaune & le blanc.
Le polium jaune, polium mont an um, Ititeum, I. R.
H. i q G. a la racine ligneufe, garnie de quelques fibres.
Elle pouffe plufieurs tiges grêles , dures , hautes
d’environ un demi-pié , cotonneufes , dont les unes
fe tiennent couchées fur terre, & les autres redref
fées. Ses feuilles font petites, oblongues , épaiffes,
dentelées fur leurs bords , garnies en-deffus & en-
deffous d’un duvet ou coton blanchâtre.
Ses fleurs naiffent au fommet des tiges & des branches
; elles font formées en gueules, petites, ramafi
fées plufieurs enfemble en maniéré de tête de couleur
jaune comme de l’or, d’une odeur pénétrante &
A A A a a a