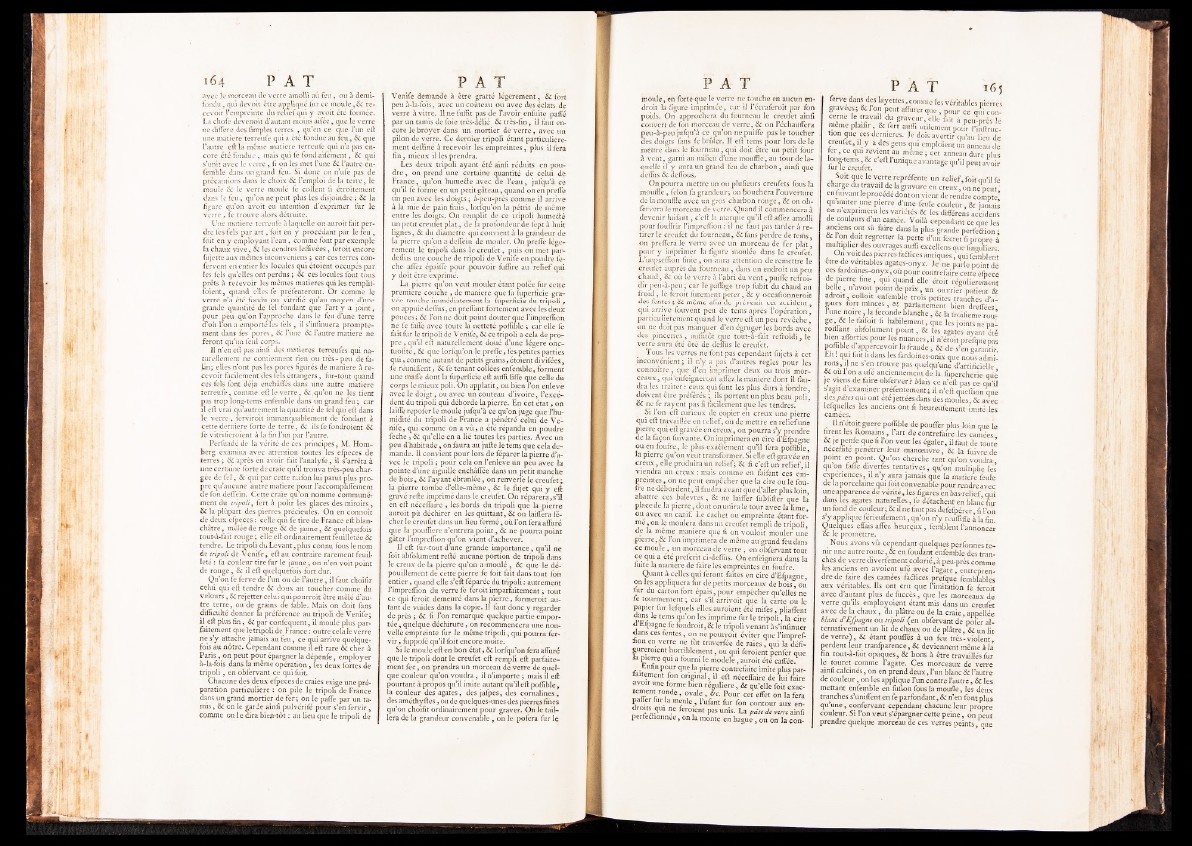
avec le morceau de verre amolli au feu, ou à demi-
fondu , qui devoit Être appliqué liir ce moule, Ôc recevoir
1*empreinte du relief qui y avoit été formée.
La chofe devenoit d’autant moins ailée, que le verre
ne différé des (impies terres , qu’en ce que l’un eft
une matière terreufe qui a été fondue au feu, ôc que
l’autre eft la même matière terreule qui n’a pas encore
été fondue , mais qui fe fond aifément, & qui
s’unit avec le verre, fi on les met l’une ôc l’autre en-
femble dans un grand feu. Si donc on n’ul'e pas de
précautions dans le choix ôc l’emploi de la terre, le
moule ôc le verre moulé fe collent li étroitement
dans le feu, qu’on ne peut plus les disjoindre ; ôc la
figure qu’on avoit eu intention d’exprimer fur le
verre > fe trouve alors détruite.
Une matière terreufe à laquelle on auroit fait perdre
fes fiels par a r t , foit en y procédant par le feu ,
foit en y employant l’eau, comme font par exemple
la chaux v iv e , ôc les cendres leffivées, feroit encore
fujette aux mêmes inconvéniens ; car ces terres con-
fervent en entier les locules qui étoient occupés par
les fels qu’elles ont perdus ; ôc ces locules font tous
prêts à recevoir les mêmes matières qui les remplif-
foient, quand elles fe préfenteront. Or comme le
verre n’a été fondu ou vitrifié qu’au moyen d’une
grande quantité de fel fondant que l’art y a joint,
pour peu qu’on l’approche dans le feu d’une terre
d’oîi l’on a emporté les fels , il s’infinuera promptement
dans fes pores, Ôc l’une ôc l’autre matière ne
feront qu’un feul corps.
Il n’ en eft pas ainfi des matières terreufes qui naturellement
ne contiennent rien ou très-peu de fa-
lin; elles n’ont pas les pores figurés de maniéré à recevoir
facilement des fels étrangers, fur-tout quand
ces fels font déjà enchâfies dans une autre matière
terreufe, comme eft le v erre, & ( qu’on ne les tient
pas trop long-tems enfemble dans un grand feu ; car
il eft vrai qu’autrement la quantité de fel qui eft dans
le verre, lerviroit immanquablement de fondant à
cette derniere forte de terre, & ils fe fondroient ôc
fe vitrifieroient à la fin l’un par l’autre.
Perfuadé de la vérité de ces principes, M. Hom-
berg examina avec attention toutes les efpeces de
terres ; & après en avoir fait l’analyfe, il s’arrêta à
une certaine forte de craie qu’il trouva très-peu chargée
de fe l, & qui par cette raifon lui parut plus propre
qu’aucune autre matière pour l’accompliffement
de fon deffein. Cette craie qu’on nomme communément
du tripoli, fert à polir les glaces des miroirs,
& la plupart des pierres précieufes. On en connoît
de deux efpeces : celle qui fe tire de France eft blanchâtre
, melée de rouge Ôc de jaune, & quelquefois
tout-à-fait rouge ; elle eft ordinairement feuilletée .&
tendre. Le tripoli du Levant, plus connu fous le nom
de tripoli de Venife, eft au contraire rarement feuilleté
: fa couleur tire fur le jaune ; on n’en voit point
de rouge, & il eft quelquefois fort dur.
Qu’on fe ferve de l’un ou de l’autre, il faut choifir
celui qui eft tendre ôc doux au toucher comme du
velours, & rejetter celui quipourroit être mêlé d’autre
terre, ou de grains de fable. Mais on doit fans
difficulté donner la préférence au tripoli de Venife;
il eft plus fin, ôc par conféquent, il moule plus parfaitement
que le tripoli de France : outre cela le verre
ne s’y attache jamais au feu, ce qui arrive quelquefois
au nôtre. Cependant comme il eft rare ôc cher à
Paris, on peut pour épargner la dépenfe, employer
à-la-fois dans la même opération, les deux fortes de
tripoli, en obfervant ce qui fuit.
Chacune des deux efpeces de craies exige une préparation
particulière : on pile le tripoli de France
dans un grand mortier de fer; on le paffe par un tamis
, & en le garie ainfi pulvérifé pour s’en fervir
comme on le dira bien-tôt : au lieu que le tripoli de •
Venife demande à être gratté légèrement, & fort
peu à-la-fois, avec un coûteau ou avec des éclats de
verre à vitre, li ne fuffit pas de l’avoir enfuite paffé
par un tamis de foie très-délié ôc très-fin, il faut encore
le broyer dans un mortier de verre, avec un
pilon de verre. Ce dernier tripoli étant particulièrement
deftiné à recevoir les empreintes, plus il fera
fin, mieux il les prendra.
Les deux tripoli ayant été ainfi réduits en poudre,
on prend une certaine quantité de celui de
France, qu’on humeéte avec de l’eau, jufqu’à ce
qu’il fe forme en un petit gâteau, quand on en prefle
un peu avec les doigts ; à-peu-près comme il arrive
à la mie de pain frais, lorfqu’on la pétrit de même
entre les doigts. On remplit de ce tripôlj hume&é
un petit creufèt plat, de la profondeur de l'ept à huit
lignes, & du diamètre qui convient à la grandeur de
la pierre qu’on a deffein de mouler. On prefle légèrement
le tripoli dans le creufet, puis on met par-
defliis une couche de tripoli de Venife en poudre fe-
che affez épaiffe pour pouvoir fuffire au relief qui
y doit être exprimé.
La pierre qu’on veut mouler étant pofée fur cette
première couche, de maniéré que fa fuperficie gravée
touche immédiatement la fuperficie du tripoli >
on appuie defliis, en preflant fortement avec les deux
pouces ; & l’on ne doit point douter que l’impreffion
ne fe faffe avec toute la netteté poffible ; car elle fe
fait fur le tripoli de Venife, ôc ce tripoli a cela de propre
, qu’il eft naturellement doué d’une légère onc-
tuofite, ôc que lorfqu’on le prefle, fes petites parties
qui, comme autant de petits grains, étoient divifées,
fe réunifient, & fe tenant collées enfemble, forment
une mafle dont la fuperficie eft aufli lifle que celle dix
corps le mieux poli. On applatit, ou bien l’on enlevé
avec le doigt, ou avec un couteau d’ivoire, l’excédent
du tripoli qui déborde la pierre. En cet état, on
laifle repofer le moule jufqu’à ce qu’on juge que l’humidité
du tripoli de France a pénétré celui de Venife,
qui -comme on a v ît, a été répandu en poudre
feche, & qu’elle en a lié toutes les parties. Avec un
peu d’habitude, on faura au jufte le tems que cela demande.
Il convient pour lors de féparer la pierre d’avec
le tripoli ; pour cela on l’enleve un peu avec là
pointe d’une aiguille enchâflee dans un petit manche
de bois, & l’ayant ébranlée, on renverfe le creufet-;
la pierre tombe d’elle-même, & le fujet qui y eft
gravé refte imprimé dans le creufet. On réparera,s’il
en eft néceflaire , les, bords du tripoli que la pierre
auroit pu déchirer en les quittant, ôc on laiflerafé-
cher le creufet dans un lieu fermé, oii l’on fera afliiré
que la pouffiere n’entrera point, & ne pourra point
gâter l’impreffion qu’on vient d’achever.
Il eft fur-tout d’une grande importance, qu’il ne
foit abfolument refté aucune portion de tripoli dans
le creux de la pierre qu’on a-moulé , & que le dépouillement
de cette pierre fe foit fait dans tout fon
entier, quand elle s’eft féparée du tripoli : autrement
l’impreflion du verre fe feroit imparfaitement ; tout
ce qui feroit demeuré dans la pierre, formeroit autant
de vuides dans la copie. Il faut donc y regarder
de près ; ôc fi l’on remarque quelque partie emportée
, quelque déchirure , on recommencera une nouvelle
empreinte fur le même tripoli, qui pourra ferv
ir , fuppofé qu’il foit encore moite.
Si le moule eft en bon état, ôc lorfqu’on fera afliiré
que le tripoli dont le creufet eft rempli eft parfaitement
fe c , on 'prendra un morceau de. verre de quelque
couleur qu’on voudra, il n’importe ; mais il eft
pourtant à propos qu’il imite autant qu’il eft poffible,
la couleur des agates, des jafpes, des cornalines,
des améthyftes, ou de quelques-unes des pierres fines
qu’on çhoifit ordinairement pour graver. On le taillera
de la grandeur convenable, on le pofera fur le
îriôiile, en forte que le verre ne touche en aucun endroit
la figure imprimée, Car il l’écraferoit par fon
poids. On approchera du fourneau le Creufet ainfi
couvert de fon morceau de verre, ôc on l’échauffera
peu-à-peu jufqii’à ce qu’on ne puifle pas le toucher
des doigts fans fe briller. Il eft tems pour lors de le
mettre dans le fourneau, qui doit être un petit four
à vent, garni au milieu d’une mouffle, au tour de laquelle
il y aura un grand feu de charbon, ainfi que
defliis ôc aeffous.
On pourra mettre un pu plufieurs creiifets fous la
mouffle, félon fa grandeur; on bouchera l’oiiverturé
de la mouffle avec un gros charbon rouge, & on ob-
fervera le morceau de verre. Quand il cofnmertCera à
devenir luifant, c’eft la marque qu’il eft affez amolli
pour fouffrir l’impreflioh : il ne faut pas tarder à retirer
le creufet du fourneau, ôc fans perdre de tems
on preffera le verre avec un morceau de fer plat,
pour y imprimer la figure moulée dans le creufet.
L ’mipreflion finie , on aura attention de remettre le
creufet auprès du fourneau, dans un endroit un peu
chaud, ôc où le verre à l’abri du v en t , puifle refroidir
peu-à-peü ; car le pàflagê trop fubit du chaud au
froid j le feroit furement peter, Ôc y occafionneroit
des fentes ; ôc même afin de prévenir cët accident
qui arrive fouvent peu de tems après l’opération,
particulièrement quand le. verre eft un peu revêche,
on ne doit pas manquer d’en égruger les bords avec
des pincettes , auflitot que tout-à-fait refroidi, le
verre aura été Ôté de defliis le creufet.
Tous les verres ne font pas cependant fujets à cet
inconvénient ; il n’y a pas d’autres règles pour les
connaître , que d’en imprimer deux ou trois mor- :
ceaiix, qui 'enfeigneront aflez la maniéré dont il faudra
les. traiter : ceux qui font les plus durs à fondre,
doivent être préférés ;. ils portent un plus beau poli.
& ne fe rayent pas fi facilement que les tendres.
Si l’on eft curieux de copier en creux une pierre
qui eft travaillée en relief, ou de mettre en relief une |
pierre qui eft gravée en creux:, on pourra s’y prendre
de la façon fuivante. Ori imprimera en cire d’Efpagne
ou en foufre, le .plus éxâftement qu’il ferà poffible,
la pierre qu’on veut transformer. Si elle èft gravée en
creux , elle produira un relief; & fi ç’eft un relief il
viendra un creux : mais comme en faifant ces empreintes,
on ne peut empêchèr que la cire ou le foü-
fre ne débordent, il faudra avant que d’aller plus loin,
abattre ces balevres , ôc ne laiffer fubfifter que la
place de la pierre, dont on unira le tour avec la lime,
ou avec un canif. Le cachet ou empreinte étant formé
, on le moulera dans un creufet rempli de tripoli,
de la même maniéré que fi on vouloit mouler une
pierre, & l’on imprimera de même au grand feu dans
ce moule , un morceau de ve r re , en obfervant tout
ce qui a été preferit ci-defîus. On enfeignera dans la
fuite la maniéré de faire les empreintes en foufre.
Quant à celles qui feront faites en cire d’Efpagne
on les appliquera fur de petits morceaux de bois, ou
fur du carton fort épais, pour empêcher qu’elles ne
fe tourmentent ; car s’il arrivoit que la carte ou le
papier fur lefquels elles auroient été mifes, pliaffent
dans le tems qu’on les imprime fur le tripoli, la cire
d Efpagne fe fondroit,&le tripoli venant às’infinuer
dans ces fentes, on ne pourroit éviter que l’impreffion
en verre ne fût traverfée de raies, qui la défî-
gureroient horriblement, ou qui feroient penfer que
la F erre qui a fourni le modèle, auroit été caflee.
Enfin pour que la pierre contrefaite imite plus par-
îaitement fon original, il eft néceflaire de lui frire
avoir une forme bien régulière, ôc qu’elle foit exac-
tement ronde, ovale, &c. Pour cet effet on la fera
palier fur la meule , l’ufant fur fon contour aux en-
fer°ient pas unis. La pdtede verre ainfi
perfectionnée, on la monte en bague, ou on la con-
; ferve dans des layettes, comme les véritables pierées
i gravee,s; & 1 ■ Peut affurer que , pour ce qui con-
i earne tri™ < * • graveur, elle fait à peu-près le
même plaifir & fert aufïï utilement pour l’inftruc-
, tion que ces dernières. Je dois avertir qu’au lieu de
creufet, il y a des gens qui emploient un anneau de
: te r , ce qui revient au même ; cet anneau dure plus
long-tems, & c eft l’unique avantage qu’il peut avoir
; luHe creufet. r
I , Soit f ‘ è Ie verre tepréfente un relief, foit qu’il fé
; charge du travail de la gravure en creux, on ne p eut1
1 en Uuvanl le procédé dont on vient de rendre compte’
; qu imiter une pierre d’une feule couleur, & jamatf
I T n e*PnmÇra les variétés & les différons accidenS
i de couleurs d un camée. Voilà cependant ce que les
I anciens ont sû Élire dans la plus grande perfeflion ;
& I on doit regretter la perte d’un fecret fi propre à
multiplier des ouvrages aufli excellens que fingiiliers.
: On voit des pierres factices antiques, qui femblent
etre de véritables agates-ohyx. Je ne parle point de
ces iardoines-onyx, oii pour contrefaire cette efpecè
de. pierre fine, qui quand elle étoit régulièrement
belle, n avoit point de prix, un ouvrier patient &
adroit, coltoit enfemble trois petites tranches d’agates
fort minces , & parfaitement bien dreffées'
lunenoire la fécondé Blanehe, 8c la froifieme rou-’
8e.» “ le.&ifotHi habilement, que les joints ne paà
roiffant abfolumênt point, & les agates ayanr été
bien affomes pour les nuances, il n’étoit prefqué pas
poffible d appercevoir la fraude ; &- de ÿen garantir.
Eh ! qui frit fi dans les fardoines-onix que nous admirons,
il ne s’en trouve pas quelqu’une d’artificielle
-&011 l’on aufé anciennement de la fupercherie que
je viens de faire obferver? Mais ce n’eft pas ce qu’il
S’agit d’examiner préfentement ; il n’eft queftion que
des pâtes qui ont été jettées dans des moules, & avec
lefquelles les anciens ont fi heureufement-imité.les
camees.
Il n’étoit guère poffible de pouffer plus .loin que le
firent les Romains, l’art de contrefaire les camées:
& je penfe que fi l’on veut les égaler, il faut de toute
neceffité pénétrer leur manoeuvre, & la fuivrede
point en point. Qu’on Cherche tant qu’on.voudra:
qu’on fafle diverfes tentatives, qu’on multiplie les
expériences, iLn y aura jamais que la matière feule
de la porcelaine qui foit convenable pour rendre avec
une apparence de vérité, les figures en bas-relief, qui
dans les agates naturelles, fe détachent en blanc fur
un fond de couleur ; & il ne faut pas defefpérer fi l’on
s’y applique férieufement, qu’on n’y réuffifle à la fin.
Quelques efîais affez heureux, femblent l’annoncer
'& le promettre.
Nous avons vu cependant quelques perfonnes tenir
une autre route, ôc en foudant enfemble des tranches
de verre diversement colorié, à peu-près comme
les anciens en avoient ufé avec l’agate , entreprendre
de faire des camées factices prefque femblables
aux véritables. Ils ont cru que l’imitation fe feroit
avec d’autant plus de fuccès, que les morceaux de
verre qu’ils employoient étant mis dans un creufet
avec de la chaux, du plâtre ou de la craie, appellée
blanc d'Efpagne ow tripoli (en obfervant de pofer alternativement
un lit de chaux ou de plâtre & un lit
de v erre), & étant pouffés à un feu très-violent
perdent leur tranfparence, & deviennent même à la
fin tout-à-fait opaques, & bons à être travaillés fur
le touret comme l’agate. Ces morceaux de verre
ainfi calcinés, on en prend deux, l’un blanc & l’autre
de couleur, on les applique l’un contre l’autre, ôc les
mettant enfemble en fufion fous la moufle, les deux
tranches s’unifient en fe parfondant, ôc n’en font plus
qu’une, confervant cependant chacune leur propre
couleur. Si l’on veut s’épargner cette p eine, on peut
prendre quelque morceau de ces verres peints, que