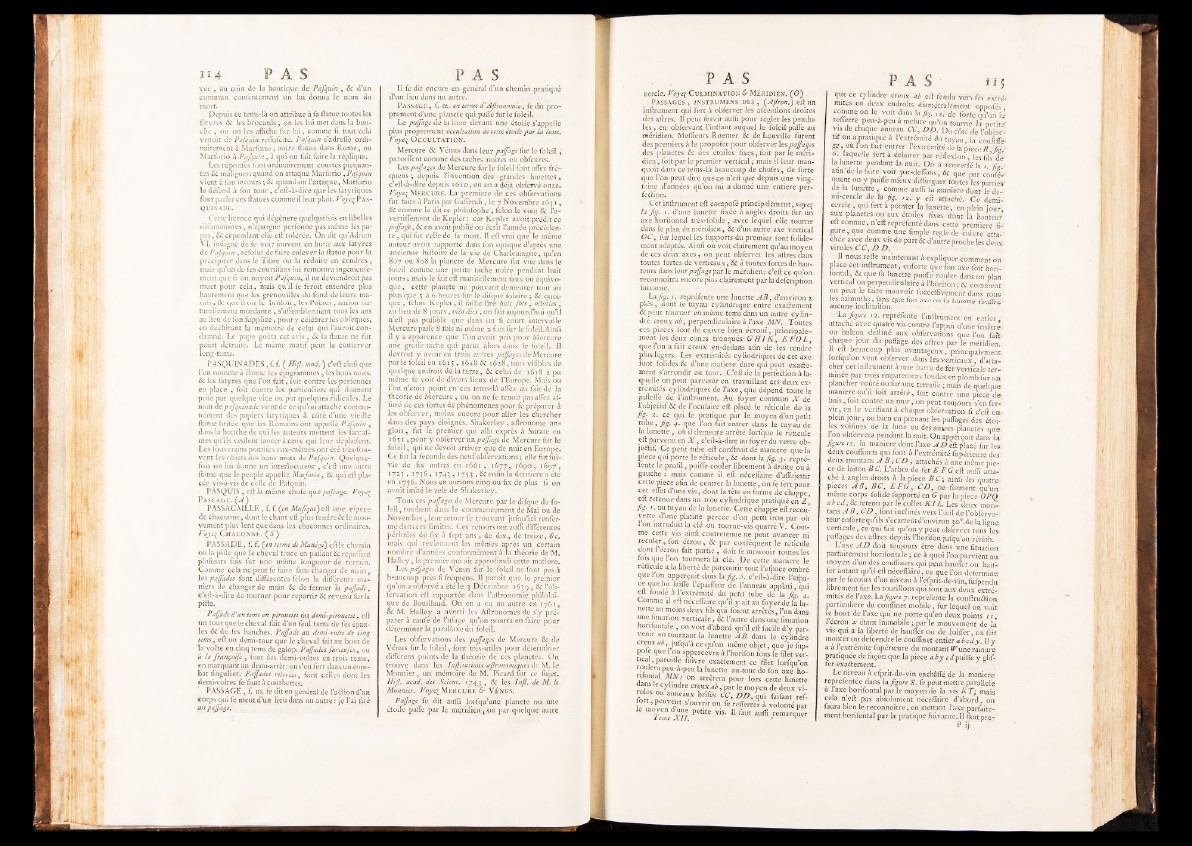
v é e , au coin de la boutique de Pafquin , & d’un
commun confentement on lui donna le nom du
mort»
Depuis ce tems-là on attribue à fa'Hatue toutes les
fatyres 6c les brocards ; on les lui met dans la bouche
, ou on les affiche fur lui, comme fi tout cela
Venoit de Pafquin reffufcité. Pafquin s’adreffe ordinairement
à Marforio , autre ftatue dans Rome, ou
Marforio à Pafquin, à qui on fait faire la réplique.
Les réponfes font ordinairement courtes picquan-
tes 6c malignes : quand on attaque Marforio, Pafquin
vient à fon fecours ; 6c quand on l’attaque, Marforio
le défend à fon tou r, c’eft-à-dire que les fatyriques
font parler ces lia tu es comme il leur plaît. Foye^ Pas-
quinade.
Cette licence qui dégénéré quelquefois en libelles
diffamatoires, n’épargné perfonne pas même les papes
, 6c cependant elle eft tolérée. On dit qu’Adrien
VI. indigné de fe voir fouvent en butte aux fatyres
de Pafquin , réfolut de faire enlever la ftatue pour la
précipiter dans le Tibre ou la réduire en cendres ,
mais qu’un de fes courtifans lui remontra ingénieufe-
ment que ft on noyoit Pafquin, il ne deviendroit pas
muet pour cela, mais qu’il fe feroit entendre plus
hautement que les grenouilles du fond de leurs marais
; 6c que li on le briiloit, les Poètes , nation naturellement
mordante , s’affembleroient tous les ans
au lieu de fon fupplice, pour y célébrer fes obfeques,
en déchirant la mémoire de celui qui l’auroit condamné.
Le pape goûta cet avis , 6c la ftatue ne fut
point détruite. Le même motif peut la conlerver
long-tems.
PASQUINADES , f. f. ( Hiß. mod. ) c’ eft ainfi que
l’on nomme à Rome les épigrammes , les bons mots.
6c les fatyres que l’on fait, foit contre les perfönnes
en place , fôit contre les particuliers qui donnent
prife par quelque vice ou par quelques ridicules. Le
nom de pafquinade vient de ce qu’on attache communément
des papiers fatyriques à côté d’une vieille
ftatue brifée que les Romains ont appellé Pafquin ,
dans la bouche de qui les auteurs mettent les farcaf-
mes qu’ils veulent lancer à ceux qui leur déplaifent.
Les fouverains pontifes eux-mêmes ont été très-fou-
vent les objets des bons mots de Pafquin. Quelquefois
on lui donne un interlocuteur , c’eft une autre
ftatue que le peuple appelle Marforio, & qui eft placée
vis-à-vis de celle de Pafquin.
PASQUIS , eft la même choie que pafcaee. Foyer
Pascage. (A )
PASSACAILLE, f. f. (en Mufiquè) eft une efpece
de chaconne, dont le chant eft plus tendre 6c le mouvement
plus lent que dans les chaconnes ordinaires.
H?ye£ C haconne. ( S )
PASSADE, f. f. (en terme de Manège) eft le chemin
ou la pifte que le cheval trace en paffant & repaffant
plufieurs fois fur une même longueur de terrain.
Comme cela ne peut fe faire fans changer de main,
les paffades font différentes félon la différente maniéré
de changer de main 6c de fermer la paffade,
c’eft-à-dire de tourner pour repartir 6c revenir fur la
pifte.
Paffade d'un tems en pirouette ou demi-pirouette, eft
un tour que le cheval fait d’un feul tems de fes épaules
6c de fes hanches. Paffade au demi-volte de cinq
tems, eft,un demi-tour que le cheval fait au bout de
la volte en cinq tems de galop. Paffades furieufes, ou
'à la fra n ç o ife font des demi-voltes en trois tems,
en marquant un demi-arrêt : on s’en fert dans un combat
finguïier. Paffades relevées, font celles dont les
demi-voltes. fe font à courbettes. ■
PASSAGE „ f. m. fe dit en général de l’aftion d’un
corps qui fe meut d’un lieu dans un autre : je l’ai tiré
au paffage, ,,
Il fe dit encore en général d’un chemin pratiqué
d’un lieu dans un autre.
Passage , f. m» en terme d'Aflronomie, fe dit proprement
d’une planete qui pafle fur le foleil.
Le paffage de la lune devant une étoile s’appelle
plus proprement occultation de cette étoile par la lune.
Foye^ O ccul ta t io n .
Mercure 6c Vénus dans leur paffage fur le foleil ,
paroiffent comme des taches noires ou obfcures.
Les paffages de Mercure fur le foleil font affez fré-
quens ; depuis l’invention des grandes lunettes,
c’eft-à-dire depuis 1610, on en a déjà obfervé onze»
Fyyeç Mercure. La première de ces obfervations
fiit faite à Paris par Gaffendi, le 7 Novembre 1631,
6c comme le dit ce philofophe , félon le voeu & l’a-
vertiffement de Kepler : car Kepler avoit prédit ce
paffage, 6c en avoit publié ou écrit l’année précédente
, qui fut celle de fa mort. Il eft vrai que le même
auteur avoit rapporté dans fon optique d’après une
ancienne hiftoire de la vie de Charlemagne, qu’en
807 ou 808 la planete de Mercure fut vue dans le
foleil comme une petite tache noire pendant huit
jours ; mais le fait eft manifeftement faux ou équivoque
, cette planete ne pouvant demeurer tout au
plus que 5 à 6 heures fur le difque folaire ; 6c quoique
, félon Kepler, il faille lire huit fo is , ocloties,
au lieu de 8 jours, oclo dies, on fait aujourd’hui qu’il
n’eft pas poflible que dans un fi court intervalle
Mercure paffe 8 fois ni même 2 fois fur le foleil.Ainfi
il y a apparence que l’on avoit pris pour Mercure
une groffe tache qui parut alors- dans le foleil. Il
devroit y avoir eu trois autres paffages de Mercure
par le foleil en 1615 , 1618 Sc 1628, tous vifibles de
quelque endroit de la terre, & celui de 1618 a pu
même fe voir de divers lieux de l’Europe. Mais ou
l’on n’étoit point en ces tems-là affez au fait de la
théorie de Mercure , ou on ne fe tenoit pas affez af-
furé de ces fortes de phénomènes pour fe préparer à
les obferver, moins encore pour aller les chercher
dans des pays éloignés. Shakerley , aftronome an-
glois, fiit le premier qui alla exprès à Surate en
1651., pour y obferver un paffage de Mercure fur le
foleil, qui ne devoit arriver que de nuit en Europe.
Ce fut la fécondé des neuf obfervations ; elle fut fui-
vie de fix autres en 1 6 6 1 , 1 6 7 7 , 1690, 16^7 ,
1723 , 1736, 1743,1753 , 6c enfin la derniere a été
en 1756. Nous en aurions cinq ou fix de plus fi on
avoit imité le zele de Shakerley.
Tous ces paffages de Mercure par le difque du foleil,
tombent dans le commencement de Mai ou de
Novembre, leur retour fe trouvant jufqu’ici renfermé
dans ces limites. Ces retours ont aufli différentes
périodes de fix à fept ans, de d ix, de treize, &c.
mais qui reviennent les mêmes après un certain
nombre d’années conformément à la théorie de M.
Halley, le premier qui ait approfondi cette matière.
Les paffages de Vénus fur le foleil ne font pas à
beaucoup près fi fréquens. Il paroît que le premier
qu’on a obfervé a été le 3 Décembre 1639 » & Pob-
fervation eft rapportée dans l’aftronomie philolaïque
de Bouillaud. On en a eu un autre en 1761,
6c M. Halley a averti les Aftronomes de s’y préparer
à caufe de l’ufage qu’on pourra en faire pour
déterminer la parallaxe du foleil.
Les obfervations des paffages de Mercure 6c de
Vénus fur le foleil, font très-utiles pour déterminer
différens points de la théorie de ç.es planètes. On
trouve dans les Infiïtutions aflronomiques de M. le
Monnier, un mémoire de M. Picard fur ce fujet.
Hiß. acad. des Scienc. 1743 ,6 c les Inß. de M. le
Monnier. Foye\ MERCURE & VÉNUS.
Paffage fe dit aufli lorfqu’une planete ou une
étoile paffe par le méridien, ou par quelque autre
Cercle. F6yc{ C ulmination & Méridien. (O)
Pa s sa g e s , instrdmens. d e s , (Aftron.') eft un
infiniment qui fert à obferver les afcenfions droites
des aftres. Il peut fervir aufli pour regler les pendule
s , en: obfervant rinftant auquel le foleil paffe au
méridien. Meflïeurs Rdemer 6c de Louville furent
des premiers à le propofer pour obferver les paffages
des planètes 6c des étoiles fixç s,foit par le méris
dien, foit par le premier vertical; mais il leur man-
quoit dans ce tems-là beaucoup de chofes, dé forte
que l’on peut dire que ce-n’eft que depuis une vingtaine
d’années qu’on lui a donné une entière per-:
feétion.
Cet infiniment eft compofé principalement, voye^
la fig. 1. d’une lunette fixée à angles droits fur un
axe horifontal très-folide, avec lequel elle tourne
dans le plan du méridien, 6c d’un autre axe vertical)
O C , fur lequel les fupports du premier font folide-
ment adaptes. Ainfi on voit clairement qu’au moyen
de ces deux axes, on peut obferver les aftres dans
toutes fortes de verticaux, 6c à toutes fortes de hauteurs
dans leur paffage par le méridien: c’eft ce qu’on-
reconnoitra encore plus clairement par la defcription
fiiivante.
La fig. 1. répréfente une lunette A B , d’environ 2
pies , dont le tuyau cylindrique entre- exactement
& peut tourner en même tems dans un autre cylindre
creux ab, perpendiculaire à l’axe MN. Toutes
ces pièces font de cuivre,bien écroui, principale-“,
ment les deux cônes tronqués G H I K , E P O L ,
que l’on a fait creux en-dedans afin de les rendre
plus légers. Les extrémités-cylindriques de cet axe
font folides 6c d’une matière dure qui peut exactement
s’arrondir au tour. jC’éft de la perfe&ion à laquelle
on peut parvenir en travaillant ces deux extrémités
cylindriques de l’axe, que dépend toute la
jufteffe de l’inftrument. Au foyer commun X de
l’objeCtif 6c de l’oculaire eft placé le réticule de la
fig- z. ce qui fe pratique par le moyen d’un petit
tube , fig. 4. que l’on tait entrer dans le tuyaju de
la lunette , oii il demeure arrêté lorfque le réticule
eft parvenu en X , c’eft-à-dire au foyer du verre objectif.
Ce petit tube eft conftruit de maniéré que la
piece qui porte le réticule , 6c dont la fig. 3 . repréfente
le profil, puiffe couler librement à droite ou à
gauche : mais comme il eft néceffaire d’affujettir
cette piece afin de centrer la lunette, on fe fert pour
cet effet d’une v is , dont la tête en forme de chappe,
eft retenue dans un trou cylindrique pratiqué en Z*
fig. /. aii tuyau de la lunette. Cette chappe eft recouverte
d’une platine percée d’un petit trou par oii
l’on introduit la clé ou tourne-vis quarré V . Comme
cette vis ainfi contretenue ne peut avancer ni
reculer, fon ecrou, 6c par confisquent le réticule
dont 1 ecrou fait partie , doit fe mouvoir toutes les
fois que l’on tournera la clé. De cette maniéré le
réticule a la liberté de parcourir tout l’efpace ombré
que l’on apperçoit dans la fig. 6. c’eft-à-dire l’efpa-
Cn. ^ue l’épaiffeur de l’anneau applati, qui
eft foudé à l’extrémité du petit tube de la fig. 4.
Comme il eft néceffaire qu’il y ait au foyer de la lunette
au moins deux fils qui foient arrêtes, l’un dans
une fituation verticale, 6c l’autre dans une fituation
norifontale , on voit d’abord qu’il eft facile d’y parvenir
en tournant la lunette A B dans le cylindre
creux ab, jufqu’à ce qu’un même objet, que je fup-
pofe que 1 on appercevra à l’horifon fous le filet vertical,
paroiffe fuivre exactement ce filet lorfqu’on
roulera peu-à-peu la lunette au-tour de fon axe ho-
nlontal M N ; on arrêtera pour lors cette lunette
dans le cylindre creux ab, par le moyen de deux v iroles
ou anneaux brifés CC, D D , qui faifant ref-
lo r t , peuvent s’ouvrir ou fe refferrer à volonté par
le moyen d une petite yis. Il faut aufli remarquer
lome X I I , , , 1
ipfWe n y lîü d fr Cîèilx M a à àhJti vêts fes « t r ÿ
mites-en deux 'endroits: cliamétKaïeMénf oHpôfS;
m ‘forte ÿi'on-Itf
refferre. peu-a-peu à mgfure qu’ou <büme la petit«'
Vis de chaque anneau >ee, D D . Du a ê r & f â j î
tif onapratlque-à-l’ex trèmé du tuyau, ia couliffif
gg, ou l’on fait entrer l’extrémité de la pièce R
<T. laquelle fert à éclairer par réflexion , les fils' &
ladunette: pendaïH ila huit. Oii aufewérffi la
afmîdeia-faire- yoir-par-defrotiSipfe.’ qiiêjpar éonffi
quent on y puiffe mieux diftinguar .foutes lesWartiès»
de la lunette , comme aufli la maniéré dont le de-*"
mi.fenle udcîla j f e '.v a l'y e& iattaOié/.’<Sé
cerderpiqiufett à'^oiriterfa luna:tey.toptein'iôi,fs'
: aux.planètes.oa.-aax «toiles fixesudcM 'la haiïféuF:
eft GonnuBj n’e®epféfeflté dans<p)tt» pfemiére fii'
i gure ifq®!,coiùin‘e'.iiife.fimple're,gy attip't
chée avec deux,vis de pa rt&d’alitfë!tfr'odiel«sd'eux?
viroiés t ’ t ', /> D.
"•'H TOUS refte maintenant
, place, cet infiniment, enforte, qnefon' axe fi,if hori«
i iontal, .& que ia lunette puiffe rouler daHs'un' ftlafi:
vertical,ou perpeifdtettlairê^l’lKififsn ,&,comment:
on, .peut, le faire tflouvofr fucceïfivetioentfdans: toit»-.’
les aaimuths, fans que fon -axe ou;fa l-.mette fetiffta>
aucune inclinaifon.
ha figure ^repréfente Pinftrument en' entier
attache avec quatre vis contre l’appui d’une fenêtrei
Ou balcon deftiné aux • obfervations : que l’on faft-
chaqiie jour du paffage des aftres par le méridien»
Il eft beaucoup, plus avantageux., principalement
• lorfqu on veut obferver dans les verticaux, d’attacher
cet inftrument à une barré defer verticale terminée
par trois empatemens foudës en plomb fur un
plancher voûté ouiurame terraffe ; mais de quelque,
maniéré qu’il foit arrêté , foit-contre une piece der
bois, foit contre un mur, on peut toujours s’en fer--
vu- , en le vérifiant à. chaque obfervation fi c’eft en:
plein jou r, ou bien en prenant les paffages des étoiles.
voifines de la. lune ou des antrès planètes que
j l’on obfervera pendant la nuit. Omapp.erçoit dans lm
figure 12. la maniéré dont l’axe A D e l l placé fur les;
deux couflinets qui font à l’extrémité fupérieure des!
deux montans A B , C D ) attachés à une même pie-
| ce de laiton B G. L’arbre , de fer E F G eft aufli atta«;
che à angles droits à la piece B C ; âih-fi-les quatre-
pièces A B , B C , E F G , C D , ne forment qu’un;
même corps folide fupporté en G par la piece OPQ
ab cd , 6c retenu par le collet K IL . Les deux mon-,
tans. A B , CD , font inclinés vêts- l’Oeil.de l’obfèrva-r
teur enforte qu’ils s’écartent d’environ 3op.de la li^ne
verticale., ce qui fait qu’on y peut obferver tous°les,
paflages des aftres depuis l’norifon-jufqû’au zénith.
L’axe A D doit toujours être dans une fituation
parfaitement honfontale ; ce à quoi-l’on parvient au
moyen d’un des couffinets. qui peut hauffer ou baif--
fer autant qu’il eft néceffaire, ce que l’on détermine
par le fecours d’un niveau à Pefprit-de-vin, fufpendu
librement fur les tourillons qui font aux deux extrémités
de l’axe i La figure 7. repréfentè la conftru&ion.
particulière du couffmet mobile, fur lequel on voit
le bout de l’axe qui ne porte qu’en deux points t t
l’écrou x étant immobile i par le mouvement de la
vis qui a la liberté de hauffer ou de baiffer, on fait
monter où defeendre le coUffinet entier abedy. Il y
a à l’extremite fupérieure du montant Wune rainure
pratiquée de façon que la piece ab y e d puiffe y glif*
fer exactement.
Le niveau à efprit-de-vin enchâffé dé la maniera
reprefentée dans la figure 8. fe peut mettre parallèle
à l’axe horifontal par le moyen de la vis R T; mais
cela n’eft pas abfolument néceffaire d’abord, on
faura bien le reconnoître, en mettant l’axe parfaitement
horifontal par la pratique fuivante. Il faut pre