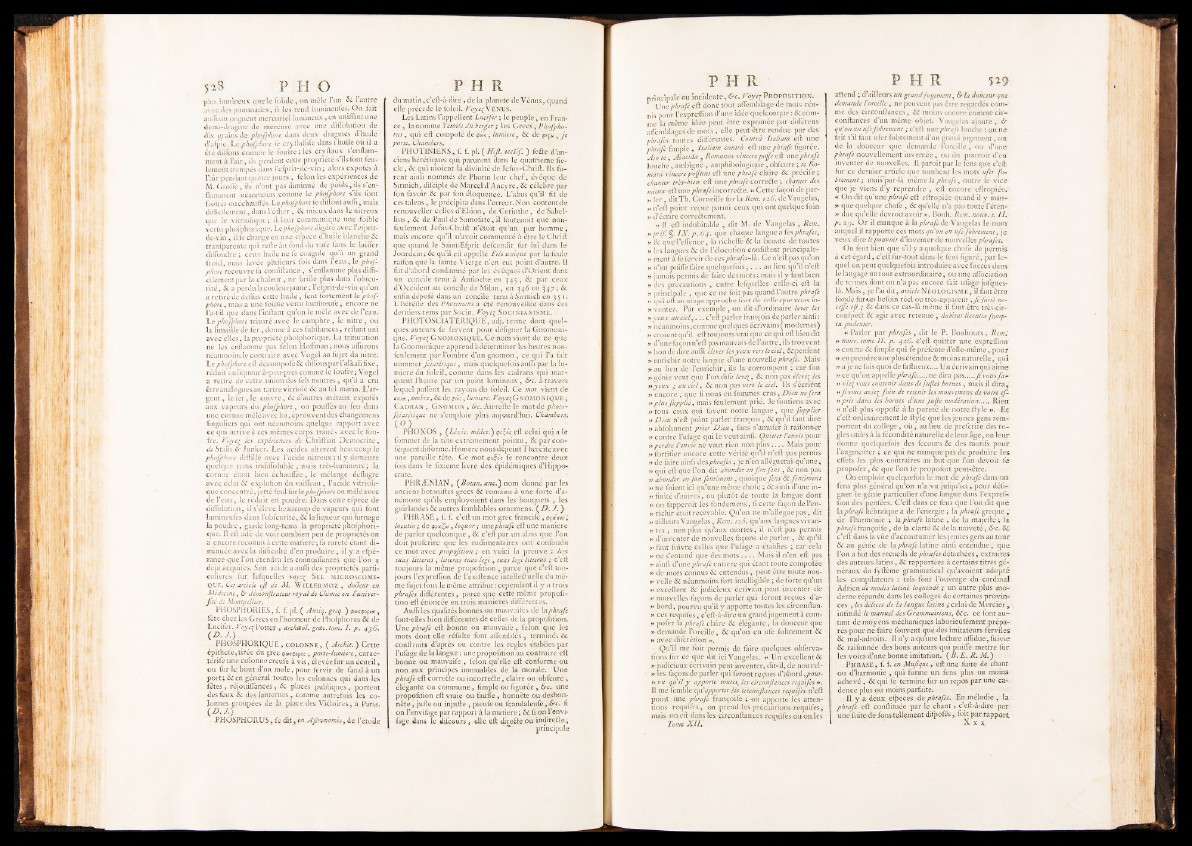
328 P H O
plus lumineux que le folide, on môle l’un 8c l’autre
avec des pommades, il les rend lumineulës. On fait
aufîiun onguent mercuriel lumineux, en unifiant une
demi-dragme de mercure avec une diflolution de
dix grains de phofphore dans deux dragmes d huile
d’afpic. Le phofphore fej cryftallife dans l’huile oii il a
été diflbus comme le foutre ; les cryftaux s’enflamment
à l’air, ils perdent cette propriété s’ils font feulement
trempés dans l’efprit-de-vin ; alors expofes à
l’air pendant quinze jours , félon les expériences de
M. Grofl'e, ils n’ont pas diminué de poids, ils s’enflamment
néanmoins comme le phofphore s’ils font
frottés ou échauffés. Le phofphore le diflout aufli, mais
difficilement, dans l'éther, 8c mieux dans le nitreux
que le vitriolique; il leur communique une foible
vertu pholphorique. Lephofphore digéré avec l’efprit-
de-vin , il le change en une efpece d’huile blanche 8c
tranfparente qui relie àu fond du vafe fans le lailfer
dilfoudre ; cette huile ne fe coagule qu’à un grand
froid, mais lavée plufieurs fois dans l’eau, le phofphore
recouvre fa confiftance , s’enflamme plus difficilement
par la chaleur , ne brille plus dans l’obfcu-
rité, & a perdu la couleur jaune ; l’el'prit-de-vin qu’on
a retiré de defliis cette huile, fent fortement le phofphore
, mais a une foible vertu lumineufe, encore ne
l’a-t-il que dans l’inftant qu’on le mêle avec de l’eau.
Le phofphore trituré avec le camphre , le nitre, ou
la limaille dé fer, donne à ces lubffances, reliant uni
avec elles, la propriété pholphorique. La trituration
ne les enflamme pas félon Hoffman ; nous alfurons
néanmoins le contraire avec Vogel au fujet du nitre.
Le phofphore elt décompofé ÔC diflous par l’alkali fixe,
réduit en liqueur à-peu-près comme le foufre; Vogel
a retiré de cette union des fels neutres, qu’il a cru
être analogues au tartre vitriolé 6c.au fel marin. L’argent
, le fer, le cuivre, 8c d’autres métaux expofés
aux vapeurs du phofphore, ou poulfés au feu dans
une cornue mêlé avec lui, éprouvent des changemens
finguliers qui ont néanmoins quelque rapport avec
ce qui arrive à ces mêmes corps traités avec le foufre.
Voye{ Les expériences de Chrillian Democrite,
de Stalh & Junker. Les acides altèrent beaucoup le
phofphore diltillé avec l’acide nitreux ; il y demeure
quelque tems indilfoluble , mais très-lumineux ; la
cornue étant bien échauffée, le mélange déflagre
avec éclat 8c explofion du vailfeau , l’acide vitriolique
concentre, jetté leul fur le phofphore ou meleavec
ae l’eau, le -réduit en poudre. Dans cette efpece de
diflolution, ils ’éleve beaucoup de vapeurs qui font
lumineufes dans l’obfcurité, 8c la liqueur qui fumage
la poudre, garde long-tems la propriété phofphori-
,que. Il eft aifé de voir combien peu de propriétés on
a encore reconnu à cette matière ; fa rareté étant diminuée
avec la difficulté d’en produire , il y a efpé-
rance que l’on étendra les connoiffances que l’on a
déjà acquifés. Son acide a aufli des propriétés particulières
fur lefquelles voyt\ S e l m i c r o s c o m i -
QUE. Cet article ejl de M. WlLLERMOZ , docteur en
Medecine, 6* demonflrateur royal de Chimie en Üuniver-
Jité de Montpellier.
PHOSPHORIES, f. f. pl. ( Antiq. greq. ) çanpopitt,
fête chez les Grecs en l’honneur de Phofphorus 8c de
Lucifer. V Potter , archceol. grcec. tom. I. p. 43 G.
PHOSPHORIQUE, c o l o n n e , ( Archit. ) Cette
epithete, tiree du grec tputrçopoç, porte-lumière, carac-
terife une colonne creufe à v is , élevée fur un écueil,
ou fur le bout d’un mole, pour fervir de fanal à un
port; & en général toutes les colonnes qui dans les
fêtes, réjouiflances, 8c places publiques, portent
des feux 8c des-lanternes, comme autrefois les colonnes
groupées de la place des Vittoires, à Paris. jPPj
PHOSPHORUS, fe dit, en Afronom'u, de l’étoile
P H R
' du matin, c’eff-à-dire, de la planete de y énus., quand
elle précédé le foleil. Voye^ V é n u s .
Les Latins l’appellent Lucifer ; le peuple, en Franc
e , la nomme Vétoile du berger ; les Grecs., Phofphorus
, qui eff compofé de <pûg, lumière, 8c de <pipu, je
- porte. Chamhers.
PHOTINIENS, f. f. pl. ( Hifi. eccléf. ) feûe d’anciens
hérétiques qui parurent dans le quatrième fie-
cle, 8c qui moient la divinité de Jefus-Chriff. Ils furent
ainfi nommés de Photin leur chef, évêque de
Sirmich, difciple de Marcel d’Ancyre, 8c célébré par
fon favoir 8c par fon éloquenee. L’abus qu’il fit de
ces talens, le précipita dans l’erreur. Non content de
renouveller celles d’Ebian, de Cerinthe, de Sabel-
lius , 6c de Paul de Samofate, il foutenoit que non-
feulement Jefus-Chriff n’étoit qu’un pur homme,
mais encore qu’il n’avoit commencé à être le Chrift
que quand le Saint-Efprit defcendit fur lui dans le
Jourdain; 6c qu’il eft appelle Fils unique par la feule
raifon que la fàinte Vierge n’en eut point d’autre. Il
fut d’abord condamné par les cvêques d’Orient dans
un concile tenu à Antioche en 345, 6c par ceux
d’Occident au concile de Milan, en 346 ou 347 ; 6c
enfin dépofé dans un concile tenu à Sirmich en 3 5 k
L ’héréfie des Photinitns a été renouvellée dans ces
derniers tems par Socin. Voye^ S o c i n i a n i s m e .
PHOTOSCIATÉRIQUE, adj. terme dont quelques
auteurs fe fervent pour défigner la Gnomoni-
que. Voye^ G n o m o n i q u e . Ce nom vient de ce qite
laGnomonique apprend à déterminer les heures non-
feulement par l’ombre d’un gnomon , ce qui l’a fait
nommer fciatérique, mais quelquefois aufli par la lumière
du- foleil, comme dans les cadrans qui marquent
l’heure par un point lumineux, &c. à-travers
lequel pafîent les rayons du foleil. Ce mot vient de
r id a , ombre, 6C d eçuç, lumière. J'qy^GNOMONlQUE;
C a d r a n , G n o m o n , &c. Au-refte le mot de photo*
fciatérique ne s’emploie plus aujourd’hui. Chàmbe rsi
c ° ) m : . ;
PHOXOS , ( Léxic. médec.') çoçoç eft celui qui a le
fommet de la tête extrêmement pointu, 6c par con-
féquent difforme. Homere nous dépeintThercite avec
une pareille tête. Ce mot <po^éç fe rencontre deux
fois dans le fixieme livre des épidémiques d’Hippo-
Crate. ,
PHRÆNIAN, ( Botan, ancf) nom donné par les
anciens botaniftes grecs 6c romains à une forte d’anémone
qu’ils employoient dans les bouquets , les
guirlandes 6c autres femblables ornemens. (D . J. f
■ PHRASE, f. f. c’eft un mot grec francifé, <pp«Viç ,
locutio ; de tppâ^u, loquor ; unephrafe eft une maniéré
de parler quelconque, 6c c’eft par un abus que l’on
doit profcrire que les rudimentaires ont confondu
ce mot avec propojition ; en voici la preuve : legi
tuas Hueras, litteras tuas legi, tuas legi lit ter as ; c’eft:
toujours la même propofition , parce que c’eft toujours
l’expreflion de l’exiftence intelleftuelle du me-»
me fujet fous le même attribut: cependant il y a trois
phrafes differentes , parce que cette même propofition
eft énoncée en trois maniérés differentes.
Aufli les qualités bonnes ou mauvaifes de la phrafe
font-elles bien differentes de celles de la propofition.
Une phrafe eft bonne ou mauvaife, félon que les
mots dont elle réfulte font affemblés , terminés 6c
conftruits d’après ou contre les réglés établies par
l’ufage de la langue : une propofition au contraire eft
bonne ou mauvaife , félon qu’elle eft conforme ou
non aux principes immuables de la morale. Une
phrafe eft correae ou incorreûe, claire ou obfcure ;
élégante ou commune, fimple ou figurée , &c. une
propofition eft vraie ou faune , honnête ou deshonnête
, jufte ou injufte , pieufe ou fcandaleufe, &c. fi
on l’envifage par rapport à la matière ; 6c fi on l’envr-
fage dans le difeours, elle eft dirette ou indireéte ;
* principale
P H R
principale ou incidente, &c. Voye^ PROPOSITION.
1 Une phrafe eft donc tout affemblage de mots réunis
pour l’expreflion d’une idée quelconque : 6c comme
la même idée peut être exprimée par différens
aflemblawès de mots ,• elle peut être rendue par des
phrafes toutes différentes. Contra Italiam eft une
phrafe fimple, Italiam contra eft une phrafe figurée.
Aio te Æacida , Romanos vincere pojfe eft une phrafe
louche ambiguë , amphibologique, obfcure ; te Romani
vincere poffant eft une phrafe claire 6c précife ;
chanter tris-bien eft une phrafe corre&e ; chanter des
mieux eft une phrafe incorre£le. « Cette façon de par-
» 1e r , dit Th. Corneille fur la Rem. izS. deVaugelas,
» n’eft point reçue parmi ceux qui ont quelque foin
» d’écrire correélement.
» Il eft indubitable , dit M. de Vaugelas , Rem.
» Prtf- §• IX . p-. 64. que chaque langue a fesphrafes,
» 6c que l’effence, la richeffe 6c la beauté de toutes
» les langues 6c de l’élocution confiftent principale-
» ment à fe fervir de ces phrafes-là. Ce n’ell pas qu’on
» n’en puifle faire quelquefois, . . . au lieu qu’il n’eft
« jamais permis de faire des mots ; mais il y faut bien
« des précautions , entre lefquelles celle-ci eft la
» principale , qué ce ne foit pas quand l’autre phrafe
» qui eft en ufage approche fort de celle que vous in-
» ventez. Par exemple, on dit d’ordinaire lever les
» yeux au ciel, . . . c’eft parler françois de parler ainfi :
» néanmoins,comme quelques écrivains ( modernes)
» croient qu’il eft toujours vrai que ce qui eft bien dit
» d’une façon n’eft pas mauvais de l’autre, ils trouvent
» bon de dire aufîi élever les yeux vers le ciel, 6cpenfent
» enrichir notre langue d’une nouvelle phrafe. Mais
» au lieu de l’enrichir, ils la corrompent ; car fon
» génie veut que l’on dife leveç, 6c non pas éleve^ les
» yeux ; au ciel, 6C non pas vers le ciel. Ils s’écriant
» encore , que fi nous en fommes crus, Dieu ne fera
» plus fuppliè, mais feulement prié. Je foutiens avec
»tous ceux qui favent notre langue , quc fupplier
» Dieu n’eft point parler françois, 6c qu’il faut dire
» abfolument prier Dieu, fans s’amufer à raifonner
» contre l’ufage qui le veut ainfi. Qiiitter Venvie pour
» perdre l'envie ne vaut rien non plus. . . . Mais pour
» fortifier encore cette vérité qu’il n’eft pas permis
» de faire ainfi des phrafes, je n’en alléguerai qu’une,
» qui eft que l’on -dit abonder en fon fens , 6c non.pas
» abonder en fon fentiment, quoique fens 6c fentiment
» ne foient ici qu’une même choie ; 6c ainfi d’une in-
» finité d’autres, ou plutôt de toute la langue dont
» on fapperoit les fondemens, fi cette façon d el’en-
» richir etoit recevable. Qu’on ne m’allegue pas, dit
» ailleurs Vaugelas, Rem. 126. qu’aux langues vivan-
» tes , non plus qu’aux mortes, il n’eft pas permis
» d’inventer de nouvelles façons de parler , 6c qu’il
» faut fuivre celles que l’ufage a établies ; car cela
» ne s’entend que des mots . . . . Mais il n’en eft pas
» ainfi d’une phrafe entière qui étant toute compofée
» de mots connus 6c entendus, peut être toute nou-
» velle 6c néanmoins fort intelligible ; de forte qu’un
» excellent 6c judicieux écrivain peut inventer de
» nouvelles façons de parler qui feront reçues d’a-
» bord, pourvu qu’il y apporte toutes les circonftan-
» ces requifes, c’eft-à-dire un grand jugement à com-
» pofer la phrafe claire 6c élégante, la douceur que
» demande l’oreille, 6C qu’on en ufe fobrement 6c
» avec diferétion ».
Qu’il me foit permis de faire quelques obferva-
tions fur ce que dit ici Vaugelas. <* Un excellent 8c
» judicieux écrivain peut inventer, dit-il, de nouvel-
» les façons de parler qui feront reçues d’abord ,pour-
>\vu qu’il y apporte toutes, les circonfances requifes ».
Il me femble qu 'apporter lès circonfances reqaifesn,efl
point une phrafe françoife ; on apporte le.s attentions
requifes, on prend les précautions requifes,
mais on eft dans les cirçonftan.ces requifes ou ondes
Tome X I I ,
P H R 3^9
attend ; d’ajlleurs un grand jugement, & la doùceür que
demande l'oreille, ne peuvent pas être regardés côm-
me des circonftances, 6c moins encore comme cir-
conftances d’un même objet. Vaugelas ajoute , <S*
qu'on en ufe fobrement ; c’eft une phraj'c louche : on ne
fait s’il faut ufer fobrement d’un grand jugement, oit
de la douceur que demande l’oreille , ou d’une-
phrafe nouvellement inventée, ou du pouvoir d’en
inventer de nouvelles. Il pafoît par le lens que c’eft
fur ce dernier article que tombent les mots ufer fo brement
; maispar-là même la phrafe, outre le vice'
que je viens d’y reprendre , eft encore eftropiée.
« On dit qu’une phraj'e eft eftropiée quand il y man-
» que quelque chofe , 6c qu’elle n’a pas toute l’étén-
» due qu’elle devroit avoir >1. Bouh. Âe//z. nouv. t. II.
p, 2 C). Or il manque à la phrafe de Vaugelas le nom
auquel il rapporte ces mots qu’on en ufe fobrement, je
veux dire le pouvoir d’inventer de nouvelles phrafes.
On fent bien que s’il y a quelque chofe de permis
à cet égard, c’eft fur-tout dans le fens figuré, par lequel
on peut quelquefois introduire avec fucces dans
le langage un tour extraordinaire, ou une aflociation
de termes dont on n’a pas encore fait ufage jufques-
là. Mais, je l’ai dit, article NÉOLOGISMÉ, il faut être
fondé fur un befoin réel ou très-apparent, f i forti ne^
cejfe efl ; 8c dans ce cas-là même il faut-être très-cir-
confpeét 6c agir avec retenue , dabitur licentia Jump->
ta pudenter.
« Parler par phrafes , dit le P. Bouhours, Retnl
» nouv■. tome II. p. 4x6. c’eft quitter une expreflion
» courte 6c fimple qui fe préfente d’elle-même, pour
» en prendre une plus étendue 6c moins naturelle, qui
» a j e ne fais quoi de faftueux.:.. Un écrivain qui aime
I » ce qu’on appelle phrafe......ne dira pas.....72^02« fa -
» vie[ vous contenir dans de jujles bornes , mais il dira,'
» f i vous avie{ foin de retenir les mouvemens de votre ef-
» prit dans les bornes d’une jufie modération..... Rien
» n’eft plus oppofé à la pureté- de notre ftyle ». Et
c’eft ordinairement le ftyle que les jeunes gens rem-
. portent du college , o ii, au lieu de preferire des réglés
utiles à la fécondité naturelle de leur âge, on leur
donne quelquefois des fecours 6c des motifs pour
l’augmenter ; ce qui ne manque pas de produire les
effets les plus contraires au but que l’on devoit fe
propofer, 6c que l’on le propofoit peut-être.
On emploie quelquefois le mot de phrafe dans un
fens plus général qu’on n’a vu jufqu’ic i, pour défi-'
gner le génie particulier d’une langue dans l’expref-
fion des penfées. C’eft: dans ce fens que l’on dit que
la phrafe hébraïque a de l’énergie .; la phrafe greque
de l’harmonie ; la phrafe latine , de la maj efte ; là
phrafe françoife, de la clarté 8c de la naïvete, &c. 8c
c’eft dans la vue d’accoutumer les jeunes gens au tour
6c au génie de la phrafe latine ainfi entendue, que
l’on a fait des recueils de phrafes détachées, extraites
des auteurs latins, 8c rapportées à certains titres généraux
du fyftème grammatical qu’avoient adopté
les compilateurs : tels font l’ouvrage du cardinal
Adrien de modis latinh loquendi ; un autre plus moderne
répandu dans les colleges de certaines provinces
, les délices de la langue latine ,• celui de Mercier ,
intitulé le manuel des Grammairiens, 8cc. ce font au*-
tant de moyens méchaniques làborieufement.préparés
pour ne faire fouvent que des imitateurs, ferviles
6c mal-adroits. Il n’y a qu’une lefture aflidue, fuivie
6c raifonnée des bons auteurs qui puiffe mettre fur
les voies d’une bonne imitation. ( B. E. R. M.')
Phr a se , f. f. en Mufique, eft une fuite de chant
ou d’harmonie , qui forme un fens plus ou moins
achevé , 6c qui fe termine fur .un repos par une cadence
plus ou moins parfaite.
Il y a. deux efpeces d c phrafes. En mélodie , la
phrafe eft conftituée par le chant , c’eft-à-dire par
une fuite dç fons tellement difpofés, foit par. rapport
' X x x