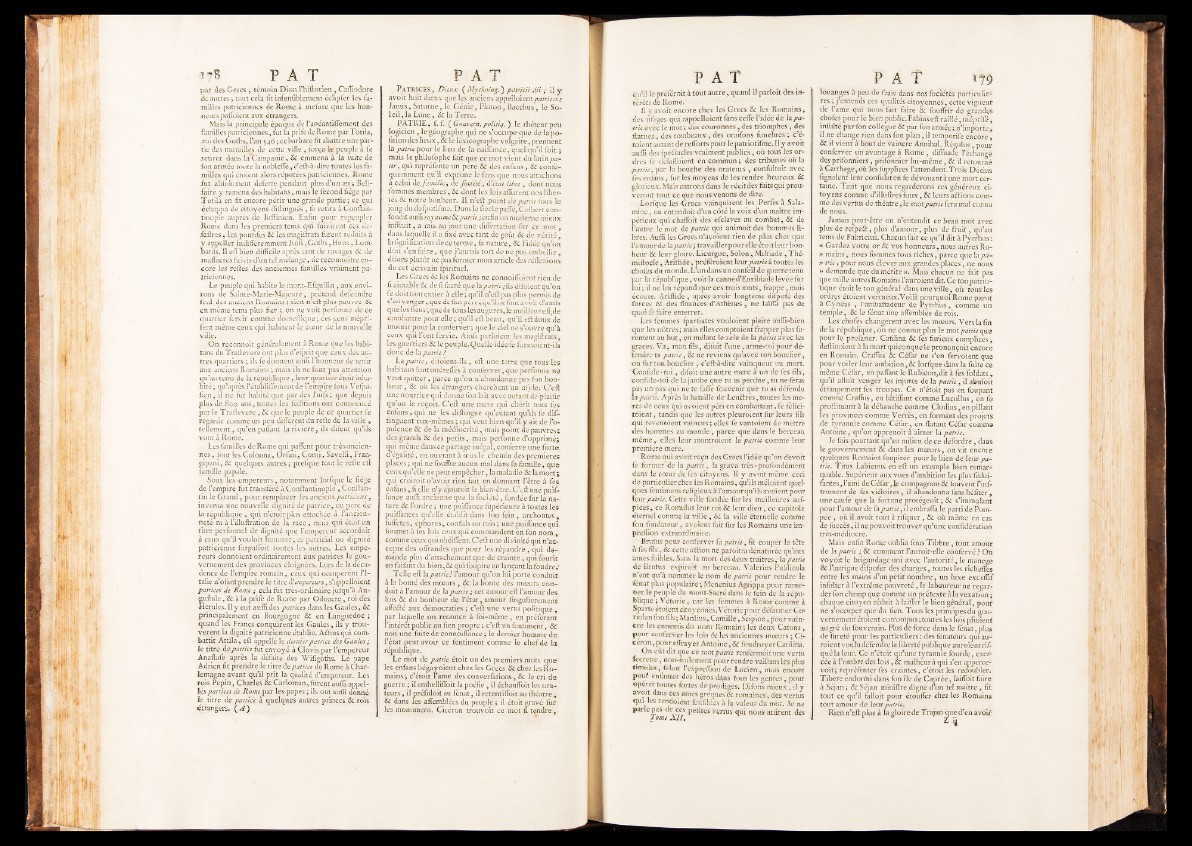
Wtmm
aar des Grecs , témoin D ion l’hiftorien, Caffibdore
6c autres ; tout cela fit infenfiblement éclipfer les familles
patriciennes de Rome à mefure que les honneurs
paffoient aux étrangers.
Mais la principale époque de l’anéantiffement des
familles patriciennes, fut la prifedeRome parTotila,
jo i des Goths, l’an 546 ;cebarbare fit abattre une partie
des murailles-de cette ville ., força k peuple à fe
retirer dans la Campanie-, 6c -emmena à la fuite de
fon armée toute la nobleffe, c’eflsà-dire toutes les familles
qui étoient alors réputées patriciennes. Rome
fut abfolument deferte pendant plus d’un an ; Beli-
faire y ramena des habitans, mais le fécond fiége par
Totila en fit encore périr une grande partie; ce qui
.échappa de citoyens diflingués, fe retira à Conftan-
tinople auprès de Juftinien. Enfin pour repeupler
Rome dans les premiers tems qui fuivirent cfes de-
falires,, les pontifes & les magiiîrats furent réduits à
y appeller indifféremment Juifs,Goths, Huns , Lombards.
Il eilbien difficile après tant de ravages 6c de
maflacres fuivis d’un tel mélange, de reconnoître encore
les relies des -anciennes familles vraiment patriciennes,
•
Le peuple qui habite le mont-Efquilin , aux environs
de Sainte-Marie-Majeure, prétend descendre
feul des anciens Romains ; rien n’eft plus pauvre 6c
en même tems plus fier ; on ne voit perfonne de ce
quartier fervir comme domeftique; ces gens mépri-
l'ent même ceux qui habitent le coeur de la nouvelle
ville.
On reconnoît généralement à Rome que les habitans
duTraltevere ont plus d’efprit que ceux des autres
quartiers ; ils fe donnent auffi l’honneur de tenir
aux anciens Romains ; mais ils ne font pas attention
qu’au tems de la république, leur quartier étoit inhabité
; qu’après l’établifi'ement de l’empire fous Velpa-
fien, il ne fut habité que par des Juifjs ; que depuis
plus de 800 ans, toutes,les féditions ont commencé
par le Traflevere, 6c que le peuple de ce quartier fe
regarde comme un peu différent du refie de la ville ,
tellement,, qu’en pallant la,riviere, ils difent qu’ils
vont à Rome.
Les familles de Rome qui paffent pour très-anciennes
, font les Colonna, Orfini, Conti, Sayelli, Fran-
gipani, 6c quelques autres ; prefque tout le relie efl
famille papale.
' Sous les empereurs, notamment lorfque le fiége
de l’empire fiit transféré à Conllantinople , Conftan-
tin le Grand, pour remplacer les anciens patriciens,
inventa une nouvelle dignité de patrice, ou pere de
Li république , qui n’étoitplus attachée à l’ancienneté
ni à l’illuftration de la race, mais qui étoit un
titre perfonnei de dignité que l’empereur accordoit
à ceux qu’il vouloit honorer ; ce patricial ou dignité
patricienne furpafibit toutes les autres. Les empereurs.
donnoient ordinairement aux patrices le gouvernement
des provinces éloignées, Lors de la décadence
de l’empire romain, ceux qui occupèrent l’Italie
n’ofant prendre le titre d'empereurs, s’appelloient
patrices de Rome ; cela fut très-ordinaire julqu’à Aj.i-
■ guitule, & à la prife de Rome par Odoacre,, roi des
Herules. Il y eut auffi des patrices dans les Gaules, 6c
principalement en Bourgogne 6c en Languedoc ;
quand les Francs conquirent les Gaules, ils y trouvèrent
la dignité patricienne établie. Aélius qui combattit
Attila, efl appellé le dernier patrice des Gaules ;
le titre de patrice fut envoyé à Clovis par l’empereur
Ànaftafe après la défaite des "Wifigoths. Le pape
Adrien fit prendre le titre de patrice de Rome à Charlemagne
avant qu’il prît la qualité d’empereur. Les
rois Pépin, Charles 6c Carloman,furent auffi appelles
patrices de Rome par les papes ; ils ont auffi donné
le titre de patrice à quelques autres princes 6c rois
«rangers. ( 4 )
Pa tr ic e s , Dieux ( Mytholog.) pdtricii dit ; il y
avoit huit dieux que les anciens appelloient patrices :
Janus, Saturne, le Génie, Pluton, Bacchus, le So- 1 eil, la Lune, & la T erre.
PATRIE, f, f. ( Gouvem, politiq. ) le rhéteur peu
logicien , le géographe qui ne s’occupe que de la po-
fition des lieux, 6c le léxicographe vulgaire, prennent
la patrie pour le lieu de la naiffance, quel qu’il foit ;
mais le philofophe fait que ce mot vient du latinpa-
ttr, qui repréfente un pere & des enfans, & confé-
quemment qu’il exprime le fens que nous attachons
à celui de famille, de fociété, d’état libre , dont nous
fommes membres, 6c dont les lois affurent nos libertés
& notre bonheur. Il n’eft point de patrie fous le
joug du defpotifme. Dans le fiecle paffé, Colbert confondit
auffi royaume Scpatrie ; enfin unmoderne mieux
' inflruit , a mis au jour une differtation fur ce mot,
dans laquelle il a fixé avec tant de goût 6c de vérité
la fignification de ce terme, fa nature, & l’idée qu’on
doit s’en faire, que j ’aurois tort de ne pas embellir ,
difons plutôt ne pas former mon article des réflexions
de cet écrivain fpirituel.
Les Grecs 6c les Romains ne connoiffoient rien de
fi aimable & de fi facre que la patrie; ils difoient qu’on
le doit tout entier à elle ; qu’il n’eft pas plus permis de
s’en venger, que de fon pere ; qu’ilne faut avoir d’amis
queles liens ; que de tous les augures, le meilleur ellde
combattre pour elle; qu’il eft beau, qu’il eftdouxde
mourir pour la conferver; que le ciel ne s’ouvre qu’à
ceux qui l’ont fervie. Ainfi parloient les magiiîrats,
les guerriers 6c le peuple. Quelle idée fe formoient-ils
donc de la patrie ?
La patrie, difoient-ils , efl une terre que tous les
habitans font intérefles à conferver, que perfonne ne
veut quitter, parce qu’on n’abandonne pas fon bonheur
, 6c oîi les étrangers cherchent un afyle. C’efl
une nourrice qui donne fon lait avec autant de plaifir
qu’on le reçoit. C ’ell une mere qui chérit tous fes
enfans , qui ne les diltingue qu’autant qu’ils fe distinguent
eux-mêmes ; qui veut bien qu’il y ait de l’opulence
6c de la médiocrité, mais point de pauvres ;
des grands 6c des petits, mais perfonne d’opprimé;
qui même dans.ee partage inégal, conferve une forte
d’égalité, en ouvrant à tous le chemin des premières
places; qui ne fouffre aucun mal dans fa famille, que
ceux qu’elle ne peut empêcher, la maladie & la mort;
qui croiroit n’avoir rien fait en donnant l’être à fes,
enfans, fi elle n’y ajoutoit le bien-être. C’ell une puif-
fance auffi ancienne que la fociété, fondée fur la nature
& l’ordre ; une puiffance fupérieure à toutes les
puiffances qu’elle établit dans fon fein, archontes ,
i.iiffetes, éphores, confuls ou rois ; une puiffance qui
foumet à fes lois ceux qui commandent en fon nom ,
comme ceux qui obéiffent. C ’ell une divinité qui n’accepte
des offrandes que pour les répandre , qui demande
plus d’attachement que de crainte, qui fourit
en faifant du bien, & quifoupire en lançant la foudre.’
Telle ell la patrie! l’amour qu’on lui porte conduit
à la bonté des moeurs , 6c la bonté des moeurs conduit
à l’amour de la patrie ; cet amour ell l’amour des
lois & du bonheur de l’état, amour fingulierement
affeélé aux démocraties ; c’eft une vertu politique ,
par laquelle on renonce à foi-même , en préférant
l’intérêt public au lien propre ; c’ell un fentiment, 6c
non une fuite de connoiffance ; le dernier homme de
l’état peut avoir ce fentiment comme le chef de la
république.
Le mot de patrie étoit un des premiers mots que
les enfans bégayoient chez les Grecs & chez les Romains
; c’étoit l’ame des converfations, 6c le cri de
guerre ; il embelliffoit la poéfie, il échauffoit les orateurs
, il préfidoit au fénat, il retentiffoit au théâtre,
& dans les affemblées du peuple ; il étoit gravé fur
les, monumens, Ciçéron trouvoit ce inot fi tendre,
qu’il le préféroit à tout autre, quand il parïoit dès îri-
.térêts de Rome.
Il y avoit encore chez les Grecs & les Romairïs,
des fi lages qui rappelloierft fans ceffe l’idée de la patrie
avec le m ot; des couronnes, des triomphes, dés
fiâmes , des tombeaux, dès oraifons funèbres ; c’é-
toient autant de refforfs pour lé patriotifme. Il y avoit
auffi des fpeflacles vraiment publics , où tous les ordres
fe délafl’oient en commun ; dés tribunes où la
patrie, par la bouche dés orateurs , confultoit avec
fes enfans, fur lés moyens dé les rendre heureux &c
glorieux. Mais entrons dans le récit des faits qui prouveront
tout ce que nous venons de dire.
Lorfque lès Grecs Vainquirent les Perfes à Sala-
mine, on entendoit d’un côté la voix d’un maître impérieux
qui chaffoit des efclavès ait combat , & de
l’autre le mot de patrie qui ànimoit déS hommes libres.
Auffi lès Grecs n’àvoient rien de plus cher que
l’amour de la patrie} travailler pour elle étoit leur bonheur
6c leur gloire. Licurgue, Solon , M iltiade, Thé-
■ mifto cle j Àrifiide, préféroient leur patrie à toutes lès
•chofes du monde. L’un dans un confeil de guerre tenu
par la république, voit la canned’Euribiaae levée fur
lui ; il ne lui répond que ces trois mots, frappe, mais
écoute. Arifiide , après avoir longtéms difpofé dès
forces 6c des finances d’Athènes , ne laiffa pas de
'quoi fe faire enterrer-.
Les femmes fpartiates vouloient plaire auffi-bien
que les nôtres; mais elles comptoient frapper plus fu-
rement au but, en mêlant le zélé de la patrie avec les
grâces. V a , mon fils, difoit l’une, arme-toi pour défendre
ta patrie, & ne reviens qu’avec ton bouclier ,
•où fur ton bouclier, c’efi-à-dire vainqueur ou mort.
'Confolé-toi, difoit une autre mere à ufi de fes fils,
sconfole-toi de la jambe que tu as perdue, tu ne feras
pas un pas qui né te faffe fôuvenir que tu as défendu
la patrie. Après la bataille dé Leuèlres, toutes les mères
de ceux qui avôient péri en combattant, fe félici-
toient, tandis que les autres plèuroierit fur leurs fils
qui revènoiènt vaincus ; elles fe vantaient de rnéttre
dés hommes ait monde, parce que dans le berceau
m êm e e lle s leur montroient la patrie comme leur
première mere.
Rome qui avoit reçu des Grecs l’idée qu’on devoit
fe former dé la patrie, la grava très-profondément
dans le Coeur de fès citoyens. Il y avoit même ceci
de particulier chez les Romains, qu’ils méloient quelques
fentimens-fel-igiêux à l’amotir qu’ils avoieirt pour
leur patrie. Cette trille fondée fur lés meilleiirés auf-
-piées, ce RomultiS leur roi & leur dieu, ce Capitole
■ éternel comme la- v ille , 6c la ville éternelle comme
fon fondateur j aVoiènt fait fur les Romains une im-
preffion extraordinaire.
Brufus pour conferver fà patrie, fit coupèr la tête
à fe’s fils, & cette’ a£lion ne.paroîtradénaturée qu’aux
&més foibles. Sans la mort des deux traitres,- la patrie
de Brufüs expiroit au berceau. Valeritts Publicôla
ïi’eiït qu’à nommer le nom dé patrie pour rendre le
fénat plus populaire ; Meilenius Agrippa pour ramener
le peuple du mônt-SaCré dans le fein de la répXi-
blique ; Véturie ,■ car les femmes à Rônie coiranè à
Sparte étoient eifoyènnes,Véturie pour défarmer Ço1
riolan fon fils; Manlius, Camille $ Seipion ; pour vaincre
les ennemis dïi nom Romain ; les deux Gâtons ,
pour conféïvèr lés lois Séles anciennes moeurs; Cicéron,,
pour effrayer Antôine', 6c foudroyer Catilirfa.
On eût dit que ce mot patrie renfermoit itrte vertu
ieefette, nôn-feulem'ent p'pùr rendre vaillans les plus
timides, lelon l’éxpreffion de Lucien,. mais encore
pouf enfanter dés héros dàns tous les; genres, pour
operer toutes fortes de prodiges. D'ifo ns mieux, il ÿ
avoit dans tes âmes grequesq£ romaines,- des vertus
qui les reridôiént fénfibles à h valeur cfu mot. Je' ne
parle pas de_ces petites vertus qui nous attirent des
Tome X I I ,
louanges à peu de frais dans nos fociétés particulières
; j’entends ces qualités citoyennes, cette vigueur
de l’amè qui nous fait faire 6c fouffrir de grandes
■ chofes pour le bieh public. Fabius eft raillé, méprifé ,
infulté par fon collègue 6c par fon armée ; n’importe,
il ne change rien dans fon plan, il temporife encore
& il vient à bout de vaincre Annibal. Régulus pour
conferver un avantage à Rome, diffuade l’échangé
des prifonftters, prifonnier lui-même, & il retourné
à Carthage, où lés fitpplices l’attendent. Trois Décius
lignaient létfr confulat èti fe dévouant à une mort certaine.
Tarit que nous regarderons ces généreux citoyens
comme d’illufîres foux, & leurs aélïôns corn-"
me des vertus de théâtre, le motpatrie fera mal connu
de nous.
Jamais peut-être' on n’eritendit ce beau mot aVeè
plus de refpeft, plus d’amour, plus de fruit, qu’au
tems de Fabricius. Chacun fait ce qu’il dit à Pyrrhus :
« Gardez votre or & vos honneurs, noiis autres Ro-
» mains, nous fommes tous riches, parce que la pa-
» t r i e pour rioiis élever aux grandes places, ne nous
>> demande que du mérite >>. Mais chacun ne fait pas
que mille àutr es Romains l’aüroient dit. C e ton patriotique
étoit le ton général dans une ville , où tous les
ordres étoient vertueüx.Voilà pourquoi Rome parut
à Cynéas , l’ambàffàdeür de Pyrrhus, comme un
temple, & le fénat une affemblée de rois.
Les chofés changèrent avec les moeurs. Vers la fin
de la république, on ne connut plus le mot patrie que
pour le profaner. Catilina & fes furieux complices,
deftinoient à la mort quiconque le prononçoit encore
en Romain. Craffus 6c Céfar rie s’en fervoierit que
pour voiler leur ambition, 6c lorfque dans la fuite ce
même Céfar, en pàffant le Rubicôn,dit à fes foldats ,
qu’il alloit venger les injures de la patrie, il abufoit
étrangement fes troupes. Ce n’étoit pas en foupant
comme Craffus, en bâtiffant comme Lucullus, en fe
profiituant à la débauche comme Clodius, en pillant
les- provinces comme Verrès , en formant des projets
,de tyrannie comme Céfar-, en datant Céfar commà
Antoine, qu’on apprenoit à aimer la patrie.
Je fais pourtant qu’au milieu de ce défordre, dans
le gouvernement 6c dans les moeurs, on vit encore
quelques Romains foirpir.êr pour le bien de leur patrie.
Titus Labienus en éft un exemple bien reniait
quable. Supérieur âux vues d’ambition les plus fédui-
fantes, l’ami de Céfar, le compagnon & fou vent l’inf-
trument de fes viâroires, il abandonna fans héfiter ,
une caufe que la fortune protégeoit ; & s’immolant
pour l’amour de fa patrie, il embraffa le parti de Pompée
, où il avoit tout à rifquer, 6c où' mèmè en cas
de fuccès, il rie pouvôit trouver qu’une confidératiori
très-médiocre.
Mais enfin Rome oublia fous Tibè re, tôut airioùf
de la patrie ; 6c comment l’ariroit-elle conférvé ? Ont
voyoitle brigandage fini avec l’aiitorits , le manegé
& l’intrigue difpofer des charges, toutes les richefks
entre les mains d’un petit' nombre, un luxe exceffif
infulter à l’extrême pauvreté, le laboureur ne regarder
fon champ que commé fin prétexté à la vexation ;
chaque citoyen réduit à laiffer le bien général, pour
ne s’occuper que du fie'ft. Tous les principes du gouvernement
étoient corrôfiïpuS ; tout es les Ibis pîioient
au gré du foüverain. Plus dé force dans le fénat, plus
de fureté pour les particuliers : des fénateiirs qui au-
roiènt voulfi défendre là liberté pübliqûe afiroierit rif-
qué la leur. Ce n’étoit qit’urie tyrarinie fourde, exercée
à l’ombre dès lois, 6c malheur à qui s’è.n apperce-
voit; tepréfenter fés crairites, c’étoit les redoubler;
Tibere endorfni daris fori île de Caprée, laiffoit faire
à Séjan ; & Séjan minifire digne d’un tel maître, fit
tout ce qu’il falioit pour étouffer chez lés Romains
tout amour de leur pàiriè.
Rien n’eft plus à là gloire de Trajan qfié d’en avoir
Z ÿ