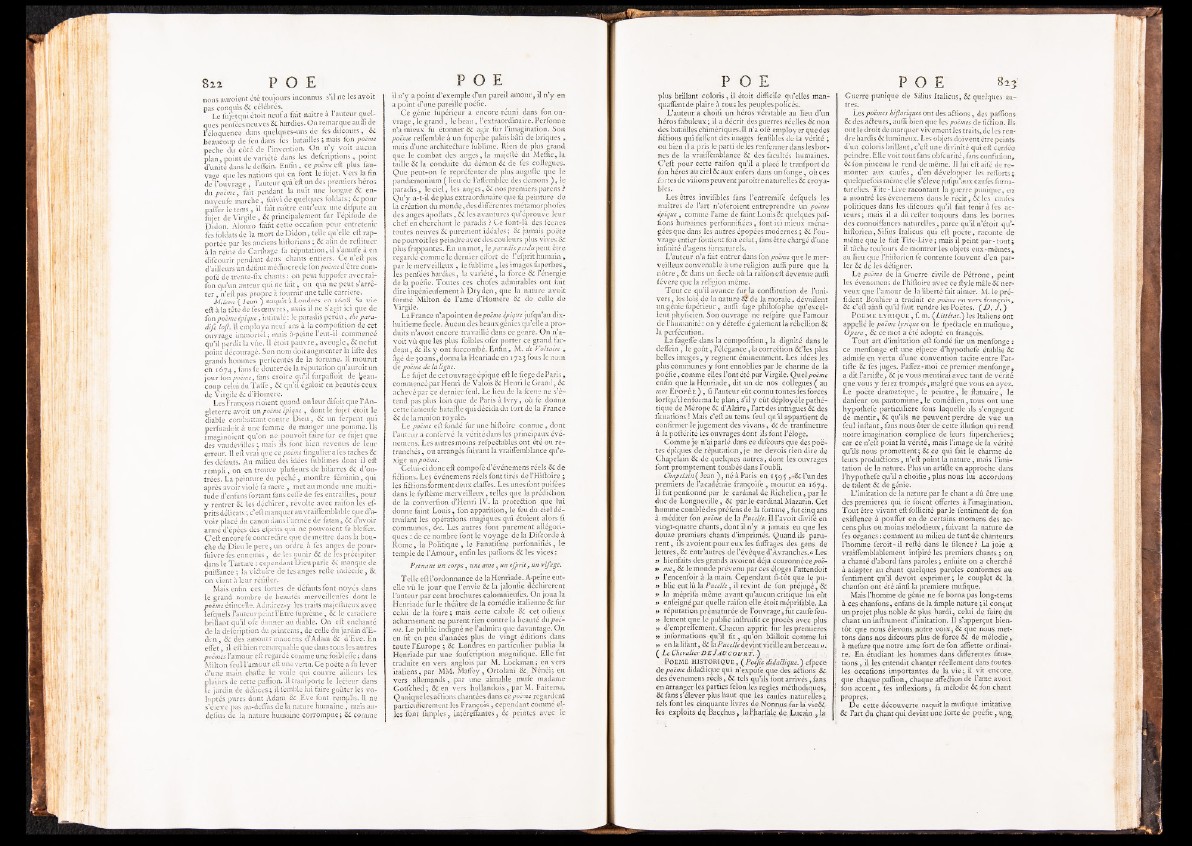
nous auraient été toujours inconnus s’il ne les avoit
pas conquis 6c célébrés.
Le fujet qui étoit neuf a fait naître a 1 auteur quelques
penfées neuves 6c hardies. On remarque auffi de
l’éloquence dans quelques-uns de fes difcours, 6c
beaucoup de feu dans les batailles ; mais fon poème
peche du côté de l’invention. On n’y voit aucun
plan, point de variété dans les deferiptions , point
d’unité dans le deffein. Enfin, ce poème eû plus fau-
vage que les nations qui en font le fujet. Vers la fin
de l’ouvrage , l’auteur qui eft un des premiers héros
du poème, fait pendant la nuit une longue & en-
nuyeufe marche , fuivi de quelques foldats; 6c pour
paffer letems , il fait naître entr’eux une ffifpute au
fujet de Virgile, & principalement fur l’épifode de
Didon. Alonzo faifit cette occafion pour entretenir
fes foldats de la mort de Didon, telle qu’elle eft rapportée
par les anciens hiftoriens ; & afin de reftituer
à la reine de Carthage fa réputation, il s’amufe à en
difeourir pendant deux chants entiers. Ce n’eft pas
d’ailleurs un défaut médiocre de fon poème d’être com-
pofé de trente-fix chants : on peut fuppofer avec rai-
fon qu’un auteur qui ne fait, ou qui ne peut s’arrêter
, n’eft pas propre à fournir une telle carrière.
Milton ( Jean ) naquit à Londres en 160S. Sa vie
eft à la tête de fes oeuvres, mais il ne s’agit ici que de
fon poème épique, intitulé : le paradis perdu, the para-
dife loft. Il employa neuf ans à la compofition de cet
ouvrage immortel ; mais à-peine l’eut-il commencé
qu’il perdit la vue. Il étoit pauvre, aveugle, 6c ne fut
point découragé. Son nom doit augmenter la lifte des
grands hommes perfécutés de la fortune. Il mourut
en 1674 , fans fe douter de la réputation qu’auroit un
jour fon poème, fans croire qu’il furpaffoit de^ beaucoup
celui duTaffe, 6c qu’il égaloit en beautés ceux
de Virgile 6c d’Homere.
Les François rioient quand on leur difoit que l’Angleterre
avoit un poème épique , dont le fujet etoit le
diable combattant contre D ieu , 6c un ferpent qui'
perfuadoit à une femme de manger une pomme. Ils
imaginoient qu’on ne pouvoit faire fur ce fujet que
des vaudevilles ; mais ils font bien revenus de leur
erreur. Il eft vrai que ce poème fingulier a fes taches &
fes défauts. Au milieu des idées fublimes dont il eft
rempli, on en trouve plufieurs de bifarres & d’outrées.
La peinture ;du péché , monftre féminin, qui
après avoir violé fa mere , met au monde une multitude
d’enfans fortant fans ceffe de fes entrailles, pour
y rentrer 6c les déchirer, révolte avec raifon les ef-
prits délicats ; c’eft manquer au vraiffemblable que d’avoir
placé du canon dans l’armée de fatan, 6c d’avoir
armé d’épées des efprits qui ne pouvoient fe bleffer.
C ’eft encore fe contredire que de mettre dans la bouche
de Dieu le pere, un ordre à fes anges de pour-
fuivre fes ennemis , de les punir 6c de les précipiter
dans le Tartare : cependant Dieu parle 6c manque de
puiflance ; la viftoire de fes anges refte indécife, &
on vient à leur réfifter.
Mais enfin ces fortes de défauts font noyés dans
le grand nombre de beautés merveilleufes dont le
poème étincelle. Admirez-y les traits majeftueuxavec
lefquels l’auteur peint l’Etre fuprème, 6c le cara&ere
brillant qu’il ofe donner au diable. On eft enchanté
de la defeription du printems, de celle du jardin d’E-
den, 6c des amours innocens d’Adam 6c d’Eve. En
effet, il eft bien remarquable que dans tous les autres
poèmes l’amour eft regardé comme une foibleffe ; dans
Milton feul l’amour eft une vertu. Ce poëte a fu lever
d’une main chafte. le voile qui couvre ailleurs les
plaiiirs de cette paffion. Iltranfporte le ledteur dans
le jardin de délices ; il femble lui faire goûter les voluptés
pures dont Adam 6c Eve font remplis. Il ne
s’élève pas au-deffus delà nature humaine, mais au-
deffus de la nature humaine corrompue ; 6c comme
il n’y a point d’exemple d’un pareil amour, il n’y en
a point d’une pareille poéfie.
Ce génie fupérieur a encore réuni dans fon ouvrage
, le grand , le beau, l’extraordinaire. Perfonne
n’a mieux fu étonner 6c agir fur l’imagination. Son
poème reffemble à un fuperbe palais bâti de briques ,
mais d’une architecture fublime. Rien de plus grand
que le combat des anges, la majefté du Meflîe,la
taille 6c la conduite du démon 6c de fes collègues.
Que peut-on fe repréfenter de plus augufte que le
pandæmonium ( lieu de l’affemblée des démons ) , le
paradis , le ciel, les anges, & nos premiers parens ?
Qu’y a-t-il déplus extraordinaire que fa peinture de
la création du monde, des différentes métamorphofes
des anges apoftats, 6c les avantures qu’éprouve leur
chef en cherchant le paradis ? Ce font-là des feenes
toutes neuves 6c purement idéales ; 6c jamais poëte
ne pouvoit les peindre avec des couleurs plus vives 6c
plus frappantes. En un mot, le paradis perdu peut être
regardé comme le dernier effort de l’efprit humain ,
par le merveilleux , le fublime , les images fuperbes,
les penfées hardies, la variété, la force & l’énergie
de la poéfie. Toutes ces chofes admirables ont fait
dire ingénieufement à Dryden, que la nature avoit
formé Milton de l’ame d’Homere 6c de celle de
Virgile.
La France n’a point eu de poème épique jufqu’au dix-
huitiemefiecle. Aucun des beaux génies qu’elle a produits
n’avoit encore travaillé dans ce genre. On n’a-
voit vu que les plus foibles ofer porter ce grand fardeau
, 6c ils y ont fuccombé. Enfin, M. de Voltaire ,
âgé de 3 o ans, donna la Henriade en 1713 fous le nom
de poème de la ligue.
Le fujet de cet ouvrage épique eft le fiege deParis,
commencé par Henri de Valois 6c Henri le Grand, 6c
achevé par ce dernier feul. Le lieu de la feene ne s’étend
pas plus loin que de Paris à Ivry, oîi fe donna
cette fameufe bataille qui décida du fort de la France
6c de lamaifon royale.
Le poème eft fondé fur une hiftoire connue , dont
l’auteur a confervé la vérité dans les principaux évé-
nemens. Les autres moins refpe&ables ont été ou retranchés
, ou arrangés fuivant la vraiffemblance qu’exige
un poème.
Celui-ci donc eft compofé d’événemens réels 6c de
fixions. Les événemens réels font tirés de l’Hiftoire ;
les fixions forment deux claffes. Les unes font puifées
dans le fyftème merveilleux, telles que la prédiélion
de la converfion d’Henri IV. la prote&ion que lui
donne faint Louis, fon apparition, le feu du ciel dé-
truifant les opérations magiques qui étoient alors fi
communes, &c. Les autres font purement allégoriques
: de ce nombre font le voyage de la Difcorde à
Rome , la Politique , le Fanatifme perfonnifiés, le
temple de l’Amour, enfin les pallions 6c les vices :
Prenant un corps, une ame, un efprit, un v i f âge.
Telle eft l’ordonnance de la Henriade. A-peine eut-
elle vû le jour que l’envie & la jaloufie dechirerent
l’auteur par cent brochures calomnieufes. On joua là
Henriade furie théâtre de la comédie italienne & fur
celui de* la foire ; mais cette cabale 6c cet odieux
acharnement ne purent rien contre la beauté du poème.
Le public indigné ne l’admira que davantage. On
en fit en peu d’années plus de vingt éditions dans
toute l’Europe ; 6c Londres en particulier publia la
Henriade par une foufeription magnifique. Elle fut
traduite en vers anglois par M. Lockman; en vers
italiens, par MM. Maffey, Ortolani 6c. Nénéi; en
vers allemands, par une aimable mufe madame
Gotfched; & e n vers hollandois, par M. Faitema,
Quoique les aérions chantées dans ce poème regardent
particulièrement les François, cependant comme elles
font fnnples, intéreffantes, 6c peintes avec lé
plus brillant coloris, 11 étoit difficile qu’elles man-
quaffentde plaire à tous les peuples policés.
L’auteur a choili un héros véritable au lieu d’un
héros fabuleux ; il a décrit des guerres réelles 6c non
des batailles chimériques. Il n’a ofé employer que des
fi fiions qui fuffent des images fenfibles de la vérité ;
ou bien il a pris le parti de les renfermer dans les bornes
de la vraiffemblance 6c des facultés humaines.
C’eft pour cette raifon qu’il a placé le tranfport de
fon héros au ciél 6c aux enfers dans un fonge, oii ces
fortes de vifions peuvent paroître naturelles 6c croyables.
Les êtres invifibles fans l’entremife defquels les
maîtres de l’art n’oferoient entreprendre un poème
épique, comme l’ame de faint Louis 6c quelques paf-
fions humaines perfonnifiées, font ici mieux ménagées
que dans les autres épopées modernes ; 6c l’ouvrage
entier foutient fon éclat, fans être chargé d’une
infinité d’agens fiirnaturels.
L’auteur n’a fait entrer dans fon poème que le merveilleux
convenable à une religion auffi pure que la
nôtre, 6c dans un fiecle oii la raifon eft devenue auffi
févere que la religion même.
Tout ce qu’il avance fur la conftitution de l’univers,
les lois de la nature o t de la morale, dévoilent
lin génie fupérieur, auffi fage philofophe qu’excellent
phyficien. Son ouvrage ne refpire que l’amour
de l’humanité : on y détefte également la rébellion 6c
la perfécution.
La fageffe dans la compofition, la dignité dans le
deffein, le goût, l’élégance, la correction &*les plus
belles images, y régnent éminemment. Les idées les
plus communes y font ennoblies par le charme de la
poéfie, comme elles l’ont été par Virgile. Quel poème
enfin que la Henriade, dit un de nos collègues ( au
mot Épo p é e ) , fi l’auteur eût connu toutes fes forces
lorfqu’il en forma le plan; s’il y eut déployé le pathétique
de Mérope 6c d’Alzire, l’art des intrigues 6c des
fituations ! Mais c’eft au tems feul qu’il appartient de
confirmer le jugement des v ivans, 6c de tranfmettre
à la poftérité les ouvrages dont ils font l’éloge.
. Comme je n’ai parlé dans ce difcours que des poètes
épiques de. réputation, je ne de.vois rien dire de
Chapelain 6c de quelques autres., dont les ouvrages
font promptement tombés dans l’oubli.
Chapelain ( Jean ) , né à Paris en 1595» l’un des
premiers de l ’académie françoife , mourut en 1674.
Il fut penfionné par le cardinal de Richelieu, par le
duc de Longueville, 6c par le cardinal Mazarin. Cet
homme comblé des préfens de la fortune, fut cinq ans
à méditer fon poème de la Pucelle. Il l’avoit diyife en
yingt-quatre chants, dont il n’y a jamais eu que les
douze premiers chants d’imprimés. Quand ils parurent,
ils avoient pour eux les fuffrages des gens de
lettres, & entr’autres de l’évêque d’Avranches..« Les
» bienfaits des grands avoient déjà couronné ce poè-
» me, 6c le monde prévenu par ces éloges l’attendoit
» l’encenfoir à la main. Cependant fi-tôt que le pu-
» blic eut lû la Pucelle, il revint de fon préjugé, 6c
» la méprifa même avant qu’aucun critique lui eût
» enfeignépar quelle raifon, elle étoit méprifable. La
» réputation prématurée de l’ouvrage, fiit caufe, feu-
» lement que le public inftruifit ce procès avec plus,
» d’empreffement. Chacun apprit fur les premières
» informations qu’il f it , qu’on bâilloit comme lui
» en la lifant, 6c la Pucelle devint vieille au berceau
( Le Chevalier DE J a v COURT. ) -
POEME HISTORIQUE, (Poéfie didactique.} efpec'e
de poème didaélique qui n’expofe.qiie des aérions
des évenemens réels, 6c tels qu’ils font arrivés ,tfans
en arranger les parties felon fes reglqs méthodiques^
& fans s’élever plus haut que fes caufes naturelles «
tels font les cinquante livres de Nonnus fur la vie&-
les exploits de Baççhus, laPfiarfale de Lucain , la
Guerre puniquè de Silius Italicus, & quelques autres.
Les poèmes hiftoriques ont des a llions, des partions
6c des afreurs, auffi bien que les poèmes de fiérion. Ils
ont le droit de marquer vivement les traits, de les rendre
hardis 6c lumineux. Les objets doivent être peints
d’un coloris brillant, c’eft une divinité qui eft cenfée
peindre. Elle voit tout fans obfcurité, fans confufion,
& fon pinceau le rend de même. Il lpi eft aifé de remonter
aux caufes, d’en développer les refforts ;
quelquefois même elle s’élève jufqu’aux caufes furna-
turelles. Tite-Live racontant la guerre punique, en
a montré les évenemens dans le récit, 6c les caufes
politiques dans les difcours qu’il fait tenir à fes acteurs
; mais il a dû refter toujours dans les bornes
des connoiffances naturelles, parce qu’il n’étoit qu’-
hiftorien, Silius Italicus qui eft poëte, raconte de
même que le fait Tite-Live ; mais il peint par-tout;
il tâche toujours de montrer les objets eux-mêmes>
au lieu que l’hiftorien fe contente fouvent d’en parler
& de les défigner.
Le poème de la Guerre civile de Pétrone, peint
les évenemens de l’hiftoire avec ce ftyle mâle 6c nerveux
que l’amour de la liberté fait aimer. M. le pré-
fident Bouhier a traduit ce poème envers françois,
6c c’eft ainfi qu’il faut rendre les Poètes. (D . J. )
P o em e l y r iq u e , f. m. (Littéral.} les Italiens ont
appellé le poème lyrique ou le fpeâacle en mufique,
Opéra, 6c ce mot a été adopté en françois.
Tout art d’imitation eft fondé fur un menfonge r
ce menfonge eft une efpece d’hypothefe établie 6c
admife en vertu d’une convention tacite entre l’ar-
tifte 6c fes juges. Paffez-moi ce premier menfonge ,
a dit l’artifte, 6c je vous mentirai avec tant de vérité
que vous y ferez trompés, malgré que vous en ayez.
Le poëte dramatique, le peintre, le ftatuaire, le
danfeur ou pantomime, le comédien, tous ont une
hypothefe particulière fous laquelle ils s’engagent
de mentir, & qu’ils ne peuvent p'erdre de vue un
feul inftant, fans nous ôter de cette illufion qui rend
notre imagination complice de leurs fupercheries ;
car ce n’eft point la vérité , mais l’image de la vérité
qu’ils nous promettent; 6c ce qui fait le charme de
leurs produirions , n’eft point la nature, mais l’imitation
de la nature. Plus un artifte en approche dans
l’hypothefe qu’il a choifie, plus nous lui accordons
de talent 6c de génie.
L’imitation de la nature par le chant a dû être une,
des premières qui fe. foient offertes à l’imagination.;
Tout être vivant eft follicité par le fentiment de fon
exiftence à pouffer en de certains momens des ac-
cens plus ou moins mélodieux, fuivant la nature de
fes organes : comment au milieu de tant de chanteurs^
l’homme feroit - il refté dans le filence ? La joie a.
vraiffemblablement inlpiré les premiers chants ; on
a chanté d’abord fans paroles ; enfuite on a cherché
à adapter au chant quelques paroles conformes au-
fentiment qu’il devoit exprimer; le couplet 6c la
chanfon ont été ainfi la première mufique.
Mais l’homme de génie ne fe borna pas longrtems.
à ces chanfons, enfans de la fimple nature ; il conçut
un projet plus noble 6c plus, hardi, celui de. faire du
chant un inftrument d’imitation. Il s’apperçut bientôt
que nous élevons, potre vo ix, 6c que nous mettons
dans nos difcours plus de force 6c de mélodie,
à mefure que notre ame fort de fon affiette ordinaire.
En étudiant les hommes dans différentes fitua-
tions, il les entendit chanter réellement dans toutes
les ocçafipns importantes de ;la v ie; il vit encore,
que chaque paffion, chaque affeérion de l’ame avoit
Ion accent, fes inflexions-, fa mélodie 6c fon chant
propres,
De cette découverte naquit la mufique imitative
6c l’art du chant qui devint une forte de poéfie, une.